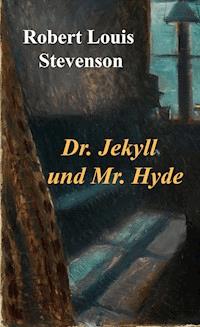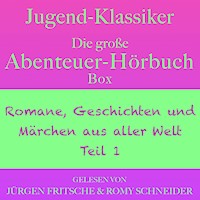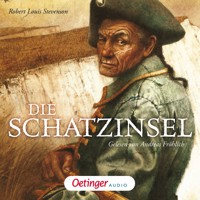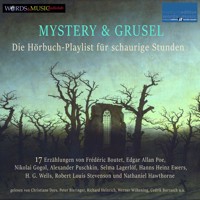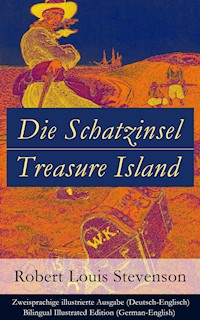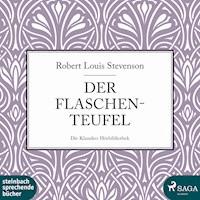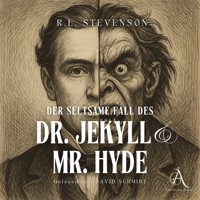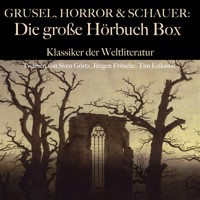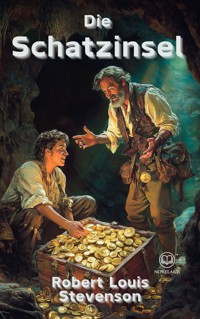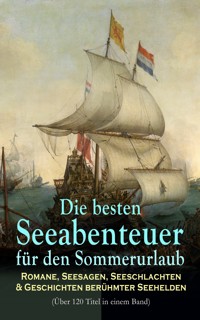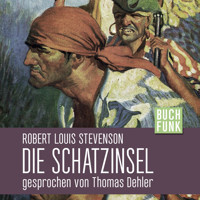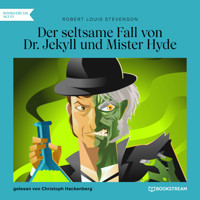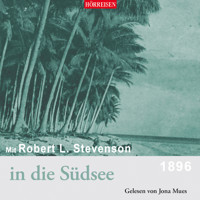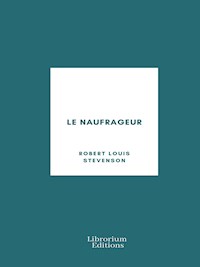
0,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
«Vous voulez dire que vos histoires d’opium, d’épave, de contrebande et celle de l’homme qui devint votre ami étaient vraies?» Loudon Dodd, un américain qui vient de débarquer aux Îles Marquises, étonne les membres du «Cercle» un lieu de rencontre des expatriés: «Vous vous rendrez bientôt compte par vous-même que nos occupations touchent à l’art, puisqu’elles sont un effort combiné de l’imagination et de l’observation, le mouvement en plus. Vous serez bientôt sous le charme!»
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Robert Louis Stevenson
LE NAUFRAGEUR
(The Wrecker)
Traduction : Louise Zeys
1906
© 2021 Librorium Editions
ISBN : 9782383830238
Table of Contents
PROLOGUE AUX ÎLES MARQUISES
CHAPITRE I UNE BONNE ÉDUCATION COMMERCIALE
CHAPITRE II LE VIN DU ROUSSILLON
CHAPITRE III LE LECTEUR FAIT LA CONNAISSANCE DE M. PINKERTON
CHAPITRE IV LA FORTUNE SE MONTRE INCONSTANTE
CHAPITRE V LE MALHEUR ME POURSUIT
CHAPITRE VI JE PARS POUR L’OUEST
CHAPITRE VII UNE PART DANS LES AFFAIRES
CHAPITRE VIII UN COUP D’ŒIL DANS LA CITÉ
CHAPITRE IX LE NAUFRAGE DE L’« ONDÉE VOLANTE »
CHAPITRE X OÙ L’ÉQUIPAGE DISPARAÎT
CHAPITRE XI NOS ROUTES SE SÉPARENT
CHAPITRE XII LA « NORAH CREINA »
CHAPITRE XIII L’ÎLE ET LE BRICK NAUFRAGÉ
CHAPITRE XIV LA CABINE DE L’« ONDÉE VOLANTE ».
CHAPITRE XV LA CARGAISON DE L’« ONDÉE VOLANTE »
CHAPITRE XVI JE DEVIENS CONTREBANDIER ET LE CAPITAINE CASUISTE
CHAPITRE XVII LE VAISSEAU DE GUERRE APPORTE QUELQUES ÉCLAIRCISSEMENTS
CHAPITRE XVIII QUESTIONS RÉITÉRÉES ET RÉPONSES ÉLUDÉES
CHAPITRE XIX VOYAGES EN COMPAGNIE D’UN AGENT D’AFFAIRES
CHAPITRE XX STALLBRIDGE-LE-CARTHEW
CHAPITRE XXI FACE À FACE
CHAPITRE XXII LE FILS REPOUSSÉ
CHAPITRE XXIII LE BUDGET DU « CURRENCY LASS ».
CHAPITRE XXIV UNE AFFAIRE DIFFICILE
CHAPITRE XXV UNE MAUVAISE AFFAIRE
ÉPILOGUE
PROLOGUEAUX ÎLES MARQUISES
C’était par un après-midi d’hiver, à Taiohaé, capitale française et port des îles Marquises ; il était environ trois heures. Le vent soufflait par rafales, et le ressac battait furieusement la grève. Le bâtiment de guerre, chargé de planter le drapeau de la France et d’établir son influence dans ces îles, était amarré au-dessous de Prison-Hill et tanguait fortement. Les nuages étaient si bas, qu’ils semblaient soutenus par les cimes environnantes. Durant toute la matinée, la pluie n’avait cessé de tomber, une de ces pluies des tropiques, véritables trombes d’eau par leur violence, et les flancs de la montagne portaient encore les traces du torrent qui les avait ravinés.
À l’exception du commandant, qui dirigeait momentanément les travaux des forçats occupés à un nouvel aménagement du jardin de la Résidence, toute la population semblait plongée dans une somnolence profonde. Vaekehu, la reine des natifs, dormait aussi paisiblement dans sa coquette maison, ombragée de palmiers, que les marchands dans leurs boutiques, ou que le garçon du cercle, qui ronflait, la tête appuyée sur le comptoir chargé de bouteilles. On n’aurait pu découvrir, dans toute la longueur de la rue bordant la plage, une seule créature animée, mais au bout de la jetée, assis sur une pile de vieux effets, se trouvait la curiosité vivante de Taiohaé : le fameux blanc tatoué.
Bien que les grands yeux ouverts de notre personnage semblassent se fixer sur le paysage pittoresque qui se déroulait à l’horizon, il était insensible aux beautés du site et laissait follement vagabonder sa pensée à travers l’espace.
Cependant il fut soudain tiré de son assoupissement par une apparition inattendue. L’accès de la baie n’est pas difficile aux bâtiments ; ils peuvent aisément approcher de l’un ou l’autre des deux îlots qui en gardent l’entrée. Le foc d’un vaisseau émergea brusquement ; bientôt après parurent deux voiles d’avant, et notre rêveur n’avait pas eu le temps de sauter sur ses pieds, qu’un brick contournait l’îlot et se trouvait à l’entrée de la passe.
La ville endormie se réveilla comme par enchantement. De tous côtés accoururent les indigènes, se renvoyant les uns aux autres ce cri magique : « Un vaisseau ! un vaisseau ! » La reine, sous sa véranda, scrutait l’horizon ; pour mieux voir, elle avait abrité ses yeux sous une main, véritable chef-d’œuvre de l’art du tatouage. Le commandant rentra précipitamment pour chercher sa longue-vue ; le gouverneur de la prison courut en hâte vers le port. Enfin, les dix-sept Canaques et le capitaine qui composaient une partie de l’équipage du vaisseau de guerre français se précipitèrent sur le pont. Les marchands et les commis de nationalités diverses s’étaient rassemblés, selon leur coutume, dans la rue, devant le cercle. Tout cela s’était fait en un clin d’œil, avant que le bâtiment eût eu le temps de jeter l’ancre. Quelques minutes plus tard, les couleurs anglaises furent arborées.
« Ah ! voici Havens, » dit l’un des membres du Cercle, en se tournant vers un nouvel arrivant qui fumait nonchalamment sa cigarette.
« Eh bien, Havens ! que pensez-vous de ce vaisseau ? »
Le personnage ainsi interpellé était un Anglais de haute stature, à l’air affable et doux :
« Je n’en pense rien, je sais positivement ce qui le concerne ; il m’est envoyé d’Auckland par Donald et Edenborough, et je me rends à son bord.
— Quel est son nom ? demanda l’ancien marin.
— Je l’ignore, c’est sans doute quelque bâtiment qu’ils auront frété. »
Puis il continua sa route, et, peu d’instants après, il prenait place dans une chaloupe manœuvrée par des Canaques.
« Vous m’êtes envoyé d’Auckland, je suppose, » dit-il au capitaine, qui le reçut à bord du brick. « Je suis M. Havens.
— Très bien, Monsieur, répliqua celui-ci en lui tendant la main. Vous trouverez M. Dodd, le propriétaire, dans la cabine. Prenez garde à la peinture ! »
Havens, suivant les indications données, fut bientôt en présence d’un homme de taille moyenne, assis devant un bureau.
« Est-ce à Monsieur Dodd que j’ai l’honneur de parler ? » fit Havens en se dirigeant vers lui ; puis tout à coup : « Eh mais ! n’est-ce pas là Loudon Dodd ?
— Moi-même, mon cher ami, répondit ce dernier en se levant vivement. J’espérais un peu qu’il s’agissait de vous, en voyant le nom de Havens dans mes papiers. Vous n’avez nullement changé. Toujours bonne mine et cette même figure d’Anglais placide.
— Je puis vous retourner le compliment : mais vous paraissez être devenu Anglais à votre tour, répliqua Havens.
— Vous faites erreur, le pavillon qui flotte là-haut n’est pas le mien, c’est celui de mon associé. Tenez, le voici, fit-il en désignant de la main un buste placé parmi d’autres objets d’art.
— Une belle tête ! Votre associé a l’air très bien.
— Oui, c’est un bon garçon. Il est le bailleur de fonds.
— Il ne paraît pas être à court d’argent, fit Havens en regardant avec étonnement le luxe qui l’entourait.
— Oui, répondit Dodd, il apporte les capitaux, et moi, je me mets en frais d’intelligence et de goût… Ces étagères en vieux noyer sont anglaises ; les livres qui s’y trouvent m’appartiennent. Les glaces que vous voyez là viennent de Venise ; ces tableaux sont notre propriété à tous les deux ; ceci est à moi…
— Quoi donc ?
— Ces marbres. J’ai commencé par être sculpteur. Je suis né artiste, et ne me suis jamais véritablement soucié d’autre chose que d’art. Si je devais quitter ce vaisseau, je crois que je reprendrais mon premier métier. Voulez-vous que nous examinions les papiers ensemble ?
— Nous en aurons tout le loisir demain, et l’on vous attend probablement au Cercle. C’est l’heure de l’absinthe. Vous dînez avec moi, naturellement. »
M. Dodd acquiesça. Il endossa son habit, frisa sa moustache, lissa ses cheveux devant une des glaces de Venise ; puis, après un examen satisfaisant de sa personne, posa un feutre à larges bords sur sa tête, et suivit son ami.
Le soleil avait disparu de l’horizon quand nos amis atterrirent ; le crépuscule tombait, et déjà l’on voyait briller sous ses vérandas les lampes allumées du Cercle International (nom officiel du cercle). C’est le moment le plus agréable de la journée, celui où les piqûres de la mouche venimeuse de Unka-hiva ne sont plus à redouter, alors qu’une douce brise de mer vient rafraîchir la température.
Les membres du Cercle étaient réunis, Loudon Dodd fut présenté en toutes règles à chacun séparément. Tous ces hommes de nationalités diverses, que leur état ou les hasards d’un naufrage, d’une désertion, etc., avaient réunis à Taiohaé, accueillirent le nouveau venu avec une cordialité parfaite. Son extérieur agréable, ses manières douces, sa façon élégante de s’exprimer tant en anglais qu’en français, lui attirèrent toutes les sympathies. Assis à une table sur laquelle on avait posé quelques bouteilles de bière, il devint bientôt le centre d’un groupe animé.
Bien que Loudon Dodd se trouvât pour la première fois aux Marquises, il était depuis assez longtemps dans les affaires pour être renseigné sur les vaisseaux et les équipages dont on discutait les mérites ; il avait assisté dans d’autres îles voisines au début de carrières dont il apprenait maintenant l’apogée, de même qu’il pouvait raconter la suite de bien des histoires dont le prologue s’était déroulé à Taiohaé. Au nombre des nouvelles récentes qu’il apportait, figurait le naufrage du John Richards.
« Dickinson en a acquis l’épave à l’île Palmerston, ajouta Dodd.
— Quels en étaient les propriétaires ? demanda un des membres du cercle.
— Oh ! comme d’habitude, Capsicum et Cie. »
Les membres du Cercle échangèrent un sourire et un regard d’intelligence. Loudon exprima peut-être la pensée générale en disant :
« Parlez-moi de bonnes affaires ! Je ne connais rien de meilleur qu’une goélette, un capitaine entendu et un bon récif auquel on puisse se fier.
— De bonnes affaires ! opina un homme originaire de Glasgow. Il n’y en a plus.
— Je n’en suis pas sûr, dit un autre, car il y a quelque chose à gagner dans le commerce de l’opium.
— Il y a mieux que cela, fit un troisième interlocuteur : tomber sur un banc d’huîtres perlières, l’écumer, et prendre la poudre d’escampette avant même que les autorités en aient eu vent.
— Une grosse pépite d’or est bonne à trouver, dit un Allemand.
— On peut aussi tirer un joli profit des naufrages.
— Oui, il est possible de faire de belles affaires en achetant des épaves, dit l’homme de Glasgow, mais c’est rare.
— En général, fit Havens, il y a diablement peu d’opérations profitables.
— C’est vrai. À mon avis, le plus avantageux serait de posséder un secret dont dépendît l’honneur d’un homme riche, intéressé à payer le silence.
— Votre idée n’est pas nouvelle, dit Havens, mais n’en est pas meilleure pour cela.
— Qu’importe ? le pire de la chose, c’est qu’il n’y a pas moyen de découvrir un mystère dans les mers du Sud ; il faudrait être à Paris ou à Londres.
— Mac-Gibbon aura lu quelque roman sensationnel, fit remarquer un des membres du club.
— Eh bien ! après tout, s’écria Mac-Gibbon, ce sont des histoires vraies. Lisez les journaux ! C’est par ignorance que vous ricanez ainsi ; cependant le genre d’affaires que j’indique est aussi lucratif et, pour le moins, aussi honnête que le métier d’assureur. »
L’acrimonie soudaine de cette remarque tira Loudon Dodd, qui était un homme paisible, de sa réserve habituelle. « C’est singulier, dit-il, mais je crois avoir essayé à peu près tous les genres d’existence dont vous parlez.
— Avez-vous jamais trouvé une pépite ? interrogea l’Allemand avec vivacité.
— Non, répondit Loudon.
— Alors, demanda un autre, vous avez fait la contrebande de l’opium ?
— Oui, répliqua Loudon.
— Y avez-vous gagné de l’argent ?
— Certainement.
— Auriez-vous par hasard aussi acheté une épave ?
— Oui, Monsieur.
— Et comment vous en êtes-vous tiré ?
— Oh ! je dois dire que c’était une épave d’une espèce particulière ; après tout, je ne sais si je recommanderais cette branche d’industrie.
— L’épave a-t-elle coulé ? questionna un des assistants.
— Je crois plutôt que c’est moi qui ai été coulé, je n’avais pas la tête assez forte pour pareille entreprise.
— Vous avez été maître d’un secret ? interrogea l’homme de Glasgow.
— Oui, et d’un secret aussi grand que l’État du Texas.
— Et celui qu’il concernait était-il riche ?
— Assez riche pour acheter ces îles, s’il en avait eu envie.
— Mais alors, qu’est-ce qui vous manquait ? N’avez-vous pu mettre la main sur votre Crésus ?
— J’ai eu de la peine à le rejoindre ; mais enfin, je l’atteignis, et alors…
— Eh bien, alors ?
— La face des choses changea complètement, je devins son meilleur ami.
— Nous partirons pour aller dîner, Loudon, quand vous aurez fini de débiter vos fadaises », interrompit Havens.
Pendant le repas, ils mangèrent en affamés et causèrent en hommes blasés.
« Je ne vous ai jamais entendu raconter autant de bêtises que ce soir au Cercle, dit Havens à son ami.
— Bah ! j’ai cru sentir une odeur de soufre dans l’air. J’ai bavardé pour le seul plaisir de parler, mais je n’ai pas dit de bêtises.
— Vous voulez dire que vos histoires d’opium, d’épave, de contrebande et celle de l’homme qui devint votre ami étaient vraies ?
— Depuis le premier jusqu’au dernier mot.
« Oui, c’est une étrange histoire que la mienne, et je suis prêt à vous la raconter, si elle vous intéresse. »
Ce qui suit est le récit de Loudon Dodd, non pas comme il le fit à son ami, mais tel qu’il l’écrivit plus tard.
CHAPITRE IUNE BONNE ÉDUCATION COMMERCIALE
Je commencerai par vous parler de mon père. Jamais homme ne fut meilleur, plus beau, ni, à mon point de vue, plus malheureux, tant dans ses affaires que dans ses plaisirs, dans le choix de son lieu de séjour, et, je suis fâché de l’avouer, même dans son fils. Il commença par être intendant, devint bientôt propriétaire lui-même, et, grâce à quelques spéculations avantageuses, ne tarda pas à être compté parmi les notabilités de la contrée. Les gens avaient l’habitude de dire de lui « Dodd a une forte tête ». Pour ma part, je n’eus jamais grande confiance en ses conceptions. Mais si les succès l’abandonnèrent parfois, son assiduité ne se démentit jamais. Il lutta dans ce combat journalier à la recherche de l’or, avec une espèce de loyauté tranquille et triste qui le faisait ressembler à un martyr. Levé avec l’aurore, il consacrait le moins de temps possible à ses repas et se refusait tout plaisir.
Malheureusement, je ne me souciais et ne me soucierai jamais de rien d’autre que d’art. Mes idées sur la destinée de l’homme étaient d’enrichir le monde d’œuvres artistiques et de jouir de la vie, le plus agréablement possible. Je ne pense pas que j’aie fait connaître cette dernière manière de voir à mon père, mais il a dû la deviner, car il montra toujours une indulgence excessive pour toutes mes peccadilles.
Dès que j’eus passé mes examens, je fus envoyé à l’École commerciale de Muskegon. Vous êtes étranger, par cela même, vous aurez peine à croire ce que je vais raconter, quoique je vous en garantisse l’authenticité.
L’école existe peut-être encore aujourd’hui ; tout le comté en était fier comme d’un établissement extraordinaire. Bien certainement, quand mon père me vit monter dans la voiture qui allait m’y conduire, il s’imagina que j’étais en route directe pour la présidence des États-Unis ou quelque autre grande destinée.
Le collège commercial était un grand et vaste établissement, agréablement situé au milieu d’une forêt. L’air y était pur, la nourriture excellente, et le prix établi en conséquence. Des fils électriques (pour employer l’expression du prospectus) « reliaient l’établissement avec les principaux centres financiers du monde ». Le cabinet de lecture était amplement approvisionné de journaux contenant tous les renseignements commerciaux désirables.
Les élèves, dont le nombre variait entre cinquante et cent, étaient occupés essentiellement à s’escamoter de l’argent les uns aux autres, pour ce que nous appelions le papier de collège. Nous avions naturellement des heures de classe : la matinée était employée à l’étude de l’allemand, du français, de la tenue des livres, etc., mais la majeure partie de la journée et le but de l’éducation que nous recevions se concentraient sur la Bourse, enseignement dont nous tirions profit, sans courir de véritables risques, puisque tous nos titres étaient fictifs. Nous nous livrions, par conséquent, à un jeu purement théorique, dépourvu d’agrément et non déguisé.
Notre simulacre de marché était réglé par les prix des marchés extérieurs, afin que nous fussions à même de nous rendre compte de la hausse et de la baisse. Nous étions obligés à une tenue de livres très régulière, et nos comptes étaient scrupuleusement examinés à la fin de chaque mois par le directeur ou par les professeurs. Afin d’ajouter un semblant de vérité à nos transactions, le papier de collège était coté à 5 francs les cent feuilles, prix que les parents ou les tuteurs payaient très volontiers.
Quand j’entrai pour la première fois dans la salle des transactions, où l’un des professeurs devait m’indiquer le pupitre qui m’était destiné, je fus étourdi par les clameurs et la confusion qui y régnaient. Des tableaux noirs, posés à l’autre extrémité de la pièce, étaient couverts de chiffres constamment remplacés par d’autres. À chaque changement, c’était une bousculade, des cris formidables, des vociférations dont le sens m’échappait, puis des sauts à travers bancs et pupitres, un mouvement extraordinaire de têtes et de bras, et des notes écrites rapidement. Je crois que je n’ai jamais rien vu de semblable, et je m’étonnai d’une telle agitation pour des transactions qui, en somme, n’étaient qu’illusoires, puisque tout l’argent du marché aurait à peine suffi à l’achat d’une paire de patins ; mais je me souvins bientôt que nombre de gens riches perdent tout caractère pour un enjeu de deux sous.
Le professeur, absorbé qu’il était à suivre les fluctuations du marché, avait oublié de m’indiquer mon pupitre. Il le fit enfin, ajoutant quelques conseils pour m’inculquer le goût du jeu ; et il m’engagea à suivre les traces d’un certain jeune homme à cheveux blond filasse et à lunettes, un nommé Bilson, le meilleur sujet de l’établissement, m’assura-t-il.
Peu après, au milieu d’un tumulte toujours grandissant, les chiffres parurent sur le tableau, plus pressés encore que par le passé, et l’immense hall retentit de cris aussi formidables que ceux que l’on doit entendre au pandémonium. Je regardai autour de moi, mon guide avait disparu, me laissant livré à mes propres ressources devant mon pupitre. Mon voisin était en train d’additionner les sommes qui, je l’appris plus tard, représentaient les pertes faites dans la matinée ; mais il fut distrait de son occupation en m’apercevant.
« Quel est votre nom, nouvel arrivant ? s’informa-t-il. Ah ! vous êtes le fils de Dodd à la forte tête. À quel chiffre se montent vos fonds ? Cinquante mille ! Oh ! vous êtes solide. »
Je lui demandai ce qu’il me fallait faire, puisqu’il était de règle d’examiner les livres une fois par mois.
« Mais, naïf que vous êtes, vous aurez un comptable, s’écria-t-il. L’un de nos morts prendra cette peine pour vous, ils sont là pour cela. Et si vous êtes heureux dans vos opérations, vous n’aurez jamais à travailler dans notre vieux collège ».
Le bruit étant devenu assourdissant, et mon nouvel ami, m’ayant assuré que quelqu’un devait certainement « être coulé » boutonna son paletot et se perdit dans la foule, pour chercher des nouvelles et m’amener un teneur de livres.
La suite prouva qu’il avait deviné juste, quelqu’un était ruiné : un prince d’Israël était tombé ; un marchand de lard avait été fatal à sa puissance, et le commis amené pour tenir ma comptabilité, m’épargner tout ouvrage et me guider à raison de 5 000 francs par mois, papier de collège (au cours de 50 francs aux États-Unis), n’était autre que l’éminent Bilson, dont on m’avait vanté la compétence.
Suivant une des recommandations de mon père, je spéculais sur les chemins de fer. Pendant un mois, je maintins une position sûre, mais peu brillante, trafiquant pour de petites sommes sur un marché passablement calme, à la grande indignation du commis que j’avais engagé. À la fin, cédant à ses instances, je voulus tenter un grand coup ; je vendis pour quelques milliers de francs d’obligations Pan Handles Preferences, alors en baisse. À peine cette opération était-elle achevée, que Pan Handles remonta à la Bourse de New-York d’une façon stupéfiante, et, en moins d’une demi-heure, je vis ma position compromise. Bon sang ne saurait mentir, comme dit mon père ; je supportai vaillamment cette déconvenue et je jouai un jeu infernal pendant tout le reste de la journée. Ce soir-là, la déconfiture de H. Loudon Dodd défraya la Gazette du collège, et Bilson, jeté une fois de plus sur le pavé, devint mon compétiteur pour la même place de commis. L’objet le plus en vue attire davantage l’attention : mon désastre me mit en évidence, et je fus choisi de préférence à mon compagnon. Vous voyez que l’on acquiert de l’expérience, même au collège commercial de Muskegon.
Pour ma part, il m’était assez indifférent de perdre ou de gagner dans un jeu si complexe et si monotone ; mais j’étais humilié d’avoir à annoncer cette débâcle à mon père. J’employai donc toutes les ressources de mon éloquence pour lui dire, ce qui était d’ailleurs la vérité, que les jeunes gens heureux dans leurs spéculations ne recevaient pas l’ombre d’éducation dans l’établissement, de sorte que, si son désir était de me voir étudier et travailler, il avait tout lieu de se réjouir de mes malheurs. Je le priai de me remettre à flot et je promis de m’en tenir à ses conseils de ne plus spéculer que sur les chemins de fer. À la fin, entraîné par le sujet qui me tenait le plus à cœur, je l’assurai que je me sentais peu de capacité pour les affaires, et je le suppliai de me retirer de ce lieu détesté, pour m’envoyer à Paris étudier la peinture.
Il me répondit très brièvement. Le ton de sa lettre était aimable, mais empreint d’une nuance de tristesse : il me rappelait que, le moment des vacances étant proche, nous aurions alors le loisir de discuter à fond la question qui nous intéressait tous les deux.
Quand je revis mon père, je fus frappé du changement qui s’était opéré en lui : il avait beaucoup vieilli et paraissait bien fatigué. Je fus touché de ses efforts pour me consoler et pour ranimer mon courage, qu’il supposait à bout.
Il conclut en me disant :
« Dieu sait, mon cher enfant, que je n’ai que ton seul bien en vue ; et, pour te le prouver, je te propose un nouvel arrangement. Tu retourneras au collège après les vacances, avec une seconde mise de fonds de 50 000 francs. Conduis-toi en homme, et arrange-toi de façon à doubler ce capital. Si, après cela, tu désires encore aller à Paris, je m’engage à t’y envoyer ; seulement, je suis trop fier pour te retirer maintenant du collège, comme si l’on t’en avait chassé. »
Mon cœur bondit de plaisir à cette proposition, mais le découragement me ressaisit bientôt. Il me semblait plus facile de peindre comme Meissonier que de gagner 50 000 francs dans des spéculations aussi hasardeuses que celles de notre simulacre de Bourse. Je ne pouvais non plus comprendre pourquoi, ainsi que le prétendait mon père, un bon peintre doit être forcément un heureux spéculateur. Je risquai quelques timides observations à ce sujet.
Mon père soupira profondément.
« Tu oublies, mon cher enfant, dit-il, que je suis juge de l’un et non pas de l’autre. Il est possible que tu aies le génie d’un Bierstadt, mais je n’en sais rien.
— Alors, répondis-je, je conclus un bien mauvais marché. Les parents des autres élèves les conseillent, leur télégraphient et leur indiquent les bonnes opérations. Et ne comprenez-vous pas que, si les uns gagnent, il faut bien que les autres perdent.
— Mais je te tiendrai au courant, s’écria mon père avec une animation peu habituelle chez lui. »
Puisque mon père consentait à diriger mes opérations et que le collège commercial devait être un acheminement vers Paris, je pouvais reprendre confiance en l’avenir.
Maintenant, j’ai à vous parler d’un nouveau facteur, qui prit place dans ma vie et eut une grande influence sur ma carrière. Ce nouveau facteur est tout simplement le Capitole de l’État de Muskegon, que l’on projetait alors de bâtir. Mon père avait embrassé cette idée avec une ardeur patriotique jointe à une combinaison commerciale. Il fit partie de tous les comités, souscrivit pour d’énormes sommes d’argent, et s’arrangea de manière à posséder voix au chapitre dans la plupart des contrats.
Deux plans lui avaient été envoyés, et il était plongé dans leur examen très approfondi lors de mon retour du collège. Comme cette idée l’occupait entièrement, la première soirée ne s’écoula pas sans que je fusse appelé en conseil. C’était là un sujet d’affaires intéressant pour moi. Il est vrai que je ne connaissais pas encore l’architecture, mais c’était au moins un art : or, j’avais, pour ce qui touche de près ou de loin aux beaux-arts, ce goût prononcé que les imbéciles confondent avec le génie.
J’examinai soigneusement tous les plans et découvris aisément leurs mérites et leurs défauts. Je lus des traités d’architecture pour me pénétrer des différents styles, j’étudiai les prix courants des matériaux et je saisis si parfaitement toute l’affaire, que, lors de la discussion des plans, mon père recueillit de nouveaux lauriers. Ses arguments firent loi, son choix fut approuvé par le Comité, et j’eus la satisfaction anonyme de constater qu’arguments et choix étaient miens. Plus tard ma coopération devint encore plus active, car je proposai moi-même d’exécuter certains changements assez importants, et ceux-ci eurent le bonheur ou le mérite d’être adoptés. L’énergie et les aptitudes dont je fis preuve dans cette affaire surprirent délicieusement mon père.
Quant à moi, je retournai très gaiement au collège, où mes nouvelles opérations financières furent couronnées du plus grand succès.
Dans l’espace d’un mois je réalisai 85 000 à 90 000 francs en papier de collège, mais, à ce moment-là, je fus victime d’un des vices adhérents au système établi. Le papier de collège, je l’ai déjà dit, avait une valeur réelle de 1 p. 100 et, à ce taux, était mis en circulation dans notre établissement. Des spéculateurs malheureux vendaient donc des habits, des livres, des guitares, des boutons de manchettes, etc., pour régler leurs différences ; par contre, les spéculateurs heureux étaient souvent tentés de réaliser de grands profits dans ces sortes d’échanges. Il advint un jour que j’eus besoin de 150 francs pour divers articles de peinture, car je dessinais toujours beaucoup, et la pension qui m’était allouée se trouvait momentanément épuisée. Grâce aux idées de mon père, j’avais fini par regarder la Banque comme un endroit où l’on n’a qu’à prendre la peine de se baisser pour ramasser de l’argent, et, dans une heure malheureuse, je réalisai 15 000 francs de titres, avec lesquels j’achetai un chevalet.
C’était un mercredi matin, me voilà transporté de joie. Mon père, car je puis à peine revendiquer une part dans cette combinaison, essayait à ce moment une des opérations les plus tentantes et les plus périlleuses de l’échiquier de la Bourse. Le mardi, déjà, la chance tournait contre nous, et le vendredi soir, j’étais, pour la seconde fois, déclaré en faillite. Ce fut un rude coup, et, dans toute autre circonstance, mon père aurait assez mal pris la chose, car, si un homme ressent profondément l’incapacité de son fils, il est encore plus sensible à la démonstration de la sienne propre. Mais à notre coupe amère vint se mêler un ingrédient que l’on pourrait appeler empoisonné. Mon père était au courant de mes opérations, il s’aperçut de la disparition des 15 000 francs en titres, et resta sous l’impression que j’avais volé 150 francs en circulation.
Depuis lors, il ne me donna plus l’ombre d’un conseil.
Pourtant il ne songeait sans doute à rien d’autre qu’à son fils et au meilleur moyen d’en faire un homme. Je crois qu’il était réellement très affecté de ce qu’il regardait comme un relâchement de mes principes, et qu’il se mit à réfléchir à la manière dont il pourrait me préserver de la tentation.
Sur ces entrefaites, l’architecte du Capitole ayant parlé avantageusement de mes dessins, sa résolution fut prise.
« Loudon, me dit mon père en souriant quand nous nous revîmes, si je t’envoyais à Paris, combien de temps te faudrait-il pour devenir un sculpteur expérimenté ?
— Qu’entendez-vous par expérimenté ? demandai-je.
— Un homme entendu, connaissant tous les styles patriotiques et emblématiques.
— Je crois qu’il faudrait y consacrer trois années.
— Penses-tu qu’un séjour à Paris soit indispensable ? Il y a de grandes ressources dans notre pays, et des sculpteurs très célèbres qui pourraient te donner des leçons.
— J’ai la conviction qu’à Paris seulement on peut former de vrais artistes.
— Très bien ! Cela sonnera très agréablement : Un jeune homme, originaire de cet État, fils d’un des plus notables habitants de notre ville, a fait ses études sous la direction des premiers artistes de Paris, ajouta-t-il en savourant longuement sa phrase.
— Mais, mon cher père, objectai-je, à quoi bon tout cela ? Je n’ai jamais songé à devenir sculpteur.
— Oui, c’est vrai, mais j’ai accepté tout d’abord comme une affaire l’entreprise de sculpture pour notre nouveau Capitole ; plus tard, j’ai réfléchi qu’il vaudrait mieux qu’elle ne sortît pas de la famille. Mes idées se rencontrent avec les tiennes sur les beaux-arts : il y a immensément d’argent à gagner, et c’est une œuvre patriotique. Tu n’as donc, cher enfant, qu’un mot à dire si tu veux partir immédiatement pour Paris. Au bout de trois années, tu reviendras pour décorer le Capitole de ton pays natal. C’est une occasion unique qui se présente, il faut la saisir ; l’argent que tu gagneras t’appartiendra en propre, et, à chaque dollar j’en ajouterai un autre.
CHAPITRE IILE VIN DU ROUSSILLON
Ma mère était d’origine écossaise, et il fut jugé convenable que mon voyage en Europe débutât par une visite à sa famille. En conséquence, je me rendis à Édimbourg où habitait mon oncle, Adam Loudon, ancien épicier, actuellement retiré des affaires, à la tête d’une jolie fortune. C’était un homme d’un caractère froid et ironique. Il me reçut bien, me nourrit et m’hébergea avec une grande hospitalité, me demandant en échange de l’amuser et de l’intéresser par mes récits, pendant lesquels ses lunettes glissaient, et sa bouche se tordait d’une façon comique. La cause de sa gaieté mal déguisée venait tout simplement, je crois, de ce que j’étais Américain.
Je portais un assez vif intérêt à mon grand-père, Alexandre Loudon. Celui-ci, ancien maçon, était le fils de ses œuvres. Sa tournure, son langage, ses manières, tout dans sa personne témoignait de son origine plébéienne, au grand désespoir de mon oncle.
Un des avantages d’être né Américain, c’est qu’il ne m’arrivait jamais de rougir de mon grand-père, et le vieillard ne fut pas long à s’en apercevoir. Il avait gardé un tendre souvenir à ma mère, peut-être parce qu’il avait l’habitude d’établir des comparaisons entre elle et mon oncle Adam, qu’il détestait cordialement, et il attribua à l’influence de sa fille préférée ma sympathie pour lui. Lors de nos promenades, devenues quotidiennes, il m’emmenait souvent chez des vieillards de son âge (non sans m’avoir recommandé le plus grand secret vis-à-vis d’Adam) ; il me présentait à la société avec un orgueil manifeste, et ne manquait jamais de donner quelques coups d’épingles à ses autres descendants.
Lorsque je quittai Édimbourg, j’étais loin de me douter que je venais de donner une excellente impulsion à mes affaires personnelles ; j’étais simplement enchanté de m’échapper d’une maison triste pour me jeter dans cette lumineuse cité que l’on nomme Paris. Chacun a son idéal : le mien se bornait à l’étude des arts et à la vie du quartier Latin, ce monde évoqué par le magicien impitoyable qui écrivit la Comédie humaine. Je ne fus pas désappointé. Je n’aurais pu l’être.
Si je prenais mes repas dans un pauvre restaurant et logeais dans un misérable garni, ce n’était pas par nécessité, mais par caprice. La forte pension que m’allouait mon père m’aurait permis d’habiter le quartier de l’Étoile, si je l’eusse désiré, et de me faire conduire chaque jour en voiture à l’atelier ; mais, en menant cette vie-là, tout charme aurait disparu : j’aurais encore été M. Loudon Dodd, fils de millionnaire, tandis que je devenais un étudiant du quartier Latin, le successeur de Murger, vivant en chair et en os les scènes de ces romans que j’avais lus et relus avec délices et desquelles je rêvais dans les bois de Muskegon.
Dans ce temps-là, nous avions tous, au quartier Latin, la folie de Murger ; la comédie de la Vie de Bohême, jouée à l’Odéon pendant un temps déraisonnable pour Paris, avait fait revivre la légende dans toute sa fraîcheur. C’étaient les mêmes scènes qui se rejouaient individuellement dans chaque galetas du voisinage, et le tiers des étudiants personnifiaient en conscience Rodolphe ou Schaunard. Quelques-uns d’entre nous allèrent loin, d’autres plus loin encore.
Ce laisser-aller m’entraîna, dès la seconde année de mon séjour à Paris, dans une aventure que je dois relater ici, puisqu’elle m’a amené à faire la connaissance de James Pinkerton. Je dînais seul, un soir, dans un petit restaurant dont la cave jouissait d’une grande renommée parmi nous autres étudiants. On était en octobre : au dehors, les feuilles mortes tourbillonnaient emportées par le vent d’automne. Je parcourais distraitement la carte des vins, en amateur de bons crus et de beaux noms, quand mes yeux tombèrent sur le mot roussillon. Je me souvins que je n’avais jamais goûté de ce vin-là, et j’en fis venir immédiatement une bouteille. Il me parut excellent, et j’en redemandai une pinte ; or, comme le garçon me répondit que le roussillon ne se vendait pas par demi-bouteille, je lui commandai d’en apporter encore une entière. Les tables du restaurant étaient fort près les unes des autres, et tout ce dont je me souviens, c’est de m’être trouvé engagé dans une conversation animée avec mes voisins les plus immédiats. Je devins de plus en plus loquace, j’eus des saillies qui firent rire aux éclats les consommateurs. J’invitai mes nouveaux amis à m’accompagner pour aller prendre le café dans un établissement voisin ; mais, à ma grande surprise, à peine avais-je fait trois pas dans la rue, que je me trouvai seul. J’éprouvai un vague sentiment d’inquiétude et me demandai si les fumées de la dernière bouteille que j’avais bue ne m’avaient pas obscurci le cerveau. Enfin, j’eus tout à coup le sentiment que j’étais ivre et que le mieux était de m’aller coucher.
Je regagnai mon hôtel, qui était à deux pas, et le portier me remit, en passant, ma bougie. Je gravis les quatre étages qui conduisaient à ma chambre. Bien que je fusse incontestablement gris, je possédais cependant un reste de lucidité : je n’avais qu’une idée fixe, celle de me lever assez tôt le lendemain matin pour me rendre à l’atelier ; et, comme je m’aperçus que ma pendule était arrêtée, je voulus redescendre pour charger le garçon de m’éveiller à temps. Je laissai la bougie allumée dans ma chambre et la porte grande ouverte, afin de m’orienter plus facilement, et je partis. La maison était plongée dans l’obscurité la plus profonde ; mais, comme il n’y avait que trois portes par étage, il était impossible d’errer longtemps à l’aventure. Je n’avais donc qu’à redescendre l’escalier jusqu’au moment où j’apercevrais la lueur de la veilleuse brûlant dans la loge du concierge.
Je comptai quatre étages : point de portier. Comme je pouvais m’être trompé dans mon calcul, je continuai ma marche, descendant un étage, puis un autre, et ainsi de suite jusqu’à ce que j’eusse compté le chiffre insensé de neuf étages. Je compris que j’avais dépassé la loge du concierge sans la remarquer et que je me trouvais dans les entrailles de la terre, c’est-à-dire à une profondeur de cinq étages sous la rue. Mon hôtel était donc construit au-dessus des catacombes !
Je rebroussai chemin et regrimpai vers le niveau de la rue en comptant laborieusement. Je remontai cinq, six et sept étages, et toujours pas de loge de concierge. Ces recherches inutiles commençaient à m’ennuyer, et je pris le parti le plus sage, celui de retourner dans ma chambre, qui ne devait pas être très éloignée. Huit, neuf, dix, onze, douze, treize étages, et ma porte semblait aussi introuvable que le portier et sa loge. Je me rappelai très nettement que la maison n’avait que six étages, je devais donc forcément en avoir gravi trois au-dessus du toit. À ma bonne humeur habituelle succéda une profonde irritation.
Dans cette conjoncture, j’aperçus un filet de lumière s’échappant de la fente d’une porte ; j’étendis la main et tournais une poignée, ce qui me permit de m’introduire sans cérémonie dans une chambre. Une jeune femme s’y trouvait, sur le point de se mettre au lit, et sa toilette était fort avancée… ou peu complète, si vous préférez.
« J’espère, Madame, que vous voudrez bien me pardonner mon indiscrétion, dis-je ; ma chambre porte le numéro 12, et il y a un mystère dans cette damnée maison. »
Elle me regarda fixement et répondit :
« Si vous voulez bien sortir pendant quelques minutes, je vous conduirai à votre chambre. »
La chose étant ainsi arrangée, à la complète satisfaction des parties, je l’attendis sur le palier. Elle me rejoignit bientôt après, enveloppée d’un peignoir, et, me prenant par la main, me fit monter un nouvel étage, ce qui faisait quatre au-dessus du niveau du toit, puis m’enferma dans ma propre chambre, où, très fatigué par mes explorations extraordinaires, je ne tardai pas à m’endormir d’un sommeil de plomb.
Je vous raconte la chose calmement, telle qu’elle me sembla s’être passée ; mais le jour suivant, quand je m’éveillai et que je me rappelai ces divers incidents, je ne pus m’empêcher d’y découvrir bon nombre d’improbabilités. Je n’étais pas en disposition de travailler et, au lieu d’aller à mon atelier, je me dirigeai vers les jardins du Luxembourg, dans le but d’éclaircir mes idées au milieu des moineaux, des feuilles tombantes et des statues. Je m’assis donc sur une chaise de l’allée principale.
Je songeais encore à mon aventure de la nuit, quand un coup de vent fit tourbillonner les feuilles mortes ; une bande de moineaux effarés prit son essor au-dessus de ma tête. Ce tumulte n’eut que la durée de quelques secondes, mais il eut pour effet de m’arracher aux réflexions dans lesquelles je m’abîmais. Je me relevai brusquement, et mes yeux s’arrêtèrent sur une jeune femme, vêtue d’une jaquette marron, qui tenait une boîte de peinture à la main. Un jeune homme, qui paraissait avoir quelques années de plus que moi, marchait à côté d’elle en portant son chevalet. Imaginez ma surprise, quand je reconnus l’héroïne de mon aventure. Nos yeux se rencontrèrent : la dame, se souvenant sans doute de la toilette sommaire dans laquelle j’avais eu le loisir de l’admirer, détourna rapidement les siens avec une ombre de confusion.
Je ne saurais vous dire aujourd’hui si elle était laide ou jolie. Elle s’était conduite avec tant de sang-froid ; moi, j’avais eu l’air si stupide en sa présence, qu’instantanément j’éprouvai le désir de lui apparaître sous un jour plus favorable. D’ailleurs, le jeune homme pouvait être son frère ; les frères sont parfois emportés et assument de bonne heure les responsabilités viriles. Il était donc sage de prévenir toute complication possible en lui faisant des excuses.
En conséquence, je me rapprochais des deux promeneurs, quand, soudain, le jeune homme se retourna, et nous nous trouvâmes face à face. Telle fut ma rencontre avec la troisième influence qui devait agir sur ma vie, car ma carrière entière s’est faite sous l’influence de mon père, du Capitole de Muskegon et de mon ami James Pinkerton. Quant à la jeune femme qui occupait alors toutes mes pensées, à partir du jour de notre rencontre, je n’en entendis plus parler.
CHAPITRE IIILE LECTEUR FAIT LA CONNAISSANCE DE M. PINKERTON
L’étranger, comme je viens de l’indiquer, était un peu plus âgé que moi ; c’était un homme de haute taille, à la physionomie franche et cordiale, aux gestes vifs.
« Puis-je échanger un mot avec vous ? lui demandai-je.
— Mon cher Monsieur, répliqua-t-il, je ne sais à quel sujet, mais je consens à en échanger cent, si cela peut vous être agréable.
— Vous venez de quitter une jeune dame, continuai-je, que j’ai offensée bien malgré moi. Lui parler à elle-même serait renouveler son embarras ; je saisis donc l’occasion de lui présenter mes excuses, avec l’expression de mon profond respect, en m’adressant à son ami, peut-être même, ajoutai-je en m’inclinant très bas, son protecteur naturel.
— Vous êtes un de mes compatriotes, s’écria-t-il, je le devine à votre délicatesse envers cette dame. Vous ne faites d’ailleurs que lui rendre justice. Je lui ai été présenté l’autre soir, à une réception chez des amis, et, la rencontrant ce matin, je ne pouvais pas faire moins que de porter son chevalet. Mais, cher Monsieur, quel est votre nom ? »
Je fus désappointé de voir qu’il n’existait pas d’autre lien entre lui et la jeune femme ; et moi, qui avais cherché cet entretien, j’éprouvais la tentation de battre en retraite. Cependant une certaine expression dans les yeux gris de l’étranger m’engagea à continuer la conversation.
« Je m’appelle. Loudon Dodd, je suis étudiant en sculpture, et j’arrive de Muskegon.
— En sculpture ! s’écria-t-il, comme si cette conjecture eût été la dernière à faire. Mon nom, à moi, est James Pinkerton, et je suis ravi d’une occasion qui me permet de faire votre connaissance.
— Pinkerton ! Ce fut mon tour d’être surpris. Êtes-vous Pinkerton « tabouret cassé », dis-je.
Il convint de son identité avec un éclat de rire juvénile, et, vraiment, tout jeune homme eût été fier de porter un sobriquet acquis comme le sien.
Pinkerton devait sa réputation à l’incident que voici : Dans un atelier, pendant que de grossières brutalités étaient pratiquées sur un débutant qui tremblait de peur, un grand jeune homme pâle et maigre se leva brusquement, et, s’armant de son siège, protesta vivement en s’adressant aux hommes de cœur. Une lutte s’engagea, et, quelques secondes plus tard, il ne restait dans l’atelier que la victime et ses défenseurs. Je suis fier de revendiquer la nationalité américaine pour le héros de l’affaire. Dans la bagarre, Pinkerton avait du premier coup cassé son tabouret sur le dos de son adversaire.
Je crus bien faire en invitant ma nouvelle connaissance à déjeuner avec moi. Nous nous installâmes dans un restaurant passablement éloigné du Luxembourg ; là, nos langues se délièrent, et nous nous contâmes réciproquement notre histoire.