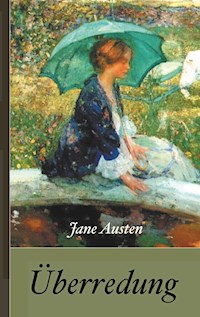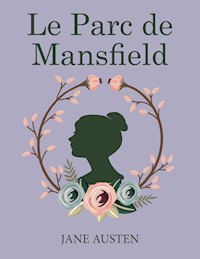
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Pretorian Media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Fanny Price est une jeune fille pauvre élevée par des parents riches et insouciants. Elle est envoyée à Mansfield Park, la résidence de son oncle et de sa tante, où elle doit apprendre à naviguer dans les eaux troubles de la haute société anglaise. Tout en essayant de trouver sa place parmi les cousins de la famille, Fanny doit faire face à des défis moraux et sociaux qui remettent en question les normes et les valeurs de la société de son temps. "Le Parc de Mansfield" est un roman classique de la littérature anglaise qui explore les thèmes de la famille, de la morale, de la classe sociale, et de la liberté individuelle. Avec sa prose subtile et ses personnages complexes, Jane Austen a créé une histoire pleine d'intrigues, de rebondissements, et de réflexions sur la société et les relations humaines. "Le Parc de Mansfield" est un livre intemporel qui continue de captiver les lecteurs du monde entier. Plongez dans ce roman incontournable et laissez-vous transporter dans l'Angleterre du XIXe siècle.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 516
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Table des matières
Tome I
CHAPITRE PREMIER.
CHAPITRE II.
CHAPITRE III.
CHAPITRE IV.
CHAPITRE V.
CHAPITRE VI.
CHAPITRE VII.
CHAPITRE VIII.
CHAPITRE IX.
CHAPITRE X.
CHAPITRE XI.
CHAPITRE XII.
CHAPITRE XIII.
CHAPITRE XIV.
Tome II
CHAPITRE XVI.
CHAPITRE XVII.
CHAPITRE XVIII.
CHAPITRE XIX.
CHAPITRE XX.
CHAPITRE XXI.
CHAPITRE XXII.
CHAPITRE XXIII.
CHAPITRE XXIV.
CHAPITRE XXV.
CHAPITRE XXVI.
CHAPITRE XXVII.
Tome III
CHAPITRE XXVIII.
CHAPITRE XXIX.
CHAPITRE XXX.
CHAPITRE XXXI.
CHAPITRE XXXII.
CHAPITRE XXXIII.
CHAPITRE XXXIV.
CHAPITRE XXXV.
CHAPITRE XXXVI.
CHAPITRE XXXVII.
CHAPITRE XXXVIII.
CHAPITRE XXXIX.
CHAPITRE XL.
CHAPITRE XLI.
CHAPITRE XLII.
CHAPITRE XLIII.
CHAPITRE XLIV.
CHAPITRE XLV.
CHAPITRE XLVI.
CHAPITRE XLVII.
CHAPITRE XLVIII.
Mentions légales
Titre: Le Parc de Mansfield
Auteur: Jane Austen
Éditeur: Pretorian Media GmbH, Ul. Yanaki Bogdanov 11, BG-9010 Varna
Date: 25/03/2023
Tome I
CHAPITRE PREMIER.
Il y a une trentaine d’années, miss Maria Ward, de la petite ville d’Huntingdon, n’ayant que sept mille livres sterling pour fortune, eut le bonheur de captiver sir Thomas Bertram, propriétaire du parc de Mansfield dans le comté de Northampton, et de se trouver par-là élevée au rang d’épouse d’un baronet, avec tous les agrémens et l’importance d’une belle maison et d’un grand revenu. Tout Huntingdon se récria sur les avantages d’un tel mariage ; l’oncle de miss Maria lui-même, qui était un homme de robe, reconnut qu’elle aurait dû posséder trois mille livres sterling de plus pour pouvoir y prétendre avec quelque raison. Elle avait deux sœurs qui, aussi jolies qu’elle, paraissaient devoir se ressentir de son élévation ; mais il n’y a pas dans le monde autant d’hommes d’une grande fortune, que de jolies femmes qui les méritent. Miss Ward, l’aînée des sœurs de miss Maria, après avoir attendu cinq ou six ans, fut obligée de s’attacher au révérend monsieur Norris, ami de son beau-frère, qui n’avait que fort peu de biens ; et miss Fanny, la plus jeune des trois sœurs, fut encore plus mal partagée. Le mariage de miss Ward ne fut pas toutefois désavantageux : sir Thomas s’étant trouvé heureusement à même de procurer à son ami le presbytère de Mansfield, et monsieur et madame Norris commencèrent leur carrière de félicité conjugale avec un revenu de près de mille livres sterling par an. Mais miss Fanny se maria tout à fait contre le gré de sa famille, en s’unissant à un lieutenant de marine, sans éducation, sans fortune, et sans aucune protection. Elle pouvait difficilement faire un plus mauvais choix. Sir Thomas avait le désir de voir toutes les personnes qui étaient liées à sa famille dans une situation respectable, et il aurait volontiers cherché à améliorer celle de la sœur de lady Bertram ; mais avant qu’il eût trouvé quelque moyen d’y réussir, une rupture absolue entre les deux sœurs avait eu lieu. Pour s’épargner des remontrances inutiles, miss Fanny, devenue madame Price, n’avait point écrit à sa famille au sujet de son mariage, qu’après l’avoir contracté. Lady Bertram, qui était d’un caractère singulièrement tranquille et indolent, se serait volontiers contentée d’abandonner sa sœur et de n’y plus penser ; mais madame Norris avait un esprit d’activité qui ne put être satisfait qu’après qu’elle eut écrit une longue lettre pleine de reproches, pour lui représenter la folie de sa conduite et la menacer de toutes les conséquences fâcheuses qui pourraient en résulter. Madame Price fut piquée et courroucée. Une réponse qui renfermait les deux sœurs dans ses plaintes amères, et qui contenait des réflexions peu respectueuses sur l’orgueil de sir Thomas, à qui madame Norris ne manqua pas de communiquer cette lettre, interrompit toute communication entre madame Price et ses sœurs pendant un espace de temps considérable.
La distance entre leurs demeures était si grande, et leur position dans le monde était si différente, que, pendant onze ans, les uns et les autres ignorèrent à peu près mutuellement leur existence. Il n’y eut que madame Norris qui, de temps en temps, annonçât avec humeur à sir Thomas, qui en était surpris, que sa sœur Fanny était encore accouchée d’un autre enfant. Au bout de onze ans cependant, madame Price ne put se résoudre à conserver plus long-temps de l’orgueil et du ressentiment, et à perdre une liaison de famille qui pouvait lui donner de l’assistance. Des enfans en grand nombre, et qui pouvaient se multiplier encore, un mari incapable de prendre un service actif, mais qui n’en était pas moins enclin aux plaisirs de la table, et un très-faible revenu pour subvenir à l’entretien de sa famille, déterminèrent madame Price à rechercher, à regagner l’affection des amis qu’elle avait si inconsidérément négligés. Elle écrivit en conséquence à lady Bertram, et peignit ses regrets et sa situation de manière à la disposer, ainsi que son époux, à une réconciliation. Elle était sur le point d’accoucher de son neuvième enfant, et après avoir rappelé cette circonstance et imploré leur protection pour l’enfant attendu, elle ne cachait point combien les huit autres pourraient avoir besoin de leur appui par la suite. Son aîné était un garçon de dix ans, plein d’ardeur et de bonne volonté, et qui désirait déjà ardemment d’avoir une carrière à suivre. Mais que pouvait-elle faire pour lui ? S’il pouvait par la suite être utile à sir Thomas dans ses possessions d’Amérique, tous les emplois lui seraient bons, ou bien il prendrait la carrière de la marine pour les Indes orientales, si cela paraissait plus convenable à sir Thomas.
Cette lettre ne fut point sans effet. Elle rétablit la concorde et l’affection entre les différens membres de la famille. Sir Thomas envoya en réponse un avis amical et des assurances de bienveillance, lady Bertram envoya de l’argent et un trousseau d’enfant, et madame Norris écrivit la lettre.
Ce furent-là les suites immédiates de la démarche de madame Price ; mais au bout d’un an, il en résulta pour elle un avantage plus important. Madame Norris faisait observer souvent à sir Thomas et à lady Bertram qu’elle ne pouvait bannir de sa pensée sa pauvre sœur et sa nombreuse famille, et elle finit par dire qu’elle serait charmée de voir que l’un de ses enfans fût élevé à Mansfield. « Que serait-ce d’avoir soin entr’eux de la fille aînée de madame Price, âgée de neuf ans, et arrivée à une époque de la vie qui demandait plus d’attention que sa pauvre mère ne pouvait lui en donner ? L’embarras et la dépense ne seraient rien, comparés à la bonté de cette action. » Lady Bertram accueillit sur le champ cette proposition. « Je crois que nous ne pouvons mieux faire, dit-elle aussitôt ; envoyons chercher l’enfant. »
Sir Thomas ne pouvait donner son consentement si subitement. Il fit des objections ; il hésita. C’était une charge sérieuse. En prenant cet enfant, il fallait lui donner une éducation convenable, autrement ce serait une cruauté que de l’ôter à sa famille. Il pensait à ses quatre propres enfans, à ses deux fils, à l’amour entre cousins, etc. Mais il n’eut pas plutôt entrepris d’établir ses objections, que madame Norris l’interrompit en répondant à toutes, qu’il les eût faites ou non.
« Mon cher sir Bertram, je vous comprends à merveille, et je rends justice à la générosité et à la délicatesse de vos réflexions, qui sont entièrement d’accord avec votre conduite : je pense comme vous, que l’on doit tout faire pour l’établissement d’un enfant que l’on a en quelque sorte adopté. Comme je n’ai point d’enfans, il n’y a qu’à ceux de mes sœurs que je puisse vouloir laisser mon bien ; et je suis sûre que M. Norris est trop juste… Mais vous savez que je n’aime pas à me vanter. Ne soyons pas effrayés par une bagatelle. Que la jeune fille reçoive une bonne éducation, et qu’elle soit introduite convenablement dans le monde, et il y a dix à parier contre un, qu’elle trouvera un bon établissement sans qu’il en coûte rien à aucun de nous. Il suffit qu’elle soit votre nièce, sir Thomas, pour qu’elle soit vue favorablement dans tout le voisinage. Je ne dis pas qu’elle deviendra aussi belle que ses cousines ; j’ose même dire qu’elle ne le deviendra pas ; mais tant de favorables circonstances la serviront dans ce pays, qu’il y a toute sorte de probabilité qu’elle formera un excellent mariage. Vous pensez à vos fils… ; mais ce que vous craignez ne peut arriver. Élevés ensemble, ils se regarderont comme frères et sœurs. Cela est moralement impossible, je ne connais aucune preuve de ce que vous redoutez. C’est même le seul moyen de prévenir une semblable liaison. Supposez qu’elle devienne une jolie personne, et que dans sept ans d’ici elle soit vue pour la première fois par Thomas ou Edmond ? j’ose dire qu’il y aurait quelque mésaventure à redouter. Mais, élevés ensemble, quand bien même elle aurait la beauté d’un ange, elle ne leur paraîtra jamais qu’une sœur. »
« Il y a beaucoup de choses vraies dans ce que vous dites, répliqua sir Thomas ; je suis loin de vouloir m’opposer, sur de frivoles prétextes, à un plan qui convient aussi bien à nos situations mutuelles. Je veux dire seulement qu’il ne faut pas l’adopter légèrement ; et que, pour rendre cette action profitable à madame Price, nous devons assurer à l’enfant, ou nous regarder comme obligés de lui assurer une pension convenable, si cet établissement que vous prévoyez si promptement n’avait pas lieu.
« Je vous entends parfaitement, s’écria Mme Norris ; vous êtes la générosité même, et nous serons toujours d’accord sur ce point. Vous savez que je suis toujours prête à faire tout ce que je puis pour le bonheur de ceux que j’aime ; et quoique je ne ressente pas pour cette petite fille la centième partie de l’attachement que j’ai pour vos enfans, je me haïrais moi-même si j’étais capable de la négliger. N’est-elle pas la fille de ma sœur ? et pourrais-je la voir manquer de quelque chose tant que j’aurais un morceau de pain à lui donner ? Mon cher sir Thomas, avec tous mes défauts, j’ai un bon cœur, et pauvre comme je suis, je me refuserais plutôt le nécessaire que de manquer de générosité. Ainsi, j’écrirai demain à ma pauvre sœur, si vous le voulez, et je lui ferai la proposition dont nous venons de parler. Aussitôt que ce sera une chose décidée, je me charge de faire venir l’enfant à Mansfield ; vous n’aurez aucun embarras à cause de cela. Vous savez que je ne regarde pas à ma peine. J’enverrai Nanny à Londres pour cet objet. Elle descendra chez son cousin le sellier, et l’enfant lui sera envoyé dans ce lieu. On peut aisément trouver à Portsmouth des personnes respectables allant à Londres par les voitures publiques, auxquelles madame Price confiera sa fille. »
Sir Thomas ne fit plus d’objections ; il blâma seulement le plan d’envoyer Nanny. Un moyen plus honorable et moins économique ayant été arrêté pour le voyage de l’enfant, la chose fut regardée comme arrangée, et l’on jouit d’avance des plaisirs d’un projet si bienveillant. Ces plaisirs, en stricte justice, n’auraient pas dû être les mêmes pour les différens intéressés dans cette affaire ; car sir Thomas était résolu d’être le protecteur réel de l’enfant, et madame Norris n’avait pas la moindre intention de faire les plus petits frais pour son entretien. Elle avait assez de bienveillance pour marcher, parler, donner des avis, et personne ne savait mieux qu’elle dicter aux autres la libéralité. Mais son amour pour l’argent était égal à sa passion pour donner des conseils, et elle s’entendait aussi bien à conserver sa bourse qu’à dépenser celle des autres. Comme elle avait fait un mariage au-dessous des prétentions qu’elle avait eues, elle avait jugé devoir adopter d’abord une conduite économe, et ce qui avait commencé par une mesure de prudence, était devenu ensuite une chose de choix.
Quand on reprit ce sujet, les vues de madame Norris se découvrirent entièrement ; et lorsque lady Bertram lui demanda tranquillement : « Ma sœur, l’enfant ira-t-il d’abord chez vous ; ou viendra-t-il chez nous ? » sir Thomas entendit avec quelque surprise madame Norris lui répondre qu’elle était dans l’impossibilité de prendre aucune part personnelle à cette charge. Il avait jugé que ce serait une addition convenable aux habitans du presbytère, et que cette jeune fille serait une compagne très-désirable pour une tante qui n’avait point d’enfants ; mais il reconnaissait qu’il s’était entièrement abusé. Madame Norris allégua le mauvais état de la santé de M. Norris, qui lui rendait le bruit insupportable, et qui nécessitait, quand il avait ses accès de goutte, qu’elle ne bougeât pas d’auprès de lui.
« Alors, il sera mieux que ma nièce vienne ici, dit lady Bertram froidement. Après une courte pause, sir Thomas ajouta avec dignité : « Oui, que notre maison soit la sienne. Nous ferons notre devoir envers elle, et elle aura du moins l’avantage d’avoir des compagnes de son âge, et une institutrice. »
« Cela est très-vrai, s’écria madame Norris, et ce sont deux considérations importantes. Ce sera la même chose pour miss Lee d’avoir trois jeunes filles à instruire au lieu de deux. Je voudrais seulement pouvoir être plus utile ; mais vous voyez que je fais ce que je puis. Je ne suis pas de ces gens qui craignent leur peine. Nanny ira chercher la petite, quoique cela me gênera un peu. J’espère que ce sera une bonne fille, et qu’elle sera sensible au bonheur d’avoir de tels amis. »
« Si ses dispositions étaient réellement mauvaises, dit sir Thomas, nous ne pourrions, à cause de nos enfans, la garder dans notre maison ; mais il n’y a aucune raison pour craindre un si grand mal. Nous devons nous attendre à ce qu’elle soit fort ignorante, à ce qu’elle ait des sentimens peu élevés et des manières communes ; mais ce ne sont pas là des défauts incurables. Si mes filles eussent été plus jeunes qu’elle, j’aurais fait une attention extrême à cette introduction auprès d’elles d’une nouvelle compagne ; mais dans l’état où sont les choses, je crois qu’il n’y a rien à craindre pour mes filles, et qu’il y a tout à espérer pour leur jeune cousine, dans cette association. »
« C’est exactement là ce que je pense, dit madame Norris, et ce que je disais ce matin à mon mari. Il suffira que l’enfant soit avec ses cousines pour recevoir de l’éducation ; si miss Lee ne lui apprenait rien, ses cousines seules leur enseigneraient à être bonne et intelligente. »
« J’espère, dit lady Bertram, qu’elle ne tracassera pas mon pauvre petit singe. Il n’y a que peu de temps que j’ai obtenu de Julie qu’elle le laissât tranquille. »
« Nous rencontrerons quelques difficultés, madame Norris, dit sir Thomas, relativement à la distinction qu’il y aura à faire entre les jeunes personnes, quand elles prendront de l’âge, et pour faire sentir à mes filles ce qu’elles sont ; sans qu’elles regardent cependant leurs cousines trop au-dessous d’elles, tout en se rappelant qu’elle n’est pas une miss Bertram. Je désire qu’elles soient unies d’amitié, sans vouloir autoriser aucun degré d’arrogance de la part de mes filles ; mais cependant elles ne peuvent pas être égales. Leur rang, leur fortune, leurs droits seront toujours différens. C’est un point fort délicat, et vous devrez nous aider dans nos efforts pour suivre exactement la meilleure ligne de conduite à suivre. »
Madame Norris fut entièrement disposée à seconder sir Thomas ; et quoiqu’elle convînt avec lui que c’était une chose très-difficile, elle lui fit espérer qu’entre eux ce serait aisément exécuté.
Le lecteur croira facilement que madame Norris n’écrivit pas en vain à sa sœur. Madame Price fut étonnée que l’on eût choisi une fille, tandis qu’elle avait tant de beaux garçons ; mais elle n’en accepta pas moins l’offre avec reconnaissance, assurant ses sœurs que sa fille avait un heureux caractère, de bonnes dispositions, et qu’elle ne mériterait jamais qu’on la renvoyât. Elle la représenta comme étant un peu délicate et faible ; mais elle espérait que le changement d’air lui ferait un bien remarquable. Pauvre femme ! elle pensait probablement que le changement d’air ne serait pas moins avantageux à plusieurs autres de ses enfans !
CHAPITRE II.
La petite fille fit son long voyage heureusement ; madame Norris alla au-devant d’elle à Northampton, pour avoir l’agrément de la présenter à son beau-frère et à sa sœur, et de la recommander à leur bonté.
Fanny Price avait, à cette époque, dix ans accomplis ; et quoiqu’au premier aspect elle n’eût rien de remarquable pour la beauté, elle n’avait rien aussi qui pût déplaire à ses parens. Elle était petite pour son âge ; elle avait peu de carnation. Sa timidité était extrême ; mais son air, quoique craintif, n’avait rien de vulgaire : sa voix était douce, et quand elle parlait, sa contenance était aimable. Sir Thomas et lady Bertram la reçurent avec beaucoup de bonté ; et le premier, voyant combien elle avait besoin d’encouragement, essaya de paraître moins grave. Lady Bertram, sans prendre tant de peines, ni dire beaucoup de paroles, se contenta de regarder sa jeune nièce avec un sourire bienveillant, et lui parut à ce moyen moins imposante que son époux.
Tous les enfans étaient au logis. Ils accueillirent la petite cousine avec affabilité et gaîté, sur-tout les fils, qui, âgés de dix-sept ans et de seize ans, et grands pour leur âge, paraissaient à Fanny être des hommes. Les deux filles, qui étaient plus jeunes, étaient plus embarrassées à cause des remarques peu judicieuses que leur père avait cru devoir leur faire sur leur conduite avec leur cousine. Mais elles avaient trop l’habitude de la société et des louanges pour éprouver rien qui ressemblât à de la timidité ; et leur confiance en elles-mêmes augmentant par le peu de hardiesse de leur cousine, elles furent bientôt en état d’examiner ses traits et son habillement avec une paisible indifférence.
Les enfans de sir Thomas étaient remarquables par les avantages qu’ils tenaient de la nature. Les garçons étaient très-bien, et les filles véritablement belles. Tous étaient précoces dans leur taille, ce qui faisait entre eux et leur cousine une différence pour leurs personnes, comme l’éducation en faisait une autre dans l’aisance de leurs manières. Il n’y avait que deux ans entre la plus jeune des filles et Fanny. Julia Bertram n’avait que douze ans, et Maria, l’aînée, n’en avait que treize. La petite Fanny cependant, était aussi malheureuse que possible. Effrayée de tout, honteuse d’elle-même, et soupirant après la maison qu’elle avait quittée, elle ne pouvait lever les yeux, proférait à peine quelques paroles et était toujours prête à pleurer. Madame Norris lui avait parlé pendant toute la route de Northampton à Mansfield, de son étonnant bonheur, de la reconnaissance extraordinaire qu’elle en devait avoir, ainsi que de la bonne conduite qu’elle devait tenir. Son chagrin s’était augmenté par l’idée de sa dépendance d’autrui. La fatigue du voyage l’accablait aussi. En vain sir Thomas lui fit-il quelques caresses ; en vain madame Norris prédit-elle qu’elle serait une bonne fille ; en vain lady Bertram lui sourit-elle et la fit-elle s’asseoir sur son sopha avec elle et son petit singe ; en vain lui présenta-t-on des gâteaux de toutes les espèces ; elle pouvait à peine manger quelques morceaux sans que ses larmes vinssent l’interrompre. Le sommeil paraissait être ce dont elle avait le plus besoin, on la mit au lit pour finir ses chagrins.
« Voilà un commencement qui ne promet pas beaucoup, dit madame Norris, lorsque Fanny eut quitté le salon. Après tout ce que je lui ai dit pendant la route, j’aurais cru qu’elle se serait mieux conduite. Je désire qu’il n’y ait pas un peu d’apathie dans son caractère. Sa pauvre mère y était très-portée. Cependant, nous devons avoir de l’indulgence pour un enfant de son âge. Le regret qu’elle a d’avoir quitté sa maison, n’est pas à son désavantage ; car c’était sa maison, malgré tout ce qui y manque : elle ne peut pas encore comprendre ce qu’elle gagne à en changer. Ainsi donc, il faut de la modération en toutes choses. »
Il fallut toutefois plus de temps que madame Norris ne l’avait cru pour réconcilier Fanny avec la nouveauté du parc de Mansfield, et l’accoutumer à son éloignement de toutes les personnes avec lesquelles elle était habituée à vivre. Sa sensibilité était très-vive, et l’on y faisait trop peu d’attention à Mansfield.
Le jour de fête accordé aux filles de lord Bertram, pour qu’elles se liassent davantage avec leur cousine, produisit entre elles peu d’intimité. Les deux sœurs prirent une idée peu favorable de Fanny, en sachant qu’elle n’avait jamais étudié la langue française ; et quand elles virent qu’elle était peu frappée du duo qu’elles eurent la complaisance de chanter pour elle, se bornant alors à lui donner quelques-uns de leurs plus anciens jouets, elles la laissèrent à elle-même et s’occupèrent de ce qui leur plaisait davantage pour le moment.
Fanny, soit qu’elle fût auprès ou loin de ses cousines ; soit qu’elle fût dans la chambre d’études, dans le salon ou dans le jardin, était également malheureuse, parce que tout lui inspirait de la crainte. Le silence de lady Bertram glaçait son cœur ; la gravité des regards de sir Thomas la rendait interdite, et les leçons de madame Norris l’effrayaient. Ses cousines la mortifiaient par leurs réflexions sur sa timidité. Miss Lee s’étonnait de son ignorance, et les femmes de chambres se moquaient de ses vêtemens. Lorsqu’à tous ces sujets de chagrin elle y ajoutait le souvenir des frères et des sœurs pour lesquels elle avait toujours été une compagne importante, son cœur éprouvait un découragement qu’elle ne pouvait surmonter.
Une semaine s’était écoulée sans que l’on eût soupçonné, d’après l’air tranquille de Fanny, qu’elle finissait toutes ses journées par des larmes, lorsqu’elle allait chercher les bienfaits du sommeil. Un matin, elle fut surprise pleurant dans sa chambre, par son cousin Edmond, le plus jeune des fils de sir Bertram.
« Ma chère petite cousine, dit-il avec toute la douceur d’un excellent naturel, qu’avez-vous ? » et s’asseyant auprès d’elle, il s’efforça d’apprendre le sujet de sa douleur. « Êtes-vous malade ? quelqu’un est-il fâché avec vous ? Julia et Maria vous ont-elle querellée ? » À toutes ces questions, il n’obtint long-temps pour réponse que non, non du tout ; non, je vous remercie. Mais il persévéra, et aussitôt qu’il eut nommé dans les sujets de chagrin de Fanny, sa séparation de la maison paternelle, il reconnut, par le redoublement de ses larmes, qu’il en avait découvert le motif : il essaya de la consoler. »
« Vous êtes fâchée d’avoir quitté votre mère, ma chère petite Fanny, dit-il, et cela prouve la bonté de votre cœur ; mais vous devez songer que vous êtes ici avec des parens et des amis qui vous aiment et qui désirent vous rendre heureuse. Allons-nous promener dans le parc, et vous me direz tout ce que vous vous rappelez de vos frères et de vos sœurs. »
Dans cette conversation, Edmond apprit que le frère que Fanny regrettait le plus était William ; il était plus âgé qu’elle d’un an. C’était son compagnon, son ami. William avait été fâché qu’elle fût partie, il lui avait dit qu’il souffrirait beaucoup de son absence. « Mais William vous écrira, j’en suis certain. » Oui, il m’a promis de le faire ; mais il m’a dit de lui écrire la première. » « Et quand lui écrirez-vous » ? Fanny baissa la tête, hésita, et répondit qu’elle ne savait pas, qu’elle n’avait point de papier.
« Si c’est là toute la difficulté, je vous donnerai tout ce qu’il vous faudra. Seriez-vous bien aise, d’écrire à William ? « Oh ! oui. »
« Eh bien, venez avec moi dans la chambre du déjeûner, nous trouverons là tout ce qu’il faudra. »
« Mais, mon cousin…, la lettre ira-t-elle à la poste ?
« Oui, je vous assure, elle ira avec les autres lettres ; et, comme votre oncle l’affranchira, elle ne coûtera rien à William. »
« Mon oncle ! » répéta Fanny avec un air effrayé.
« Oui, quand vous aurez écrit votre lettre, je la donnerai à mon père pour qu’il l’affranchisse. »
Fanny trouva que c’était une grande hardiesse ; mais elle ne fit plus d’objections. Ils allèrent ensemble dans le salon du déjeûner, où Edmond disposa le papier de Fanny avec toute la complaisance que son frère William aurait pu y mettre, et probablement avec plus d’adresse. Il resta avec elle tout le temps qu’elle mit à écrire sa lettre, l’aidant dans son orthographe, et de tous les petits soins qui pouvaient lui être utiles. Quand elle eut fini, il écrivit lui-même ses complimens d’amitié pour William, et il lui envoya une demi-guinée sous le cachet. La sensibilité de Fanny fut vivement excitée par cette bienveillance : elle se croyait incapable d’exprimer ses sentimens, mais son air et quelques mots sans art témoignaient toute sa reconnaissance, et son cousin commença à la trouver un objet intéressant : il lui parla davantage, et, d’après tout ce qu’elle dit, il fut convaincu qu’elle avait un cœur sensible et un vif désir de bien faire. Il reconnut qu’elle avait droit à ce qu’on eût des attentions pour elle, par la grande délicatesse avec laquelle elle envisageait sa situation, et par son extrême timidité ; il ne lui avait jamais fait aucune peine, mais il voyait qu’elle avait besoin d’une bonté plus positive ; et, dans cette vue, il commença d’abord par tâcher de dissiper les craintes que lui inspiraient tous les habitans de Mansfield ; il lui conseilla de jouer avec Maria et Julia, et d’être aussi gaie qu’elle le pourrait.
À partir de ce jour, Fanny se trouva plus agréablement ; elle sentait qu’elle avait un ami, et la bonté de son cousin Edmond lui donna du courage ; le lieu lui parut moins extraordinaire, les personnes lui devinrent moins formidables, et, s’il y en avait parmi elles qu’elle ne pouvait cesser de craindre, elle commença du moins à connaître leurs manières d’être, et comment il fallait agir pour s’y conformer. Son extrême timidité qui avait été gênante pour les autres, et d’un mauvais effet pour elle-même, se dissipa. Elle ne fut plus épouvantée de paraître devant son oncle, et la voix de sa tante Norris ne la fit plus tressaillir au dernier degré. Elle devint une compagne pour ses cousines, qui la trouvaient quelquefois agréable, et elles ne tardèrent pas à avouer que Fanny avait un assez bon caractère.
Edmond avait toujours la même bonté pour elle, et elle n’avait à endurer de la part de Thomas que cette sorte de gaîté qu’un jeune homme de dix-sept ans croit souvent devoir employer à l’égard d’un enfant de dix ans. Il entrait dans la vie plein d’ardeur, et avec toutes les dispositions libérales d’un fils aîné qui se sent né pour seulement dépenser et jouir. Ses égards pour sa petite cousine étaient en rapport avec sa situation ; il lui faisait de très-jolis petits présens, et riait d’elle.
Comme l’apparence et l’esprit de Fanny s’étaient améliorés, sir Thomas et madame Norris s’applaudissaient de leur plan bienveillant, et ils étaient très-disposés à penser que, quoique Fanny fût encore loin de montrer beaucoup d’intelligence, elle avait cependant d’heureuses dispositions, et paraissait ne pas devoir leur causer d’embarras.
Fanny savait seulement lire, travailler et écrire ; on ne lui avait rien appris de plus, et, comme ses cousines trouvaient qu’elle ignorait beaucoup de choses qui leur étaient familières, elles la jugèrent extrêmement stupide. Pendant deux ou trois semaines, il ne fut question dans le salon que de l’ignorance de Fanny. « Chère maman, disait Maria ou Julia, ma cousine ne peut pas rassembler la carte d’Europe ; ma cousine ne peut nommer les principales rivières de la Russie ; ma cousine n’a jamais entendu parler de l’Asie mineure. »
« Ma chère, répliquait madame Norris, cela est très-mal ; mais vous vous ne devez pas attendre que tout le monde soit aussi avancé en instruction que vous l’êtes. « Ma tante, je vous dirai une autre chose de Fanny qui montre combien elle est stupide ; elle ne paraît point envieuse d’apprendre la musique ni le dessin. »
« Certes, ma chère, cela est très-stupide en effet, et cela montre un grand manque de génie et d’émulation : cependant, tout considéré, il est peut-être bien qu’elle pense ainsi, car, quoique votre père ait la bonté de la faire élever avec vous, il n’est nullement nécessaire qu’elle soit aussi accomplie que vous l’êtes. Au contraire, il est à désirer qu’il y ait entre vous de la différence. »
Tels étaient les conseils que madame Norris donnait à ses nièces pour leur former l’esprit. Il n’était pas étonnant d’après cela qu’elles manquassent de générosité et de modestie, quoiqu’elles eussent des talens naissans et une instruction précoce. Sir Thomas, ne s’apercevait pas de ce qu’il y avait à blâmer en elles, parce que, quoiqu’il fût un père tendre, la gravité de son caractère empêchait ses filles de parler librement devant lui.
Lady Bertram ne donnait pas la plus légère attention à leur éducation ; elle n’avait aucun temps à donner à de pareils soins : elle passait ses journées sur un sopha, habillée avec élégance, occupée de quelque travail d’aiguille, pensant plus à son singe qu’à ses enfans, mais très-tendre cependant pour ceux-ci quand ils ne la gênaient pas. Sir Thomas était son guide pour tout ce qui avait de l’importance, et, dans les intérêts plus petits, c’était sa sœur qui la dirigeait.
Fanny, avec toute son ignorance et sa timidité, était fixée cependant à Mansfield, et, prenant de l’attachement pour sa nouvelle résidence, elle croissait auprès de ses cousines sans être malheureuse. Maria ni Julia n’avaient pas précisément un mauvais naturel ; et quoique Fanny fût souvent mortifiée par la manière dont elles agissaient avec elle, l’opinion qu’elle avait de ses droits était trop peu élevée pour qu’elle s’en offensât.
À l’époque où Fanny était venue à Mansfield, lady Bertram, par indolence autant que pour le soin de sa santé, avait renoncé à aller habiter sa maison à Londres où elle se rendait ordinairement chaque printemps. Elle resta entièrement à la campagne, laissant sir Thomas assister au parlement avec le plus ou le moins d’agrément qu’il pouvait trouver à être éloigné d’elle. Les demoiselles Bertram continuèrent en conséquence à exercer leur mémoire et cultiver leur esprit à la campagne, et devinrent tout à fait grandes. Leur père les trouvait aussi bien qu’il pouvait le désirer, et il augurait qu’elles feraient de respectables alliances. Son fils aîné était étourdi et extravagant, il lui avait déjà donné du mécontentement ; mais ses autres enfans ne lui promettaient que de la satisfaction. Le caractère d’Edmond, son bon sens, sa justesse d’esprit annonçaient qu’il ferait honneur à sa famille et la rendrait heureuse ainsi que lui-même. Il était destiné à la carrière du clergé.
Sir Thomas, au milieu des soins qu’il donnait à sa famille, n’oubliait pas celle de madame Price. Il pourvoyait libéralement à l’éducation et à la carrière de ses fils à mesure qu’ils devenaient assez âgés pour prendre un état, et Fanny, quoique totalement séparée de sa famille, était charmée d’apprendre tout ce que sir Thomas faisait pour elle. Dans le cours de plusieurs années, elle n’avait goûté que rarement le plaisir d’être avec William. Elle n’avait vu aucun autre de ses parens ; mais William qui, peu de temps après le départ de Fanny de Porstmouth avait pris la carrière de la mer, avait été invité à venir passer une semaine dans le Northampton avec sa sœur. On peut s’imaginer avec quel plaisir le frère et la sœur se revirent, et avec quel chagrin ils se séparèrent. Heureusement cette visite avait eu lieu à l’époque des fêtes de Noël ; Edmond revenait du collége ces jours-là, et il parla avec tant de raison à Fanny sur ce que la profession de William exigeait et sur les avantages qui pouvaient résulter pour lui de leur séparation, qu’il la lui fit trouver moins pénible. L’affection d’Edmond ne lui manquait jamais ; quand il quitta le collége d’Eton pour aller à Oxford, il conserva les mêmes dispositions pour Fanny. Il était toujours fidèle à son amitié pour elle, essayant de faire ressortir ses bonnes qualités, lui donnant ses conseils, ses consolations, ses encouragemens.
Ses attentions pour elle étaient de la plus haute importance pour le perfectionnement de son esprit et l’augmentation de ses plaisirs. Il reconnaissait qu’elle était intelligente, qu’elle avait autant de facilité d’esprit que de bon sens, et un amour pour la lecture qui, bien dirigé, est seule une éducation. Miss Lee lui apprit la langue française et lui fit répéter chaque jour une leçon d’histoire ; mais c’était Edmond qui lui indiquait les livres qui charmaient ses heures de loisir ; il encourageait son goût, il rectifiait son jugement, il lui rendait ses lectures utiles en lui parlant de ce qu’elle avait lu, et il augmentait son goût pour l’instruction par des éloges judicieux. En retour de semblables services, elle l’aimait plus que toute autre personne au monde, à l’exception de William ; son cœur était partagé entre eux deux.
CHAPITRE III.
Le premier évènement de quelque importance qui eut lieu dans la famille, fut la mort de M. Norris, qui arriva lorsque Fanny atteignit l’âge de quinze ans. Il devait en résulter nécessairement quelques changemens : madame Norris, en quittant le presbytère, demeura quelque temps à Mansfield, et alla ensuite habiter une petite maison qui appartenait à sir Thomas dans le village. Elle se consola de la perte de son mari en réfléchissant que sa dépense serait diminuée.
Le presbytère devait appartenir par la suite à Edmond, et si M. Norris fût mort quelques années plutôt ; cette cure aurait été donnée à quelque ami qui l’aurait occupée jusqu’à ce qu’Edmond eût été en âge de recevoir les ordres ; mais l’extravagance de Thomas avait été si grande avant que cette époque fût arrivée, qu’il fallut changer ces dispositions et se contenter pour Edmond d’une autre cure moins considérable.
Sir Thomas fit à cette occasion de fortes remontrances à son fils aîné. Celui-ci les écouta avec quelque confusion et quelque regret ; mais il tâcha d’y échapper aussi promptement qu’il le pût faire, et s’en consola en pensant que ses dettes n’étaient pas de moitié aussi considérables que celles de quelques-uns de ses amis.
Après la mort de M. Norris, la cure fut dévolue à M. le docteur Grant, qui vint en conséquence résider au presbytère de Mansfield, et qui, âgé seulement de quarante-cinq ans, paraissait devoir conserver sa place long-temps.
Il avait une femme plus jeune que lui de quinze ans, mais il n’avait point d’enfans. Ils furent représentés suivant la coutume, dans le voisinage, comme des gens aimables et respectables.
L’époque était venue où sir Thomas s’attendait que sa belle sœur prendrait sa nièce avec elle. Son état de veuve et l’âge de Fanny semblaient rendre cette réunion on ne peut plus convenable. Quelques pertes récentes faites aux Indes occidentales et les dépenses folles de son fils aîné, faisaient désirer à sir Thomas de n’être plus chargé de l’entretien de Fanny. Il croyait cet arrangement tellement naturel, qu’il en parla à sa femme comme d’une chose arrêtée ; et, dès que lady Bertram se trouva avec Fanny, elle lui dit tranquillement : « Eh bien, Fanny ! vous allez nous quitter et vivre avec ma sœur. En serez-vous contente ? »
Fanny fut trop étonnée pour ne pas faire répéter les mêmes paroles à sa tante. « Moi vous quitter ! » dit-elle » « Oui, ma chère. De quoi vous étonnez-vous ? vous avez été cinq ans avec nous, et ma sœur a toujours eu l’intention de vous prendre chez elle aussitôt que M. Norris serait mort. »
Cette nouvelle fut aussi désagréable à Fanny qu’elle lui était inattendue. Elle n’avait jamais reçu de témoignages d’amitié de sa tante Norris, et elle ne pouvait l’aimer.
« Je serai très-fâchée de m’en aller, » dit Fanny d’une voix timide.
« Oui, je le crois. Cela est assez naturel ; car je pense que vous avez été aussi peu tourmentée dans cette maison, qu’aucune personne dans le monde. »
« J’espère que je ne suis pas une ingrate, ma tante, » dit Fanny modestement.
« Non, ma chère, je ne le suppose pas ; je vous ai toujours trouvée une très-bonne fille. »
« Et je ne vivrai plus ici de nouveau ? »
« Non ma chère. Mais vous n’en aurez pas moins une agréable résidence. Peu vous importe d’être dans une maison ou dans l’autre ? »
Fanny quitta l’appartement avec un cœur attristé. Aussitôt qu’elle vit Edmond, elle lui fît part de son chagrin. « Mon cousin, dit-elle, il arrive quelque chose qui me fait de la peine ; et, quoique vous m’ayez souvent dit que je devais me réconcilier avec des choses qui me déplaisaient d’abord, je crois que vous penserez comme moi cette fois-ci. Je vais vivre entièrement auprès de ma tante Norris. »
« Vraiment ! »
« Oui, ma tante Bertram vient de me l’apprendre ; c’est une chose décidée : je dois quitter le parc de Mansfield et aller à la maison de ma tante. »
« Eh bien, Fanny, si ce plan ne vous déplaisait pas, je le trouverais excellent. »
« Oh ! mon cousin ! »
« Ma tante agit comme une femme sensible, en désirant vivre avec vous. Elle choisit une amie et une compagne exactement telle qu’elle doit le faire, et je suis bien aise que son amour pour l’argent ne soit pour rien dans cette affaire ; j’imagine, Fanny, que vous n’êtes pas trop fâchée d’aller auprès d’elle ? »
« Pardonnez-moi, je ne puis trouver cela agréable : j’aime cette maison-ci, et tout ce qui s’y trouve. Je n’aimerai rien dans l’autre ; vous savez combien je suis peu dans les bonnes grâces de ma tante Norris ? »
« Elle a été de même avec nous tous ; elle n’a jamais su se rendre agréable aux enfans. Mais aujourd’hui vous êtes d’un âge à être traitée autrement. Il me semble qu’elle se conduit déjà mieux à votre égard ; et quand vous serez sa seule compagne, vous obtiendrez nécessairement de l’importance à ses yeux. »
« Je ne puis jamais avoir quelque importance pour qui que ce soit. »
« Et par quelle raison ? »
« Par une infinité de raisons : ma situation, mon ignorance, ma timidité. »
« Croyez-moi, Fanny, vous vous servez d’expressions qui ne vous conviennent point ; par-tout où vous serez connue vous exciterez de l’intérêt ; vous avez du bon sens, vous avez un aimable caractère, et je suis certain que vous avez un cœur reconnaissant qui vous portera toujours à montrer votre gratitude de la bonté que l’on vous témoignera. Je ne connais aucune meilleure qualité pour une amie et une compagne. »
« Vous avez trop d’indulgence, dit Fanny en rougissant à chaque louange qu’Edmond lui donnait. Comment puis-je vous remercier d’une opinion aussi flatteuse pour moi ? Ah ! mon cousin, si je quitte cette maison-ci, je me rappellerai votre bonté jusqu’au dernier moment de ma vie. »
« En vérité, Fanny, vous parlez comme si vous partiez pour deux cents lieues ; mais songez donc que vous serez presque aussi rapprochée de nous qu’auparavant. Nous nous réunirons tous les jours, et la seule différence qu’il y aura, sera que madame Norris, en vous ayant auprès d’elle, sera forcée de vous rendre justice. »
Fanny soupira, et dit : « Je ne puis voir comme vous ; mais je dois croire que vous pensez d’une manière plus juste que moi, et je vous suis très obligée de ce que vous cherchiez à me réconcilier avec ce que je ne puis empêcher. »
Ainsi se termina cette conversation. Fanny aurait bien pu s’épargner le chagrin que le projet dont elle venait de parler à Edmond lui avait causé, car madame Norris n’avait pas la moindre intention de la prendre avec elle. Lady Bertram s’en assura bientôt. « Je pense, ma sœur, dit-elle à madame Norris, que nous n’aurons plus besoin de miss Lee quand Fanny ira vivre avec vous ? »
« Vivre avec moi ! chère lady Bertram ! » s’écria madame Norris presque en tressaillant.
« Je pensais que c’était une chose arrangée avec sir Thomas ? »
« Jamais, jamais je n’ai dit une syllabe de cela à sir Thomas. Fanny vivre avec moi ! c’est la dernière chose au monde à laquelle je penserais. Bon Dieu ! que pourrais-je faire avec Fanny ? Moi, pauvre veuve, dont les esprits sont abattus, Je devrais prendre soin d’une jeune fille de quinze ans ! Sir Thomas est trop mon ami pour vouloir me charger d’un pareil fardeau. Je ne me refuse pas à cet embarras par un motif d’économie : mon objet, lady Bertram, est d’être utile à ceux qui viennent après moi ; c’est pour le bien de vos enfans que je conserve ce que j’ai ; je n’ai personne qui m’intéresse davantage, et je voudrais bien pouvoir leur laisser quelque chose qui fût digne d’eux. »
« Vous êtes bien bonne, mais ne vous gênez pas à cause de cela ; ils sont sûrs d’avoir de la fortune ; sir Thomas y pourvoira. »
« Tant mieux : je veux dire seulement que mon seul désir est d’être utile à votre famille. Ainsi, lorsque sir Thomas vous reparlera d’envoyer Fanny chez moi, vous pourrez lui dire que ma santé et ma situation d’esprit s’opposent entièrement à ce que cela ait lieu ; et de plus, que véritablement je n’ai pas un lit à lui donner, car je veux avoir une chambre à offrir à un ami. »
Lady Bertram, en répétant cet entretien à son mari, le convainquit qu’il s’était trompé sur les vues de sa belle-sœur. Il ne fut plus question d’envoyer Fanny chez elle ; sir Thomas réfléchissant que tout ce qu’elle possédait était réservé à sa famille, ne songea plus à la contrarier pour cet objet. Fanny apprit bientôt qu’elle avait eu tort de s’affliger pour ce projet, et la joie qu’elle ressentit de le voir détruit, consola Edmond de ce que les avantages qu’il en avait attendus pour Fanny fussent évanouis.
M. et Mme Grant, montrant des dispositions amicales et sociables, donnèrent beaucoup de satisfaction aux diverses personnes de leur voisinage. Ils avaient leurs défauts, et madame Norris sut bientôt les découvrir. Le docteur Grant aimait beaucoup la table, et madame Grant, au lieu d’user d’économie, payait un cuisinier aussi cher que celui de Mansfield. Madame Norris ne tarissait point sur les prodigalités du presbytère.
Depuis un an, ils étaient l’objet de ses remarques, quand un évènement qui survint dans la famille changea le sujet des conversations de madame Norris et de lady Bertram. Sir Thomas jugea convenable à ses intérêts d’aller lui-même à Antigoa ; et, pour mieux arranger ses affaires, il emmena son fils aîné avec lui, afin de le détacher de quelques liaisons pernicieuses. Ils quittèrent l’Angleterre, en présumant être absens pendant une année.
La nécessité de cette mesure, sous le rapport pécuniaire, et l’espérance de l’utilité quelle aurait pour son fils, consolèrent sir Thomas de ce qu’il quittait sa famille et ses filles, sur-tout au moment le plus important de leur vie : il ne pouvait pas se fier entièrement dans lady Bertram pour le remplacer ; mais, avec l’active attention de madame Norris et le jugement d’Edmond, il crut pouvoir partir sans craindre aucun mauvais résultat de son absence.
Lady Bertram ne fut nullement satisfaite du départ de son mari ; mais elle ne conçut aucune alarme sur sa santé, étant du nombre de ces personnes qui regardent les difficultés ou les dangers comme ayant de l’importance suivant le degré où leurs individus y sont exposés.
Les filles de sir Thomas étaient à plaindre dans cette occasion, non pas à cause de leur chagrin, mais plutôt parce qu’elles n’en éprouvaient point. Elles n’avaient aucune affection pour leur père ; il n’avait jamais paru l’ami de leurs plaisirs, et son absence malheureusement leur était très-agréable : elles sentaient qu’elles allaient être leurs maîtresses absolues, et que toute indulgence leur serait accordée. Fanny éprouvait à peu près les sensations de ses cousines ; mais son caractère plus tendre lui faisait se les reprocher comme une ingratitude, et elle s’affligeait de ce qu’elle ne pouvait s’affliger. « Sir Thomas avait tant fait pour elle et pour ses frères ! Il partait peut-être pour ne plus revenir ; comment le voir partir sans répandre une larme ? c’était une honteuse insensibilité. » Il lui avait dit de plus, dans la matinée, qu’elle pourrait voir William dans le cours de l’hiver, et il l’avait chargée de lui écrire et de l’inviter de venir à Mansfield aussitôt que l’on apprendrait que l’escadre à laquelle il appartenait serait arrivée en Angleterre. Quelle bonté ! quelle attention ! mais il avait fini son discours d’une manière qui avait été une triste mortification pour Fanny. « Si William, avait-il dit, vient à Mansfield, j’espère que vous serez à même de le convaincre que les années qui se sont écoulées depuis que vous êtes séparés, ne se sont pas passées inutilement pour votre instruction, quoique je craigne qu’il ne trouve sa sœur, à l’âge de seize ans, aussi peu avancée pour son éducation que lorsqu’elle en avait dix. » Fanny pleura amèrement, à cause de cette réflexion, lorsque son oncle fut parti ; et ses cousines, en lui voyant les yeux rouges, l’accusèrent d’être une hypocrite.
CHAPITRE IV.
Le fils aîné de sir Thomas Bertram avait passé si peu de temps avant son départ à la maison paternelle, que l’on ne pouvait s’apercevoir de son absence ; et lady Bertram fut bientôt étonnée de voir comment les choses suivaient leur cours accoutumé, malgré l’absence de son mari, et comment Edmond le remplaçait en parlant à l’intendant, en écrivant au procureur, et lui épargnant tous les embarras de l’administration de sa maison.
On reçut bientôt la nouvelle de l’heureuse arrivée des deux voyageurs à Antigoa. L’hiver vint, et se passa sans que sir Thomas annonçât son retour. Les nouvelles qu’il donnait continuaient à être très-bonnes.
Les demoiselles Bertram étaient alors pleinement établies parmi les belles du voisinage ; et comme elles joignaient à la beauté des talens brillans, des manières naturellement aisées et polies, elles faisaient l’objet de l’admiration de leur tante, madame Norris. Lady Bertram n’allait point en public avec ses filles ; elle était trop indolente pour aller jouir de leurs triomphes ; cette agréable charge était confiée à sa sœur, qui ne désirait rien tant qu’une aussi honorable représentation, et qui trouvait fort commode de jouir des plaisirs de la société sans avoir besoin de louer une voiture.
Fanny ne prenait aucune part aux fêtes de la saison ; mais elle trouvait une grande jouissance à être une compagne utile pour sa tante Bertram, quand toute la famille était dehors ; et comme miss Lee avait quitté Mansfield, elle était devenue naturellement nécessaire à lady Bertram dans les soirées où il y avait un bal ou une partie. Elle lui parlait, elle l’écoutait, elle lui faisait une lecture ; et la tranquillité de ces soirées, sa sécurité parfaite dans ce tête-à-tête, rendaient ces momens extrêmement agréables pour elle. Elle aimait à entendre ses cousines lui raconter ce qui s’était passé au bal, lui dire avec qui Edmond avait dansé. Mais elle avait une idée trop peu élevée de sa situation pour imaginer qu’elle pût jamais être admise à partager ces amusemens, et elle en écoutait le détail sans penser qu’elle y pût prendre aucun autre intérêt. L’hiver se passa agréablement pour elle. Quoique William ne fût pas venu en Angleterre, l’espoir de le revoir bientôt avait adouci le regret de la prolongation de son absence.
Le printemps et l’été se passèrent sans que sir Thomas revînt. Au mois de septembre, des circonstances défavorables étant survenues qui reculaient encore la conclusion de ses affaires, il se détermina à renvoyer son fils en Angleterre ; et à rester seul à Antigoa, pour y terminer ses opérations. Thomas arriva en bonne santé, et donna les meilleures nouvelles de celle de son père. Madame Norris tira un mauvais augure de ce que sir Thomas se fût ainsi séparé de son fils ; de tristes pressentimens l’assiégeaient, et pour y échapper, elle venait chaque jour dîner au parc de Mansfield. Mais le retour des plaisirs de l’hiver ne fut pas sans effet, et bientôt madame Norris ne fut plus occupée qu’à surveiller les destinées de sa nièce aînée. « Si le pauvre sir Thomas était condamné à ne plus revenir, se disait-elle, ce serait une consolation que de voir la chère Maria bien mariée. Elle pensait souvent à cela, sur-tout quand elle voyait dans les cercles où elle se trouvait, quelques jeunes gens d’une grande fortune, parmi lesquels elle en avait remarqué un qui venait d’hériter d’une des propriétés les plus belles et les plus considérables du pays.
M. Rushworth fut frappé de la beauté de miss Bertram dès la première fois qu’il l’aperçut ; et comme il était disposé à se marier, il crut éprouver de l’amour. C’était un jeune homme lourd, n’ayant qu’un bon sens vulgaire ; mais comme il n’y avait rien de désagréable dans sa figure, miss Bertram fut charmée de faire sa conquête. Maria Bertram ayant atteint l’âge de vingt-un ans, commençait à penser que le mariage était un devoir ; et comme en épousant M. Rushworth elle aurait la jouissance d’un revenu plus considérable que celui de son père, ainsi qu’un hôtel à Londres, ce qui était un point capital, il lui devint évident qu’elle devait épouser M. Rushworth, si cela lui était possible. Madame Norris mit beaucoup de zèle pour effectuer ce mariage ; et entr’autres moyens qu’elle employa pour y parvenir, elle chercha à faire naître une intimité avec la mère de M. Rushworth, qui vivait avec lui. Elle détermina même lady Bertram à faire dix milles d’une route assez mauvaise, pour aller lui rendre une visite du matin. Madame Rushworth annonça elle-même que son fils désirait beaucoup se marier, et déclara que de toutes les personnes qu’elle avait vues, miss Bertram lui avait paru, par ses aimables qualités, la plus susceptible de faire le bonheur de son fils. Madame Norris accepta le compliment, admira le discernement de madame Rushworth en distinguant Maria, qui, en effet, dit-elle, était sans aucun défaut, était un ange et tellement entourée d’admirateurs, qu’elle pouvait être difficile dans son choix. Mais autant que madame Norris pouvait en juger d’après une si courte connaissance, M. Rushworth paraissait être précisément le jeune homme qui pouvait la mériter et lui inspirer de l’attachement.
Après avoir dansé ensemble à un certain nombre de bals, les jeunes gens justifièrent ces opinions ; et avec la réserve convenable pour l’absence de sir Thomas, un engagement fut pris entre les deux familles, à leur satisfaction mutuelle et à celle de tout le voisinage, qui depuis plusieurs semaines avait décidé que M. Rushworth devait épouser miss Bertram.
Il fallait un délai de quelques mois avant que le consentement de sir Thomas pût être reçu ; mais comme on ne doutait point qu’il ne fût charmé de cette union, les deux familles se fréquentèrent habituellement, et la seule mesure de mystère qui fut adoptée, fut que madame Norris dirait partout que c’était une affaire dont il ne fallait pas parler pour le présent.
Edmond était le seul de la famille qui ne vît pas favorablement ce mariage. Toutes les représentations de sa tante ne pouvaient lui faire trouver dans M. Rushworth une liaison à rechercher. Il ne pouvait nier que sa sœur ne dût mieux juger que personne de son propre bonheur ; mais il aurait désiré qu’elle ne l’eût point basé sur un grand revenu ; et il disait souvent de M. Rushworth : « Si ce jeune homme n’avait pas douze mille livres sterlings de rente, ce serait un très-stupide garçon. »
Sir Thomas toutefois fut très-satisfait d’une alliance si avantageuse, et dont il n’entendait dire que des choses agréables. Il envoya son consentement aussi promptement que possible. La seule condition qu’il y mit, fut que le mariage ne serait célébré qu’à son retour en Angleterre, qui devait avoir lieu incessamment. Il écrivait en avril, et il avait l’espoir de terminer heureusement toutes ses affaires à Antigoa avant la fin de l’été.
Telle était la situation des choses à Mansfield, au mois de juillet ; et Fanny venait d’atteindre sa dix-huitième année, lorsque la société du village fut augmentée de deux personnes : le frère et la sœur de madame Grant, monsieur et miss Crawford, enfans de la mère de madame Grant par un second mariage. Ils étaient jeunes l’un et l’autre et fort riches. Le fils avait une belle propriété dans le comté de Norfolk, la fille avait vingt mille livres sterling. Madame Grant les avait aimés tendrement dans leur enfance ; mais comme peu de temps après son mariage, leur mère commune était morte, et qu’ils avaient été confiés alors à un frère de leur père, elle les avait à peine vus depuis cette époque. Ils avaient trouvé une agréable maison dans celle de leur oncle, nommé l’amiral Crawford. L’amiral aimait vivement son neveu, et sa femme avait la même amitié pour sa nièce ; mais madame Crawford étant venue à mourir, sa protégée fut obligée d’aller habiter une autre maison. L’amiral Crawford était un homme d’une conduite peu régulière, qui, au lieu de chercher à retenir sa nièce, fut bien aise qu’elle s’éloignât, pour qu’il pût loger sa maîtresse dans sa propre maison. Ce fut à cela que madame Grant dut la demande que lui fit sa sœur de venir demeurer avec elle, demande qui fut aussi bien accueillie d’un côté qu’elle était pressante de l’autre. Madame Grant n’avait point d’enfans, et éprouvait le besoin d’avoir un peu de variété dans son genre de vivre. L’arrivée d’une sœur qu’elle avait toujours aimée, lui fut donc très-agréable ; sa seule crainte était que Mansfield ne parut un peu triste à une jeune personne accoutumée aux plaisirs de Londres.
Miss Crawford partageait un peu cette appréhension, et ce n’avait été qu’après avoir essayé vainement de persuader à son frère d’habiter avec elle sa maison de campagne, qu’elle s’était résolue à venir chez sa sœur. Henri Crawford avait une aversion insurmontable pour tout domicile fixe, et toute restriction de société. Il ne pouvait satisfaire sa sœur sur un point de cette importance ; mais il l’accompagna avec la plus grande complaisance dans le comté de Northampton, et s’engagea à être à ses ordres aussitôt quelle lui écrirait qu’elle se déplairait dans cette nouvelle situation.
Le premier abord fut satisfaisant réciproquement. Miss Crawford trouva une sœur tendre, sans affectation ; un beau-frère qui avait tout l’air d’un gentleman, et une maison commode et bien tenue. Madame Grant reçut dans ceux qu’elle espérait aimer mieux que jamais, un jeune homme et une jeune personne de l’apparence la plus avantageuse. Marie Crawford était très-jolie ; Henri, sans avoir de la beauté, avait un air noble et agréable. Leurs manières étaient vives et enjouées, et madame Grant les jugea immédiatement propres à réussir par-tout. Elle était charmée de les voir l’un et l’autre ; mais Marie était sa favorite. N’ayant jamais été dans le cas de se glorifier de sa propre beauté, elle était enchantée de pouvoir tirer vanité de celle de sa sœur. Elle n’avait pas attendue qu’elle fût arrivée pour penser à lui faire former un mariage convenable, et ses vues s’étaient fixées sur Thomas Bertram. Le fils aîné d’un baronet n’était pas un parti trop avantageux pour une jeune personne ayant vingt mille livres sterling, avec toutes les grâces et l’élégance que madame Grant apercevait en elle ; et comme madame Grant s’épanchait facilement, Marie avait à peine passé trois heures auprès d’elle, qu’elle lui fit part de tous ses plans.
Miss Crawford fut charmée de trouver une famille de cette importance dans son voisinage, et ne fut nullement fâchée du projet de sa sœur et du choix qu’elle avait fait. Le mariage était son objet, pourvu qu’il fût avantageux ; et comme elle avait vu M. Bertram à Londres, elle ne trouvait pas plus d’objection à faire sur sa personne que sur le rang qu’il avait dans la société. En conséquence, tout en ayant l’air d’en plaisanter, elle y pensa sérieusement. Le plan fut bientôt répété à Henri.
« Et maintenant, ajouta madame Grant, j’ai pensé à compléter entièrement cette affaire. Je voudrais vous fixer tous les deux dans ce pays ; c’est pourquoi, Henri, il faut que vous épousiez la plus jeune des demoiselles Bertram ; une jeune fille innocente, belle, d’un aimable caractère, qui vous rendra très-heureux. »
Henri s’inclina et la remercia.
« Ma chère sœur, dit Marie, si vous pouvez persuader à Henri de se marier, il faut que vous ayiez l’adresse d’une française. Tout ce que l’habileté anglaise a pu faire y a échoué. Trois de mes intimes amies se sont consumées d’amour pour lui successivement. Toutes les peines que l’on a prises pour lui persuader de se courber sous le joug du mariage sont inconcevables ; c’est le plus inconstant papillon que l’on puisse imaginer. Si les demoiselles Bertram ne veulent pas avoir le cœur tourmenté, il faut qu’elles évitent Henri. »
« Mon frère, dit madame Grant, je ne veux pas croire cela de vous. »
« Et vous avez bien raison, répondit Crawford. Vous aurez plus d’indulgence que Marie. Je suis défiant, et ne veux pas risquer mon bonheur dans un moment de précipitation. Personne n’a une plus haute idée du mariage que moi, et je crois qu’un poëte a eu raison de le nommer le dernier don du ciel. »
« Voyez-vous comme, il sourit en parlant ainsi, dit miss Crawford. Je vous assure qu’il est détestable. Les leçons de l’amiral l’ont tout à fait perdu. »
« Je crois dit madame Grant, que lorsque les jeunes gens montrent peu d’inclination pour le mariage, c’est qu’ils n’ont pas encore rencontré l’objet qu’ils doivent aimer. »
Le docteur Grant félicita en riant miss Crawford de ses sentimens.
« Je n’en suis point honteuse, dit miss Crawford ; je voudrais que chacun se mariât quand on trouve à s’unir convenablement. Je n’aime point que l’on se marie sans y réfléchir ; mais aussitôt qu’on le peut faire avec avantage, il ne faut pas en laisser échapper l’occasion. »




![Emma (Centaur Classics) [The 100 greatest novels of all time - #38] - Jane Austen. - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/ba91eea69a27a8fd52d9e1952c7c4a74/w200_u90.jpg)