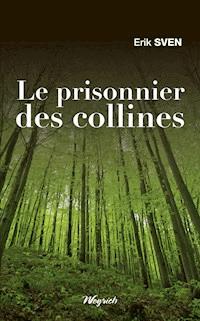
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Weyrich
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Romance en plein cœur de l'Ardenne belge, là où la Nature est plus que jamais reine
Ce matin-là, le vieux Jean Mélaize se réveille avec le sentiment qu'une ère nouvelle se présente à lui. Une chance unique lui est offerte, et il ne peut la rater. Profitant du dégel de ce mois de février 2001, il décide d'aller se promener aux alentours de son village de la vallée de la Semois. Il désire revoir la forêt, la rivière, et pourquoi pas grimper jusqu'à la Table des Sorcières ? Sa voisine Marie-Laure tente de l'en dissuader : après tout, il n'a plus la vigueur de la jeunesse...
Soixante ans auparavant, adolescents, ils ont exploré les collines alentour, les ont habitées, possédées. Ensemble, ils y ont vécu des joies, des peines, de l'amitié... De l’amour aussi ? Pourquoi sont-ils voisins alors que tout semble les unir ? Parcourant les sentiers de leur mémoire, le vieux se souvient du jeune Jean, de son histoire, de ses regrets.
Restée chez elle, Marie-Laure attend son retour avec le même pressentiment : aujourd'hui, quelque chose de différent va se produire. Le passé ne leur appartient plus, mais est-il trop tard pour profiter du présent ?
Dans ce roman plein de mystère, Erik Sven invite le lecteur à suivre les pas de personnages aussi riches et énigmatiques que les paysages de l’Ardenne.
A PROPOS DE L'AUTEUR
Né en 1971,
Erik Sven s'est inspiré de sa région natale des Ardennes pour écrire son premier roman. En parallèle de son travail d'auteur, il assure également des traductions vers le néerlandais et est fortement engagé dans diverses associations.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 231
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
À Marie-Louise C.-P.
Avertissement préalable
Certains lieux mentionnés dans ce roman existent bel et bien et sont nommés par leur vrai nom. D’autres se situent à mi-chemin entre la réalité et l’imaginaire. C’est ainsi que l’amoureux de l’Ardenne et de la vallée de la Semois pourra penser reconnaître l’un ou l’autre village, l’une ou l’autre rue. En même temps, il aura l’impression que vient s’y mêler une autre réalité – celle d’un lieu proche ou plus lointain. C’est que l’Ardenne, terre de mystères, a le don d’éveiller l’imagination…
Toute ressemblance avec des villes, villages et lieux-dits existants n’est donc pas fortuite.
I
Dans ses derniers rêves, le vieux Jean Mélaize fut déjà sensible au changement que la nuit avait apporté. Un vent de tempête avait balayé la bruine verglaçante de la veille, venue elle-même libérer les collines d’une longue période de gel. Sous les combles, ce fut un remue-ménage de craquements et de crépitements, comme si les poutres s’excitaient au souvenir de la sève qui les avait, un jour, animées. Malgré sa résistance, le cœur de la maison finit lui aussi par se dégeler. C’est à ce moment que Jean se réveilla, plus tôt que d’habitude. Le clocher sonna sept heures.
Le vieil homme ne se leva pas tout de suite. Il se plaisait à écouter les bourrades du vent contre les carreaux, qui tremblotaient dans leurs châssis depuis longtemps négligés. Avec un certain étonnement, il constata que l’agitation du monde ne lui causait aucun trouble. Au contraire… Autant il avait aimé l’hibernation des derniers mois, autant il jouissait maintenant de l’avènement de cette journée qui, pour une raison qu’il ne pouvait encore déceler, se présentait à lui comme une ère nouvelle.
Une ère nouvelle à septante-huit ans… Jean Mélaize ne put réprimer un sourire. Ce sourire – son premier geste de la journée – le ramena à ses rêves de la nuit. À des images, des paroles, des émotions aussi, qu’il avait cru enfouies, mais qu’il avait laissé resurgir sans éprouver la moindre crainte. Comme si, après tant d’années, une chance unique s’offrait à lui. Une chance à ne pas rater.
Soudain, il eut hâte de se lever.
En bas, Jean trouva la maison encore plongée dans l’obscurité. Dans le poêle à bois, le feu s’était éteint et, malgré le redoux, le fond de l’air était resté frisquet.
Que faire ?
Raviver la chaleur qu’il était parvenu à faire régner, hier, au fil d’une journée de dévouement au feu ? Ou renoncer à cette coutume hivernale pour se joindre à l’enthousiasme printanier ? Pendant quelques instants, Jean demeura figé dans son irrésolution. Ce furent le bourdonnement d’un moteur et une lueur orangeâtre qui le décidèrent à tâter d’abord les événements extérieurs.
Dès que Jean ouvrit la porte, des flots d’air pétillants inondèrent la maison. Dans la pâleur matinale, des nuages sombres tentaient de garder à l’écart un soleil qui guettait sa chance. Si Jean avait toujours été sensible aux humeurs du temps, cette foisci, il en fut particulièrement touché.
— Bizarre, se dit-il.
Était-ce dû au contraste avec la somnolence de la période écoulée ? Ou à la fragilité qu’il crut détecter, malgré tout, dans ce réveil précoce de la saison vive ? Une fragilité mise en exergue par le halo du gyrophare sur la camionnette stationnée non loin de là, le moteur ronflant. Des ouvriers communaux venaient enlever les barrières Nadar placées la veille pour interdire aux voitures l’accès à la rue, transformée en patinoire par le verglas. Ayant toujours habité cette rue – la plus courte et la plus pentue à relier la rue Haute et la rue Basse du village – Jean s’était accoutumé à ces périodes de cantonnement hivernal. Mieux encore, il avait fini par les apprécier, car, enneigée, la rue se transformait en un îlot d’immobilité en plein cœur du village. Il y régnait alors une sérénité que seuls ponctuaient les cris égayés des enfants : la pente se prêtait à merveille aux descentes en luge.
Hier, avec le verglas, la rue était restée déserte. Fermée sur elle-même, elle avait été abandonnée à son sort. Non seulement par les voitures et les enfants, mais aussi par sa poignée d’habitants : Jean n’avait osé s’aventurer à l’extérieur, pas plus que sa voisine Marie-Laure, qui, en charge de son mari alité, avait assumé sans grogner cette assignation à résidence. Tout au plus avaient-ils échangé quelques paroles le matin, dressant, chacun depuis le pas de sa porte, le constat de la situation. Après quoi ils s’étaient retranchés à l’intérieur : Jean, près du feu et de ses amis silencieux, les livres ; Marie-Laure, sans doute près du feu aussi et de Robert, rendu muet par une hémorragie cérébrale.
Leur rue ne comptait que quatre maisons, construites toutes du même côté. En bas, la cure formait l’angle avec la rue Basse et était pourvue d’un petit jardin arrière qui montait jusqu’à un pâté de maisons. Celui-ci englobait d’abord la maison de Marie-Laure, puis celle de Jean et enfin une bâtisse plus volumineuse, qui, juste en face de l’église, formait l’angle avec la rue Haute du village.
C’est donc contre cette grosse maison abritant, jadis, une épicerie, que s’adossaient la maison de Jean et celle de Marie-Laure, tels deux blocs de rocher relégués au pied de la montagne après un éboulement. En face de chez eux, en contrebas de l’église, s’étendait le cimetière – espace emmuré à l’intérieur duquel s’alignaient des tombes parfois monumentales. Certaines l’étaient tellement que le cimetière ne passait pas inaperçu auprès des touristes. On pouvait les voir mener leurs prospections entre les pierres funèbres, comme à la recherche d’un edelweiss sur une falaise trop harcelée par le soleil pour être agréable. Du moins, c’est ce que Jean pensait. À ses yeux, le cimetière était dépourvu de l’indulgence que les morts sont en droit d’attendre. Marie-Laure semblait être du même avis.
— Ça manque de verdure, lui avait-elle confié encore tout récemment. Quand je pense que, bientôt, je me retrouverai là-bas, en plein soleil et sous les yeux des touristes, je me demande si je ne ferais pas mieux de me réserver un endroit en forêt. Au-dessus de la ferme de Gérardfontaine par exemple, sur la Table des Sorcières. Ça, oui, ce serait l’endroit idéal. Une belle vue, un coin à la fois dégagé et ombragé. Et très peu fréquenté. Là, je risquerais moins d’être foulée aux pieds. Et si ça m’arrivait, avait-elle ajouté après un instant de réflexion rêveuse, je suis sûre que je le serais par des pieds prudents, qui ne me feraient aucun mal.
Elle avait tenu ces propos en lui jetant un regard coquin. Un regard qui faisait presque oublier ses quatre-vingt un ans et qui avait troublé Jean. Celui-ci, toutefois, s’était rapidement ressaisi :
— Ne te tracasse pas, Marie-Laure, tu sais bien que je fais toujours attention avant de poser mes gros pieds quelque part. D’ailleurs, il y a longtemps que je n’ai plus poussé jusqu’à la Table des Sorcières. Peut-être ce printemps…
Il s’était tu. Trébuchant sur l’ambiguïté de sa réponse. Arrêté par la désagréable impression qu’il venait d’accepter une invitation malséante. Et quel sens donner à cette évocation de la mort, cet événement peut-être plus proche qu’ils ne le croyaient, que ni elle ni lui ne craignaient vraiment, mais qu’ils refusaient de voir comme une fatalité ? Pourtant, au fur et à mesure que leurs jours avançaient, ils ne pouvaient ignorer que le temps commençait à presser, qu’il devenait urgent d’éviter que leur histoire ne se termine en mineur. Mais comment provoquer le point d’orgue auquel ils aspiraient ? Marie-Laure n’avait-elle pas voulu aider son voisin à trouver, enfin, les paroles appropriées : celles qui jetteraient la lumière et qui débloqueraient tout ?
Ce jour-là, Jean ne les avait pas trouvées. Il s’était senti comme un de ces innombrables blocs de schiste qui parsèment la forêt ardennaise et que le soleil, aussi puissant qu’il soit, ne touchera jamais au cœur.
Les ouvriers communaux avaient fini d’enlever les barrières et la camionnette se mit en marche. Jean vit le chauffeur lui faire des signes d’adieu. Le vieil homme lui répondit d’un mouvement de bras. C’était le « fils Poncelet », comme tout le monde persistait à l’appeler : un colosse débonnaire, la cinquantaine bien sonnée et qui, dans la vie, n’aimait que sa moto. Au bout d’un long calvaire, son père – bûcheron notoire à son époque – lui avait trouvé un emploi auprès des services communaux. Au grand étonnement du village, que la démarche paternelle avait amusé, le « fils » s’en tirait tellement bien qu’il avait accédé rapidement au poste de contremaître.
Une fois effacés le bruit du moteur et les faisceaux lumineux du gyrophare, Jean reprit conscience de la présence du village. Sous un ciel de plus en plus clair mais toujours houleux, celui-ci paraissait retenir son souffle. Comme s’il attendait du vieil homme un geste délivrant. C’est peut-être pour cette raison que Jean ne rentra pas chez lui pour allumer le poêle, mais qu’il se libéra de la masse noire de sa maison. À côté, une lueur derrière les rideaux lui apprit que Marie-Laure, aussi, était déjà levée. Une odeur de café l’atteignit à travers la porte d’entrée – entrouverte comme pour le convier.
Après une dernière hésitation, Jean accepta l’invitation.
II
À l’intérieur, l’arôme de café se mêlait à une odeur de poêle tellement intense qu’on eût dit que la maison tout entière – les murs, les poutres, les meubles, voire les vêtements des habitants – sentait le jambon fumé. Jean adorait ce parfum complexe, qui l’accueillait également dans sa propre maison, mais, lui semblait-il, de façon plus discrète. Peut-être parce qu’il y manquait cette touche de tendresse que seule peut engendrer la présence d’un autre être humain. — Te voilà déjà réveillé aussi, lui sourit Marie-Laure. On était joliment coincés, hier. Je suis contente qu’il ne soit rien arrivé à Robert et que l’aide-soignante n’ait pas dû venir. Qu’est-ce qu’elle aurait patiné, la pauvre fille !
Elle se leva pour embrasser Jean. Elle y mit plus d’ardeur que d’habitude. Après tous les signes que cette journée lui avait déjà adressés, Jean eut l’impression que Marie-Laure, à son tour, nourrissait à son égard un espoir.
— Tu boiras bien un petit café avec nous ? demanda-t-elle en se dégageant. Il est prêt et il sent bon. Attends, je vais le chercher.
Comme elle se rendait à la cuisine, Jean s’avança vers un coin de la pièce, près du poêle, où, dans la semi-obscurité, se dessinaient les contours d’un canapé-lit.
— Ça va, Robert ? dit-il à la silhouette qui s’y trouvait allongée. On dirait que l’hiver a plié bagage. Bientôt, les beaux jours vont revenir et on va pouvoir s’installer à l’extérieur.
Jean alluma une lampe d’ambiance. Depuis la table de salon reconvertie en table de nuit, elle diffusa une lueur indécise. Refusant d’un regard presque suppliant toute aide, Robert se mit debout. Une fois cette manœuvre accomplie, il scruta la pièce, comme s’il la découvrait pour la première fois. Jean baissa les yeux.
— Et si on laissait entrer le soleil ? s’informa Marie-Laure auprès des deux hommes.
Elle était revenue avec la cafetière et trois tasses disposées soigneusement sur un plateau en bois, qui conservait encore les traces d’un dessin décoratif.
— Tout, ici, est usé et décrépit, se dit Jean, sans que cela ne l’assombrît particulièrement : les objets, la maison, les gens – même moi, je n’ai pas retrouvé ma vigueur d’avant l’hiver.
Il dut toutefois nuancer ce constat, ne fût-ce qu’en raison du calendrier flambant neuf, accroché au mur à côté du poste de télévision et affichant fièrement « février 2001 ». Le deuxième mois, déjà, d’une année nouvelle, d’un siècle nouveau et, peut-être, d’une ère nouvelle. Il y avait aussi Marie-Laure qui, d’un geste doux mais résolu, ouvrait un à un les rideaux. Malgré la mainmise des années, sa voisine avait pu conserver l’agilité qui avait marqué sa jeunesse. Une agilité mystérieuse, qui avait bouleversé Jean dès le premier jour et qui, dans cette contrée refermée sur elle-même, fascinait autant qu’elle rendait suspect.
— Aujourd’hui, je ferais bien ma première promenade de l’année, décida-t-il.
La gravité de sa propre voix le surprit. C’était la voix d’un homme qui, après mûre réflexion, venait de prendre une décision lourde de conséquences.
Il crut lire la même surprise dans les yeux de Marie-Laure et de Robert.
— J’ai besoin d’air, se justifia-t-il un peu trop hâtivement. L’hiver a été long. Je veux voir si les forêts sont toujours là – et la Semois. Question de faire le point…
— Tu crois vraiment que ce soit une bonne idée, Jean ? N’oublie pas que si tu descends jusqu’à la Semois, il faudra remonter la pente par la suite. En seras-tu capable ? Ça fait au moins quatre mois que tu es cloué chez toi. Attends plutôt que le temps se stabilise et qu’il fasse moins humide. Il se présentera encore d’autres occasions.
Il se présentera encore d’autres occasions.
Jean encaissa le coup sans sourciller. Ce ne fut qu’au bout de quelques instants qu’il en éprouva l’effet. Comme une bombe à fragmentation. Sa première impulsion fut de se lever et de rentrer chez lui, de fuir le lieu du danger. Mais une pointe de douleur l’en empêcha violemment. Sans bouger d’un pouce, Marie-Laure et Robert s’éloignèrent et Jean se retrouva seul. Cloîtré dans une bulle de silence, isolé du monde qui ne semblait avoir reculé que pour mieux sauter et lui adresser avec plus de vigueur encore son verdict. Un verdict qu’il connaissait depuis longtemps, mais que Marie-Laure, sans penser à mal, venait de réitérer : il se présentera encore d’autres occasions.
— Hé, ho ! Jean, qu’est-ce qui te prend ? Ne fais pas cette tête-là ! Tu te sens bien ?
La voix de Marie-Laure déferla sur lui avec la violence d’un raz-de-marée.
— Non… Oui, ça va. Je réfléchissais.
Elle le dévisagea, cherchant à capter son regard et à le ramener auprès d’elle et de Robert.
— Eh bien, tant mieux si ce n’était que ça, soupira-t-elle.
Et puis, d’un ton plus gai :
— N’empêche que tu m’as fait peur. Ma foi, pendant un moment tu as eu les yeux presque aussi noirs que mon café !
À cette remarque, Jean se détendit. Ils restèrent encore un certain temps sans parler, jusqu’à ce que Marie-Laure, à grandes gorgées, vide sa tasse et se lève.
— Tu as déjà chauffé ta maison, Jean ?
Jean fit non de la tête.
— Écoute, pendant que tu réfléchis si tu fais ta promenade, je m’en occuperai. Entre-temps, tu pourras prendre le petit-déjeuner chez moi, avec Robert, car je parie que tu n’as pas encore mangé. Tu trouveras des tartines à la cuisine.
Depuis le pas de la porte, elle ajouta :
— Elles sont toutes préparées depuis ce matin, pour Robert et pour toi. Je t’en ai mis trois comme tu les aimes bien. Deux au fromage et une à la gelée de groseilles.
Elle ferma la porte et, à travers les carreaux, Jean la vit s’en aller d’un pas décidé. Le vent s’en prenait joyeusement à ses cheveux mi-longs, d’un blanc cristallin.
Jean se rendit à la cuisine, où l’attendait un petit-déjeuner simple, trop coutumier pour réserver encore des surprises, mais préparé avec une délicatesse presque maternelle qui aurait dû l’attendrir. Il n’en fut rien. S’il se sentait remis des secousses qu’il venait d’éprouver, son trouble n’avait pas disparu pour autant. Il saisit le plateau avec les tartines, mais ne trouva pas le courage de retourner auprès de Robert.
— Qu’est-ce qu’elle est déroutante aujourd’hui… fut tout ce qu’il arriva à grommeler.
Au salon, Robert semblait l’attendre. Cela faisait deux ans maintenant que les hommes se côtoyaient sans échanger la moindre parole. Cette fois-ci, le silence leur pesait. Comme s’il ne s’agissait plus d’un simple décor auquel ils s’étaient accommodés tant bien que mal, mais d’un venin qui s’était infiltré dans leurs veines. Fallait-il y voir l’échec de leur complicité – une complicité presque légendaire au village qui, tout à coup, s’avérait aussi caduque qu’un château de cartes ? Ou ne vivaient-ils qu’un trouble passager, privés qu’ils étaient de la présence de Marie-Laure qui, par des gestes en apparence anodins, par des mots prononcés avec parcimonie mais avec sagesse, et par des regards qui en disaient plus qu’un roman, avait toujours réussi à établir entre les deux hommes (qu’elle appelait parfois mes deux hommes) une atmosphère d’entente et de respect mutuel dont on eût pu s’étonner ?
Ce fut bel et bien Marie-Laure qui vint les arracher à la toile de suspicion qui les avait surpris comme des insectes trahis par leur insouciance.
— Ça y est ! annonça-t-elle, feignant ne pas s’apercevoir de leur morosité. Ton feu est parti, Jean. Et, à mon avis, pour de bon…
Elle hésita quelques secondes, ruminant la question qui lui brûlait les lèvres.
— Et toi ? Tu pars aussi ou tu as changé d’avis ?
Comme pour se préparer au choc, elle prit un air dépité. On aurait dit une petite fille dans l’attente d’une punition qu’elle juge ne pas avoir méritée.
— Oui, je pars, répondit Jean. Merci pour le poêle.
Tu n’aurais pas dû…
Sa voix, enrouée, l’accompagna dehors.
— Jean !
Marie-Laure l’attrapa au moment où il s’apprêtait à entrer chez lui. Elle réussit à immobiliser son regard, mais sa victoire ne fut que de courte durée. Car Jean choisit la contre-attaque et Marie-Laure dut affronter deux yeux durs. Deux yeux qui la fixaient avec fureur et qui – elle en eut soudain la certitude – l’accusaient.
— D’accord, tu pars, se résigna-t-elle. Mais ne t’aventure pas du côté de la Semois. Je parie qu’elle est en crue. Et puis, c’est trop loin et trop accidenté par là. Reste sur le plateau, tu n’as pas encore la force d’affronter à nouveau les pentes.
— J’aimerais revoir la ferme de Gérardfontaine.
— Il n’y a plus rien à voir là-bas. Gérardfontaine, c’est fini. Tu sais bien que le passé ne nous appartient plus. Comme l’avenir d’ailleurs… Je t’en prie, Jean, au moins ne nous enlève pas le présent ! Tu comprends ce que je veux dire ?
La voix de Marie-Laure se heurta à un mur, se blessa, puis se brisa.
Pendant quelques instants, il n’y eut entre eux que le hurlement du vent. D’un mouvement lent, Jean se détourna de sa voisine et souleva le loquet pour entrer chez lui.
— Il faut que j’y aille.
Marie-Laure le saisit par le bras.
— Promets-moi au moins de passer nous voir ce soir.
— Je le promets, fit-il, d’un ton endurci par sa détermination.
— D’où la tient-il si soudainement ? se demanda-t-elle. Et pourquoi maintenant, alors qu’il a passé sa vie à hésiter ?
Un sentiment d’amertume, tellement intense qu’il devait l’habiter depuis longtemps, l’inonda. Mais sa tendresse résista et Marie-Laure tira Jean vers elle.
— Tu me fais peur. Je t’en supplie : rassure-moi ! Serre-moi !
Il la serra fort.
III
Jean quitta le village avec entrain. Le vent s’était mué en une brise folâtre qui enthousiasma le vieil homme et dissipa l’angoisse que lui avait laissée son malaise du matin. Il se sentait même léger, rassuré par la résolution qu’il avait prise et qui le conduisait, à pas sûrs et réguliers, vers les contrées de sa jeunesse. Cette perspective conférait à son départ une certaine solennité. Comme s’il entreprenait un voyage depuis longtemps préparé et que tous les habitants du village (il les imaginait rassemblés derrière les fenêtres de leurs maisons, en train de l’épier) l’escortaient dans un silence à la fois inquiet et admiratif.
Ce sentiment d’avoir des dizaines d’yeux rivés sur lui, au risque de paraître vaniteux pour un homme de son âge, le remplit d’émotion. Car ne l’avait-il pas éprouvé mille fois dans sa vie depuis que, à peine âgé de dix ans, il avait pris l’habitude de parcourir les étendues boisées autour du village ? C’est dans cet univers revêche, où les touristes et les villageois n’allaient que pour leur balade dominicale le long des chemins battus, que Jean avait passé le plus clair de son existence.
Fils de l’instituteur du village, Jean avait toujours adopté un profil bas, tiraillé qu’il était entre le devoir de réserve qui assurait à son père son autorité devant la classe, et le souci de ne pas devenir, par ce fait même, la risée des autres élèves. Avec adresse, il avait navigué entre soumission et insubordination. Cette diplomatie lui avait valu le respect de tous. Du respect. Pas moins, mais peut-être pas davantage. Ses camarades de classe, enfants de fermiers et de bûcherons pour la plupart, l’acceptaient dans sa singularité. Ils s’abstenaient de toute remarque inconvenante lorsqu’il daignait se joindre à leurs jeux, et se gardaient de toute médisance les jours où, comme un ermite en devenir, il s’isolait pour se plonger dans un livre ou – chose étrange pour un garçon « bien élevé » – dans la forêt. Aux yeux des adultes, Jean était avant tout un enfant tranquille, bien moins accaparant que la moyenne des enfants. On l’eût même trouvé attachant, s’il n’avait pas été si insondable, si peu enclin à capter les rayons de chaleur qu’on émettait dans sa direction.
Toutefois, comme Jean ne dérangeait personne, on lui pardonnait volontiers des excentricités qui auraient valu à des âmes moins conciliantes un rejet sans merci. Dans toute leur bizarrerie, ses escapades forestières allaient même jusqu’à susciter de l’admiration chez les villageois. Aujourd’hui encore, à la vue du vieux Jean quittant le village, quelques-uns s’en souvenaient comme si c’était hier : le petit Jean, muni d’un bâton et d’un havresac, marchant d’un pas décidé vers un horizon que l’on ne pouvait que deviner. Rares étaient, en effet, les bûcherons ou autres forestiers qui avaient croisé son chemin. On eût dit qu’il se cachait… Mais personne ne s’inquiétait ni même ne critiquait la permissivité de ses parents pourtant obligés à jouer un rôle d’exemple. C’est que Jean bénéficiait d’un consensus silencieux, du sentiment collectif qu’il était à l’abri de l’infortune, qu’en « brave garçon », il ne faisait que suivre sa nature profonde et qu’il devait donc en être ainsi.
— Il a sûrement un ange gardien, disait l’un.
— Peut-être la fée de Gérardfontaine, suggérait l’autre.
— Pourvu qu’il ne succombe pas à la chimère de la Table des Sorcières, ajoutait un troisième, sans cependant y croire.
Ensuite, tous se taisaient. À quoi bon poursuivre la conversation, s’il était clair comme de l’eau de roche que le Petit s’en sortirait ? Aussi, une fois que Jean avait disparu de la vue, les rideaux se refermaient-ils et la vie au village reprenait-elle son cours.
Sur ce plan non plus, rien n’avait changé en près de septante ans.
Le vieux Jean Mélaize, ce matin, emprunta la rue qui quittait le village vers le nord. Elle ne menait pas vers un bourg voisin, mais se transformait en une petite route goudronnée qui, sans but apparent, faisait le tour du plateau et des champs pour rejoindre le village à l’état de chemin cahoteux. La seule issue du village à ne mener nulle part…
Évidemment, Jean pouvait s’écarter de ce curieux tracé circulaire – que les villageois appelaient « La Boucle des Champs » – et descendre jusqu’aux bords de la Semois par un des chemins dont il connaissait chaque virage, chaque inégalité. Mais cette possibilité ne lui offrait pas non plus d’issue réelle, car peu de ces chemins le mèneraient vers un endroit habité. Plutôt que d’ouvrir ses bras à l’Homme, la Semois a choisi la solitude. Avec patience, elle a entaillé le plateau de schiste. Ravissante mais hermétique, sa vallée forme, à son tour, l’artère d’un dédale de vallons les uns plus densément boisés que les autres, si bien que terre, végétation et ciel s’y agglutinent en une substance tellement opaque qu’il faut une bonne dose de hardiesse pour y mettre le pied.
De la hardiesse, Jean en possédait. Seulement : avait-il encore le cœur – et le corps – à affronter la Semois et Gérardfontaine ? Les implorations de Marie-Laure lui traversèrent l’esprit, mais ne ralentirent point le rythme de ses pas. Il aviserait plus tard, une fois arrivé au pied du Chêne de la Vierge. Depuis cet arbre séculaire dont la silhouette dominait le village, partaient, vers la gauche le chemin de Gérardfontaine, vers la droite la Boucle des Champs.
Environ quatre cents mètres séparaient le centre du village de ce lieu vénérable et décisif. Quatre cents mètres que Jean avait parcourus des milliers de fois et qui semblaient s’être raccourcis au fil du temps, à mesure que le village, auparavant lové dans un creux du plateau, s’était développé en remontant les pentes. Jadis, seules quelques fermes avaient jalonné cette rue, cédant rapidement la place aux pâturages. Maintenant, les tentacules du village s’apprêtaient à déborder du vallon et à engloutir le chêne solitaire. Contrairement à son habitude, Jean Mélaize ne maugréa pas lorsqu’il traversa ce no man’s land, ni village ni campagne, parsemé de nouvelles constructions dont certaines, érigées hâtivement en blocs de béton, attendaient avec résignation la couche de crépi qui les délivrerait de leur décrépitude précoce. C’est que le vieil homme avait hâte d’atteindre le sommet et de connaître la suite des événements.
Le Chêne de la Vierge le reçut avec hospitalité et l’invita à s’appuyer contre son tronc déjà chauffé par le soleil. Le dos tourné vers le village, une main posée sur la peau ridée de l’arbre, Jean prit le temps de contempler la croisée de chemins. Celui que l’on appelait la Boucle des Champs et qui menait plutôt vers l’est, lui présenta un ciel encore tourmenté par la tempête de la nuit. Le chemin de Gérardfontaine, qui s’échappait vers l’ouest, attira son regard vers la vallée, où un air printanier venait de chasser la plupart des nuages. Jean comprit qu’il n’avait pas le choix. Il lui suffisait de se détacher du chêne pour sentir ses pas le conduire vers l’ouest. Vers la Semois. Vers Gérardfontaine.
Rêveuse ce jour-là, la forêt ne se montra guère troublée par le jeune garçon, un enfant encore, qui la pénétra. Il emprunta le chemin de Gérardfontaine qui, après avoir dessiné trois courbes dans les prairies scintillantes, s’enfonçait dans une vallée étroite et ombrée. Là, sous un fourré de broussailles, suintait un ruisselet fraîchement éclos, dont le clapotis se distinguait à peine du bruissement des feuilles. Ce n’est qu’au bout d’un kilomètre, après s’être alimenté d’une demi-douzaine d’autres rus, que le ruisselet prenait suffisamment d’envergure pour parler d’une voix propre. Une voix au timbre varié, selon que les eaux se lançaient dans les rapides ou s’alanguissaient dans les endroits à plus faible dénivelé.
Jean connaissait les caprices du ruisseau, pour l’avoir côtoyé presque quotidiennement pendant les vacances qui venaient de s’écouler. Exceptionnellement ensoleillé, l’été lui avait paru comme un rêve sans fin. Un rêve rythmé de balades sous la houlette de ses parents, à travers un entremêlement de lumière, de feuillages, d’eau et de terre. Ce fut la première fois que Jean prit conscience de l’univers autour du village.
Il fut comblé.
Mais il lui fallut se retrouver dans la classe orchestrée par son père pour saisir l’ampleur de sa découverte. Son appétit d’apprendre et de s’instruire lui laissait un vide qu’il mit plusieurs jours à identifier. Finalement, Jean confronta ses parents à une demande particulière pour un garçon de dix ans : il souhaitait poursuivre l’exploration de la forêt. En solitaire.
Sa voix, en posant la question, avait eu quelque chose de décidé et de fatal à la fois, comme si elle n’exprimait pas une volonté, mais une vocation. Voilà sans doute pourquoi l’autorisation de ses parents fut si immédiate, accompagnée toutefois de la triple recommandation d’être prudent, d’éviter les endroits où œuvraient les bûcherons et de ne pas déranger les habitants de la ferme de Gérardfontaine…
Mais comment ne pas être attiré par Gérardfontaine ?





























