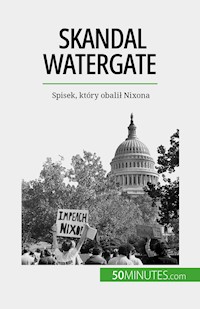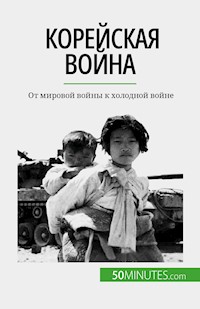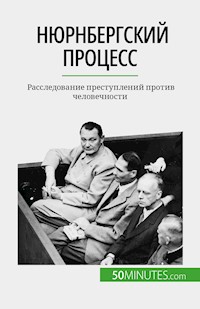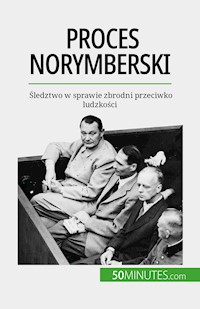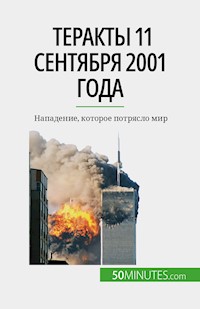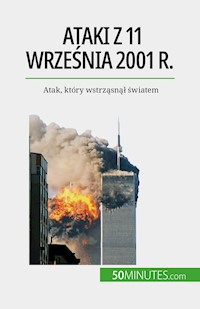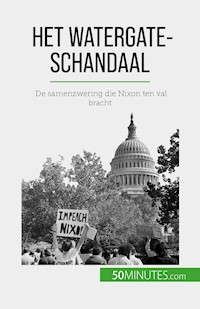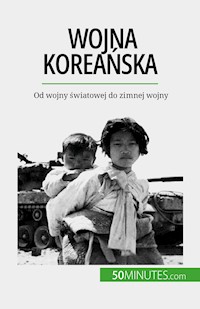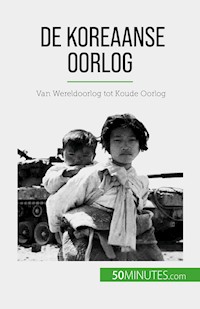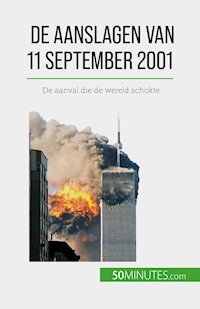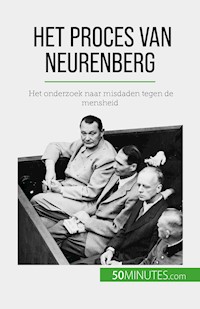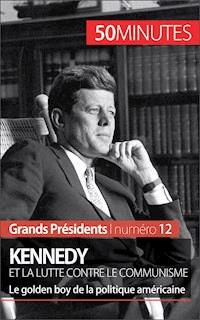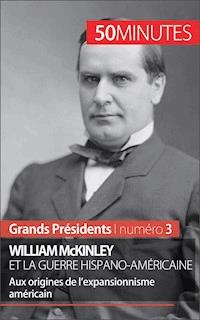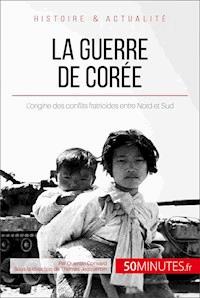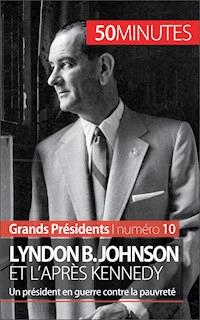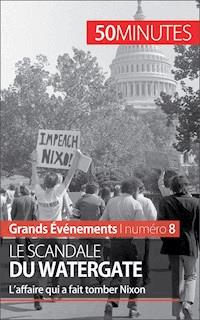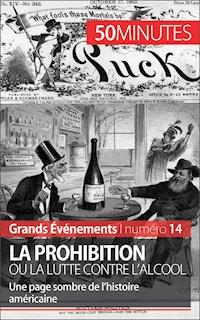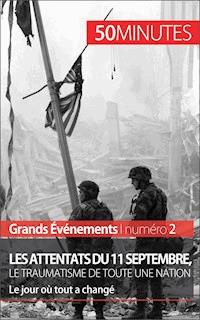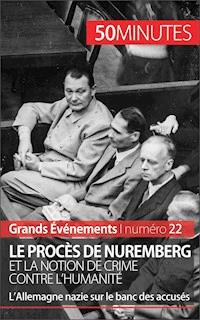
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: 50Minutes.fr
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Grands Événements
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Découvrez enfin tout ce qu’il faut savoir sur le procès de Nuremberg en moins d’une heure !
Novembre 1945. Un procès unique en son genre s’ouvre à Nuremberg. Son objectif ? Juger 24 dirigeants nazis et 8 organisations accusés de crimes contre la paix, de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité et de complots. Pendant dix mois, c’est une cascade de révélations qui laisse entrevoir la folie de l’Allemagne d’Adolf Hitler. Très médiatisé, le procès de Nuremberg devient une source d’inspiration pour les procès de dénazification qui suivent. Mais il s’agit également de la première mise en œuvre d’une juridiction pénale internationale.
Ce livre vous permettra d’en savoir plus sur :
• Le contexte de l’époque
• Les acteurs principaux
• Le déroulement du procès de Nuremberg
• Ses répercussions
Le mot de l’éditeur :
« Dans ce numéro de la collection « 50MINUTES|Grands Événements », Quentin Convard nous fait découvrir le procès de Nuremberg. S’il s’agit en premier lieu de voir l’Allemagne nazie condamnée pour ses agissements, ce procès rassemblant diverses nations marque également un tournant dans l’histoire du droit international. Non content de définir les responsabilités de chacun, le verdict pose également les premières définitions des notions de crime contre la paix, de crime contre l’humanité et de génocide. » Stéphanie Dagrain
À PROPOS DE LA SÉRIE 50MINUTES|Grands Événements
La série « Grands Événements » de la collection « 50MINUTES » aborde plus de cinquante faits qui ont bouleversé notre histoire. Chaque livre a été pensé pour les lecteurs curieux qui veulent tout savoir sur un sujet précis, tout en allant à l’essentiel, et ce en moins d’une heure. Nos auteurs combinent les faits, les analyses et les nouvelles perspectives pour rendre accessibles des siècles d’histoire.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 41
Ähnliche
LE PROCÈS DE NUREMBERG
Quand ? Du 20 novembre 1945 au 1er octobre 1946.
Où ? À Nuremberg (Allemagne).
Contexte ? La fin de la Seconde Guerre mondiale (1939-1945).
Protagonistes principaux ?
Geoffrey Lawrence, juge britannique (1880-1971).
Robert Jackson, juge à la Cour suprême des États-Unis (1892-1954).
Hermann Göring, maréchal du IIIe Reich (1893-1946).
Albert Speer, ministre de l’Armement du IIIe Reich (1905-1981).
Répercussions ?
La création de la Cour pénale internationale de justice.
La mise au point des définitions juridiques des notions de crime contre la paix, contre l’humanité et de génocide.
Alors que la Seconde Guerre mondiale fait toujours rage, les nations victimes des agissements d’Adolf Hitler (1889-1945), confrontées à l’horreur, souhaitent que les crimes perpétrés soient reconnus et jugés. Pour la première fois dans l’histoire, un tribunal militaire international est créé. Le procès qui se déroulera à Nuremberg est intenté contre 24 dirigeants nazis et huit organisations, tous accusés de complots, de crimes contre la paix, de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité. Entre le 20 novembre 1945 et le 1er octobre 1946, 401 audiences, au cours desquelles 94 témoins sont entendus et des milliers de preuves écrites analysées, viennent lever le voile sur les exactions nazies, permettant aux quatre juges titulaires, représentants des nations alliées (Grande-Bretagne, États-Unis, France et URSS), de rendre un verdict impartial.
Mais le procès de Nuremberg s’inscrit également dans un contexte plus large, celui de la juridiction pénale internationale. Il en constitue la première mise en œuvre et apporte de ce fait une nouvelle réflexion sur la manière de statuer après une guerre, ouvrant la voie à la création d’autres tribunaux internationaux. Le verdict permet également de définir juridiquement les notions de crime contre la paix, de crime contre l’humanité et de crime de génocide. La médiatisation des débats et les espoirs des peuples opprimés par l’Allemagne nazie font de ce procès un tournant majeur dans l’histoire juridique du XXe siècle.
CONTEXTE
COMMENT JUGER LA GUERRE ?
Depuis la seconde moitié du XIXe siècle, l’armement se perfectionne toujours davantage et l’armée de métier cohabite progressivement avec celle de conscription, rendant de plus en plus difficile la distinction entre le combattant et le civil. Afin de mieux réglementer la guerre et limiter les abus, le droit international tente de légiférer par des traités qui viennent rythmer l’histoire pénale de cette époque. La déclaration de Paris de 1856, réglementant le combat et le droit maritime, ainsi que la convention de Genève de 1864, visant à améliorer le sort des blessés sur les champs de bataille, vont dans ce sens. À celles-ci s’ajoutent deux textes fondamentaux : les conventions de La Haye de 1899 et de 1907 qui définissent les droits et les coutumes de la guerre sur terre, tout en insistant sur le désarmement et la prévention du conflit.
Mais la Première Guerre mondiale (1914-1948) et le recours au gaz asphyxiant, à la déportation des populations civiles et à la guerre sous-marine font voler en éclats toutes ces réglementations. Si aucun procès n’est intenté à la fin du conflit, une réflexion émerge toutefois pour déterminer les responsabilités de chaque nation. Le traité de Versailles de 1919 pointe du doigt Guillaume II (roi de Prusse et empereur d’Allemagne, 1859-1941), considéré comme étant responsable du déclenchement des hostilités suite à la violation de la neutralité de la Belgique et du Luxembourg. Le Premier ministre anglais, David Lloyd George (1863-1945), va même jusqu’à réclamer la pendaison du souverain germanique. Une demande d’extradition est d’ailleurs introduite auprès de la Hollande afin que celle-ci livre l’empereur pour qu’il puisse être jugé. En outre, un article du traité de Versailles oblige le Gouvernement allemand à livrer aux puissances alliées les personnes accusées d’avoir violé les règles de la guerre. Mais la Hollande refuse, et la requête du traité de Versailles n’aboutit pas. Cependant, le Tribunal du Reich, la plus haute instance juridique de l’Empire allemand, reçoit l’autorisation de juger les criminels de guerre. S’ouvrent alors les procès de Leipzig, qui occupent le tribunal de 1921 à 1922. Sur les 16 poursuites menées, une seule aboutit à une condamnation, celle du lieutenant Ludwig Dithmar, responsable du torpillage d’un navire hospitalier anglais, qui écope de quatre ans de prison. Mais face aux horreurs commises durant le conflit, les jugements sont perçus comme une gigantesque farce par les nations alliées.
LA CONDAMNATION DES CRIMES DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE
Pendant la période de l’entre-deux-guerres, différents traités sur le sujet sont approuvés, parmi lesquels on trouve l’idée de punir non plus seulement les États, mais également les personnes physiques agissant au cœur de ces États. Le procès de Nuremberg constitue d’ailleurs la première tentative d’une réponse internationale aux crimes commis par les hauts responsables nazis lors de la Seconde Guerre mondiale.