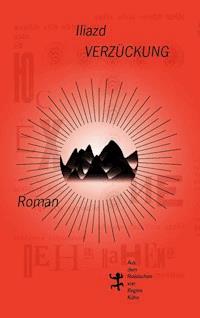6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ginkgo éditeur
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Lavrenti, le déserteur, le brigand meurtrier qui rôde dans les hautes vallées fait un jour dans un village perdu la rencontre d’Ivlita à la beauté surnaturelle, fille d’un ex-forestier. Il la ravit à son père, avant d’être entraîné par
le mystérieux Basilic dans la grande révolution politique que celui-ci prépare, loin en bas chez les « rampants »
des plaines.
Chant d’amour et de mort à la prose envoûtante, allégorie moderne et fable intemporelle à l’ombre des
glaciers et des neiges éternelles, ce récit aux accents baroques et fantastiques est le grand roman de la liberté
indomptable des montagnes.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
PETITE BIBLIOTHÈQUE SLAVE
— Collection dirigée par Xavier Mottez —
ILIAZD
Зданевич Илья Михайлович
1894-1975
LE RAVISSEMENT
Восхищение
1930
Traduction et préface de Régis Gayraud.
© Ginkgo Éditeur, 2021
© Régis Gayraud, 1987, 2021 (Édition revue et corrigée).
Couverture : Ilia ZANKOVSKI, La Route vers Gounib, 1894
PRÉFACE
« Tomber dans l’oubli est le meilleur sort du poète », écrivait Iliazd. Et, nous parlant des débuts du futurisme russe, dont il fut une des grandes figures, il commence par dire que le lieu, la date de sa naissance, sa véritable identité, ne nous regardent pas. Et d’affirmer que la vogue des notices biographiques accompagnant éditions ou expositions est née après la Seconde Guerre mondiale, dans le sillage de la généralisation des fiches de police et autres cartes indispensables à la bonne marche des États bureaucratiques modernes. Parler d’Iliazd n’est donc pas aisé. On ne peut le faire que soutenu par l’idée qu’un homme et une œuvre aussi exceptionnels ne peuvent prêter le flanc à ce qu’Iliazd nommait d’un de ces beaux mots russes dont il avait le secret : la khaltoura, le dilettantisme littéraire, la fraude, le cabotinage, l’arrivisme. Et puis aussi par l’idée qu’il ne faut pas trop attacher de crédibilité, en matière de célébrité, aux déclarations des créateurs.
De fait, il existe plusieurs Iliazd : il y a le poète d’avant-garde, le théoricien du futurisme et de la poésie abstraite qui fit connaître à Paris les résultats de quinze années de modernisme russe en s’adressant aux Dadas comme à de petits frères manquant d’imagination, il y a celui qui combattit le lettrisme dans les années cinquante et puis il y a surtout, pour les historiens d’art, le grand éditeur de livres d’artistes dont les bibliophiles s’accordent à dire que les productions sont parmi les plus extraordinaires que l’on ait jamais créées dans le domaine du livre, estimation certes justifiée, mais qui, surtout, permet de faire grimper les prix desdits ouvrages à des sommets stratosphériques. Cet éparpillement, avec son éloignement volontaire des courants artistiques et un certain silence qui cache une bonne dose de calcul sur l’avenir, contribue à créer le mythe d’Iliazd.
Quand il est connu, Iliazd l’est aujourd’hui surtout pour cette activité d’éditeur de livres précieux, tirés à peu d’exemplaires et illustrés par les plus grands noms de l’art moderne, Picasso, Miro, Ernst, Braque, etc., dont il était l’ami. En vérité, l’apparition d’Ilia Zdanevitch dans les tablettes de l’art moderne — le pseudonyme d’Iliazd date de 1922 — a lieu à Petrograd en 1912, quand le jeune homme, âgé de 18 ans à peine, monte à la tribune du théâtre Troïtski et déclame pour la première fois devant un public russe les manifestes futuristes de Marinetti. Le succès est immédiat. « Le lendemain, tous les groupements, les tendances, les écoles de jeunes sont devenus futuristes. Il ne manquait jusque-là qu’un mot-clé pour réunir tout ce monde en l’opposant à l’art du jour, je n’ai fait qu’apporter ce mot : le futurisme. » Dans l’extraordinaire bouillonnement qui anime les peintres et les poètes contre l’académisme du moment, Zdanevitch, introduit par son frère peintre Kirill, se retrouve vite au sein du groupe le plus radical de l’avant-garde, celui de Larionov et Gontcharova, dont il analysera peu après les œuvres dans ce qui reste encore la meilleure étude sur ces deux artistes. À la même époque (1913), il échafaude un nouveau critère artistique, le vsiotchestvo — souvent traduit par « toutisme », mais il ne s’agit pas d’une doctrine, et le mot russe lui-même ne contient pas le suffixe « isme » — développé et mis en pratique dans le domaine des arts plastiques par le peintre Mikhaïl Le-Dantu, et qui, en réalité, représente déjà un dépassement du futurisme.
Né dans le domaine de la peinture, le toutisme refuse le primat du moderne sur l’art, déclare toutes les formes esthétiques présentes ou passées égales et utilisables en même temps, tous genres artistiques confondus, car éternellement vivantes, à partir du moment où elles ne sont pas des représentations illusionnistes du réel, lesquelles sont le propre de l’académisme. Loin d’être un éclectisme qui accepterait tout sans discernement, le toutisme, en effet, détermine toute une série d’invariants formels qui procède de l’abstractisation des formes du réel, critères très élaborés par lesquels on juge de la valeur des œuvres. Ces invariants relient les arts « de civilisation », souvent taxés de primitifs, avec les différentes formes d’art populaire, naïf ou — comme on dirait aujourd’hui — d’art brut, considérées comme résurgences individuelles de l’esprit artistique qui souffle aux époques où l’art exprime l’inspiration profonde d’un peuple, ou une fonction sacrée ; art primitif grec, perse, byzantin, icônes, imagerie populaire russe et ukrainienne (loubok), inspireront les tableaux néoprimitivistes de Larionov, de Gontcharova ou de Chagall, pour ne citer que les plus connus. C’est ce regard toutiste qui va favoriser la découverte et la révélation au monde, par Le-Dantu et les frères Zdanevitch, en 1912, de l’œuvre de Niko Pirosmani, le « Douanier Rousseau » géorgien, peintre génial et vagabond allant de taverne en taverne et payant sa pitance en tableaux peints sur les toiles cirées des tables de bistrot. Gardons-le en mémoire, car l’imagerie primitive de Pirosmani se retrouvera bientôt dans les paysages et les personnages du Ravissement.
Le toutisme, on le voit, se place donc à l’opposé d’une certaine forme de futurisme « anecdotique » qui, mettant à bas tout l’héritage artistique, entendait chanter le monde mécanisé, et que, paradoxalement, Ilia Zdanevitch, un an plus tôt, contribuait à promouvoir.
En poésie, le toutisme regarde du côté des mythes grecs, des mystères médiévaux, des légendes et des contes populaires de tous pays. À la même époque, les poètes aveniriens Vélémir Khlebnikov et Alexis Kroutchenykh, insistant sur la puissance évocatrice des sons purs, s’intéressent à la glossolalie des sectes de flagellants ainsi qu’à la liturgie souvent inintelligible par les peuples mêmes qui la perpétuent, estiment que les mots du commun sont usés et en arrivent au langage zaoum — transrationnel — langage poétique formé de mots sans sens préétabli, « appel direct au peuple des sentiments » qui ne reste pour Khlebnikov qu’un « procédé de droit, applicable en de rares cas ».
Zdanevitch va développer le zaoum en un système poétique riche et original dans ses pièces de théâtre en un acte, les dra. Commencé à Petrograd, ce cycle correspond plutôt à la période où Zdanevitch, de retour à Tiflis, y fonde et anime entre 1918 et 1920 son Université du 41°, actif groupe artistique où se retrouve également Kroutchenykh1. Pendant que Kroutchenykh, armé des études récemment découvertes de Freud, collationne les lapsus que contiennent selon lui les œuvres des plus célèbres écrivains russes, cinq pièces se succèdent sous la plume de Zdanevitch, faisant évoluer des personnages bouffons ; leur héros est un âne qui figure l’inconscient de l’auteur, s’exprimant en un zaoum apparemment sans queue ni tête, de plus en plus dégagé de la phonétique russe, langage « dénué de sens » qui n’est pas tant « sans sens » que porteur de significations multiples et diffuses qui sont révélées, dans l’inconscient du spectateur, sous l’effet de la rencontre des sonorités pures et des références communes de la langue russe, soutenues par le jeu des acteurs. Cette polysémie permet la transmission simultanée de la représentation de plusieurs couches de conscience, renvoie elle-même au processus de formation de la pensée et, tout naturellement, le sujet des cinq pièces n’est autre qu’une approche voilée de l’évolution psychologique de l’homme, de l’enfance à l’âge adulte, l’évocation des symboles païens (idoles des Slaves) et judéo-chrétiens (Pâques) — vus sur le plan de leur signification sexuelle, permettant de dégager les liens enfouis tissés entre l’individu et le fonds inconscient commun à la civilisation entière. L’auteur érige le lapsus en outil poétique. Le langage d’outre-raison est un langage d’outre-tabou.
Le zaoum, parce qu’il permet, selon Zdanevitch, de s’adresser directement, par tout un jeu de corrélations, à un inconscient humain formé ou influencé par le souvenir des grandes structures culturelles communes à l’humanité est pour lui le matériau idéal de la poésie « toutiste ». Le zaoum, cette poésie du son sans signification donnée, mais potentiellement polysémique, lance des réseaux entre des unités culturelles différentes, parfois très éloignées. Il en résulte dans les pièces de théâtre écrite en zaoum une stratification entre plusieurs niveaux de corrélations — mythes, légendes, religions, cosmogonie, mais aussi littérature et même histoire de la Russie contemporaine... — que les sons de la langue sont censés réunir pour susciter chez l’auditeur la sensation d’une totalité psychologique mettant en relation l’individu et l’universel.
Arrivé en France à l’âge de vingt-sept ans en novembre 19212, Zdanevitch se lie à Dada, qui présente plus d’un point commun avec le 41°. Il cherche par un cycle de conférences en russe et en français à faire connaître ses expériences et son « université », refondée à Paris dès avril 1922, aux deux publics susceptibles d’être intéressés : celui des jeunes poètes et peintres russes de l’École de Paris et celui des dadaïstes. Ceux-ci l’ont généreusement adopté, mais, à l’exception de Georges Ribemont-Dessaignes, n’ont pas porté aux théories de celui qui se fait connaître maintenant comme Iliazd — la barrière linguistique n’aidant rien et eux-mêmes étant en crise — l’attention requise. En juin 1923, la soirée du Cœur à Barbe, conçue par Iliazd pour tenter de sauver Dada, précipite en fait la fin du mouvement. Iliazd passe aussi les années 1922-1926 à organiser de fastueux bals à Montparnasse sous l’égide de l’Union des artistes russes dont il est le secrétaire. Travaillant en 1925-1926 à la représentation soviétique en France, il oscille entre un compagnonnage critique et une opposition franche avec la nouvelle donne intellectuelle et artistique de l’URSS, opposition qu’il finira par manifester et qui lui vaudra son renvoi de l’ambassade. Il travaille ensuite comme dessinateur de tissus chez Chanel, une photographie nous le montre en dandy. En six ans, de 1924 à 1930, il écrit quatre romans. Un seul paraîtra : Le Ravissement.
*
Au mois d’avril 1930, à Paris, dans la vitrine de la librairie de Jacques Povolozky, rue Bonaparte, apparaît donc un volume d’apparence modeste dont la couverture jaune vert s’orne d’une curieuse vignette paraissant représenter une sorte de vase à compartiments, ou la coupe longitudinale d’un coquillage. Le livre, publié en russe à compte d’auteur, a comme titre Voskhichtchenie, un vocable russe que l’on peut traduire par « ravissement », mais aussi par « admiration », et qui comporte aussi l’idée de « capture » ou « d’enlèvement ». Le nom de la maison d’édition — 41° — relie clairement ce volume à l’activité passé de son auteur et notamment à Ledentu le Phare, son dernier livre en zaoum, paru en 1923 sous ce même label. Toutefois, par son aspect austère, clos, Le Ravissement, roman pastoral en seize chapitres de longueur plus ou moins égale, divisés en compacts paragraphes, tranche résolument avec la hardiesse de Ledentu le Phare, chef d’œuvre d’inventivité typographique, rattaché tantôt à Dada, tantôt au constructivisme, qui a fait en France la réputation d’Iliazd. Ici, à première vue, la seule innovation notable touche un détail de ponctuation : l’absence de point à la fin des paragraphes. Et le mot « roman », sur la couverture, semble dissuader toute tentative de le rattacher à une pratique d’avant-garde.
Le public du Ravissement est avant tout celui des émigrés russes de Paris, seuls aptes à déchiffrer cet ouvrage écrit en russe. Or quelques jours après la sortie de son livre, Iliazd fait ajouter autour de chaque exemplaire un bandeau avec cette formule : « Les libraires russes ont refusé de vendre ce livre. Si vous êtes aussi timorés, ne le lisez pas ! » En effet, hormis Povolozky — ami de Larionov et Gontcharova mais aussi de Tzara et de Picabia, et libraire spécialisé en livres russes mais aussi en ouvrages de toutes les avant-gardes parisiennes, qu’il éditait également —, tous les autres libraires russes (ils sont encore nombreux à Paris à l’époque) ont refusé le livre d’Iliazd « à cause d’une douzaine de mots jugés inimprimables », comme l’écrira l’auteur plus tard. Par une ironie cruelle, le jugement des libraires russes de Paris au nom des bonnes mœurs et de la religion rejoint dans son effet la censure opérée par les éditeurs soviétiques pour des raisons bien différentes, voire opposées.
Le roman est pour l’essentiel écrit en 1926 et 1927. À la fin de 1927, par l’entremise de son frère Kirill resté au pays, Iliazd en fait parvenir un tapuscrit à la rédaction de la revue soviétique Krasnaïa nov, alors orientée vers la prose des « compagnons de route », écrivains n’appartenant pas au parti mais soutenant globalement son idéologie. Après un premier accueil favorable (le roman doit être d’abord publié dans la revue, puis en édition séparée), au bout de deux mois, Kirill fait savoir à Ilia : « Le roman est très bon, mais on vient de fermer 40 maisons d’éditions et il sera plus difficile de le publier. » Ce qu’ignore alors Iliazd, c’est que Krasnaïa nov est en pleine restructuration idéologique. Son fondateur et directeur vient d’être limogé et sera bientôt arrêté pour trotskisme. Le refus officiel de la publication tombe en mai 1928 et Kirill propose cette fois le livre aux éditions Fédération, qui remplacent nombre des maisons fermées, dont celle de Krasnaïa nov. Nouveau refus. Les principaux reproches sont un certain mysticisme, une pose d’esthète indifférent au sort des personnages, l’absence de mentions de lieux et d’époques, une langue étrange, parfois même fautive. Iliazd répond. À l’accusation de mysticisme, il rétorque que le « ravissement » n’est pas un sentiment mystique, mais un sentiment qui préfigure et accompagne les révolutions. Il ajoute non sans malice qu’on ne peut pas accuser Gorki d’être un écrivain religieux parce que ses personnages prient. Il note que son opinion sur la société injuste qu’il décrit est claire, et que sa langue « hors de l’espace et du temps » est celle d’un internationaliste. « On m’a dit, écrit-il, que ma langue fait l’effet d’une traduction, c’est tant mieux. Mais dire qu’elle est incorrecte, c’est trop. »
Outre les mots inconvenants, c’est cette dose d’hermétisme, les termes précieux rarement utilisés en russe, les vocables oubliés, les combinaisons inattendues de mots de divers registres, que la plupart des lecteurs de ce livre, à l’époque, retiendront. Il faut relever comment Iliazd défend une fois encore la liberté de l’artiste. Il faut noter aussi qu’en parlant de langue « hors de l’espace et du temps », Iliazd reprend mot pour mot les termes qu’il employait en 1913 pour exposer la théorie du « toutisme », en s’opposant au futurisme par son refus d’associer à un sens téléologique une valeur artistique.
*
La grande affaire du Ravissement, c’est peut-être une fois encore la langue et aussi tous autres moyens d’expression : cris, soupirs, regards, gestes, etc., leur polysémie et les multiples interprétations qu’ils suscitent. Empilant les niveaux de langue, les significations, les résonances, l’auteur poursuit la recherche du zaoum par d’autres moyens. Le souvenir des recherches langagières du futurisme n’est d’ailleurs jamais loin non plus dans la fable du roman, et l’auteur nous le rappelle à de multiples reprises. Sans vouloir en faire un roman à clef, notons quand même que les aventures arrivées aux montagnards rappellent le sort du futurisme russe. Les héros ressemblent assez à ces poètes du front gauche de l’art qui étaient comme des déserteurs ouvrant tout grand les portes à tous les vents de la liberté, et dont les goitreux et les crétins chanteurs du hameau au nom imprononçable seraient les irréductibles partisans du zaoum. Au même hameau habitent aussi Ivlita et son père l’ancien garde-forestier, surnommé simplement l’ancien, rêveur et fantasque, dans une sorte de palais du Facteur Cheval en bois découpé. Sous les traits du père occupé à résoudre des problèmes insolubles et tenant des raisonnements paradoxaux, c’est peut-être Iliazd lui-même qui s’est représenté : dans ses souvenirs de Constantinople, ne dit-il pas que ses amis d’alors le surnommaient « l’Ancien » ? Sans doute est-il vain de chercher des correspondances exactes. Toutefois, l’histoire même de Lavrenti résonne assez clairement avec celle du plus célèbre futuriste russe : Vladimir Maïakovski. Maïakovski, jadis poète du Je, de la liberté, du désir, n’a-t-il pas trahi cette pureté du désir pour mettre sa plume au service du Nous et du militantisme révolutionnaire, et une femme au double jeu n’a-t-elle pas été pour beaucoup dans cette conversion où il va perdre son âme ? Pour ceux qui douteraient de l’identité de Lavrenti avec Maïakovski, Iliazd a semé quelques indices, associés à la symbolique des couleurs qui fait passer progressivement le décor du roman du blanc initial au rouge puis au brun. Lorsqu’il devient chef des bandits, pour symboliser ce pouvoir, Lavrenti revêt une chemise jaune. L’allusion est limpide : chacun, en 1930, sait que Maïakovski, dans sa jeunesse futuriste, montait sur scène habillé dans cette couleur alors jugée scandaleuse. Et la trahison d’Ivlita, qui va déclencher la déchéance de Lavrenti, baigne dans une lumière rouge de révolution.
Par ailleurs, Le Ravissement fourmille de réminiscences littéraires discrètes. Des parties entières du récit, des situations de l’intrigue, de simples détails glissés dans la narration évoquent plus ou moins directement des pages connues ou moins connues de la littérature russe. On pourrait en multiplier les exemples. Certes, dans le roman, terroristes et agents provocateurs sont issus de la vie politique russe du début du XXe siècle, dont Iliazd s’est inspiré comme il l’avait fait dans ses pièces zaoum. Mais leurs ombres hantaient déjà le Pétersbourg d’Andreï Biély. Tout le réalisme fantastique russe est aussi mis à contribution, de Gogol à Leskov, dont on retrouve le goût pour les personnages pittoresques et les écarts de langage. De Saltykov-Chtchedrine, Le Bon vieux temps de Pochekhonié a fourni toute une série de personnages et d’épisodes du début du roman. Plus loin, dans le couple de doubles Lavrenti-Martinian, il y a le souvenir des doubles Alekseï-David d’une nouvelle de Tourguéniev, La Montre, d’où provient aussi le nom de Martinian. Mais celui qui porte ce nom chez Tourguéniev est un vieillard aphasique qui vit avec sa fille, et préfigure donc plutôt le père d’Ivlita. La vie que mène Ivlita chez son père évoque celle que mène Tatiana dans Eugène Onéguine de Pouchkine ; la structure d’un passage entier du roman est un calque presque exact d’un passage du roman en vers de Pouchkine. Tout cela est le plus souvent quasi indécelable, mais l’accumulation de ces allusions baigne le lecteur cultivé dans la sensation que le roman s’ancre dans un inconscient culturel collectif qui façonne une réalité seconde.
Le roman d’Iliazd est plus encore lié à ceux de Dostoïevski, en particulier à Crime et châtiment, mais aussi aux Démons et à l’Idiot. Outre Tourguéniev, les doubles Lavrenti-Martinian évoquent évidemment Le Double de Dostoïevski. Mais c’est surtout le traitement biblique du sujet qui relie Le Ravissement aux œuvres de Dostoïevski. Tous les motifs bibliques dont l’usage apparente le roman à la technique narrative de Dostoïevski se cristallisent autour de Lavrenti, figure dostoïevskienne et christique par excellence. Toutes sortes de détails transposent des passages des Évangiles de la vallée du Jourdain à la vallée de haute montagne où se passe l’action du Ravissement. Outre cette ligne christique, une autre ligne, prophétique, et surtout apocalyptique, suit le chemin de Lavrenti sitôt que celui-ci cesse de tuer gratuitement et se met au service des révolutionnaires, culminant dans le seizième chapitre du roman, saturé de réminiscences de la vision de l’apôtre Jean. Dresser la liste des références bibliques nous conduirait bien au-delà de ce qu’on admet d’une préface.
Qu’ici se rejoignent la geste du Christ et de ses premiers disciples et celle des futuristes n’a d’ailleurs rien de fortuit : les futuristes ont souvent adopté une attitude christique, se qualifiant eux-mêmes de prophètes. Que le personnage de Lavrenti permette d’associer Maïakovski et le Christ ne doit pas nous étonner. Cette association, Maïakovski lui-même la suscite à plusieurs reprises dans ses recueils futuristes, et seule la censure a empêché que son grand poème au contenu autobiographique Le Nuage en pantalon ne s’appelle Le Treizième Apôtre.
Avec toutes ces réminiscences, et par le principe même de leur stratification dans sa pâte poétique, Le Ravissement se rattache sans conteste aux grands romans russes. Le Caucase lui-même, dont on devine les cimes derrière les paysages sans nom qu’il nous montre, occupe dans la littérature russe — et au-delà dans la représentation russe du monde — une place particulière, avec l’image captivante de sauvagerie et de séduction qui s’y attache. Mais Le Ravissement, dans la littérature russe du XXe siècle, occupe une place à part par sa puissance poétique singulière, qui tient sans doute à son universalité.
Le Ravissement est surtout et avant tout un roman de montagne, mettant aux prises des âmes fortes et passionnées d’habitants des hauteurs, faisant fi des lois édictées par ceux du plat pays. Peu importe, au fond, qu’Iliazd se soit souvenu de ses expéditions dans le Caucase, des ascensions qu’il effectuait, jeune homme, dans les massifs reculés de Svanétie, dont les populations et les paysages semblent descendus des toiles de Pirosmani pour envahir le roman. Peu importe qu’un chemin de fer évoqué dans un chapitre rapproche de nous cette histoire sans âge, que ce que nous savons de l’histoire permette de rapprocher les razzias de Lavrenti des raids effectués dans les premières années du XXe siècle par le célèbre Kamo et son plus célèbre encore acolyte Djougachvili pour financer les caisses du parti bolchévik, que même la description de la ville où Lavrenti descend commettre ses exploits rappelle clairement le plan de Tiflis, la ville même où Kamo réussit son plus célèbre « hold-up ». L’absence de références claires à une réalité géographique et historique extérieure au roman, que fustigeaient les éditeurs soviétiques (dans quel pays ? à quelle époque ?) alors même que, dans le cadre de l’intrigue, les éléments du décor proche des personnages sont posés de façon ferme et que le temps — celui des saisons — est clairement délimité par une série d’indices discrètement placés, contribue justement à la fascination que joue le livre sur le lecteur. Nous oublions ce contexte, le monde que nous découvrons est neuf et ce sont les personnages eux-mêmes qui le déploient devant nous.
Le titre même du roman, en russe, contient un préfixe portant l’idée d’un mouvement s’effectuant de bas en haut dont l’anabase du capitaine Arkadi, avant les ascensions brouillonnes et fatales de Lavrenti, est la manifestation la plus directe. Le décor s’étage sur plusieurs niveaux très précisément décrits — tout en haut, un lac de mercure et un hameau isolé presque entièrement peuplé de goitreux et de crétins, plus bas un village où se trouve une scierie, tout en bas une plaine qui abrite une ville malpropre et étouffante, et enfin une petite cité portuaire. Il pourrait être celui de tel ou tel roman alpin de Ramuz, dont la voix, parfois, semble si proche de celle d’Iliazd, et pourrait aussi être planté dans n’importe quelle région de hautes montagnes. Le cadre temporel, pour qui sait lire les indices discrets laissés çà et là, est lui aussi nettement marqué, c’est celui de la nature, et aussi de la grossesse d’Ivlita qui en épouse le cycle. Ivlita est associée au temps circulaire, à l’éternel retour des saisons et des êtres (son père enfermé dans le passé ne la confond-il pas avec sa propre femme décédée ?). Sauf lors de son déplacement vers la caverne, retour aux origines du monde à partir duquel l’intrigue va basculer, Ivlita ne se meut qu’en pensées, mais ses pensées la transportent loin au-dessus des montagnes, au « pays des ailes ». Rêveries d’Ivlita typiques de ce que Bachelard appelait « le psychisme ascensionnel ».
Iliazd a retenu la leçon du symbolisme, qu’il a tant aimé dans son adolescence. Le processus de symbolisation revenant à relier monde matériel et monde de l’esprit à travers l’image poétique, est directement porté par Ivlita, laquelle comprend le langage de la nature, voit les êtres cachés derrière les êtres et décrypte « l’esprit de l’esprit ». Sa pureté n’a d’égale que celle de Lavrenti, le jeune homme qui déserte par amour de la liberté et commence par détruire l’impureté apparue dans ces montagnes sous les traits d’un moine pèlerin débauché. Tuer pour affirmer sa liberté, voler pour le plaisir de voler. Mais Lavrenti entame une descente aux enfers sitôt qu’il oublie la gratuité des actes et songe à acquérir les richesses, perdant définitivement sa liberté et sa pureté. Contrairement à Ivlita, Lavrenti est soumis aux lois de l’espace. Il n’est que déplacements, descentes vertigineuses, zigzags et remontées désordonnées. Jeune homme, Iliazd avait écrit de grands poèmes solaires, nietzschéens, sur le thème d’Icare. Mais si Icare, issu du dédale, monte vers le soleil et finit par s’écrouler, c’est un chemin inverse qu’effectue Lavrenti dans sa quête insensée. Pourtant, dans un ultime sursaut, il emprunte lui aussi la voie ascensionnelle, grimpe vers les cimes à la recherche de la pureté perdue — mais c’est déjà trop tard.
Le thème des trésors cachés, de leur recherche et de la fatalité qui s’associe à la quête menée par les héros est omniprésent dans le roman. Il est central, d’ailleurs, dans les autres romans, inédits en français, d’Iliazd, et aussi dans sa poésie ultérieure en vers classiques. Les personnages sont presque tous obnubilés par cette recherche qui finit par les tuer. Seul le vieux goitreux a la sagesse d’y être indifférent. Il révèle à Lavrenti que ces trésors existent effectivement, mais qu’ils n’existent que tant qu’on ne les connaît pas : « Trouve-les, et ils tombent aussitôt en poussière », avant de l’aiguiller sur ce qui, selon lui, serait le trésor des trésors — vivre le plus longtemps possible — pour l’éloigner de sa vaine quête des biens matériels. La quête des trésors s’accompagne d’une irrémédiable chute des personnages, qui est décadence psychique autant que descente au pied de la montagne. Ainsi s’explique l’échec de Lavrenti. Il fut le plus pur, mais il n’a pas compris quels étaient les véritables trésors.
La neige est le symbole de cette pureté du trésor que sa découverte, en la violant, détruit immédiatement. La neige est pureté, mais qu’on la foule du pied, et la neige n’existe plus comme pureté. Dans un texte de présentation rédigé en 1938 de son cycle de sonnets Afet, Iliazd, revenant sur Le Ravissement, en parle comme « une définition de la poésie comme tentative toujours vaine ». La poésie est comme cette neige, pure, égale et universelle, et en même temps éphémère, et qui n’existe que pour être violée.
Ailleurs encore, en 1930, dans un de ses multiples carnets, Iliazd, tirant la conclusion extrême et désabusée de cette réflexion paradoxale sur l’inviolabilité, écrit : « Un livre ne doit pas être écrit pour être lu. Un livre lu est un livre mort. »
Nous avons toutefois envie de le lire, comme on a envie de fouler la neige. Par bien des aspects, Le Ravissement est un roman-monde à la manière de bien d’autres grands romans du XXe siècle. Mais au début du XXIe siècle, peut-être verrons-nous surtout l’univers d’Ivlita, de Lavrenti et des autres montagnards, avec ses règles propres, ses traditions et son folklore, comme un antidote au monde glacé que construit la modernité quand celle-ci s’échappe des ateliers d’artistes pour s’occuper de régenter la vie des hommes. Le Ravissement est peut-être surtout l’œuvre d’un poète resté fasciné par la poésie naturelle d’un monde archaïque peuplé d’individus singuliers, dont il nous restitue le charme qu’il nous reste à savourer en le lisant comme le simple roman montagnard qu’il demeure.
RÉGIS GAYRAUD
1. Tiflis (aujourd’hui Tbilissi) est alors la capitale de la jeune République géorgienne, fondée en 1918 et dirigée par les menchéviks. Pendant toute cette période, jusqu’à sa « soviétisation » en 1921, Tiflis sera un haut lieu d’échanges pour l’avant-garde russe qui y trouvait repos et terrain favorable à son épanouissement.
2. « Le voyage en France est devenu l’objectif de (son) existence artistique » depuis plusieurs années, et c’est « afin de parfaire (son) éducation et (sa) formation » qu’il demande dès l’automne 1920 à la Commission des arts de l’Assemblée Constituante géorgienne l’obtention d’un visa pour la France, son projet étant de rentrer en Géorgie après quelques années d’études à Paris, où, finalement, il résidera sous le statut d’apatride, jusqu’à sa mort en 1975.
1
La neige s’amassait vite, gommant les campanules, puis le gravier, et déjà, frère Moki s’avançait sur du blanc, au lieu de mousse et de fleurs. Il ne fit pas froid tout de suite, et les flocons, lui collant aux joues et rampant sous sa barbe, le rafraîchissaient. À travers l’air troublé, les flancs de la vallée, garnis de rochers, revêtirent leur dentelle, puis disparurent tout à fait. Alors, des lignes se mirent à trembler, remuer, tourner, cingler frère Moki au visage, ses yeux irrités, soudés par le froid. La sente, cachée, glissait souvent sous ses pieds nus, et le pèlerin dégringolait à tout bout de champ dans les crevasses, entre les blocs. Parfois, son pied se coinçait et frère Moki tombait, gigotait, faisait tinter ses chaînes, se relevait à grand peine, gavé de glace
Enfin, sonnèrent des trompes. Des montagnes d’alentour, s’échappaient des vents, et, plongeant dans la vallée, cognaient furieusement sans qu’on sût pourquoi. À droite, les mauvais esprits profitaient de la confusion, lançaient un cri impur, mais derrière, à peine audible dans la tourmente, se faufilait une plainte, sanglot d’un violon ou gémissement d’un nourrisson supplicié. À ces voix, d’autres voix s’ajoutaient, ne ressemblant le plus souvent à rien, imitaient parfois des accents humains, mais si maladroitement qu’on voyait bien que tout cela n’était qu’inventions. Et commencèrent à polissonner sur les cimes, repoussant les neiges