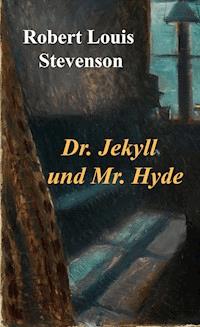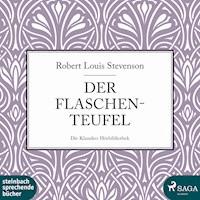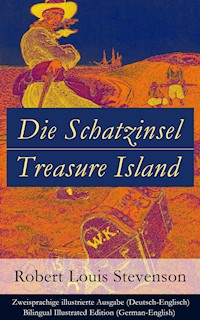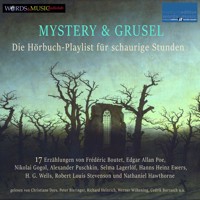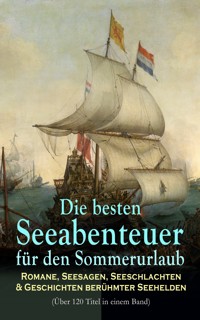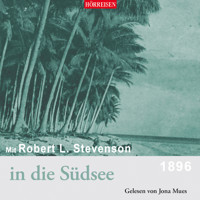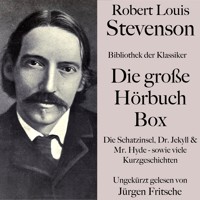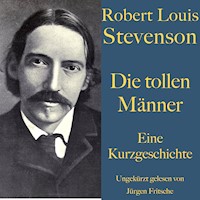Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CLAAE
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Dans le décor idyllique de Tahiti, Robert Louis Stevenson fait le récit d'un naufrage dramatique.
Papeete. Un navire de guerre français appareillait, à destination de la France : il se trouvait à mi-distance du port, tout fourmillant d'activité. Dans la nuit était arrivée une goélette, que l'on voyait à cette heure en rade, tout près de la passe, et le pavillon jaune, emblème de la contagion, flottait à son mât... Ce roman a été écrit, en 1893, en collaboration avec Lloyd Osbourne.
Un récit rocambolesque qui pose aussi la question de la rédemption.
EXTRAIT
Disséminés par tout le monde insulaire du Pacifique, des hommes appartenant aux diverses races européennes et à presque tous les rangs de la société, y portent leur activité et y propagent leurs maladies.
Quelques-uns réussissent, d’autres végètent. Ceux-là sont montés sur des trônes et ont possédé des îles et des flottes. Ceux-ci en sont réduits, pour vivre, à se marier : une dame au teint chocolat, épaisse et joviale luronne, entretient leur paresse ; et, vêtus en indigènes, mais gardant toujours quelque trait hétéroclite d’allure et de maintien, parfois même un dernier souvenir (voire un simple monocle) de l’officier et du gentleman, ils se carrent sous des vérandas en feuilles de palmier et font les délices d’un auditoire indigène avec des souvenirs de café-concert. Et il y en a aussi d’autres, moins souples, moins habiles, moins heureux, peut-être moins vils, qui persistent, jusque dans ces îles de cocagne, à manquer de pain.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Robert Louis Stevenson (1850-1894) est né dans une famille écossaise de bâtisseurs de phares et de marins. Il est l'auteur du célèbre roman
L'île au trésor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 252
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© CLAAE, 2009© CLAAE, 2017——
Le Reflux
ROBERT LOUIS STEVENSON
Le Reflux
CLAAE2009
EAN eBook : 9782379110603
CLAAE
France
PREMIÈRE PARTIE
CHAPITRE PREMIERLA NUIT SUR LA PLAGE
Disséminés par tout le monde insulaire du Pacifique, des hommes appartenant aux diverses races européennes et à presque tous les rangs de la société, y portent leur activité et y propagent leurs maladies.
Quelques-uns réussissent, d’autres végètent. Ceux-là sont montés sur des trônes et ont possédé des îles et des flottes. Ceux-ci en sont réduits, pour vivre, à se marier : une dame au teint chocolat, épaisse et joviale luronne, entretient leur paresse ; et, vêtus en indigènes, mais gardant toujours quelque trait hétéroclite d’allure et de maintien, parfois même un dernier souvenir (voire un simple monocle) de l’officier et du gentleman, ils se carrent sous des vérandas en feuilles de palmier et font les délices d’un auditoire indigène avec des souvenirs de café-concert. Et il y en a aussi d’autres, moins souples, moins habiles, moins heureux, peut-être moins vils, qui persistent, jusque dans ces îles de cocagne, à manquer de pain.
Tout à l’extrémité de la ville de Papeete, trois individus de ce genre étaient assis sur la plage, sous un purau1.
Il était tard. Depuis longtemps la fanfare avait joué son dernier morceau, pour faire sa retraite en musique, escortée par une troupe bigarrée d’hommes et de femmes, employés de commerce et officiers de marine qui dansaient dans son sillage, se tenant par la taille et couronnés de fleurs. Depuis longtemps l’obscurité et le silence avaient gagné, de maison en maison, la minuscule cité païenne. Seuls les réverbères brillaient, faisant des halos de vers luisants parmi l’ombre des avenues ou traçant des reflets vibratoires sur les eaux du port. Des ronflements s’élevaient de derrière les piles de bois longeant le môle du Gouvernement. Ils provenaient des gracieuses goélettes à quille de clipper, amarrées tout proche, dont les équipages étaient couchés sur le pont à ciel ouvert, ou entassés pêle-mêle sous une tente grossière parmi les ballots en désordre.
Mais les hommes réunis sous le purau ne songeaient pas à dormir. La température de la soirée eût semblé normale, en Angleterre, l’été ; mais pour les Mers du Sud, c’était un froid cruel. La nature inanimée le savait, et les bouteilles d’huile de coco étaient figées dans toutes les cases à claire-voie de l’île. Les hommes aussi le savaient, et grelottaient. Ils portaient des vêtements de coton légers, ceux-là mêmes dans lesquels ils avaient transpiré le jour et subi l’assaut des averses tropicales ; et pour comble d’infortune, il n’avait pas été question pour eux de déjeuner, encore moins de dîner, et aucunement de souper.
Selon l’expression des Mers du Sud, ces trois hommes étaient à la côte. Leur malheur commun les avait réunis, car ils étaient tous trois les plus misérables créatures parlant anglais à Tahiti ; mais, en dehors de leur misère, ils ne savaient presque rien l’un de l’autre, pas même leurs vrais noms. Chacun d’eux avait fait le long apprentissage de la déchéance ; et chacun, à une étape donnée de sa chute, avait, par pudeur, pris un pseudonyme. Et pourtant aucun n’avait encore passé devant les tribunaux ; deux d’entre eux possédaient de réelles qualités ; et l’un, assis tout grelottant sous le purau, avait dans sa poche un Virgile en lambeaux.
À coup sûr, s’il avait pu obtenir quelque argent du volume, Robert Herrick eût depuis longtemps sacrifié ce dernier bien ; mais la demande de littérature, qui est un trait si caractéristique en certaines régions des Mers du Sud, ne s’étend pas aux langues mortes ; et ce Virgile, qu’il ne pouvait échanger contre un repas, l’avait souvent consolé, aux heures de faim.
Souvent, la ceinture serrée, et allongé sur le plancher de l’ancienne « calabousse » 2, il le feuilletait, en quête de ses passages favoris, et trouvait moins beaux les nouveaux, qui n’avaient pas encore reçu la consécration du souvenir. Ou bien, parti à l’aventure dans la campagne, il s’arrêtait, et assis au bord du chemin, il regardait en mer les montagnes d’Eimeo ; puis ouvrant au hasard l’Enéide, il y cherchait des « sorts ». Et si l’oracle (selon la coutume des oracles) lui donnait une réponse ambiguë ou peu encourageante, des visions d’Angleterre ne laissaient pas d’emplir la mémoire de l’exilé : la studieuse salle de classe, les vastes terrains de jeux, les vacances à la maison et la rumeur continuelle de Londres, et le coin du feu, et la tête chenue de son père.
Car c’est la destinée de ces graves et gourmés auteurs classiques, dont nous faisons à l’école la connaissance forcée et souvent pénible, de passer dans le sang et de se confondre dans la mémoire avec les souvenirs natals ; si bien qu’une phrase de Virgile parle moins de Mantoue et d’Auguste que de lieux d’Angleterre et de l’irrévocable jeunesse de son lecteur lui-même.
Robert Herrick était le fils d’un homme intelligent, actif et ambitieux, associé subalterne dans une importante maison de Londres. L’enfant promettait : il fut envoyé dans une bonne école, y obtint une bourse pour Oxford, et passa à l’Université de l’Ouest. Malgré toute son aptitude et son désir d’apprendre (et ni l’un ni l’autre ne lui faisaient défaut) Robert, qui manquait d’esprit de suite et de virilité intellectuelle, s’égara dans les chemins de traverse de l’étude, s’occupa de musique ou de métaphysique au lieu de faire du grec, et finit par obtenir tout juste son diplôme. Vers la même époque, la maison de Londres subit une liquidation désastreuse ; M. Herrick dut recommencer sa vie comme employé dans un bureau étranger, et Robert, renonçant à ses ambitions, fut trop heureux d’accepter une carrière objet de son dégoût et de son mépris. Il n’avait aucune aptitude pour les chiffres, ne s’intéressait pas aux affaires, haïssait la contrainte des heures régulières, et méprisait les buts et les succès du commerce. Il ne tenait pas à devenir riche, mais bien plutôt à mener une vie facile. Un jeune homme pire ou plus hardi se fût regimbé contre le sort, soit en s’efforçant de vivre de sa plume, ou bien en s’engageant. Robert, plus prudent, voire plus timide, accepta de suivre la carrière qui lui permettait le mieux de venir en aide à sa famille. Mais ce fut à contre-cœur : il évita désormais ses anciens camarades, et choisit, entre les diverses situations qu’on lui offrait, une place de caissier à New York.
Sa carrière fut une suite ininterrompue d’échecs. Il ne buvait pas, il était strictement honnête, toujours poli avec ses patrons, et néanmoins il fut renvoyé de partout. Faute de s’intéresser à sa tâche, il manquait d’attention : ses journées étaient un tissu de négligences et de maladresses ; et, de place en place, de ville en ville, il emportait la réputation d’un parfait incapable. Nul ne peut sans rougir se voir appliquer ce qualificatif, car c’est en fait celui qui claque le plus brutalement la porte au nez de l’amour-propre. Et chez Herrick, conscient de ses qualités et de son savoir, et regardant de très haut ces modestes fonctions auxquelles on le jugeait inapte, la souffrance était encore plus aiguë. Dès l’origine de sa déchéance, il avait dû renoncer à envoyer de l’argent chez lui ; bientôt, n’ayant plus à mander que des insuccès, il cessa d’écrire ; et un an à peu près avant le début de cette histoire, jeté sur le pavé de San Francisco par un Juif allemand grossier et furieux, il avait abdiqué tout respect humain : dans un coup de tête, il changea de nom et consacra jusqu’à son dernier dollar pour prendre passage sur le brigantin du service officiel, Ville-de-Papeete. Dans quel espoir avait-il dirigé sa fuite vers les Mers du Sud ? Il est probable que Herrick l’ignorait. Sans doute il y a des fortunes à faire dans la perle ou le coprah ; sans doute d’autres gens moins doués que lui étaient parvenus dans le monde insulaire à être princes consorts ou ministres d’un roi. Mais si Herrick avait eu en partant quelque dessein viril, il aurait gardé le nom de son père : le pseudonyme attestait la banqueroute morale ; il avait amené son pavillon ; il ne gardait plus l’espoir de se relever ou de secourir sa famille dans la gêne ; et il arriva aux Iles (où il savait le climat doux, le pain à bon marché et les mœurs faciles) en déserteur du combat de la vie et de tous ses devoirs. Le ratage, avait-il admis, était son lot ; que ce fût du moins un ratage agréable.
Il ne suffit heureusement pas de se dire : « Je veux être vil. » Herrick poursuivit aux Iles sa carrière malencontreuse ; mais dans ce nouveau milieu et sous son nouveau nom, sa souffrance fut tout aussi vive que devant. Une place obtenue, il la perdait comme toujours. Épuisée la longanimité des tenanciers de restaurants, il en vint à demander ouvertement la charité sur la rue ; à la longue, sa bonne volonté se lassa, et après quelques rebuffades, Herrick devint un révolté. Il se serait trouvé des femmes pour entretenir un homme beaucoup plus méchant ou plus laid ; Herrick ne les rencontra ou ne les devina pas : ou du moins un sentiment plus noble se regimbait alors en lui, et il préférait la misère. Transpercé par la pluie, cuisant le jour, grelottant la nuit, ayant pour chambre à coucher les ruines d’une prison désaffectée, pour nourriture ce qu’il mendiait ou recueillait sur les tas de détritus, pour associés deux hors-la-loi comme lui, il buvait depuis des mois la coupe du repentir. Il avait connu tour à tour la résignation, les explosions furieuses d’une puérile révolte contre le destin, l’enlisement dans le marasme du désespoir. Le temps l’avait changé. Il ne s’en faisait plus accroire au sujet d’une déchéance aisée, sinon agréable ; il voyait son caractère sous un autre jour : il s’était montré incapable de s’élever, et l’expérience lui apprenait maintenant qu’il ne savait se plier à la chute. Un je ne sais quoi, différent de l’orgueil ou du courage, qui était peut-être simple délicatesse, lui interdisait de capituler ; mais il considérait son malheur avec une exaspération toujours accrue, et il s’étonnait parfois de sa patience.
Or, il y avait quatre mois pleins que cela durait, sans changement ni espoir de changement. La lune, voguant parmi un monde de nuages rapides de toutes dimensions, formes et densités, les uns noirs comme des taches d’encre, d’autres subtils comme du linon, répandait la merveille de son australe clarté sur le même décor aimable et détesté : les montagnes de l’île couronnées du sempiternel nuage insulaire, la ville ponctuée de rares lampes, les mâtures du port, le miroir poli du lagon et le môle du récif-barrière contre lequel écumait le ressac. La lune brillait aussi avec des éclats de lanterne sourde, sur ses compagnons : sur la massive carrure de l’Américain qui se donnait le nom de Brown, et qu’on savait être un capitaine marin en disgrâce ; et sur la personne rabougrie, les yeux pâles et le sourire mince de cet autre, un employé, cockney 3 vulgaire et perverti. Quelle société pour Robert Herrick ! Le capitaine yankee du moins était un homme : il avait de solides qualités de bonté et de décision ; on pouvait lui serrer la main sans rougir. Mais il n’y avait nulle compensation chez l’autre, qui s’appelait tantôt Hay et tantôt Tomkins, et riait de l’inadvertance ; qui avait été employé dans les magasins de Papeete, car il était habile en son genre ; qui avait été renvoyé de tous l’un après l’autre, car il était foncièrement vil ; qui s’était aliéné tous ses ex-patrons au point qu’ils le croisaient dans la rue comme ils eussent fait d’un chien, et tous ses anciens amis, lesquels l’évitaient à l’instar d’un créancier.
Peu de temps auparavant, un bateau du Pérou avait apporté l’influenza dans l’île, où cette maladie faisait rage, et spécialement à Papeete. Alentour du purau s’élevait par accès un bruit de toux, entrecoupée de suffocations. Les malades indigènes, comme tous les insulaires à la moindre fièvre, s’étaient traînés hors de leurs cases pour chercher la fraîcheur, et accroupis sur le rivage ou dans les pirogues tirées à terre, attendaient mornement le jour. Tout comme le cocorico des coqs se répondant la nuit, de ferme en ferme, à travers la campagne, les quintes de toux s’élevaient, se propageaient et mouraient dans le lointain, pour reprendre à nouveau. Chacun des infortunés fiévreux, suggestionné par son voisin, était saisi durant plusieurs minutes par cet affreux transport, qui le laissait ensuite épuisé et sans voix, anéanti. Pour quiconque avait de la pitié à dépenser, la plage de Papeete, par cette nuit froide et en cette saison maligne, était un lieu tout indiqué. Et entre toutes les victimes de la contagion, l’employé londonien était peut-être le moins méritant, mais à coup sûr le plus pitoyable. Il était accoutumé à une autre vie, aux maisons, aux lits, aux soins, aux raffinements de la chambre de malade ; et il était couché là, dans la nuit froide, exposé aux rafales, et le ventre vide. Il était d’ailleurs profondément miné par le mal, et ses compagnons s’étonnaient de le voir vivre encore. Une commisération réelle les emplissait, et luttait avec leur antipathie, qu’elle faisait taire. Le dégoût suscité par cette laide affection aggravait cet éloignement ; toutefois, avec plus d’énergie encore, la honte d’un sentiment aussi inhumain les faisait s’empresser davantage à son service ; et même ce qu’ils savaient de pis sur lui augmentait leur sollicitude car la pensée de la mort est d’autant moins supportable qu’elle menace des êtres purement sensuels et égoïstes. Parfois ils lui relevaient le torse ; ou bien, par une intention charitable et mal entendue, ils le tapotaient entre les épaules ; et quand le pauvre diable retombait hagard et épuisé après un paroxysme de toux, il leur arrivait de scruter son visage, doutant d’y voir encore un signe de vie. Il n’est personne qui n’ait sa vertu : celle de l’employé était le courage ; et il se hâtait de les rassurer par une plaisanterie souvent déplacée.
— Ça va très bien, les poteaux, râla-t-il une fois : c’est ce qu’il faut pour fortifier les muscles du larynx.
— Alors, à vous le pompon ! s’écria le capitaine.
— Oh ! ce n’est pas le nerf qui me manque, poursuivit le malade d’une voix entrecoupée. Mais ce que je trouve excessif, c’est d’être le seul de la bande soumis à ce genre de fléau, et le seul à tenir le crachoir. L’un ou l’autre de vous, il me semble, devrait bien un peu se dégrouiller. Racontez donc quelque chose, la coterie 4.
— Le malheur est que je n’ai rien à raconter, mon garçon, répondit le capitaine.
— Je vais vous dire, si vous voulez, ce à quoi je pensais, fit Herrick.
— Dites-nous n’importe quoi, reprit l’employé, je ne demande qu’une chose, c’est qu’on me rappelle que je ne suis pas mort.
Herrick commença donc son allégorie. Couché face contre terre, il s’exprimait avec lenteur, presque à voix basse, comme quelqu’un qui parle non pas sérieusement, mais pour passer le temps.
— Voici donc ce à quoi je pensais, commença-t-il ; je me voyais couché sur la plage de Papeete, une nuit, — rien que lune, rafales et gens qui toussent — et j’étais glacé, affamé et navré, et j’avais dans les quatre-vingt-dix ans, et j’en avais déjà passé deux cent vingt-cinq sur la plage de Papeete. Et je pensais aussi que j’aurais bien voulu avoir un anneau à frotter, ou avoir une fée pour marraine, ou encore évoquer Belzébuth. Et je tâchais de me rappeler comment on opère. Je savais, pour l’avoir vu dans le Freischütz, qu’on trace un cercle avec des têtes de mort ; que l’on retire son habit et que l’on retrousse ses manches de chemise, comme je l’ai vu faire à Formes dans le rôle de Kaspar, et on devinait à ses façons qu’il avait étudié la chose ; et qu’on devait avoir un produit qui répande de la fumée et qui sente mauvais — un cigare, je suppose, ferait l’affaire, — et qu’on doit réciter l’oraison dominicale à rebours. Or, je me demandais si j’y parviendrais, car cela semble un peu raide, n’est-ce pas ? Et alors l’idée me vint de la réciter à l’endroit, et je suivis cette idée. Mais j’en étais à peine à votre règne arrive, que je vis sur la plage, venant de la ville, un homme vêtu d’un pareo5 et portant sous son bras une natte. Il avait l’air d’un pauvre vieux bougre, bancroche et traînant la quille, et il n’arrêtait pas de tousser. Au premier abord, je n’en pinçai guère pour sa physionomie, mais ensuite j’eus pitié du pauvre vieux, tant il toussait. Je me rappelai qu’il nous restait de cette potion que le consul d’Amérique nous a donnée pour Hay. Elle n’a jamais profité pour un sou à Hay, mais je me dis qu’elle ferait peut-être l’affaire du vieux gentleman, et je me dressai. « Yorana ! » fis-je. « Yorana ! » fit-il. « Écoutez, dis-je, j’ai ici dans un flacon une drogue de première qualité ; elle guérira votre rhume, savez ? Venez ici, que je vous en mesure une cuillerée à soupe dans le creux de ma main, car toute notre argenterie est à la banque. » Et donc je me figurais que le vieux type s’en venait vers moi, et plus il approchait, moins je le gobais. Mais j’avais donné ma parole, n’est-ce pas ?
— Quel sacré radotage est-ce là ? interrompit l’employé. Cela ressemble aux fariboles qu’on lit dans les tracts.
— C’est une histoire ; je l’ai souvent racontée aux gosses, à la maison, dit Herrick ; si elle vous embête, je la laisserai là.
— Oh, allez toujours, répliqua le malade, grincheux. Cela vaut mieux que rien.
— Alors, continua Herrick, je ne lui eus pas plus tôt donné la potion pour la toux qu’il me parut se redresser et se transformer, et je vis que ce n’était pas du tout un Tahitien, mais une espèce d’Arabe, et qu’il avait une longue barbe au menton. « Un bon procédé en vaut un autre, me dit-il. Je suis un magicien des Mille et une Nuits, et cette natte que j’ai sous le bras est le tapis authentique de Mohammed Ben Un tel ou un Tel. Vous n’avez qu’à parler, je vous offre une croisière sur mon tapis. » — « Voulez-vous dire que c’est là le Tapis-Voyageur ? » m’écriai-je. « Pariez6, que je le dis », fit-il. « Vous avez été en Amérique depuis la dernière fois que j’ai lu les Mille et une Nuits », répliquai-je, non sans une légère méfiance. « C’est bien possible, dit-il. J’ai été partout. Avec un tapis comme celui-là, on ne va pas moisir dans une villa de banlieue. » Cela me parut juste. « Fort bien, dis-je, et voulez-vous dire que je n’ai qu’à me mettre sur le tapis pour aller tout droit à Londres, Angleterre ? » Je spécifiai : Londres, Angleterre, capitaine, parce qu’il me paraissait avoir été bien longtemps dans votre partie du monde7. « Le temps de faire claquer un fouet », dit-il. Je fis le calcul des heures. Quelle est la différence entre Papeete et Londres, capitaine ?
— Mettons de Greenwich à Pointe Vénus, neuf heures, plus des minutes et secondes, répondit le marin.
— Eh bien, c’est à peu près ce que je trouvai, reprit Herrick, environ neuf heures. Comptant ici trois heures du matin, je devais tomber dans Londres pour midi ; et cette perspective me faisait un plaisir énorme. « Il n’y a qu’une difficulté, dis-je, je n’ai pas un rouge liard. Ce serait bête d’aller à Londres et de ne pas acheter le Standard du matin. » — « Oh ! dit-il, vous ne connaissez pas tous les avantages du tapis. Vous voyez cette poche ? vous n’avez qu’à y plonger la main pour la retirer pleine de souverains8. »
— De doubles-aigles, plutôt ? interrogea le capitaine.
— C’est donc cela ! s’écria Herrick. Ils me semblaient singulièrement massifs, et je me rappelle maintenant que je dus aller chez le changeur à Charing-Cross, pour faire de la monnaie anglaise.
— Alors, vous y avez été ? dit le commis. Qu’est-ce que vous y avez fait ?
— Eh bien, voyez-vous, ça se passe comme le vieux frère l’avait annoncé, le temps de faire claquer un fouet, reprit Herrick. À un instant donné j’étais ici sur la plage, à trois heures du matin, celui d’après j’étais en face de la Croix d’or 2, à midi. Tout d’abord je fus aveuglé, et me mis la main sur les yeux, et il semblait n’y avoir rien de changé. La rumeur du Strand et celle du ressac se confondaient absolument : prêtez l’oreille, à cette heure, vous entendrez le bruit de la rue avec les cabs et les omnibus qui roulent ! Enfin je regardai autour de moi, et pas d’erreur, c’était bien la vieille place. Avec les statues dans le square, et les sergots, et les moineaux, et les fiacres. Je ne puis exprimer ce que je ressentis. J’avais envie de pleurer, je crois, ou de danser, ou de sauter à pieds joints par-dessus la colonne de Nelson. J’étais pareil à un individu retiré de l’enfer et jeté au beau milieu de l’endroit le plus chic du Ciel. Alors j’avisai un cab avec un bon cheval. « Un shilling de pourboire, si vous y êtes en vingt minutes ! » dis-je au cocher. Il marcha bon train, quoique naturellement ce ne fût rien comparé au tapis ; et en dix-neuf minutes et demie j’étais à la porte.
— Quelle porte ? demanda le capitaine.
— Oh, une maison que je sais, répondit Herrick.
— Parier que c’était une bonne maison ! s’écria le commis — mais il employa un autre mot. — Et pourquoi n’y être pas allé avec le tapis au lieu de trinqueballer dans une bagnole ?
— Je ne voulais pas mettre en émoi une rue paisible, dit le narrateur. Ce ne sont pas des manières. Et puis le cab était bon.
— Mais qu’avez-vous fait ensuite ? interrogea le capitaine.
— Oh ! je suis entré.
— Les vieux ?
— Vous y êtes, dit Herrick, mordillant un brin d’herbe.
— Vrai, vous m’avez tout l’air d’un bien pauvre conteur ! s’écria le commis. Fichtre, mais c’est une histoire édifiante que vous nous servez là ! Je vous assure qu’il y aurait plus de bière et de quilles dans ma petite ballade. Je commencerais par m’acheter une grande pelisse fourrée d’astrakan, et prendrais ma canne pour faire mon persil dans Piccadilly. Puis j’irais à un restaurant urf.et choisirais des pois verts, et une bouteille de pétillant, et une solide entrecôte… Ah ! j’oubliais, je prendrais d’abord une riche blanquette de poisson… puis une tarte aux groseilles vertes, et du café brûlant, et de… cette espèce de poison en bouteilles pansues avec un scel rouge… de la bénédictine, cré nom ! Ensuite dans un théâtre, où je ferais connaissance avec quelques bons bougres, et puis la tournée des dancings, des bars, etc., et je ne rentrerais pas avant le matin, avant qu’il fasse grand jour. Et le lendemain, je prendrais du cresson de fontaine, jambon, petits pains, et beurre frais ; et pas un peu, fichtre !
Une nouvelle quinte de toux interrompit l’employé.
— Eh bien, maintenant, je vais vous dire ce que je ferais, dit le capitaine : je ne voudrais pas de vos gréements de fantaisie avec le cocher conduisant du haut des vergues de misaine 9, mais un vulgaire fiacre à quatre roues, du plus fort tonnage immatriculé. Pour commencer, j’irais aux halles, chercher une dinde et un cochon de lait. Puis je me rendrais chez un marchand de vin prendre douze bouteilles de champagne, et douze d’un vin de liqueur, généreux, foncé et puissant, quelque chose comme du madère, ce qu’il y aurait de mieux dans la boutique. Puis je cinglerais vers un magasin de jouets, et me fendrais de vingt dollars en jouets assortis pour les gosses ; et puis chez un pâtissier, où je prendrais gâteaux, pâtés, pain de fantaisie, et ce machin avec des pruneaux dedans ; et puis à un dépôt de journaux, pour acheter toutes les publications, toutes celles à images pour les petits, et pour la bourgeoise toutes les livraisons avec les histoires du Comte qui se fait reconnaître par Anne-Marie, et de Lady Maud qui s’évade de la maison de fous. Après quoi je dirais au cocher de me conduire à la maison.
— Vous oubliez du sirop pour les gosses, insinua Herrick ; ils aiment le sirop.
— C’est vrai, du sirop pour les gosses, et même du sirop de grenadine ! reprit le capitaine. Et ces machins sur lesquels on tire et qui font paf ! et qui contiennent des poésies à la manque. Et alors je vous assure que nous aurions un jour d’actions de grâces et un arbre de Noël réunis. Bon Dieu ! quel plaisir j’aurais à voir les marmots ! Je suppose qu’ils se précipiteraient hors de la maison, quand ils verraient leur papa descendre de voiture. Ma petite Adar…
Le capitaine s’arrêta court.
— Eh bien, continuez ! dit le commis.
— Mais le diantre, c’est que j’ignore s’ils ont à manger ! s’écria le capitaine.
— Ils ne sauraient être plus mal lotis que nous, c’est une consolation, répliqua l’employé. Je défie bien le diable d’empirer ma situation.
Ce fut comme si le diable l’avait entendu. La lumière de la lune s’était éclipsée depuis un moment déjà et ils avaient conversé dans les ténèbres. Soudain un grondement se fit entendre, qui se rapprochait impétueusement ; on vit blanchir la surface du lagon, et avant qu’ils se fussent mis debout, une rafale de pluie fondait sur les parias. La rage et le volume de cette avalanche, il faut avoir vécu sous les Tropiques pour l’imaginer : son assaut coupait la respiration, comme eût fait une douche ; et le monde parut se résoudre en nuit et en eau.
À tâtons, ils s’enfuirent vers leur abri coutumier — on pourrait même dire leur demeure — la vieille calabousse ; ils arrivèrent trempés dans les salles vides ; et ces trois aqueuses loques humaines s’étendirent sur le froid dallage de corail, et un peu plus tard, quand la bourrasque fut passée, les deux compagnons du commis l’entendirent claquer des dents dans les ténèbres.
— Dites, camarades, geignit-il, pour l’amour de Dieu, levez-vous et tâchez de me réchauffer. Autrement, je suis sûr que je vais mourir.
Tous trois se rassemblèrent en une masse mouillée, et restèrent jusqu’à la venue du jour, à grelotter et somnoler, continuellement rappelés à la conscience de leur misère par la toux du commis.
__________________
1 Ou : bois de rose.
2 Terme des Mers du Sud, pour : prison, de l’espagnol calaboza, même sens.
3 Londonien vulgaire, équivalent du « Parigot ».
4 Quelques lecteurs s’étonneront peut-être de me voir employer au cours de ce volume des locutions ultra familières ou argotiques avec une fréquence beaucoup plus grande que dans les Veillées des Iles, par exemple (ces Island Nights’ Entertainments qu’un truchement contemporain s’est amusé à mettre en dialecte « poilu »). — D’un côté comme de l’autre, je me suis borné à suivre scrupuleusement le ton exact de Stevenson ; et ce n’est pas au hasard que M. Huish ou ses deux collègues parlent argot nautique, slang londonien ou américain, — rendus par des équivalents français aussi voisins que possible du texte. Note du traducteur.
5 Pièce de tissu dont les Tahitiens s’entourent la ceinture et qui descend jusqu’aux chevilles.
6You bet : américanisme.
7 Il existe un London au Canada, dans l’Ontario.
8 Le sovereign, pièce d’or anglaise, vaut 20 shillings (environ 25 fr. au pair) ; l’eagle des États-Unis vaut 10 dollars, et le double-aigle d’or pèse un peu plus que notre pièce de 100 fr.
9 Le conducteur du cab étant perché sur un siège surélevé.
CHAPITRE IILE MATIN SUR LA PLAGE. — LES TROIS LETTRES
Tous les nuages avaient disparu, la splendeur du jour tropical s’étalait sur Papeete ; et déjà la muraille de lames déferlait sur le récif, et les palmiers, sur l’îlot, vibraient dans l’air surchauffé. Un navire de guerre français appareillait, à destination de la patrie : il se trouvait à mi-distance du port, tout fourmillant d’activité. Dans la nuit, était arrivée une goélette, que l’on voyait à cette heure en rade, tout près de la passe ; et le pavillon jaune, emblème de la contagion, flottait à son mât. Tout le long de la côte, une procession de pirogues, qui s’en venaient, doublant la pointe, vers le marché, faisait comme une écharpe multicolore, avec ses piles de fruits et les vêtements bariolés des naturels.
Mais la beauté du matin et sa chaleur réconfortante, non plus que cette agitation navale, si curieuse pour des marins et des oisifs, ne captivèrent l’attention des exilés. Ils avaient le cœur glacé, la bouche amère d’insomnie, le pied mal assuré par défaut de nourriture ; et à la queue leu-leu, telles des oies boiteuses, ils longeaient la plage, dans un morne silence. Ils se dirigeaient vers la ville, vers la ville d’où montaient des fumées, où des gens plus heureux étaient en train de déjeuner ; et, chemin faisant, ils lançaient de tous côtés des regards avides, mais uniquement aux aguets d’un repas.
Une petite goélette mal tenue était accostée au quai, où la reliait une planche. À l’avant du pont, sous un haillon de tente, cinq Canaques, formant tout l’équipage, étaient accroupis autour d’une soupière de feis1 et buvaient du café dans des gobelets de fer-blanc.
— Huit coups 2 ; sonnez au déjeuner ! lança le capitaine avec une jovialité amère. Jamais essayé encore ce bateau-ci ; positivement mes premiers débuts ; je crois bien que je vais faire salle comble.