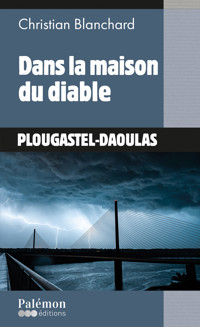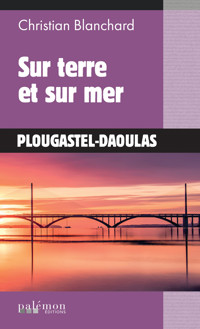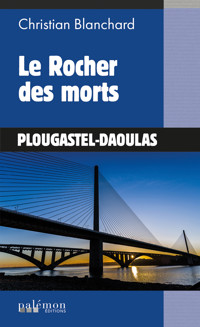
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Palémon
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Plougastel-Daoulas
- Sprache: Französisch
La tempête Ciaran a laissé de profondes cicatrices sur Plougastel-Daoulas. Malo Mahé, correspondant de presse pour le journal Les Voix de l’Ouest, supervise les dégâts sur la commune. Intrigué par l’errance d’un chien, il découvre le cadavre de son maître au pied du Rocher de l’Impératrice.
Loin de Plougastel, dans un bureau du quartier de La Défense à Paris, Oliver Bloncent, entrepreneur sans état d’âme, a une visée de développement ambitieuse pour la Bretagne et particulièrement pour Plougastel : le projet Breizh’one. S’il arrive à ses fins, la biodiversité du secteur sera mise à mal. Le cadet de ses soucis.
Bien que Zoé Kerjean, lieutenant de gendarmerie à Plougastel, tente de l’en dissuader, Malo se lance dans une enquête qui le mènera sur la piste d’histoires que personne n’aurait aimé voir ressortir de terre…
Entre intrigues et secrets familiaux, Christian Blanchard aborde d’une façon originale la problématique de l’écologie à l’échelle d’une commune.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Christian Blanchard a fait du roman noir et du suspense social sa marque de fabrique, avec des ouvrages édités chez Belfond et Points. Récompensé par de nombreux prix ("Iboga", Prix des lecteurs de Points, "Angkar", Prix du roman noir des bibliothèques et des médiathèques du Grand Cognac, "Tu ne seras plus mon frère", Prix de la Ville de Carhaix), Christian Blanchard retrouve la Bretagne, sa région de cœur, source de son inspiration.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 398
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
CE LIVRE EST UN ROMAN.Toute ressemblance avec des personnes, des noms propres, des lieux privés, des noms de firmes, des situations existant ou ayant existé, ne saurait être que le fait du hasard.
Jour J-10
Quelle est la meilleure façon d’être invisible ? Cette question le perturbe depuis tout petit ou depuis toute petite. Allez savoir !
La réponse à cette interrogation existentielle fut de se fondre dans la masse des gens. Être un individu imperceptible parmi une multitude de personnes. Être là sans y être. Parfois homme, parfois femme. Puisqu’il et elle sont les deux ou bien ni l’un ni l’autre. Allez savoir !
Il n’a pas d’ami. Elle a quelques connaissances. Rien de solide.
Il travaille de temps en temps au black dans le bâtiment ou pour de gros maraîchers pas regardants sur l’origine de l’ouvrier. À d’autres moments, elle rend des services pour des associations caritatives.
Si besoin, elle conduit des chariots élévateurs, pour dépanner. Il est doué pour bouturer les plans qui nécessitent doigté et patience.
Sa passion ?
Les poupées de chiffon.
Elles n’étaient rien avant. Des chutes d’étoffe. Des boules de laine, de coton, récupérées par-ci, par-là. Construire un corps, lui donner des formes humaines, sans sexe évidemment. Parce que le sexe, lui, il n’en a pas. Elle en est privée. Pas le choix, en vrai.
Un travail apaisant.
Heureusement, elle a sa boîte à boutons. De la récup. Comme pour le reste. Il y en a de toutes les couleurs, de toutes les tailles, des nacrés. Ses préférés ? Les noirs. Parce que le noir est neutre, comme le blanc. Sauf que le blanc est trop… – comment dire ? – trop clair… alors que le noir, lui, il avale la lumière, ne reflète rien, absorbe tout.
Heureusement, il a son coffret de couture. Plein d’aiguilles différentes. Des petites avec de gros chas, des grosses avec de petits trous pour passer le fil. Les bobines sont aussi nombreuses que possible avec leurs textures bien différentes et leurs teintes dissemblables. Parfois, il coud les tissus avec la même coloration de fil. Parfois, elle tranche avec des fibres à l’aspect contrasté.
Parfois, tout est limpide dans sa tête. Mais parfois, ses pensées, ses envies partent ailleurs. Il ne sait pas vraiment où. Sauf que, parfois, elle en a peur.
Projet Breizh’one
Paris, quartier de La Défense, début octobre
Les mains dans le dos, Oliver Bloncent observait la nuit engloutir peu à peu Paris. Face à la baie vitrée, il aimait ce moment spécial où les lumières artificielles refusaient l’obscurité naturelle et embrasaient la ville d’une multitude d’étincelles. Du quarante-deuxième étage de l’immeuble qui avait été un temps le plus haut du quartier de la Défense, il embrassait la capitale d’un seul regard. Au fond, la tour Eiffel se détachait du reste de la mégalopole. Un projecteur à son sommet prétendait être le guide de cette cité, le phare au milieu d’un océan de vies grouillantes.
Oliver Bloncent respira profondément. Il n’était pas né ici, mais, au plus loin que remontaient ses souvenirs, il n’avait connu que cette fourmilière. Une dizaine d’années auparavant, il avait remis à son fils Jean l’arbre généalogique commencé par son père. Il ne l’avait jamais ouvert. Pour lui, rechercher ses racines n’avait aucun intérêt. Il avait suffisamment de travail avec ce qu’il voulait être.
Et ce qu’il avait n’était pas satisfaisant. Toujours plus parce que pas assez. Cet adage venait de lui et était affiché en lettres d’or dans le hall d’accueil de son entreprise.
Contrairement à son père, Jean avait ressenti le besoin de s’emparer de ses origines. Il avait relevé le défi avec enthousiasme.
— Je ne comprends pas en quoi ça va t’aider, lui avait dit un jour Oliver. L’éducation est le terreau dans lequel l’enfant se développe et forge sa personnalité. L’apprentissage et les études prennent le relais. L’expérience de la vie continue à façonner l’homme. Mais ce sont surtout l’ambition, l’envie et les actions qui en découlent qui font ce que nous sommes. On ne doit à aucun moment s’arrêter de désirer, de viser plus haut, et encore plus.
Jean aurait pu argumenter que l’humain était un être social. Aucune âme ne se construisait sans interférer avec les autres. Sachant la répulsion de son père pour toutes celles et tous ceux qu’il considérait comme inférieurs, il aurait pu se contenter de sourire, mais il lui avait répondu qu’étudier ses ascendances ne signifiait pas abandonner ses rêves de conquête.
— C’est juste être conscient d’où l’on vient pour mieux comprendre là où l’on veut aller.
Oliver Bloncent avait apprécié cette réflexion. Si son fils aîné commençait à élaborer des phrases aussi pompeuses que les siennes, il était en bonne voie pour lui succéder un jour. Tout ce qu’il avait bâti depuis des décennies n’avait eu qu’un unique objectif : être au sommet de la pyramide des personnalités les plus influentes du pays… et pourquoi ne pas viser le monde ? À soixante-cinq ans, il avait plus d’années derrière lui que devant. Tôt ou tard, il passerait la main. Jean serait le plus à même pour le remplacer, le plus tardivement possible. Cette passation de pouvoir annoncerait sa fin. Pour l’instant, il se sentait apte intellectuellement et physiquement pour au moins une vingtaine d’années supplémentaires. Oliver Bloncent approchait le top dix des plus grosses fortunes françaises. Il était loin des cent plus riches entrepreneurs au niveau mondial. Du chemin restait à parcourir.
— Et que t’ont appris tes recherches généalogiques ?
— J’ai tout consigné dans un recueil. Je t’en laisse un exemplaire. Tu y trouveras l’arbre complet avec les justificatifs. C’est très instructif.
— Nous sommes d’une lignée noble ? avait demandé Oliver avec un léger sourire de satisfaction.
— Pas vraiment. Désolé, papa, mais nos ancêtres ont toujours eu les pieds profondément ancrés dans la terre.
— Nous sommes des bouseux ?
— C’est péjoratif. Je dirais plutôt que nous sommes des terriens. Il faut attendre le XVIIIe siècle pour que l’un de nos anciens apparaisse dans le commerce.
— De quoi ?
— De lin. Mais franchement, papa, prends le temps d’y jeter un œil.
Depuis cette discussion, le cahier était demeuré sur son bureau. Oliver ne l’avait pas encore feuilleté. Peut-être ne le ferait-il jamais. Connaître d’où il venait ne changerait en aucune manière ses ambitions.
La nuit avait définitivement enveloppé la ville. Sa journée de travail n’était pas terminée. Il se retourna vers son imposant cabinet sommairement meublé. Une grande table en verre sur laquelle étaient posés son ordinateur, un téléphone fixe, un sous-main et quelques dossiers impeccablement empilés faisait face à un mur vitré ouvert sur l’open space. Tous les employés pouvaient le voir et réciproquement. Oliver Bloncent ne se cachait pas.
Le long des parois latérales, les placards étaient dissimulés derrière d’immenses miroirs sur toute leur hauteur, ce qui donnait l’impression d’un espace deux fois plus vaste. Les éclairages intégrés au plafond diffusaient une lumière indirecte réglable à distance. Ici, tout avait été pensé pour offrir un maximum de clarté.
L’appel de son secrétaire remémora à Oliver Bloncent l’heure de la réunion. Il se leva, s’observa quelques secondes dans un des miroirs. Il trouva que sa chevelure poivre et sel était un peu longue. Un passage chez le coiffeur s’imposait. Il réajusta sa cravate d’un bleu profond assorti à son costume à peine plus clair. Il tira sur le gilet pour affiner son allure. Bien qu’il fasse très attention à son alimentation et qu’il pratique du sport tous les deux jours dans une salle réservée, le temps avait tendance à ramollir ses muscles. Une légère couche graisseuse tentait de recouvrir sa ceinture abdominale. Rester le plus svelte possible était un combat de tous les instants.
Il sortit et traversa le vaste couloir qui le menait à la pièce où l’attendaient ses principaux assistants. Avant d’entrer, il déposa son mobile dans la case où était inscrit son nom, à côté de la porte d’accès. Même si ce lieu était un bunker parfaitement isolé des intrusions numériques, un cellulaire était source d’espionnage. Oliver Bloncent se vantait d’avoir le même bastion que le président de la République pour ses cellules de crises. Peut-être frisait-il la paranoïa, mais il valait mieux prévenir que guérir. Le seul canal de communication était un téléphone filaire qui reliait cet endroit à son service de sécurité à l’autre bout de l’étage.
Pas d’internet. Les appareils raccordés à l’écran mural étaient systématiquement analysés par un informaticien expert en cybercriminalité et étaient connectés entre eux par un intranet affecté exclusivement à ce local.
Les six collaborateurs se levèrent à son arrivée. Quatre hommes et deux femmes. Oliver se moquait complètement de la parité. Pour lui, seules les compétences comptaient. S’il avait trouvé des femmes plus performantes que les individus masculins ici présents, il n’y aurait que des personnes de sexe féminin dans son équipe.
D’un geste de la main, il leur demanda de se rasseoir. Deux fois par semaine, en début de soirée, le même cérémonial se répétait. Chacun était chargé d’un pan particulier de l’activité de l’entreprise. C’était le moment d’effectuer un point rapide sur les actions de développement en cours et celles à mener en priorité.
La majeure partie des délibérations tombait sous le sens, celui instauré par le big boss. S’il y avait matière à discuter, la décision finale était toujours assumée par Oliver. Si des risques devaient être pris, à lui d’en mesurer les conséquences. Mais il savait aussi qu’un âne ne marchait pas à coups de bâton. La carotte devant son museau le faisait avancer plus sûrement. Les six employés qu’il avait devant lui n’avaient pas de rémunérations fixes, mais étaient payés au mérite selon une grille que personne ne connaissait sauf, évidemment, Oliver Bloncent.
Ces réunions ne duraient guère plus d’une heure trente. Chacun disposait de quinze minutes. Ils avaient tous rapidement appris à être concis. Pas la peine d’embrouiller le patron de détails. De toute façon, Oliver Bloncent avait développé d’autres moyens d’information pour appréhender la valeur de ses assistants, leur efficacité, les coûts et les recettes de chaque projet.
Quand vint le tour de Donatien Dubois, l’ambiance changea. Oliver sentit tout de suite qu’il n’était pas à l’aise. Il avait cette faculté de détecter chez quelqu’un une gêne inhabituelle. Il savait qu’il était craint par ses salariés. N’était-il pas le maître tout-puissant dans cette entreprise ? Mais il avait compris depuis longtemps que fidéliser ses plus proches collaborateurs était une source de stabilité. Les personnes réunies là constituaient le premier cercle décisionnel. Se séparer d’eux n’était pas dans l’ordre des choses pour Oliver. Beaucoup de temps était nécessaire pour former et, surtout, offrir sa confiance à un néophyte ne connaissant rien à la culture de sa société.
— On t’écoute, Donatien.
Dubois s’éclaircit la voix et manipula le clavier posé devant lui. Un plan du Finistère s’afficha sur l’écran. Des zones apparurent en couleurs, allant du vert foncé au rouge vif. La palette décrivait l’avancée du projet. Pas la peine d’être un fin communicant pour s’apercevoir que le vermillon était une mauvaise nouvelle.
— Si ma mémoire est bonne, ça n’a pas progressé beaucoup depuis la dernière fois.
— Ce n’est pas aussi simple qu’on l’avait imaginé au départ.
Oliver Bloncent leva la main pour le faire taire.
— Tu n’es pas payé pour gérer les facilités, mais pour résoudre les problèmes.
— Je pense que, rapidement, la carte virera au vert.
— Tu penses ? Je rêve ! Arrête de cogiter et agis !
Quand Bloncent haussait le ton, tout le monde plongeait les yeux dans ses dossiers. Donatien Dubois soutint le regard du grand patron.
— J’ai besoin d’un délai plus long.
Oliver souffla d’exaspération.
— OK. C’est terminé pour aujourd’hui. Vous connaissez tous vos priorités.
Tous ramassèrent leurs affaires.
— Donatien. Tu restes. On va débriefer tous les deux.
Personne ne s’éternisa.
Nul doute que, dans les couloirs, les paris étaient désormais ouverts : combien de minutes avant que Donatien ne soit remercié ?
Oliver changea de place et s’assit à côté de son collaborateur. Donatien passa un doigt entre le col de sa chemise et sa gorge. Un signe évident de stress. Sa petite taille ne l’avantageait pas. Qu’il soit debout ou posé sur un siège, il avait toujours une tête de moins que son boss.
— Bon, on est tous les deux. Tu peux tout me dire. Où en est réellement le projet Breizh’one ?
— Je vous assure qu’il avance conformément aux prévisions.
— Mais ? Parce qu’il y a un « mais », n’est-ce pas ? Si on veut respecter le planning, la quasi-totalité de la carte devrait être verte, non ? Je me trompe ? Remontre-la-moi.
Donatien Dubois s’exécuta.
— Mets uniquement en surbrillance les territoires en tension.
Les parties vertes disparurent. Donatien apporta des explications, des suggestions.
— OK. Rien d’insurmontable, souffla Oliver.
De l’index, il désigna une zone à l’ouest.
— Et là ? Agrandis, s’il te plaît.
— C’est effectivement le principal problème, susurra Donatien.
Il entoura la portion vert foncé avec un stylo pointeur.
— C’est où exactement ? demanda son patron.
— Au nord de la commune de Plougastel-Daoulas, près de Brest.
— Merci, je connais la géographie de mes projets. Et pourquoi cet endroit plutôt qu’un autre ?
— Pas évident avec certains des habitants.
— Tu ne vas pas me faire le coup des irréductibles Bretons face à l’empereur César qui souhaitait civiliser la région ?
— Non, monsieur.
Le glaive était prêt à s’abattre sur sa nuque.
— Tu es payé pour trouver des solutions.
— Oui, monsieur.
Oliver Bloncent se leva et toisa son employé. Donatien se sentit minuscule.
— Tu es dans mon entreprise en partie grâce à tes capacités de négociateur. Alors, mets toutes tes compétences pour régler cette affaire au plus vite.
— Oui, monsieur.
1
Plougastel-Daoulas, samedi 28 octobre
Je me demande ce que je fous ici. L’attachée de presse des Éditions Fortuites m’avait pourtant prévenu. « Tu fais comme tu le souhaites, mais tu risques de ne pas trouver ta place à dédicacer dans un supermarché. » Fallait bien que je tente. Quand je suis arrivé ce samedi matin de fin octobre, j’étais remonté à bloc. Si j’étais un peu connu à Plougastel-Daoulas comme correspondant local du journal Les Voix de l’Ouest, je voulais l’être également comme écrivain. La naïveté du débutant.
Le week-end précédent, j’avais été invité dans un salon littéraire où s’étaient retrouvés des géants du polar comme Franck Thilliez, Karine Giebel, Sandrine Collette et Bernard Minier. Des queues interminables de lecteurs patientaient devant leur stand. Ils avaient signé leurs nombreux ouvrages à tour de bras au point où, pour leur permettre de prendre le temps de déjeuner, les organisateurs avaient interrompu les files en demandant aux fans de revenir vers 14 heures. Moi, avec un seul titre à mon actif, j’ai compté les minutes et regardé ces auteurs à succès avec envie.
Mais les clients qui pénètrent dans cette grande surface ne viennent pas pour moi.
La responsable du rayon presse m’avait bien accueilli. Une longue table avec une nappe blanche, plusieurs piles de mon livre, une petite bouteille d’eau et un pot de fleurs au bout du plateau.
— Vous désirez un café ?
— Merci beaucoup.
J’étais assis juste après le tourniquet par lequel les gens entraient avec leur caddie. Impossible de me rater. Bien droit sur ma chaise, je souriais à chaque passage et je lançais des bonjours à la cantonade. La plupart des personnes baissaient la tête, consultaient leur liste de course, bifurquaient tout de suite à gauche. Au mieux, j’avais un rictus forcé. J’étais transparent ou, pire, invisible.
Les deux ventes du matin avaient été conclues avec des lecteurs qui semblaient vouloir me faire plaisir. Peut-être avaient-ils eu pitié. J’ai également eu des remarques déplacées du genre : « Ce que vous avez écrit ne doit pas être terrible pour être ici… » ou bien « Vous savez où se trouve le rayon des croquettes pour chat ? »
Une leçon d’humilité.
J’avais beau expliquer que l’histoire de mon livre était tirée de l’affaire dramatique de la serre de Kernisi de Plougastel qui avait défrayé la chronique l’année dernière et dans laquelle j’avais été impliqué au point d’y avoir risqué ma vie, rien n’y faisait. En désespoir de cause, j’argumentais en précisant que j’étais publié par un grand éditeur parisien. Mais la plupart des gens s’en moquent complètement et n’y connaissent rien en matière d’édition. Comme moi, neuf mois auparavant.
Un élu s’était senti obligé de m’acheter un exemplaire. Peut-être une façon de me remercier des nombreux articles que j’avais réalisés sur la commune relatant les projets et réalisations du maire.
Le summum est arrivé en milieu d’après-midi. Le pot de fleurs installé au bout de ma table avait été récupéré au rayon jardinage du magasin, le prix encore fixé à l’extrémité du tuteur en plastique. Une vieille dame passe devant moi en s’accrochant à son caddie comme à un déambulateur. Elle s’arrête devant la magnifique plante, observe l’étiquette, empoigne le bocal, le met dans son chariot et continue son chemin sans un regard.
Coup de blues.
Je range les marque-pages dans mon sac à dos, fourre ma clope élec dans la poche et enfile mon blouson de motard.
— Vous partez déjà, monsieur Mahé ? me demande l’hôtesse de l’entrée.
— Désolé. Un appel urgent du journal. Merci pour votre accueil. À bientôt.
Je prends mon temps pour rentrer dans mon repaire, au Tinduff. Les routes à cette période de l’année sont dangereuses à moto. Même si ma Low Rider S Harley-Davidson tient particulièrement bien le pavé, les feuilles sur le bitume détrempé sont source de glissades. J’aurais pu venir en voiture. Ma vieille Renault 4L répond toujours présente, mais les sensations ne sont pas les mêmes au guidon d’une bécane dont les vibrations du gros bicylindre m’embarquent dans un univers sensoriel qu’aucune automobile ne saurait faire. Sauf peut-être les sportives haut de gamme. Ce ne sont pas les piges aux Voix de l’Ouest ni les maigres ventes de mon bouquin qui me payeront un bolide sur quatre roues, sans compter le coût carbone de ces engins. Ce n’est pas avec une Ferrari, une Lotus ou une Rimac Nevera – sûrement le top – de plus dans ce monde au dérèglement climatique évident que ça changerait quelque chose. Mais issu de parents agriculteurs biologiques, je me dois de respecter leur mémoire et montrer mon attachement à la cause qu’ils ont constamment défendue : préserver la nature.
J’arrive sur les hauteurs du Tinduff avec toujours autant de plaisir. Non loin du port, mon domaine est l’ancienne ferme héritée de mes parents. Même si j’ai vendu la majeure partie des terrains, j’en ai sauvé suffisamment pour m’isoler du village.
J’entre la Harley dans le garage et la range à côté de la 4L.
Je fais chauffer de l’eau et me pose avec un bock de thé sur la terrasse qui donne sur l’anse du Moulin Neuf, Pont Callec et Pors Gwen. Je savoure ces terres de Plougastel qui tombent dans la mer d’Iroise. La lumière n’est jamais la même suivant l’heure de la journée ou les saisons. Un petit bonheur que je ne partage avec personne. Rien d’égoïste. Pas eu l’aubaine de croiser quelqu’un avec qui je pourrais construire une vie à deux. Je ne cherche pas. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas attiré par quelques Plougastellenn. J’aurais bien tenté ma chance avec Zoé Kerjean, une amie de lycée, redécouverte en uniforme de gendarme lors de l’affaire de Kernisi. J’ai eu l’impression que l’on n’était pas indifférent l’un à l’autre. En réalité, j’extrapole. Pas certain que je lui ai provoqué le moindre effet. Et puis, dans une commune comme Plougastel où tout se sait à un moment ou à un autre, une relation entre une lieutenante de gendarmerie et un correspondant local de presse ne serait sûrement pas vue d’un bon œil. Les gens que je rencontre pour un article se méfieraient. Que serais-je capable de raconter sur l’oreiller ? Foutaises ! La réciproque serait également de mise à la brigade. Zoé risquerait d’être suspectée de dévoiler des secrets d’enquête à un petit journaleux.
Et l’amour dans tout ça ? J’efface de ma tête cette idée saugrenue. Depuis plusieurs semaines, voire des mois, je n’ai aucune nouvelle d’elle. Cet été, on s’est croisés une fois sur la place du Calvaire, un jour de marché. On s’est promis qu’on allait s’appeler. Depuis, plus rien. L’affaire de la serre de Kernisi a laissé des traces. D’une certaine façon, elle nous a rapprochés, mais elle m’a surtout fait beaucoup de mal. Pas facile, ni pour l’un ni pour l’autre, de gommer ce qui s’est passé. J’ai pourtant des raisons pour la recontacter. Elle m’avait dit qu’elle allait reprendre les investigations sur la mort de mes parents. Je n’ai pas osé la relancer. Pas besoin de cumuler les douleurs.
Je souris. Ce que j’ai face à moi fait s’envoler mes soucis et mes peurs.
Je reste là de longues minutes à observer la lumière décliner. Ce n’est pas la période de l’année que je préfère. La fin octobre annonce l’arrivée des journées les plus courtes. Si les températures sont plutôt élevées pour un automne, les pluies ne nous ont pas épargnés depuis des semaines. Rares sont les moments où le soleil a pointé son nez. Tant pis pour les grincheux qui trouvent que la Bretagne est humide. S’ils ne sont pas contents qu’ils retournent d’où ils viennent.
J’aperçois au loin un voilier. De ma terrasse, je ne vois pas son nom. D’allure, je pense au coquillier Général Leclerc. Il y en a bien d’autres dans le secteur. La Bergère de Domrémy, le Notre-Dame-de-Rumengol ou le Loch Monna naviguent régulièrement dans la rade. Ici, dans la baie de Daoulas ou dans l’anse du Moulin Neuf, il y a quasiment toujours du vent, mais les côtes protègent les navires d’une forte houle ou de grosses bourrasques.
En fin d’après-midi, je rejoins la dépendance où sont stockés tous mes essais culturels : des peintures abstraites sans signification précise, des fragments de textes épinglés sur un tableau en liège. Peut-être seront-ils un jour l’ébauche d’un troisième roman. Parce que le second est déjà presque bouclé. Il me reste quelques retouches à effectuer.
Cette fois, je me suis embarqué dans une fiction totale. Un homme complètement parano est hanté par des fantômes qu’il découvre à travers l’objectif de son appareil photo. Il est persuadé que sa femme est en danger et, pour veiller sur elle, il l’enferme dans un grenier. S’ensuit une descente aux enfers pour l’épouse et mon personnage. Est-il prisonnier de sa folie ou bien subit-il une manipulation subtile d’un serial psychopathe ? La chute, dramatique, apportera la solution.
Sous la forme d’un synopsis, j’ai proposé l’idée à mon éditrice dès que j’ai été à peu près clair dans le déroulement de l’intrigue. Elle n’a pas semblé convaincue, mais elle m’a motivé à continuer. « Faudra que je lise l’ensemble pour bien appréhender ce récit. Prends le temps nécessaire pour bien poser la psychologie des protagonistes et établir une trame solide. Je te sens un poil confus. »
Effectivement, rien ne presse sauf que je ressens une urgence à écrire. Je n’avais jamais connu cela auparavant. « On n’a aucun calendrier. On n’a aucune obligation d’éditer un ouvrage par an. On ne peut pas se permettre de publier un livre si l’histoire n’est pas aboutie. » Je ne sais pas ce qu’est une bonne fiction parfaite et achevée.
Demain, je m’y remettrai et je fignolerai la fin. Pour l’instant, envie de guitare. Je sors ma réplique de la mythique Stratocaster Fender. Je la branche sur l’ampli et m’assieds sur un tabouret. Je suis un piètre musicien, incapable de jouer debout comme les vrais guitaristes de rock. Sur internet, j’ai trouvé de nombreuses applis montrant les accords basiques et quelques extraits faciles à interpréter comme la mélodie de The Sound of Silence de Simon and Garfunkel ou les premières notes de Smoke on the Water de Deep Purple. Pas très récent, tout ça. Une forme de nostalgie pour une époque que je n’ai pas connue puisqu’avec mes trente et un ans, je n’étais pas né quand ces tubes ont été créés. Je ne suis pas capable d’exécuter mes morceaux favoris. Bien loin des Jimmy Hendrix, Éric Clapton, Angus Young ou de Mark Knopfier. Même en suivant des cours, je sais que je n’ai pas le sens du rythme et aucun don en la matière. Je me contente de gratouiller les cordes et de faire semblant.
Mes parents étaient plutôt adeptes de musique bretonne ou d’artistes comme Alan Stivell. Peut-être une façon pour moi de leur échapper.
Je suis interrompu par le jingle de mon téléphone annonçant un SMS. J’avais complètement oublié la réunion de ce soir à Brest. Tous les ans, à la même période, les correspondants locaux des Voix de l’Ouest de Brest métropole et du Finistère nord sont réunis pour une grande messe dans une brasserie du centre-ville. L’occasion pour la rédaction de renouveler ses consignes sur les faits à couvrir ou les invitations à décliner. C’est également un moment important de démocratie participative où toutes les questions peuvent être posées. Quant aux réponses ? Le rédac chef de la région Bretagne sera présent pour répandre les saines paroles. Béa Le Gall, la rédactrice du secteur brestois, sera en retrait. C’est ma référente. Je ne sais pas si elle a développé les mêmes relations avec les autres correspondants, mais nous avons une connivence particulière tous les deux, avec beaucoup de respect l’un envers l’autre. Il est vrai que ce n’est pas tous les jours qu’un petit gratte-papier comme moi se retrouve impliqué dans une affaire aussi considérable que celle de la serre de Kernisi. C’est même le fondement de mon livre. Bien que ce soit un roman, la quasi-totalité de ce qu’a vécu mon personnage, un jeune journaliste pris dans une histoire d’assassinats, est réel. C’est la mienne.
J’ai ressenti l’envie d’écrire comme un impératif. À peine remis, je me suis attelé à rédiger cette pseudo-fiction en septembre de l’année dernière. Moi qui me sentais incapable de construire un récit de 400 pages, je l’ai tapé sur mon ordi comme si je visionnais un film.
En décembre, Béa a lu le manuscrit avant que je l’envoie comme une bouteille à la mer à plusieurs éditeurs. Elle n’a pas été persuadée de la pertinence de mon texte, mais elle n’a rien trouvé à redire quant aux faits racontés. J’avais changé les noms et modifié les lieux. Bien sûr, certains protagonistes pouvaient se reconnaître, mais rien n’était attaquable juridiquement.
— Pour moi, écrire a été une forme de thérapie. Besoin d’évacuer des trucs.
— Si ça te soulage, continue alors.
J’en ai même parlé à mon psychiatre, Arthur Bouvier, qui n’avait pas été neutre dans la résolution des crimes de Kernisi. Il avait jugé l’idée excellente. Plus d’un an qu’il est mon psychothérapeute. Quand on rentre en analyse, que l’on fouille dans le tréfonds de son cerveau, ce n’est pas pour quelques mois. Je suis parti pour des années.
Au début de février, j’ai eu cette chance inouïe d’avoir convaincu la responsable éditoriale des Éditions Fortuites. J’ai été reçu comme un prince dans leurs locaux parisiens où j’ai signé mon premier contrat. Le bouquin a été publié à la fin août.
N’y connaissant rien en la matière, j’ai cru que j’allais enfin toucher le Graal quand j’ai eu une chronique sympa sur France Info, un bon papier dans la revue La Fringale Culturelle et des reportages dans le Télégramme, Ouest-France et sur FR3 Iroise. Béa n’a pas souhaité écrire d’article sur moi. « Tu es le correspondant du journal pour Plougastel. Je ne veux pas mêler les genres. » Je ne l’ai pas comprise, mais je n’ai pas insisté. De toute façon, Les Voix de l’Ouest sont loin derrière ses concurrents. Pas grave.
J’en aurais désiré plus, mais je n’ai pas eu les honneurs de l’émission La Grande Librairie d’Augustin Trapenard sur France 5 ni de celle de Laurent Ruquier. « Pas de précipitation, Malo. Chaque chose en son temps », m’avait prudemment dit mon éditrice.
Je monte à l’étage pour me préparer. Le passage sous la douche va peut-être me laver de la frustration ressentie au supermarché. J’élague ma barbe et me passe un coup de rasoir sur le crâne. Dans le miroir, je revois les marques au cou. Ces traces qui resteront indélébiles dans ma tête me ramènent à ce jour du 4 juillet de l’année dernière où je me suis retrouvé pendu à une poutre dans une grange. Peut-être bien que j’ai été mort pendant de longues secondes.
Cette partie a été difficile à écrire.
Bref, une page s’est tournée avec l’arrestation du criminel.
Je veux y croire.
Thibault Morvan est en prison et le restera pour des décennies. L’instruction est toujours en cours même s’il n’y a aucun doute sur sa culpabilité avec quatre assassinats à son actif. Je devais être le cinquième. Cette affaire a défrayé la chronique et largement dépassé le cadre de Plougastel. Ce n’est pas rien, quatre meurtres causés par un seul homme dans un bled de 13 800 âmes !
Ce soir, je délaisse ma bécane pour prendre ma Renault. De nouvelles averses sont prévues.
L’occasion de mettre d’autres vêtements que mes fringues de moto. Exit mon équipement de cuir. J’enfile un jean, une chemise assortie et un gilet en laine, sans oublier un bonnet et une parka.
Direction le centre-ville de Brest.
2
Jamais contents. C’est un peu comme ça que l’on pourrait qualifier les correspondants locaux de la presse régionale, quel que soit le titre du canard. Surtout quand ils sont tous réunis. L’union fait la force. La grand-messe d’hier a apporté son lot de revendications. Le rédacteur en chef de la région Bretagne a été particulièrement patient, mais ferme dans ses réponses : pas d’augmentation de la rémunération. Nous ne sommes pas des salariés. La rétribution que nous tirons de notre travail est un complément de revenus. On le sait tous, mais qui ne tente rien n’a rien. On a tenté et on n’a rien obtenu.
Dont acte.
On a eu le droit à un rappel des lignes directrices du journal avec comme principale : centrer nos piges sur l’humain. Mettre du cœur dans le cœur des articles… sans être des bisounours pour autant, ni tomber dans le pathos. OK. Rien de nouveau. Nous avons reçu également des directives pour la tempête à venir. De son petit nom « Ciaran », il est prévu qu’elle ravage une partie du Finistère. On restera tous confinés chez nous la nuit du 1er et 2 novembre. Mais dès qu’elle faiblira, nous devrons nous intéresser aux dommages causés aux habitants de notre commune. Sans voyeurisme. Relater l’impact sur les gens, leur vie. Inévitablement, il y aura de belles histoires à raconter, et de moins bonnes.
On nous demande de fournir un maximum de photos dès l’après-midi du 2 afin que les journalistes soient en mesure de construire des reportages rapidement publiés sur le site web du journal.
— On tente de ne pas être à la traîne de nos concurrents, nous a dit le patron.
J’aurais pu ajouter « pour une fois ». Mais je ne suis pas du genre à râler.
Pendant le repas qui suit la réunion, je me suis assis avec Béa Le Gall en bout de table. Pas fréquent qu’on ait l’occasion de se retrouver en face à face. Le plus souvent, on communique par téléphone, SMS et mails. Béa est une femme pleine d’énergie. Elle paraît fragile de prime abord, mais les apparences sont trompeuses. C’est une belle personne qui a défendu sa place bec et ongles. Comme dans de nombreux métiers, elle a dû montrer qu’elle était à la hauteur. Bizarre comment la gent féminine est tenue de prouver plus que les hommes ses capacités, à diplômes et expériences identiques. L’égalité femme-homme est loin d’être acquise. Bien entendu, la majorité des dirigeants masculins de ce pays réfute cette thèse, mais il suffit de jeter un œil sur les statistiques nationales pour remarquer que la parité n’est pas de mise. Rien qu’au niveau des entreprises du CAC 40, seulement quatre pour cent des postes de direction sont occupés par des femmes.
— Alors, Malo, comment vas-tu ?
— Il y a un peu de travail sur Plougastel. C’est la saison des assemblées générales. Je ne chôme pas.
— Je ne parlais pas du journal, mais de toi.
Ce recentrage sur ma personne ne souffre d’aucune ambiguïté. Béa cherche vraiment à savoir comment je vais. L’affaire avec Thibault Morvan a laissé des traces traumatiques. Béa est sûrement la personne qui me connaît le mieux, sauf peut-être Arthur Bouvier, mon psychiatre, que je paye pour ça.
Je cligne des paupières. Je tente de contrôler une montée de larmes. Béa s’en aperçoit et me pose une paume sur la main.
— Désolée, Malo. Je n’aurais pas dû. Discutons d’autre chose.
— Ça ne s’effacera jamais. Le temps va atténuer les douleurs, mais là, dans la tête, il restera des images qui ne s’élimineront pas de sitôt. Je vois une fois par semaine mon psy, mais, parfois, j’ai la sensation de ressasser indéfiniment les mêmes trucs.
— Tu en es où de l’écriture ?
— Un bon exercice pour évacuer les émotions. J’ai presque bouclé un second roman. Mon éditrice va rapidement le recevoir.
— Avec toujours un correspondant local qui mène des enquêtes qui ne le concernent pas ?
Je souris.
— Non, pas sur ce coup. De la fiction pure. Je réfléchis déjà à un troisième. Peut-être que je vais revenir sur mon premier personnage. Il me plaît bien, ce jeune correspondant local. Ce n’est pas les anecdotes qui manquent sur la commune. De là à en écrire 400 pages, il y a une marge. Je dois trouver un fil conducteur.
— Pas tous les jours qu’une série d’assassinats se déroule dans le secteur. Avec le tome un, tu as mis la barre haut.
— L’affaire n’est pas terminée.
— Le criminel est sous les verrous.
— Oui et je suis l’une de ses victimes, tout en étant témoin. J’ai été entendu par la justice et je le serai encore. Puis, il y aura un procès. Peut-être dans deux ou trois ans. Sans compter les appels éventuels. Les procédures sont longues dans notre pays. De fait, je ne peux pas vraiment prendre de la distance.
— Tu es toujours accompagné par le même avocat ?
— Oui, maître Lucas Bellanger. Un gars assez étonnant. Il avait été commis d’office quand j’avais été injustement suspecté. Je me suis méfié de lui. Un jeune qui débute dans le métier, mais en réalité, c’est un bon. Je l’ai gardé. Il connaît parfaitement le dossier. Aucune raison d’en embaucher un autre à qui il faudra tout réexpliquer.
Une monstrueuse choucroute de la mer est arrivée sur la table. Les bouteilles de blanc ont circulé. Comme d’habitude, j’ai accaparé la carafe d’eau. L’alcool a cette particularité d’apporter des sourires aux lèvres même avant d’être bu. Il suffit d’apercevoir les carafons se pointer pour que la bonne humeur élimine la grisaille ambiante.
Et puis, c’est la rédaction qui régale ce soir. Autant profiter des largesses du chef. Une fois par an, ça ne mettra pas le journal sur la paille.
Bizarrement, d’un coup, je ne me sens plus à ma place. Je regarde tous ces gens de façon détachée. Je suis physiquement présent, mais je ne les écoute pas. Comme si je m’étais posé un casque antibruit sur les oreilles. Parfois, je me force à rire, je réponds par des phrases laconiques, mais ma tête est ailleurs. Le problème est que je ne sais pas où elle se trouve réellement.
Je me lève avant le dessert et je pars sans rien dire. Je vois le regard de Béa. Elle me sourit et cligne des paupières. Un signe pour me signifier qu’elle a compris que je ne peux plus rester.
Je suis rentré au Tinduff sous une pluie battante.
Malgré l’heure tardive, j’ai ressorti mon manuscrit pour en peaufiner la chute. L’intitulé est nul : Les fantômes dans l’objectif. Digne d’une série B… voire de troisième zone. Pas important. Mon éditrice le changera comme elle l’a pratiqué pour le tome un. C’est de sa responsabilité de pondre les titres qui flashent en fonction du public visé. Idem pour le résumé de la quatrième de couv’ et la photo de couverture. Elle sollicite mon avis, mais, à la fin, c’est elle qui décide. Un avantage en réalité. Si cela ne fonctionne pas, ce ne sera pas de ma faute, une façon de reporter sur elle les éventuelles mauvaises ventes.
Le lundi 30 octobre, j’y mets un point final. Je l’envoie par mail à mon éditrice en lui souhaitant une bonne lecture. Des écrivains avec lesquels j’avais sympathisé m’avaient dit que le plus difficile était d’éditer le premier livre. Ensuite, l’éditeur accepte plus facilement un manuscrit un peu moins abouti. Publier un nouvel auteur est un pari sur le long terme. Un investissement en temps et en argent pour la maison d’édition. Je dois m’attendre à ce que l’on me demande de retravailler le texte, voire une partie de l’histoire. Aucun souci pour moi. Je n’ai pas un ego surdimensionné au point d’imaginer que la mouture primaire serait absolument parfaite quand bien même j’aimerais rendre une copie impeccable du premier coup. Je ne me fais pas trop d’illusions. Je reçois un retour dans la foulée : « Je vais le lire rapidement. Merci beaucoup pour ta confiance. »
J’occupe les deux jours suivants à réaliser des piges pour le journal. Entre les déplacements, les interviews et la rédaction des articles, ça me prend tout mon temps. Je navigue entre les assemblées générales d’associations d’anciens combattants, de clubs sportifs, de quartiers et deux phoners d’artistes qui se produiront prochainement à l’Espace Avel Vor, la grande salle de spectacle de la commune qui, cela dit en passant, est en train de subir un sacré ravalement qui n’est pas du luxe.
Le soir du mercredi 1er novembre, je range tout ce qui risque de s’envoler en prévision de la tempête à venir. Les alertes m’arrivent par différents canaux de communication. Personne ne pourra dire qu’il n’était pas prévenu. Ça va souffler dur. Peut-être qu’elle sera plus forte que celle de 1987. Je n’étais pas né, mais je me souviens de mes parents qui en parlaient régulièrement comme étant la pire depuis des lustres.
Cet été n’a pas été beau ni chaud dans le Finistère. On a eu notre lot de pluie avec des températures plutôt faibles pour la saison. Ça n’a pas été le cas partout. S’il y a encore des gens qui pensent que le dérèglement climatique est une foutaise, une invention des puissants pour nous faire peur, qu’ils aillent se balader dans d’autres régions ou d’autres pays. Entre sécheresses extrêmes et inondations hors norme, ils verront que certaines contrées morflent déjà. Ce problème ne sera pas vécu par nos petits-enfants. Non. Il est là, sous nos yeux.
J’effectue le tour complet de la maison et des dépendances. Le bâtiment central fêtera bientôt ses soixante-dix ans. Je me console en me disant qu’il en a vu d’autres. Au pire, je perdrai quelques ardoises. Les arbres aux alentours ne sont pas très hauts. Aucun ne pourra s’affaler chez moi. Le hangar où se trouvent mes véhicules est plus fragile avec sa toiture en tôle ondulée. Il est trop tard pour y remédier. Quant à mon atelier, il paraît bien protégé.
Je ferme tous les volets et boucle les accès à double tour.
Cette nuit, l’ours restera dans sa grotte.
Quand je me couche, le vent est sacrément violent. Ce sont les bourrasques qui me foutent la trouille. Je les entends filer dans la rade et se fracasser sur la côte, contre ma maison.
Allongé sous la couette, je regarde une dernière fois une appli qui affiche la vitesse des rafales en temps réel et dans les heures à venir. On a des coups de boutoir à 150 km/h. Le pire est à craindre avec des pointes avoisinantes les 180, voire les 200.
Le dieu Éole va s’en donner à cœur joie. On paye nos errances.
Le pont de l’Iroise est évidemment interdit à la circulation. J’ai lu un article dans un journal concurrent qui explique que les vibrations dues au vent sont les plus problématiques entre 140 et 180 km/h. En dessous et au-dessus, cela pose moins de problèmes.
On verra demain dans quel état il sera.
Pour l’instant, je n’ai qu’à attendre.
Certains Bretons prieront sûrement cette nuit. Pour ma part, je croise les doigts.
3
Je n’ai pas beaucoup dormi. La peur que tout s’envole autour de moi. J’ai entendu des craquements dans la charpente. Des rafales se sont engouffrées entre les volets et les fenêtres. Ils ont résisté, mais, à plusieurs reprises, j’ai cru qu’ils allaient être arrachés. Face à ce déchaînement de violence, on se sent petit. On n’est pas grand-chose devant cette fureur. Le poêle qui me sert de chauffage principal a soufflé comme jamais. Je ne l’avais pas allumé de crainte que la fumée soit renvoyée dans la pièce. J’ai bien fait. Des cendres sont éparpillées sur le sol.
Mon réveil s’est éteint vers deux heures du matin. Sûrement des arbres tombés sur les lignes électriques aériennes. En prévision, j’avais chargé mon téléphone la veille. Si besoin, j’ai un groupe électrogène dans ma remise.
Mais la tempête n’est pas la seule fautive à mon sommeil agité. Si, pendant la journée, je maîtrise plutôt bien mes angoisses, je me relâche quand je m’endors. Je revis toujours le même cauchemar même s’il se présente de façon différente. Cette nuit, je me suis vu pendu à la poutre de la grange. J’étais spectateur et acteur. Je me déplace autour de mon corps suspendu en me parlant : comment vas-tu t’en sortir, Malo ? T’es dans une mauvaise posture. L’air te manque. Combien encore ? Une ou deux minutes avant de mourir ? Au moment où j’allais succomber, je me suis réveillé en sursaut, haletant, le torse recouvert de transpiration. Comme à chaque fois, la seule solution est de me lever pour ressusciter. Je tourne dans la pièce principale, bois un verre d’eau, tire sur ma clope électronique. J’essaie de ne plus cogiter. Je délaisse mon lit, m’assieds sur le canapé et termine ma nuit en me focalisant sur des pensées positives. Ça marche moyennement.
Le vent a faibli vers cinq heures. Il est toujours puissant quand, le jour levé, je décide d’effectuer un tour du propriétaire. Rapidement, je suis soulagé. Aucun dommage visible sur mes bâtiments. J’ai tout de même deux résineux qui ont été déracinés, mais ils se sont affalés loin de la maison. C’est triste de les découvrir comme ça, avec une grosse motte de glaise au pied, la cime au sol, les racines vers le ciel.
Je visite mon garage et l’atelier. Des outils sont par terre, ce qui démontre que les parois ont vibré suffisamment pour les faire tomber. Je remarque une flaque. Une tôle a dû se tordre, mais la toiture a résisté. Un moindre mal.
Sur la terrasse, je regarde aux alentours. Aucune embarcation n’est en mer ni échouée sur les grèves. Mes voisins semblent également bien s’en sortir.
J’attrape mon téléphone et descends la rue de Lestraouen. Juste après le virage qui suit la baie et mène au port, j’aperçois le parking face au quai an Aod. Au fond sont entreposés les bateaux pour l’hivernage. En les voyant, on conçoit aisément la puissance de la tempête. Montés sur leur rack, ils étaient alignés côte à côte. Quand le premier est tombé sur le flanc, il a provoqué la chute des autres. L’effet domino.
Je me rapproche et vole plusieurs clichés. Plusieurs ont la quille abîmée avec des safrans cassés. Pour la plupart, j’imagine que seuls les bords ont été touchés. Il faudra une grue pour les remettre sur leur socle. Les supports métalliques sur lesquels ils reposaient sont tordus ou brisés. Je n’ose pas m’aventurer plus en avant. Certains voiliers bougent encore au gré des bourrasques. Ils ne sont pas stabilisés. Ne prendre aucun risque. J’ai déjà quelques photos à proposer à la rédac.
De retour chez moi, je constate que l’électricité n’est toujours pas revenue. Pas d’internet. Mon téléphone n’a plus de 4G.
J’essaie d’atteindre le bourg en voiture, mais je suis rapidement empêché par des arbres qui jonchent la chaussée. Je rebrousse chemin. Aujourd’hui, je pense que je vais rester confiné. Je rapporte dans la cuisine un réchaud à gaz de camping déniché dans le hangar. Je me prépare un café avec une ancienne cafetière italienne. L’odeur me fait remonter en mémoire des souvenirs d’enfance. Mes parents ne partaient jamais en vacances. L’exploitation agricole leur bouffait tout leur temps, toute l’année. Mais, deux semaines par an, je rejoignais des amis de ma mère qui avaient une caravane. Avec leur fils, on plantait une tente à côté. Parfois, on n’allait pas très loin. La Vendée ou la Normandie étaient un véritable dépaysement pour un enfant de la pointe bretonne. Et puis, on roulait des heures pour tirer à bon port la roulotte. À dix ans, il ne me fallait pas grand-chose pour imaginer que sortir de ma Bretagne natale était une aventure. Les côtes normandes avec leurs falaises et les plages de galets me changeaient du sable et des rochers bretons. Quant à la Vendée ? Je ne veux pas être désagréable avec les Vendéens, mais, déjà à cette époque, je n’étais pas fan de ces grandes étendues où des centaines de touristes s’alignaient et cuisaient au soleil des journées entières. La plupart louaient des appartements dans les immeubles construits devant l’océan. Même le camping où l’on avait posé notre maison mobile était coincé entre deux hauts blocs en béton d’une dizaine d’étages.
Je suis en train de siroter mon café quand j’entends les tronçonneuses. Le déblaiement a commencé. J’enfile des bottes et un coupe-vent. Autant que je sois utile à quelque chose en proposant mon aide. Ma scie mécanique de petite taille n’est pas très puissante, mais je pourrai élaguer des branches au sol.
Mes voisins ont les traits tirés. Comme pour moi, la nuit a été longue. On a tous l’habitude des coups de vent, mais Ciaran fera date.
Très vite, l’entraide apporte des sourires. On se connaît, mais on ne se fréquente pas vraiment. Là, c’est sympa de se retrouver autour d’une action commune. On intervient au plus urgent. Le midi, on se réunit dans mon hangar et on partage ce que chacun a trouvé dans son frigo.
L’après-midi, on remonte sur le haut du Tinduff pour assister les services de la ville et de la métropole dont la tâche principale est de permettre les accès au bourg. Nous ne sommes pas franchement les bienvenus. On n’a pas les outils ni les compétences. On effectue quelques activités secondaires.
Je suis éreinté quand je rejoins ma maison. Je n’ai pas l’entraînement. Je ne suis pas un grand sportif. En réalité, je ne le suis pas du tout. Même si la nature semble m’avoir donné un physique plutôt avantageux avec une musculation qu’il n’est pas nécessaire d’entretenir, je mesure rapidement mon manque d’exercice. Certains de mes voisins, assez rondouillards, sont bien plus en forme que moi en fin de journée, bien qu’ils aient descendu plusieurs canettes de bière. Moi, j’avais embarqué une bouteille d’eau.
Le courant n’a pas été rétabli dans le quartier. Si demain c’est encore le cas, je mettrai en route le groupe.
Vers 17 heures, je reçois un appel de Béa. La communication est hachée. Les antennes relais fonctionnent à l’électricité avec des batteries qui leur assurent quelques heures d’autonomie. Sans jus pour les recharger, les portables seront bientôt inutilisables.
— Comment ça va ?
— Toujours vivant. Pas de dégât chez moi. Et toi ?
— OK… À Brest. Peux-tu…
— Je t’entends très mal.
— … envoie un SMS… gendarmerie.
Quelques secondes après, je réceptionne effectivement un message de Béa. Il est succinct : « Problème sérieux au Fresk… Présence de la gendarmerie… Coordonnées GPS à suivre. »
C’est à l’autre bout de la commune. Pas très prudent de m’y rendre.
Je saisis un bloc-notes que je fourre dans son petit sac à dos que j’utilise quand je pars à moto. Je m’équipe et quitte le Tinduff en Harley. Si les accès sont difficilement praticables en voiture, à deux-roues, ce sera peut-être plus facile.