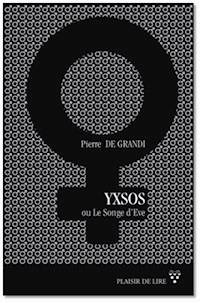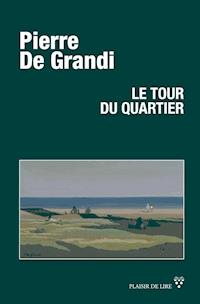
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Plaisir de Lire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Quand un chien prend le rôle de narrateur et nous emmène faire le tour de son quartier...
Un jour, j’ai vu un type tout seul, assis sur un banc, dans un square. J’ai pris note du coin de l’œil, sans plus. Avec le retour des beaux jours, je l’ai revu plusieurs fois en faisant mon tour du quartier. Sur le même banc. Tout seul. Un peu chiffonné. Calme, les yeux baissés, un sac de toile à côté de lui. Il m’a regardé. D’abord surpris, presque méfiant, il semblait étonné d’être assis là, sans rien faire, comme arrêté entre patience et impatience. Un peu comme moi quand j’attends que ma patronne me laisse sortir. Se pourrait-il qu’il subisse lui aussi un certain asservissement comme prix de son confort et de sa bonne conscience?
Un chien raconte son quotidien, ses rencontres, et plus particulièrement celle qui nous amènera à découvrir comment il se fait que nous lisions ce qu’un chien, contrairement aux apparences, n’a évidement pas écrit.
Sans tomber dans l'anthropomorphisme, ce roman original nous invite à décoder notre propre monde.
EXTRAIT
Mâtiné d’un peu de renard avec quelque chose des hommes auprès desquels me fait vivre ma névrose, je reste néanmoins et avant tout un chien.
Que je me sens bien à quatre pattes ! C’est stable, et bien commode pour renifler au ras du sol, là où j’ai le plus de chances de déceler le passage d’un intrus, là où j’espère toujours identifier l’odeur épicée de cette chienne de belle race que j’ai dans les narines et que je rêve d’avoir encore sous mon ventre. Quant à mon cerveau, il recèle un programme incontournable qui, deux fois par jour, s’impose à mon existence : je dois faire le tour du quartier, pour vivre ma vie de chien.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
En plus de côtoyer un personnage de chien réussi bien que sous-employé, les amateurs de beau langage seront servis : l'auteur fait usage d'une langue poétique et opulente à souhait, qui exploite avec pertinence tous les registres de langage, sans craindre de s'encanailler. -
Blog Fattorius
À PROPOS DE L'AUTEUR
Originaire de Zell, dans le canton de Zurich,
Pierre De Grandi est né à Vevey en 1941. C’est à Lausanne qu’il obtient son diplôme de médecine en 1966 puis son doctorat en 1970. Médecin-chirurgien, enseignant et scientifique, il a terminé sa carrière en 2007 en tant que Chef du Département de gynécologie-obstétrique, Directeur médical du Centre Hospitalier Universitaire vaudois et Professeur à la Faculté de Médecine de Lausanne.
Fils de peintre et homme d’une très grande culture, il est passionné de musique et préside l’Association vaudoise des amis de l’Orchestre de la Suisse romande. Il est l’auteur de nombreux livres et articles scientifiques mais
YXSOS ou Le Songe d’Ève est son premier roman publié.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 232
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ce livre paraît avec le soutien
des bibliothèques et archives de la Ville de Lausanne,
du Canton de Vaud et de la Loterie Romande.
ISBN : 978-2-940486-48-9
© Éditions Plaisir de Lire. Tous droits réservés.
CH – 1006 Lausanne
www.plaisirdelire.ch
Couverture : Marlyse Baumgartner
Version numérique : NexLibris – www.nexlibris.net
DU MÊME AUTEUR
Yxos ou le songe d’Ève,
Éditions Plaisir de Lire, coll. Frisson, 2011.
PIERRE DE GRANDI
LE TOUR DU QUARTIER
ROMAN
Mais que savent les mouches ?
Et que savent les chiens ?
Et, tant qu'on y est, que savent les hommes ?
Paul Auster, Tombouctou
LES ROSES D’ALBERT
Mâtiné d’un peu de renard avec quelque chose des hommes auprès desquels me fait vivre ma névrose, je reste néanmoins et avant tout un chien.
Que je me sens bien à quatre pattes ! C’est stable, et bien commode pour renifler au ras du sol, là où j’ai le plus de chances de déceler le passage d’un intrus, là où j’espère toujours identifier l’odeur épicée de cette chienne de belle race que j’ai dans les narines et que je rêve d’avoir encore sous mon ventre. Quant à mon cerveau, il recèle un programme incontournable qui, deux fois par jour, s’impose à mon existence : je dois faire le tour du quartier, pour vivre ma vie de chien. De coins de mur en réverbères, de trottoirs en allées, je suis l’itinéraire précis que m’imposent mes habitudes, en me disant, pour me rassurer, que je les ai librement choisies.
Ça y est, ma patronne m’a ouvert la porte. Ouf ! …A vous je peux le dire : son parfum est bien trop violent pour mon subtil odorat. C’est comme un incendie, ça me brûle les papilles, surtout lorsqu’elle vient de s’en asperger. A croire qu’elle n’en perçoit même plus l’odeur insistante qu’elle traîne partout avec elle comme une nuée. Notez que ça lui va bien une nuée, puisqu’elle est nue sous sa robe de chambre. Bien sûr, je ne vois pas sa nudité, mais je renifle et je sens qu’elle est à poil, si je peux le dire ainsi. Je peux même affirmer que, de toute évidence, elle ne s’est pas encore douchée ce matin et que ceci, poivré par les effets des gémissements que j’ai entendus hier soir avant que son ami Albert ne reparte, vient compliquer sa nuée.
A peine dehors, je lève la truffe et je sais d’emblée qu’il n’a pas plu : ma tournée sera donc pleine de marques odorantes et de réminiscences non encore emportées par cette saleté de flotte qui tombe si souvent du ciel et fait, paraît-il, puer mon poil. Enfin, c’est ce qu’ils disent chez moi, en essayant de me culpabiliser d’avoir voulu sortir malgré la pluie. Pour moi, mon poil ne pue jamais. Au contraire, je raffole de toutes les senteurs que recueille mon pelage au cours de mes tournées. Et je ne culpabilise pas, car chacun aime ses effluves. J’ai même surpris ma patronne à renifler furtivement son slip avant d’en changer. Et pas qu’une fois. Allez savoir !
Il fait frais. C’est mieux pour les odeurs. La chaleur excessive ne leur vaut rien et la canicule les détériore.
Tiens, voilà Albert qui revient. C’est rare le matin. Oh ! le sans-gêne : il cueille une fleur dans la plate-bande du voisin. Une rose, puis une deuxième. Et de trois. Il doit avoir quelque chose à se faire pardonner. Ou bien il se sent comme moi, quand j’ai tellement envie de trouver la trace de cette chienne dont je vous ai déjà parlé. Peut-être que le rêve d’Albert, c’est d’honorer ma patronne comme je fais moi. Du reste il m’a vu, une fois qu’en passant j’avais fait plaisir à la chienne de la concierge d’en face, le temps de la lécher un peu, comme je fais toujours, avant de leur poser mes pattes sur le dos, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà qui pourrait avoir donné des idées à Albert, mais il doit se dire que ce n’est pas forcément le genre de ma patronne parfumée, volubile et tout. Alors il pense que les fleurs ça pourrait l’aider à créer l’ambiance, comme ils disent.
Il veut savoir s’il est bien tombé, Albert, avec ces roses. Alors il se les colle sous le nez. C’est à n’y rien comprendre. Qu’est-ce que cette odeur fadasse de végétal inerte et totalement inutile peut bien avoir avec l’idée d’Albert ? Moi, je préfère déclarer mes offres contre un poteau ou contre un mur. Jamais je n’aurais l’idée de confier le moindre de mes désirs à une plante. Ce pauvre garçon semble ignorer que ma patronne a tout ce qu’il faut de non végétal pour le guider là où il veut aller. Il n’y comprend rien, Albert.
Je l’ignore et je pars dans le sens opposé. Le croiser est superflu, nous ne sommes décidément pas du même monde.
Ce constat ne signifie cependant pas que je pense cela de tous les humains. Non, je suis plus nuancé, j’ai fait mes observations : il y en a qui pensent un peu comme moi. Pas de doute. Mais d’autres sont plus que très chiens : je les ai vus faire bien pire que moi et pendant bien plus longtemps que moi. Surtout la nuit et tout particulièrement en absence de lune, là-bas dans le bois, du côté de l’étang.
UN TOUR D’ENFER
Que je sorte ou que je rentre, je ne suis pas de ceux qui glissent leur museau dans l’entrebâillement de la porte et forcent le passage, au risque de montrer ainsi qu’ils sont pressés, c’est-à-dire anxieux. Laisser percevoir son anxiété risque de dévoiler un sentiment de dépendance. Et moi j’évite, car je ne voudrais pas donner à ma patronne la possibilité d’user exagérément de mon assujettissement. Je suis déjà assez gêné d’avoir accepté tous ces compromis dont dépendent mes aises et mon confort. Il ne faut pas que j’y pense, sinon une sourde tristesse m’envahit et je me sens revêtu de honte.
Cette honte m’est venue le jour où j’ai rencontré Cartouche, un chien des rues avec lequel j’ai fait un tour d’enfer. A deux, c’est plus facile pour certains coups. Par exemple dans l’arrière-cuisine du restaurant « Au Chat Botté », ça avait été un vrai jeu de chiots de nous emparer chacun d’une côte de bœuf.
Nous savions que le gros matou, qui avait inspiré l’enseigne de cet établissement, était mort. Depuis quelques semaines, il ne se montrait plus, ne venait plus étaler son obésité sur les dalles du perron chauffées au soleil. Teigneux mais feignant, aussi fourbe que frileux, il avait crevé dans sa graisse, sur son joli coussin brodé de soie.
La porte de la cuisine donnant dans la cour était grande ouverte, si bien que de l’extérieur déjà nous avions repéré, dans un rai de soleil, une assiette posée à côté de la cheminée, et sur l’assiette, prêts à être mis au gril, deux beaux morceaux avec leur os.
Nous avons fait subrepticement irruption. Et, pendant que mon pote aboyait à tout va, puis saisissait la manche d’une grosse cuisinière en regardant vers la porte pour lui faire croire qu’il se passait quelque chose dehors, je m’emparai d’un des spécimens. Incapable d’aboyer sans lâcher le morceau, je levai la patte, et me mis à pisser dru sur le pied de la table, histoire de faire à mon tour diversion. La grosse dame saisit un torchon pour m’en frapper en hurlant et en me traitant de toutes sortes de noms que je ne compris pas. L’autre avait instantanément saisi la manœuvre. Calmement, il s’empara de la seconde côte de bœuf. Et là, nous nous sommes enfuis comme des voleurs, au point qu’après un tel effort il nous sembla que nous avions en définitive bien mérité notre butin.
Nous avons mangé en silence, l’un en face de l’autre, sans nous regarder, chacun la sienne, os compris. Un rare délice. Pour moi, néanmoins un peu émoussé à l’idée que la grosse femme puisse connaître ma patronne qui mange parfois dans cette gargote avec Albert. De toute façon, un tel coup n’est possible qu’une seule fois, même de l’avis expert de Cartouche qui s’était régalé comme jamais. Faut dire que son quotidien est plutôt maigre. Comme lui.
C’est en voyant ses flancs émaciés se creuser sous l’effet de son essoufflement que je me suis dit que, si la vie était pour lui à ce point difficile et précaire, je pourrais l’amener à la maison. Essayer de le faire accepter par ma patronne ou obtenir au moins qu’il reçoive de quoi se nourrir lorsqu’il viendrait jouer avec moi. Sur le ton d’un amical jappement, je lui demandai de m’écouter.
Ma proposition alluma une flamme de joie dans ses yeux, jusqu’à ce que son regard glisse sur mon encolure. Il y observait une discrète usure de mon pelage. Il avait compris – d’autant plus rapidement qu’il est un familier de Monsieur Jean de La Fontaine et que son grand-père avait été un authentique loup – que j’étais un de ceux qui acceptent de porter un collier.
« Non, merci ! » me dit-il, avec la dignité et le panache d’un Cyrano. Je lui reniflai la truffe pour lui signifier mon regret, il frotta son museau contre mon encolure comme pour m’assurer de son amitié malgré notre divergence.
Ensemble, nous ferons d’autres frasques. L’amitié et l’aventure nous avaient appris à nous connaître : lui indépendant mais souvent affamé, moi bien nourri, mais griffé par la honte de sacrifier ma liberté à mon confort.
Les humains, eux aussi, sont bien différents les uns des autres.
Il y a les cravatés pressés qui pensent à ce qu’ils appellent leur avenir. D’autres s’intéressent à ce qu’ils déclarent être leur qualité de vie : ils font du sport, se rencontrent au bistrot, inventorient, comparent et commentent mérites et défauts de chacun. Côté femmes, certaines sont douces et dépendantes de leurs rêves, d’autres se veulent aussi indépendantes qu’entreprenantes, mais ont cessé de rêver. Les meilleures seraient celles qui réalisent les ambitions de leurs rêves pour autant que nous soyons les acteurs de leurs songes.
RENCONTRE
Un jour, j’ai vu un type tout seul, assis sur un banc, dans un square. J’ai pris note, du coin de l’œil, sans plus.
Avec le retour des beaux jours, je l’ai revu plusieurs fois en faisant ma tournée. Sur le même banc. Tout seul. Un peu chiffonné. Calme, les yeux baissés, un sac de toile à côté de lui. J’ai commencé par m’asseoir en lui faisant face, à quelques mètres, sous un marronnier, sans le regarder.
Quelques jours plus tard, alors que j’étais assis à la même place, il m’a aperçu. Il a eu l’air d’abord surpris, presque méfiant, avec des yeux pourtant très tranquilles. Il semblait étonné d’être assis là, sans rien faire, comme arrêté entre patience et impatience. Un peu comme moi quand j’attends que ma patronne me laisse sortir. Se pourrait-il qu’il subisse lui aussi un certain asservissement comme prix de son confort et de sa bonne conscience ? Nous nous sommes observés, tous deux immobiles. Puis, sous son regard à la fois doux et peut-être triste, je me suis couché. Pour lui montrer ma confiance, j’ai fermé les yeux, tout en gardant ma truffe en éveil.
Je me souviens d’avoir rouvert un œil, sentant une odeur de pain : le type effritait un bout de baguette pour une volée de moineaux qui me croyaient endormi. Ils n’avaient pas tort : en l’absence de tout intérêt pour ces volatiles, si craintifs qu’il est définitivement impossible de jouer avec eux, je me laissai aller à m’assoupir.
A mon réveil, le banc était vide. Je pressentis que ce banc allait faire partie de mon domaine, de mon circuit obligé. Alors je m’en approchai pour le marquer en levant la patte. Puis je rentrai. Je savais que c’était le moment parce que l’air était nettement plus frais sur ma truffe et que les ombres des marronniers s’étaient beaucoup allongées.
Le lendemain j’arrivai dans le square plus tôt que d’habitude. C’est que j’y pensais, au regard de ce type tout seul et mal rasé. Je l’avais senti un peu comme moi, enclavé dans ses obligations. Se pourrait-il qu’avec son air aussi calme que préoccupé il revienne sur le banc où il m’avait vu ? De loin, ce banc me parut vide. Pourtant, il était là, mais allongé, et il dormait. Je m’assis.
Des enfants jouaient un peu plus loin, dans un bac à sable, sans faire trop de bruit. Sans non plus trop savoir que ce sable est le lieu d’aisance préféré des chats du quartier ! De tous ces faux frères indifférents et chafouins. De tous ces mauvais coucheurs, prétentieux et saintes nitouches, s’octroyant des airs de liberté alors qu’ils sont de toute évidence aussi dépendants que nous les chiens.
Le gars dormait d’une respiration calme et régulière, couché sur le côté, une main sous sa joue, l’autre dans la poche de son pantalon. Pas le moindre moineau. Seules les miettes les attirent, sans même qu’ils puissent savoir d’où elles viennent, vu que leur minuscule cervelle est entièrement vouée à la précision des mouvements de leur bec, à l’entretien de leur perpétuelle peur et, bien évidemment, aux problèmes de la navigation aérienne. Alors vous pensez, un type qui dort, ils sont bien incapables de le remarquer.
Moi pas. Et j’y vais d’un petit coup en levant la patte, pas par esprit de possession, mais juste pour marquer mon intérêt. Puis je me rassieds. Cette fois en osant me placer à une longueur de bras de sa tête qui dort.
Je regarde les enfants jouer. Dans la grande tache de lumière qui sépare l’ombre de notre marronnier de celle qui abrite le bac à sable, je vois passer quelques abeilles. L’air est doux, enfin débarrassé par le soleil du reliquat d’hiver qui avait fait perdurer la froidure des ombrages jusqu’à ces derniers jours.
Il a bougé, mais ses paupières restent closes. Probablement qu’il rêve. En tout cas c’est ce qu’on dit des chiens lorsqu’ils bougent en dormant.
D’autres enfants sont arrivés, plus grands, avec un ballon. Ils décident d’une cage de buts entre deux platanes, l’un d’eux s’y installe pour arrêter les tirs des deux autres.
Ce qui devait arriver ne se fait pas attendre : le gardien laisse passer un ballon qui vient percuter une poubelle vide, juste à côté du gars allongé sur le banc. Le vacarme le fait tressauter. Voyant qu’il se réveille, je me remets sur mes pattes, tourne le museau vers lui pour le regarder dans les yeux, sans bouger, en clignant des paupières, pour qu’il comprenne qu’il m’intéresse. Bien qu’il me trouve si près de lui à l’instant de son réveil, il n’a aucun mouvement de recul. Je vois dans son regard que son rêve s’estompe et l’abandonne. Il revient à la réalité : il me fixe, plus curieux que soucieux, le temps que la stridence d’une sirène d’ambulance se soit estompée. L’air déchiré reprend sa place dans le printemps et la rumeur de la circulation retrouve sa tonalité sur le boulevard.
Et là, je suis surpris. Mais j’ai heureusement la présence d’esprit de n’en rien laisser paraître. Tout en restant allongé, le type sort sa main de sa poche, déplie et étend lentement le bras et l’avant-bras. Il pose sa paume sur ma tête. Légèrement, doucement, pour me caresser. Je me rapproche pour qu’il ait moins à étendre son bras, pour qu’il ne se fatigue pas, pour qu’il continue à me caresser. Je n’ai jamais senti une caresse d’homme si calme et rassurante, si présente et généreuse. Je ferme les yeux. Il s’assied. Je me sens si bien que j’appuie mon museau sur sa cuisse. J’en arriverais à regretter de ne pas être capable de ronronner comme cette sale engeance de greffiers griffeurs.
Il se lève. Je le regarde partir.
Il se retourne, nos yeux s’alignent, nos regards se rencontrent, mais je ne le suis pas, il a sa vie et moi la mienne. En trottinant pour rentrer, je me demande pourtant si je ne me sentirais pas plus utile avec lui plutôt que d’être le chien d’une patronne qui a tant d’autres préoccupations avec, en plus, un Albert. A-t-elle autant besoin de son chien que moi j’ai d’attirance pour ce type ?
RETOUR
Quémander m’insupporte. Je préfère me débrouiller tout seul, et je n’aboie qu’en cas d’absolue nécessité. Ainsi, lorsque j’arrive sous la marquise, devant la porte de l’immeuble de ma patronne, j’attends, en silence, que quelqu’un entre ou sorte pour pouvoir m’introduire sans importuner quiconque. J’aime être patient, même si je m’ennuie parfois un peu. Du reste, c’est souvent dans ce vague ennui que me viennent des idées. Je m’assieds ou m’allonge, et je regarde les passants, les pigeons. Les ombres bleues des platanes s’étirent encore sur le macadam. Je somnole, ma truffe toujours aux aguets.
Voici qu’arrive la voisine du dessous. Elle rentre de sa promenade, ou plus précisément de celle qu’elle fait faire à son chien ridicule : un petit clébard ébouriffé, genre pékinois, aussi inconsistant qu’arrogant et gueulard. Impossible pour lui de s’approcher de moi sans pousser une quinte d’aboiements qu’il espère effroyablement intimidants, alors qu’il tremble de tout son corps. La vieille dame aux cheveux blancs sait que je ne bougerai pas et que je m’abstiendrai de répondre aux provocations de ce cabotin. Tout comme ma patronne ne se laisse guère intimider par les rouspétances et les agitations d’Albert ; elle se sait disposer de tout ce qu’il faut pour que ce pauvre garçon lui obéisse comme un toutou. A chacun ses servitudes ! Ceux qui voient le fil à la patte de leur maître veulent ignorer le collier qu’ils ont autour du cou. Hommes ou chiens, il nous suffit pourtant de goutter à un brin de liberté – par exemple en faisant un tour du quartier – pour comprendre que nous-mêmes sommes notre propre cage. Si la plupart s’en accommodent, quelques-uns pourraient chercher, un beau jour, à s’en échapper.
La vieille dame me regarde avec douceur et reconnaissance. Je vois dans ses yeux un brin d’admiration et un zeste d’envie. C’est peut-être ce que Cartouche, mon copain des rues, aura lui aussi vu dans les miens lorsqu’il m’a déclaré trop tenir à sa liberté pour se laisser passer un collier... Je suis flatté de m’apercevoir que c’est en réalité un chien comme moi que cette bonne voisine aurait souhaité pour compagnon, et je sais que la seule raison pour laquelle elle s’est résolue à promener ce clebs miniature est qu’elle ne tient plus très bien sur ses jambes. Elle a ainsi la certitude de ne pas être renversée par une brusque traction de son cador sur sa laisse. Pas plus que par un léger courant d’air. Elle sait aussi, comme tous les locataires de l’immeuble, qu’en m’ouvrant la porte elle rend service à ma patronne. Elle appuie deux fois sur le bouton de l’interphone. C’est le code convenu pour annoncer mon arrivée et, lorsque j’atteins le palier du troisième étage, la porte est déjà entrouverte pour m’accueillir.
Ce soir ma patronne se montre aimable, pour ainsi dire affectueuse. Elle va jusqu’à prendre un peu de temps pour moi, me caresse, même sous le menton, et en me regardant dans les yeux. Elle a peut-être senti que cet après-midi je me suis fait un ami. Moi, je soutiens son regard en m’arrangeant pour laisser traîner dans le mien un reste de tristesse, juste de quoi me montrer attachant, sans pour autant laisser paraître ma dépendance. C’est rare qu’elle soit aussi avenante, qu’elle marque pour moi une pause dans sa perpétuelle agitation. Je la sens détendue. Voilà, c’est ça, détendue et touchante et belle et jeune et appétissante, comme ils disent. Albert a dû la réussir magnifiquement, l’amenant même jusqu’à la surprise. Merci Albert.
En définitive, nul n’est inutile dans ce monde.
LES HUMAINS
Il est évident que les humains ont une tête beaucoup plus grosse que la nôtre. Surtout si on compare en faisant abstraction de l’appendice nasal. C’est d’abord pour tenir l’équilibre sur deux pattes, pour voir les couleurs dans les expositions de peinture et pour bien entendre la voix et le langage des autres. Sans oublier la musique qu’ils vont écouter, après s’être bien habillés, dans des endroits où les chiens ne sont jamais admis. Avec plein de cerveau dans leur grosse tête, ils font des choses dont les quadrupèdes n’ont pas du tout idée, des choses très compliquées, souvent inutiles, voire dangereuses. Ils peuvent aussi se parler, et ils savent rire. Là, je suis d’avis qu’ils ont beaucoup de chance. Certains savent chanter. Aïe, très peu pour moi ! Il faut croire qu’en perdant l’odorat les humains ont aussi émoussé leur sensibilité auditive ! Ou bien que nous, les chiens, nous n’entendons pas les mêmes choses qu’eux.
Tous sont censés savoir lire et écrire, mais beaucoup ne profitent pas de ce privilège :ils préfèrent regarder la télévision, sans réaliser que leur vie s’enfuit alors à leur insu. Heureusement, d’autres aiment faire comme moi, le tour de leur quartier. Pour aller musarder plus loin, certains prennent le métro ou leur vélo, voire leur auto. S’ils ne savent pas s’orienter selon leur odorat, ils sont par contre très forts pour se repérer grâce aux noms de rues, aux plans, aux cartes. Certaines de ces cartes sont même automatiques, en couleur et parlent dans leur voiture. C’est avec ce système que ma patronne est arrivée pile-poil à destination la seule fois où elle est allée rendre visite à Albert, alité en raison d’une orchite. Elle m’avait pris avec elle pour se sentir rassurée dans ce quartier qu’elle ne connaissait pas. Le bonhomme n’en revenait pas, il était enchanté de cette visite et tout excité de recevoir Madame, si séduisante. A voir comment tournaient les choses, de minauderies en sous-entendus de plus en plus explicites, j’ai regardé ma patronne avec autorité, avec un air de reproche suffisamment clair pour lui signifier qu’il valait mieux se retirer avant de compliquer l’inflammation de ce pauvre Albert.
Bref, les hommes sont bourrés d’aptitudes, quel que soit par ailleurs le degré d’amabilité ou de compassion dont ils sont capables, et indépendamment de la méchanceté ou du mépris qu’ils savent si bien manifester à l’égard de leurs semblables.
Mais il y a plus : ces humains auxquels nous, les animaux domestiques, avons fait allégeance, parviennent non seulement à se souvenir du passé tout en vivant leur présent, mais peuvent même penser à après. Ils sont capables de réfléchir pour savoir ce qui demain dépendra d’aujourd’hui et comment hier influence le présent. Ils ont compris que chaque événement, à l’instar de leur vie elle-même, est marqué par un début et une fin. Il n’en a pas fallu plus pour que le temps débarque dans leur univers. Une complication qui les fait courir ou languir, sans jamais les laisser en paix. Un truc qui me concerne aussi, puisque je vis proche d’eux, chez eux, dans le découpage de leur temps. De quoi s’affoler quand, par une simple multiplication, l’humain s’aperçoit que pour l’entier de sa vie il dispose, si tout va très bien, d’environ trente mille jours seulement, et que, s’il s’en rend compte après cinquante ans, ce nombre tombe à guère plus de dix mille. Alors il suffit d’évoquer les innombrables jours pourris d’avance par mille obligations ou par la météo, par la mauvaise conscience, les regrets ou les remords, pour avoir peur à jamais de cette invention des hommes qui s’écoule à leur poignet et les incite à enterrer leurs morts dans des jardins.
Certes ils ont leurs bonheurs – il suffit d’observer ma patronne devant son miroir – et ils ont la chance de nous avoir auprès d’eux. Mais c’est vrai que tout est très compliqué pour eux. Alors voilà, toutes ces complications occupent tant leur cerveau qu’ils en ont perdu l’odorat.
Ceci dit, les hommes ont parfois des comportements qui ne sont pas bien différents des nôtres. Lorsqu’ils se sentent menacés, il arrive qu’au-delà des mots qu’ils savent pourtant utiliser, leur ton soit bel et bien celui d’un aboiement. Très fâchés ou trop effrayés, ils ne se contentent pas, comme nous, de faire du bruit et d’envoyer des coups de dents, au pire d’arracher un bout d’oreille pour faire fuir l’intrus ou imposer une distance à leur agresseur. Eux, ils se laissent aller à ce que nous, les soi-disant animaux, nous ne faisons jamais à ceux de notre race : ils tuent les leurs. Voilà qui est bien inquiétant pour leur espèce. Nous, protégés par nos réflexes de fuite ou d’inhibition, nous ne risquons pas de disparaître de cette façon. Eux oui. Ceci est d’autant plus préoccupant que les carences de leur jugement et les excès de leurs ambitions mettent leur survie en péril. Il y a là de quoi alarmer ceux qu’ils appellent leurs animaux de compagnie, ceux dont je fais partie, certes pour mon confort, mais aussi parce que je les aime.
Oui, je les apprécie et je les admire. C’est pour cela que j’ai pu accepter de dépendre d’eux, malgré leur fragilité. Mais il serait périlleux de perdre toutes mes capacités d’autonomie. C’est pourquoi je fais deux fois par jour le tour du quartier. Pour avoir ma propre vie, pour faire des rencontres. Selon les circonstances, je peux me conduire comme un chien sauvage et voleur ou comme un compagnon de l’homme, prêt à faire alliance avec lui, par exemple dans un square, sur un banc, sous un marronnier promis à sa floraison.
Bon, je voulais réfléchir au problème du temps et voilà que je me suis laissé distraire. La question du temps est trop difficile pour moi. Pour pouvoir en parler, il faudrait que je vive un peu avec cette idée. Que je prenne le temps de soupeser l’importance du passé et l’intérêt du futur. Mais, tout compte fait, je ne suis pas certain que ce soit une bonne chose d’y penser, car c’est, à n’en pas douter, une question pleine de conséquences angoissantes. Jusqu’ici je n’avais aucune raison d’être anxieux ; je ne me préoccupais pas de cette interrogation sans tête qu’ils appellent l’avenir. A peine étais-je capable de comprendre lorsque ma patronne me promettait quelque chose pour « demain ». Par exemple, s’il arrivait qu’elle oublie de me préparer elle-même à manger et qu’elle me faisait bouffer une gamelle d’une nourriture mise en boîte depuis longtemps, je n’avais qu’une chose à comprendre : pour aujourd’hui je devais me contenter d’une pitance de secours. Même aujourd’hui n’avait pas grande signification pour moi, puisque je n’avais aucune raison de l’opposer à hier ou à demain. Maintenant, avec cette idée de temps, je découvre le passé, la mémoire, les souvenirs, les espoirs et les peurs qui vont avec, sans compter l’incertitude du futur et les tourments de l’angoisse. Et surtout, je comprends le pire : qui dit temps dit début, et qui dit début dit fin.
Là je baisse les oreilles et je me déconnecte de mon odorat, juste un instant, pour me concentrer. Si le commencement de ma vie ne m’a pas laissé de mauvais souvenirs, je me demande tout à coup quels espoirs pourra bien me laisser la fin.
Oh là ! C’est trop pour moi, trop pour aujourd’hui. Stop. Il est temps que j’abandonne ces pensées oiseuses – quitter ce vocabulaire de peur, revenir à celui des odeurs qui m’enchantent. L’averse est passée, ma patronne a ouvert toute grande la fenêtre : l’odeur de la terre mouillée s’enroule à celle, plus chaude, qui monte du bitume. Tiens, à voir cette ondée de printemps je me demande si l’eau n’est pas plus importante que le temps. Y a qu’à penser à l’expression qui remplace la notion du temps par celle de l’eau qui coule sous les ponts. Avec de l’eau on peut faire du temps ; sans cette évidence, pas de clepsydre ! Mais jamais le temps ne produira de l’eau, exception faite des larmes de ceux qui déplorent de le voir s’enfuir si inexorablement. Ce souci se serait-il installé entre mes deux oreilles ? Il faut que je me change les idées : pour cela, rien de mieux qu’un tour du quartier.