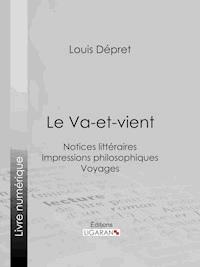
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
Extrait : "Avant d'écrire ces lignes, je voulais seulement offrir à quelques passionnés amis de la véritable poésie plusieurs extraits de Longfellow. Ce soir, en prenant la plume afin de louer cet excellent poète du souvenir, je suis moi-même assailli par le passé."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 72
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
À M. AUBAN-MOET
Cher monsieur,
Ceci n’est point une Revue, ni un Magazine, mais simplement l’échafaudage d’un assez gros livre. Ce livre, j’aurais préféré le publier en entier, d’un seul coup, si le destin inévitable des longs ouvrages, en 1866, ne sautait aux yeux. Et puis, j’ai souvent eu du bonheur avec ces petites choses. Mon projet, dont voici le spécimen, serait, tout en évitant une symétrie exclusive, de faire alterner dans chaque livraison un récit de voyage avec un portrait ou une histoire littéraire. Je n’aurai garde d’oublier mon cher et glorieux pays dans tout ce vagabondage ; cependant vous voilà prévenu que nous passerons souvent la frontière. J’ai tenu, cher monsieur, à ce que dans la première série, qui vous est affectueusement dédiée, figurât ce coin de France d’où j’ai rapporté l’amitié d’un cœur d’élite, et d’un esprit si bienveillant, dans son goût raffiné, que je n’ai aucun embarras à lui offrir ces notes familières.
Bien à vous,
LOUIS DÉPRET.
Avant d’écrire ces lignes, je voulais seulement offrir à quelques passionnés amis de la véritable poésie plusieurs extraits de Longfellow. Ce soir, en prenant la plume afin de louer cet excellent poète du souvenir, je suis moi-même assailli par le passé. Pour dépeindre à merveille l’étrange émoi de mon cerveau, je n’aurais que l’embarras du choix parmi les nombreuses peintures que Longfellow a faites d’un jeune homme, à la mémoire très fidèle, au cœur trop sensible, qui rêve, les pieds au feu et le coude appuyé sur une table chargée de gravures, de lettres et de livres, aux jeunes filles et aux vieilles espérances d’il y a dix ans. À ce nom de Longfellow, je vois se dresser, dans le crépuscule matinal de ma seizième année, la statue fantastique de l’honneur littéraire.
Je ne dois pas seulement à Longfellow le bienfait des impressions produites sur moi par ses vers ; je lui dois une part de mon premier orgueil et de mon meilleur étonnement d’écrivain. Vers la fin de 1855 (à peu près le jour même que mourait le banquier poète Samuel Rogers), je tombai, fort jeune encore, en plein Christmas, dans l’infini de Londres. Pour savoir et montrer combien Londres est grand, ce n’est point assez de le déclarer plus vaste que Paris, d’additionner rues et maisons, de dire : Londres a trois millions d’habitants ! Il ne suffit pas davantage de l’avoir foulé en excursionnist à l’aurore tumultueuse d’une exhibition ; il faut y avoir résisté aux bruines d’un long hiver ; il faut, cinq mois durant, avoir entrevu, montant jusqu’aux nuages, par les grises journées, le dôme de Saint-Paul, la tour du Parlement, et dix mille autres tours, mais non pas un autre dôme ; il faut s’être attardé quelquefois, passé minuit, dans l’inimaginable horreur de ses carrefours, et même de ses grandes voies et de ses alcazars funèbres. Je ne dis pas que vous y retrouverez l’humanité sous un aspect fait pour vous consoler d’être homme ; au contraire, il faut plutôt attendre que vous en emporterez une tenace mélancolie, assez justement comparable à la tristesse d’un pêcheur qui se trouverait seul au milieu de la plus sinistre des mers, sans la pleine vue du ciel, sans l’adorable voix des flots. Le sourire est une fleur étrangère au sol de Londres ; rencontrer un visage connu, donner et recevoir un furtif bonjour, dans cet incessant va-et-vient d’ombres humaines, est une bizarrerie. On se dit : « La gloire, la renommée, sont des mots qui ne figurent pas au dictionnaire de cette nation, et il doit être pauvre et inconnu celui qui écrit ce dictionnaire ! » On se demande, avec l’ironie du découragement suprême : « Que pourrait-on inventer qui fasse retourner une seule de ces têtes, tendues vers la Banque, vers le railway, vers le charbon ? Quelle maladie affligeait donc Shakespeare, Byron et Walter-Scott ? » Voilà Londres. Pourtant, dans ce Londres infernal, en décembre 1855, il n’est pas une de ces têtes tendues qui ne se fût penchée la veille au soir, ou fait semblant de se pencher, sur un livre nouveau, sur un livre de vers, poème issu de loin et reçu en frère, honoré comme le roman plein de joie et de larmes du grand Dickens, comme la maîtresse histoire de Macaulay, populaire comme les récits de Sébastopol ; nous sortions alors de la guerre de Crimée.
Nous sommes chez un peuple de marchands et non d’artistes et de flâneurs ; peut-être m’objectera-t-on : « Cela s’explique, et, ces gens ont besoin d’aller demander aux livres les jouissances idéales qu’ils ne sauraient trouver au-dedans d’eux-mêmes. » L’erreur serait grave : comment ignorer que la poésie vit seulement dans l’amour qu’elle inspire et par lui ? Le livre qui, en des circonstances adverses à l’épanouissement poétique, sut, à plus de mille lieues du sol qui l’avait vu naître, charmer toute l’Angleterre, je ne l’ai pas encore nommé. C’était un poème indien intitulé : The Song of Hiawatha (la Chanson d’Hiawatha), par Longfellow.
Pourtant, nulle palpitante actualité, pour parler le langage de nos libraires, ne plaidait en faveur « de ces légendes, de ces traditions, venues de la terre des Ojibways, venues du pays des Dacotahs, et recueillies sur les lèvres de Nawadaha, le musicien, le doux chanteur. »
C’était un spectacle charmant (j’y assiste encore d’esprit et de cœur) celui de ces groupes de jeunes filles au visage mince, à l’œil profond, aux boucles blondes, écoutant sans surprise, et comme l’écho de leurs pensées antérieurs, ces nouvelles aventures, venues de si étranges et lointains pays. Un tiers du livre est fait de mots inintelligibles, imprononçables pour nous, et qui ont, au jugement de l’auteur lui-même, exigé l’addition d’un petit lexique à l’usage de ceux qui, comme nous, ignoraient que kabibonok’ka veut dire : le vent du nord, et baim-wa-wa : le tonnerre. Voilà bien des embarras, bien des complications radicalement hostiles à la simplicité de la véritable poésie, et qui témoignent de sa toute-puissance, lorsqu’elle en triomphe.
On aura beau écraser l’une sous l’autre des pyramides de théories, elles ne prévaudront jamais contre le fait que voici :
Il y a d’une part les poètes qui nous prennent dès le berceau, ou à l’entrée de la jeunesse, et que nous n’abandonnons jamais. La langue qu’ils parlent nous a soudainement saisis comme l’expression éternelle du monde muet qui vit dedans nous ; ils nous ont paru eux-mêmes être la voix de ce qui n’avait jamais parlé avant eux ; puis nous les avons aimés. Ce qu’ils ont dit fait désormais partie des trésors inaliénables de notre âme. (Voyez comme les gens d’affaires ont raison de ne pas se fier à nous : un trésor qui se compose de mots !). Ces poètes-là, nous les récitons par cœur, à travers les rumeurs de la vie, malgré les chocs de la destinée, à la table de nos amis, aux genoux de notre maîtresse.
Il y a, d’autre part, les poètes qui n’ont jamais eu le temps de connaître ceux dont je viens de parler, s’étant toujours admirés eux-mêmes, avec tentative de tapage le plus souvent ; mais ce n’est pas leur faute si les vitres qu’ils cassent vont choir sur des matelas, et s’ils ne réussissent pas même à faire savoir à personne qu’ils meurent d’envie d’être connus ; bref, il y a des poètes dont nous disons, pour nous en débarrasser : « Quel talent ! » mais qui ne nous disent rien.
Je ne vais pas aborder maintenant cette insipide banalité, qu’il y a en prose d’aussi bons et d’aussi grands poètes qu’en vers.
Donc, en décembre 1855 tout Londres, toute l’Angleterre était tout admiration et tout oreilles pour le poète américain Longfellow, l’auteur du Song of Hiawatha ; et nous, à dix-huit ans, frais sorti d’un collège de France, remontant toute la série des œuvres d’un homme jusque-là de nous inconnu, il nous sembla entrer par une porte d’or dans le riche domaine de la poésie anglo-saxonne. Ce n’est pas une petite excitation d’entendre revenir le même nom propre au bout de chaque phrase d’une langue qu’on ne comprend pas encore. On me donna d’abord à lire, et je lus et relus d’un bout à l’autre, lentement, ce fameux Song of Hiawatha





























