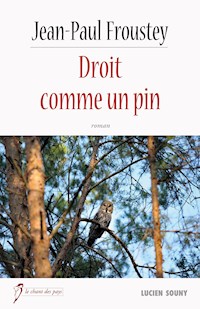Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Plume Libre
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Anaïs vit à Hossegor depuis que sa tante Josepha, dont elle a hérité du patrimoine, s’en est allée.
Cette maîtresse femme a tout connu : la guerre, la Résistance, les ors de la République. Autant sa vie professionnelle fut un succès, autant sa vie sentimentale fut chaotique. De ses amours avec un maquisard – devenu agent secret avant de disparaître – est né un fils qu’Anaïs a élevé seule et qui, à son tour, lui a donné une petite-fille, Julie.
Cette dernière obtient la préférence de sa grand-mère, au point qu’elle la protège et finance en cachette ses études de cinéma.
Et puis un jour, un mystérieux violon fait resurgir le passé. Anaïs ouvre sa boîte à souvenirs, mais cela ne suffit pas à résoudre toute l’énigme… Alors, elle fait tout naturellement appel à Julie.
Un jeune policier vient se greffer à ce binôme complice et tous trois vont conjuguer leurs efforts de recherches.
Mais le jeu en vaut-il la chandelle ?
Surprises et sentiments s’imbriquent ici sournoisement, pour dénouer les mémoires et… lever le mystère ?
À PROPOS DE L'AUTEUR
Jean Paul Froustey est né entre un ruisseau et une rivière, depuis il n’a jamais quitté cette nature et cette forêt qui l’inspirent pour ses romans.
Outre l’entretien d’un petit paradis sur les bords du Courlis où il a planté des arbres, il s’intéresse au rugby et s’occupe de ses abeilles.
Il présente ici son douzième roman.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 291
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Le violon du lac
Roman
Jean-Paul Froustey
C’était au moins la dixième fois que Josepha visitait la pinède verdoyante qui dominait le lac dans ce quartier de Soorts, qu’on appelait Hossegor, sans qu’elle parvienne à se décider. Son frère Max en avait assez de conduire cette éternelle indécise. Josepha était bien d’accord, c’était un coin de paradis, mais où construire sa maison? Elle habitait Paris et venait régulièrement rendre visite à son frère, chirurgien à Dax. Max avait amputé à tour de bras durant la Grande Guerre, parfois dans des hôpitaux dignes de ce nom, parfois au plus près des tranchées alors que la gangrène avait déjà attaqué le membre blessé par un obus.
Après cette hécatombe, le chirurgien aspirait à plus de tranquillité et choisit la ville de Dax où il lui semblait qu’il faisait bon vivre, tout près à la fois de la montagne et de l’océan.
Son épouse eut du mal à s’adapter; Parisienne jusqu’au bout des ongles, elle parvint tout de même à s’intégrer à la bourgeoisie locale, pourtant réfractaire à tout ce qui n’était pas Dacquois.
Josepha les rejoignait après de longues heures de train, elle logeait chez eux, mais parfois, il lui arrivait de prendre pension à l’hôtel Splendid, lorsqu’elle voulait préserver sa vie intime.
Josepha avait perdu son mari durant la guerre. Brillant officier, il n’échappa point aux tirs allemands, bien qu’il fût toujours le premier à se lancer à l’assaut des lignes adverses, contrairement à la majorité de ses confrères.
Il laissa à son épouse une fortune colossale à laquelle s’ajoutait la pension de veuve de guerre.
Josepha aurait pu se remarier cent fois, mais elle préférait conserver son indépendance et sa liberté. À trente-cinq ans elle en paraissait dix de moins et toute l’élite parisienne qu’elle aimait fréquenter, peintres, écrivains, comédiens, journalistes s’empressaient auprès d’elle. Elle avait le choix et ne s’en privait pas.
Pour l’heure, si elle songeait à s’installer à Hossegor, c’était pour cacher ses amours clandestines avec un peintre célèbre et marié. Son amant fut subjugué par ce magnifique point de vue, si bien qu’il put le fixer sur ses toiles sans avoir besoin de faire travailler son imagination.
Max avait prévenu sa sœur : dans dix ans, il n’y aurait plus un mètre carré à vendre dans cet endroit.
Ils furent plusieurs personnages célèbres à en faire l’éloge, parmi eux, Rosny jeune, Maurice Martin et surtout Pierre Pignat, ancien international de rugby. Cela suscita la curiosité de quelques nantis que les trois hommes orchestrèrent savamment.
***
Lorsqu’elle était seule et qu’elle empruntait la voiture de son frère, Josepha aimait emmener sa nièce Anaïs, c’était sa préférée parmi les trois enfants du chirurgien et de son épouse. Ne dit-on pas que la vérité sort de la bouche des enfants? Cela fut rapide. Josepha demanda à Anaïs, qui venait d’avoir huit ans :
«Si tu devais construire une cabane sur cette colline, où l’installerais-tu?»
Anaïs désigna alors un creux dans la dune, d’où l’on apercevait la totalité du lac. La vue était sublime.
«Tu as raison! C’est là que je construirai ma maison.»
Josepha se rendit immédiatement chez le marchand de biens qui la félicita pour son choix et lui suggéra, par la même occasion, d’adopter le style basco-landais.
Bien que ce ne fût point une architecture obligatoire, le nouveau quartier n’en aurait que plus de charme. Josepha avait déjà choisi son constructeur, ce serait Callune, ami de son frère et entrepreneur en vogue à Dax. L’agent immobilier en fut ravi, les deux hommes se connaissaient parfaitement pour avoir porté en même temps les couleurs de l’équipe de France de rugby.
Dès lors, Josepha ne quitta plus les Landes. Elle fit la navette entre Dax et Hossegor, pour vérifier l’avancée des travaux.
Son peintre avait droit à des lettres dithyrambiques concernant son futur cadre de vie, de quoi l’inciter à venir la rejoindre lorsque tout serait terminé, mais seulement à ce moment-là!
Il fallut un peu plus d’un an à l’entreprise pour achever le joyau. Tout le monde fut satisfait : Josepha parce qu’elle avait réalisé son rêve et l’entrepreneur parce que cette construction splendide à la vue imprenable lui servirait de vitrine.
À son arrivée, le peintre fut émerveillé. Officiellement, il était là pour travailler comme d’autres artistes l’avaient fait avant lui. Il avait laissé femme et enfants à Paris.
Mais au bout de quelque temps, Josepha se rendit compte que l’homme n’était pas aussi bon amant qu’elle l’eût espéré.
Heureusement, ce dernier se lassa vite de la solitude et de l’isolement dans lequel se trouvait, à l’époque, la future station balnéaire. Les soirées parisiennes, la foule, les activités de la Ville lumière qui avait craint pendant quatre ans l’invasion allemande lui manquaient. Un jour, il s’éclipsa discrètement après que Josepha se fut plainte du peu d’empressement qu’il mettait à son égard.
Pour Josepha ce fut une délivrance. De toute façon, il y avait ici assez d’hommes jeunes, influents et discrets, parmi lesquels elle pourrait faire son choix. D’autre part, ils étaient sportifs et arboraient la couleur ambrée que le soleil ne manquait pas de dispenser. Ce qui était curieux, c’était que ces amants d’un soir se sentaient obligés et finissaient par lui rendre une multitude de petits services qu’elle appréciait, même si la discrétion était de rigueur. Josepha était exigeante sur ce point, mais ainsi, la rumeur ne s’empara jamais de ses amourettes.
La petite Anaïs était une privilégiée, elle était la seule à passer la totalité des vacances avec sa tante qui l’emmenait tous les jours à la plage. Elles s’y rendaient à pied, mais il n’était pas rare qu’un galant proposât de les accompagner en voiture. Josepha refusait, c’était bon pour la petite de marcher. Elle avait besoin d’exercice à cet âge-là, un âge où il faut apprendre l’effort!
Pendant longtemps les voisins crurent qu’Anaïs était la fille de Josepha, ce que la jeune femme ne confirma ni ne démentit jamais.
Anaïs était une excellente élève, à une époque où seuls les garçons étaient appelés à poursuivre de longues études. La jeune fille, brillante bachelière, poursuivait des études de droit. Hélas! les bruits de bottes résonnaient dans toute l’Europe. Même si auparavant, le Front populaire avait fait trembler les gens fortunés, c’était une autre menace qui se profilait à l’horizon.
Hossegor connut ses heures de révolte, les résiniers largement majoritaires dans la population se disputèrent une énième fois sur la répartition du prix de la gemme. Josepha, qui n’était pas propriétaire de forêt, ne fut pas inquiétée et, de ce fait, put observer le conflit comme un arbitre. Elle trouvait que les gemmeurs avaient en partie raison, le fruit de leur travail profitait beaucoup trop aux sylviculteurs. Cela lui valut quelques inimitiés d’un côté et un certain respect de la part des résiniers et des employés qui se voyaient, désormais, bénéficier de congés payés, sans savoir vraiment quoi en faire, surtout dans ce petit paradis où il faisait bon vivre.
Anaïs ne se rendait à Dax que parce qu’il y avait la gare. Elle saluait brièvement ses parents et embarquait aussitôt dans la voiture de Josepha, pour partager avec elle les quelques jours de vacances qu’elle s’accordait pour fuir Bordeaux où la vie lui semblait bien morne. Elle songeait, à l’issue de ses examens, à s’installer à la campagne. C’était sans compter cette satanée guerre qui vida en un clin d’œil les villes et les villages de toutes leurs forces vives. La jeunesse fut une nouvelle fois conviée à défendre la patrie.
Josepha, qui avait connu le premier conflit, savait que celui-ci aussi serait long et difficile. Elle prévint Anaïs :
«Je n’aime pas te savoir éloignée ni isolée dans une ville. Le secrétaire de mairie a été mobilisé et le maire est disposé à te confier le poste.»
Il restait une année à Anaïs pour se perfectionner, mais elle avait déjà obtenu son diplôme. Elle n’hésita pas. Josepha avait toujours été de bon conseil pour elle et puis la rentrée s’annonçait difficile avec le manque flagrant de professeurs.
Dès son entrée à la mairie, Anaïs fut confrontée à l’évacuation des Alsaciens qui arrivaient par trains entiers, avec seulement trente kilogrammes de bagages. Elle dut procéder en urgence au recensement des familles susceptibles d’héberger les expatriés, parmi lesquels il y avait de nombreux enfants en âge scolaire. Hormis Josepha, peu de volontaires se présentèrent. Le maire dut faire du porte-à-porte pour parvenir à loger ces pauvres gens déracinés et complètement perdus au niveau du langage entre le gascon et l’alsacien.
Par le biais de cette démarche, Anaïs fit immédiatement connaissance avec les habitants et constata que certains lui vouaient une certaine inimitié, considérant qu’elle avait usurpé ce poste de secrétaire de mairie. Mis à part quelques irréductibles, la fronde s’estompa grâce au maire qui vantait ses qualités, mais aussi au curé qui n’hésitait pas à venir saluer Josepha et Anaïs à la sortie de la messe le dimanche.
Un jour, il présenta Alice, sa propre nièce, aux deux femmes. Son neveu s’était éclipsé. Le curé avait recueilli les enfants de sa sœur, parce que leur père, cheminot à Dax, était en même temps délégué du syndicat et dirigeant du parti communiste. Comme tous les communistes importants, le bonhomme avait été déplacé et muté. Dès lors, il assurait un poste subalterne à Sabre, dans la Haute Lande. Il fallait isoler ces personnages de leur base. S’ils s’étaient montrés laxistes au début du conflit, depuis que les Soviétiques avaient changé de camp, les communistes représentaient un danger tout autant pour les autorités en place que pour les Allemands.
Alice et Anaïs se lièrent d’amitié ; sensiblement du même âge, elles devinrent inséparables. Alice confia à sa nouvelle amie que le curé tenait son frère à l’écart. Anaïs l’avait aperçu et crut comprendre. Malingre, un tantinet benêt, le garçon semblait dérangé. Il se racontait qu’il avait été victime d’une tumade, un choc avec une vache dans les arènes de Dax.
Anaïs, quant à elle, comprit trop tard qu’elle s’était exagérément confiée à Alice. Le curé l’aborda et lui dit ouvertement qu’il aimerait l’entendre en confession. Pour Anaïs, la messe du dimanche n’avait rien à voir avec la religion. Cela représentait simplement une sortie qui donnait l’occasion de rencontrer des gens et de mieux connaître la population. C’était aussi un moyen de repérer les garçons. Hélas, tous ceux de son âge étaient partis combattre et beaucoup d’entre eux étaient prisonniers en Allemagne.
Le village peu peuplé comptait à peine un millier d’habitants. Si ce n’était son cadre et sa proximité avec le port de Capbreton, l’ancien quartier de Soorts n’offrait aucun intérêt pour l’occupant.
Il ne fut point question de prière ni de pénitence, le curé balança tout de go :
«J’ai besoin que tu me rapportes tout ce que tu entends et tout ce que tu vois à la mairie, susceptible d’intéresser les alliés.»
Anaïs demanda à réfléchir. Ce qui l’intriguait le plus c’était de savoir qui, de Josepha ou d’Alice, était la plus impliquée dans cette démarche.
Elle tenta auprès de Josepha :
«Je suis allée me confesser…»
Au lieu de s’étonner, sa tante, à voix basse, lui conseilla de se montrer prudente.
La jeune fille avait sa réponse et ce fut ainsi qu’elle entra en résistance.
Dès leur arrivée, les Allemands incitèrent les Alsaciens à rentrer chez eux et ceux qui avaient cru en la bonne foi de l’occupant et qui étaient en âge de combattre furent enrôlés de force et expédiés, pour la plupart, sur le front russe.
Aussitôt libérée des Alsaciens, la maison de Josepha fut occupée par des officiers allemands.
Elle s’en prit sévèrement au maire qui n’y pouvait rien, mais il fallait un souffre-douleur à cette maîtresse femme.
Josepha réussit tout de même à caser ses hôtes indésirables dans la partie de la maison qui donnait sur la forêt. Ainsi, elle conservait pour elle toute seule la vue sur le lac. En condamnant une porte intérieure, elle ne croisait jamais les hommes en uniforme vert de gris.
Le matin, elle les observait de sa fenêtre, lorsqu’ils quittaient l’habitation pour se rendre à leur sinistre besogne, laquelle consistait à défigurer la côte avec des constructions en béton armé pour y placer des canons. Elle pouvait alors profiter de son jardin à son aise.
De son côté Anaïs entreprit son travail d’investigation.
Elle collectait toutes les informations susceptibles d’intéresser le curé et les lui remettait, le plus souvent, dans un ordre et avec une précision qui étonnait l’homme d’Église. Ainsi, tout était répertorié : les emplacements des blockhaus, de l’artillerie, les lieux de résidence de la troupe et des officiers, leur nombre, le nom des gens qui étaient réquisitionnés et les tâches auxquelles ils étaient astreints. Dès qu’il y avait un changement, Anaïs le notait aussitôt. Et, des changements, il y en eut, notamment chez Josepha.
Un soir, les officiers rentrèrent ivres et, sans doute, continuèrent à boire et à chanter toute la nuit. Au petit matin, Josepha se rendit à la kommandantur et se plaignit de la tenue, pour le moins équivoque, de ces gradés qui n’avaient pas le moindre savoir-vivre. Elle sut se faire entendre : les quatre hommes furent sanctionnés et déplacés dans une autre maison.
Leurs remplaçants, à qui la leçon avait dû être faite, se montrèrent beaucoup plus sages.
Il y avait, parmi eux, un musicien qui, pour ne pas gêner la maisonnée, prit l’habitude d’aller jouer au milieu du lac où trônait la cabane de chasse du père Loussy. Ce dernier était un vieux chasseur qui avait dû, comme ses collègues, remettre son fusil aux autorités. Enfin, il n’avait remis qu’une vieille arme dont il ne se servait plus. Son propre fusil, bien graissé, enveloppé dans un drap et enfermé dans une caisse, attendait des jours meilleurs dans un coin de l’étable des vaches, juste sous le râtelier.
Anaïs et Alice guettaient le départ du jeune musicien qui partait le soir avec son ordonnance, empruntait la barque attachée à un saule et s’installait sur le ponton de la cabane. Les filles se précipitaient alors sur la terrasse et écoutaient le magnifique concert qu’offrait l’Allemand, lorsque le vent daignait porter vers les terres.
Parfois, Josepha aussi ouvrait sa fenêtre pour écouter ce violoniste hors pair, niché au cœur d’un magnifique tableau avec, en arrière-plan, le soleil rougeoyant qui s’enfonçait doucement derrière la dune.
Tout en longueur, le lac était un ancien bras de cet Adour paresseux qui cherchait une issue vers l’océan et que l’avancée des sables avait contrarié. Il avait fallu l’intervention de Joséphine, l’épouse de Napoléon III, un amoureux inconditionnel des Landes et de la côte basque, pour qu’un canal fût creusé afin de le relier à l’océan. Depuis, les eaux montaient et descendaient au rythme des marées.
Josepha, qui n’en était pas à son premier concert, était impressionnée : incontestablement, ce jeune Allemand était un prodige! D’ailleurs, il faisait tache au milieu des autres officiers.
Hans était ingénieur et c’était à ce titre qu’il travaillait à la construction de ce que les occupants appelaient le mur de l’Atlantique. Le garçon avait mené de front ses études et sa passion. Ce ne fut que lorsqu’il eut obtenu ses diplômes que ses parents lui offrirent un superbe violon qu’ils étaient allés chercher de l’autre côté de la frontière.
Par deux fois ils s’étaient rendus à Nancy, dans l’atelier du célèbre luthier, Charles Allaume. La seconde fois, l’homme de l’art mit la dernière main au violon qu’il avait fabriqué pour le jeune prodige. C’était sa récompense. Hans obtint simultanément son titre d’ingénieur et le premier prix au Conservatoire de Berlin.
On dit que les mathématiques et la musique vont de pair, cela s’avéra pour Hans.
Le luthier, particulièrement exigeant, s’était rendu compte que le jeune musicien ne l’était pas moins. Trois jours furent nécessaires pour accorder cette pièce exceptionnelle, tant l’attention que l’un et l’autre apportèrent à l’instrument était extrême. Le luthier était satisfait de son chef-d’œuvre, tandis que le jeune Allemand allait pouvoir se livrer, à loisir, à l’interprétation ou à la composition, ce qui le tentait davantage. Il s’était d’ailleurs attaché à écrire quelques partitions qu’il avait bien l’intention de travailler avec son nouveau violon.
Cependant, tout n’alla pas aussi bien qu’il l’eut souhaité dans ce pays où les bruits de bottes s’amplifiaient de jour en jour. Hans avait tout juste eu le temps d’épouser une jeune fille dont il était tombé éperdument amoureux, avant d’être happé par la guerre.
Un matin, après une nuit d’orage, Hans ne se présenta pas à l’appel de son régiment, son ordonnance non plus.
Ni Josepha ni Anaïs ne furent inquiétées.
L’enquête se déroula au sein de l’armée. Seul le cadavre de l’ordonnance, lardé de coups de couteau, fut découvert sur le ponton. Le musicien ainsi que son précieux violon avaient disparu. La barque fut retrouvée au pied du vieux saule, là où elle était amarrée habituellement. Seules quelques questions sur les habitudes du lieutenant furent posées aux deux femmes. La police militaire, qui songeait fortement à une désertion, rechercha le jeune officier du côté des Pyrénées. Chacun était persuadé que le lieutenant tenait davantage à son violon qu’à son arme. Celui-ci avait disparu, tandis que son arme et son uniforme étaient restés bien visibles sur le ponton de la cabane de chasse, à côté du cadavre de l’ordonnance.
Furieux, le commandant de la garnison déclara Hans Hassendofer déserteur et ordonna pour ce dernier, s’il était repris, le peloton d’exécution.
Anaïs partagea ses doutes avec Josepha : la musique exigeait une discipline exemplaire et le violoniste était, à l’image de ses congénères, un homme discipliné. Même s’il détestait la guerre, s’il abhorrait ce conflit, il n’était pas homme à s’y soustraire.
Personne n’approfondit l’histoire. Cela fit un Allemand de moins. Alice et Anaïs n’assistèrent plus jamais aux merveilleux concerts donnés par le virtuose sur la plus belle scène d’Hossegor, son lac.
Anaïs aurait tôt fait d’oublier la péripétie. Certes, cet homme disparu était sans doute plus attachant que la plupart des occupants, mais il n’en restait pas moins un ennemi.
***
Depuis le temps qu’elle y passait toutes ses vacances, la forêt, autour d’Hossegor, avec ses pistes cyclables qui permettaient aux résiniers de se rendre au fin fond des dunes plantées en pins et ses chemins forestiers utilisés par les muletiers, n’avait aucun secret pour Anaïs. De plus, si elle avait le moindre doute, il lui suffisait de consulter le plan cadastral qu’elle avait en permanence à disposition.
Le curé lui confia rapidement d’autres missions et, lorsqu’elle se déplaçait la nuit, elle savait où logeaient les Allemands, le parcours qu’ils effectuaient pour se rendre à leur travail, pour rentrer chez eux, comment ils organisaient les gardes… Si par hasard ils décidaient de patrouiller la nuit dans le village ou en forêt, ils ne passaient pas inaperçus. Méticuleuse, Anaïs prenait soin de ne rien laisser au hasard, elle vérifiait que son vélo fut bien graissé afin de ne pas risquer le moindre couinement et n’hésitait pas à parcourir de nombreux kilomètres supplémentaires pour éviter les rencontres.
Il restait, parmi la population, quelques personnes qu’elle n’aurait pas aimé croiser, la jalousie envers cette jeune étrangère qui venait leur voler le travail ne s’était pas encore éteinte. Une partie des habitants ne lui pardonnerait jamais d’avoir obtenu le poste de secrétaire.
Sa chance, c’était que le curé, possédant une autorité naturelle sur les villageois, s’employait à annihiler la méchanceté gratuite que certains entretenaient à l’encontre de la jeune fille. C’était aussi une sécurité que le prêtre servît de trait d’union entre les demandeurs et les exécutants. Il tenait lieu d’arbitre dans le choix des missions, tout en favorisant le cloisonnement entre les intervenants. Anaïs était certaine que tout un réseau gravitait autour de l’homme d’Église, qu’il était une des pièces maîtresses de l’organisation, peut-être même en était-il le chef? En tout cas, la jeune fille n’avait pas l’impression de prendre des risques ni d’accomplir de grands exploits.
Chaque jour, elle passait devant le presbytère pour se rendre de son domicile à la mairie. Il n’était pas rare qu’elle rencontrât le curé, un homme jovial, qui n’hésitait pas à saluer et à aborder les villageois, même les plus réfractaires à la religion.
Un jour, et ce n’était pas dû au hasard, il l’attendait dans son jardin et lui demanda de le rejoindre.
Même si elle était l’amie d’Alice, Anaïs n’avait jamais mis les pieds dans la demeure du prêtre, c’était toujours Alice qui se rendait chez Josepha.
L’homme qui portait une soutane rapiécée sans la moindre gêne lui tendit une enveloppe.
«Il faudrait que tu m’établisses de faux papiers, il y a tout ce dont tu as besoin dans ce pli.»
Anaïs crut rêver. Il y avait dans l’emballage, des papiers officiels vierges que seule la préfecture détenait avec, et c’était le bouquet, une empreinte du tampon préfectoral qu’il suffirait d’apposer sur les documents. Il faudrait simplement trouver une identité plausible et coller la photographie. Une autre surprise attendait la jeune fille, la photographie fournie n’était autre que celle du neveu du prêtre. Pour quelle raison, un demeuré, c’était ainsi qu’on désignait le garçon, avait-il besoin d’une fausse identité?
Tout en se posant des questions, Anaïs cherchait une cache pour dissimuler ces documents dont elle se doutait qu’ils allaient encore servir. Tout compte fait, la mairie était sans doute le seul endroit où l’on ne viendrait pas chercher ce genre de trésor, probablement dérobé à la préfecture. Le tampon avait sans doute été fabriqué artisanalement par un orfèvre en la matière, comme il s’en découvrait chaque jour, face à un ennemi coriace secondé par quelques autorités pour le moins zélées.
Fernand Labrit était donc né à Hossegor, vingt-cinq ans plus tôt. Il exerçait la profession de distillateur itinérant, rien à voir avec le bouilleur de cru. Il était censé remplacer ponctuellement ses collègues malades, blessés ou encore maintenus en captivité, pour transformer la gemme en essence de térébenthine et en brai, des produits qui intéressaient les Allemands au plus haut point.
Le choix du curé pour cette couverture inhabituelle s’avéra judicieux, Henri Casting devint Fernand Labrit et put ainsi se déplacer dans toute la lande forestière sans connaître le moindre souci.
Le garçon se déplaçait à vélo, ce qui ne l’empêchait pas de parcourir de longues distances. En réalité, Fernand était un artificier hors pair, il avait fait son apprentissage chez Dardayou à Dax. Très vite il était devenu précieux pour son patron qui profitait de son aura dans les arènes pour placer son feu d’artifice le soir dans les fêtes des villages landais. Le garçon était adulé dans les milieux taurins, les organisateurs tenaient à s’assurer de la participation de Riri, son nom de sauteur qu’il devait pour une partie à son vrai prénom, Henri, mais aussi parce qu’il ne souriait jamais. Ce fut pour toutes ces raisons qu’il fut contraint de changer d’identité.
D’après la photographie, Anaïs put constater que le garçon avait changé d’apparence, ses cheveux étaient plus longs, plus noirs, semblait-il. Il n’était pas très beau avec son visage anguleux, mais ses yeux dégageaient une espèce de force intérieure. Anaïs comprit qu’il n’était pas le garçon benêt pour lequel il voulait se faire passer. Elle réalisa que Fernand pouvait changer de personnage tout en restant crédible.
Il fut un homme insaisissable durant le conflit, jamais là où on l’attendait, ou alors, il intervenait sous un déguisement qui le rendait méconnaissable. Fernand était un solitaire qui n’avait pas son pareil pour fabriquer des bombes artisanales et qui les posait lui-même à l’endroit où on lui demandait, sans le moindre état d’âme. On lui prêta également quelques initiatives personnelles que d’aucuns n’avaient pu confirmer.
Fernand vint lui-même chercher ses nouveaux papiers à la mairie, en plein jour. Rusé, il avait probablement guetté et attendu que le secrétariat fût vide. Sur le coup, Anaïs se trouva quelque peu paniquée. Le garçon était bien plus grand qu’elle ne l’avait imaginé, il était vrai que la seule fois où elle l’avait aperçu, il courbait l’échine et tordait son visage. C’était un vrai contraste, là, Fernand paraissait calme, sûr de lui, il parlait avec douceur, d’une voix envoûtante.
La jeune fille tomba sous le charme de ce garçon intrépide et imprévisible à défaut d’être beau. Elle songea qu’en temps normal, ils auraient pu se revoir, sortir ensemble pour faire plus ample connaissance. Mais voilà, c’était la guerre et Fernand s’en fut, tout en esquissant un dernier sourire et en agitant le papier qui recelait sa nouvelle identité :
«Merci!» souffla-t-il.
Avait-il deviné son trouble? Anaïs n’eut pas le temps d’y réfléchir, elle était encore bouleversée lorsque le maire entra en trombe, passablement contrarié.
«Il faut m’établir une liste des hommes valides avec leur âge et leur situation familiale. Les attelages et les entreprises ne leur suffisent plus, ils veulent aussi des manœuvres!»
Ainsi, une fois de plus, les Allemands réquisitionnèrent la population.
Ce coup-ci, c’était pour décharger et transporter des sacs de ciment, une autre fois ce fut pour monter la garde à la gare parce qu’un aiguillage avait été saboté. La jeune fille ne put s’empêcher de penser que son visiteur n’était peut-être pas étranger à ces méfaits qui pénalisaient la population.
Pendant plusieurs mois, Anaïs n’entendit plus parler de Fernand.
Sa sœur, Alice, pensa qu’il était parti en Angleterre subir un entraînement pour être parachuté quelque part, avec de vraies bombes cette fois. Anaïs n’y croyait pas. Elle présumait que le garçon était resté au pays, sinon, pour quelle raison aurait-il eu besoin de faux papiers? À l’étranger, il pouvait très bien utiliser sa véritable identité.
Très vite, à la demande du curé, Anaïs dut établir d’autres faux papiers pour les jeunes gens frappés par le service du travail obligatoire. Son grand regret fut de ne pouvoir en établir pour tous. Certains se résignèrent, par crainte ou par manque de renseignements. Quelques-uns choisirent la clandestinité, d’autres l’exil, mais ce fut toute une génération qui se trouva confrontée à un véritable cauchemar, au lieu de vivre une jeunesse paisible.
Anaïs continuait à parcourir la forêt, guidait quelques personnages, ravitaillait des clandestins ou des résistants. Elle ne savait rien, parce qu’elle ne rencontrait personne, elle ne faisait que déposer la nourriture à l’endroit que le curé lui avait indiqué. Une seule fois, la silhouette de Fernand Labrit se déploya devant elle. Elle sursauta et faillit émettre un cri. Avec une vivacité qu’elle n’avait pas imaginée, Fernand étouffa le son qui s’apprêtait à réveiller la forêt, en apposant ses lèvres sur les siennes.
Anaïs se débattit à peine, mais cela suffit pour que le garçon n’insistât pas. Il s’attendait à recevoir une gifle qui ne vint pas. La jeune fille déposa les provisions aux pieds du garçon et enfourcha sa bicyclette, davantage pour se dérober que pour s’enfuir. Fernand la rattrapa par le bras, la fit pivoter, planta ses yeux dans les siens à la lueur d’un quartier de lune et, d’une voix monocorde, il lâcha :
«Samedi minuit, à la cabane du père Loussy, sur le Lac.»
Anaïs ne répondit pas, elle attendit que la main qui la retenait à peine cessât d’exercer sa pression et rebroussa chemin. Fernand était-il de retour? … Du moins se manifestait-il à nouveau. Les jours passaient et Anaïs ne savait pas quelle suite elle allait donner à la demande du garçon. Pourtant, le désir était bien réel, sauf que se retrouver en plein milieu du lac était de la pure provocation, pratiquement sous le nez des Allemands qui logeaient chez sa tante. Finalement, le vendredi soir, Anaïs apprit qu’il y avait une réunion de l’état-major à l’hôtel Splendid à Dax et que tous les officiers de la région y participeraient. Ce diable de Fernand devait connaître l’information depuis plusieurs jours. C’était un gros rassemblement dont Anaïs pensait qu’il ne fallait rien attendre de bon, si ce n’était une pression supplémentaire sur la population afin qu’elle se tînt tranquille et qu’elle ne fût pas tentée de rejoindre le maquis. Anaïs avait donc le champ libre, mais ce fut son esprit qui ne se libérait pas et qui tergiversait entre le désir et la raison.
Cela faisait belle lurette que Josepha ne prêtait plus attention aux départs de sa nièce en pleine nuit.
Or, ce soir-là, elle trouva la jeune fille bien nerveuse, ce qui n’était pas dans ses habitudes. Elle l’observa, tandis qu’Anaïs, le regard tourné vers le couchant, semblait… perplexe. Admirait-elle le soleil, dans sa descente rapide derrière les pins, au-delà de la dune et qui allait sombrer incandescent dans l’océan?
Peut-être, mais c’était surtout la cabane qui entrait peu à peu dans l’ombre et qui faisait l’objet d’un combat intérieur. Dans peu de temps, Anaïs devrait se décider, même si elle avait déjà méticuleusement choisi les vêtements qu’elle allait porter et prévu de se parfumer, alors que c’était quelque chose qu’elle ne faisait jamais lorsqu’elle partait en mission dans les bois.
L’heure fatidique arriva et la jeune fille ne s’était toujours pas décidée. Elle changea d’avis : elle s’habillerait de sombre, comme d’habitude, et pas de parfum non plus!
Elle se glissa presque mécaniquement hors de la maison, descendit jusqu’à l’emplacement où la barque était arrimée, le cœur battant, le désir semblait avoir vaincu les dernières réticences de la raison… Elle pouvait toujours revenir en arrière, mais non! Elle grimpa dans le canot, saisit les rames et s’efforça de glisser sans bruit sur les eaux du lac. L’embarcation fut happée par des bras solides et amarrée au ponton de la cabane. Anaïs se leva de son banc et saisit la main qui se tendait vers elle pour l’aider à grimper sur les planches. Ce contact annihila toutes les résistances de la jeune fille, ce fut une première pour elle.
Ce n’était pas l’homme dur, rusé, sauvage qui lui fit connaître l’amour, mais un garçon doux, attentionné qui lui permit de se donner en toute confiance. Était-ce la tension qui s’exerçait autour d’eux qui les avait réunis? Anaïs ne se posa pas de question. Elle connut le bonheur cette nuit-là et, tant que le conflit continuerait, seul l’attrait physique qui l’avait projetée dans les bras de Fernand compterait. Les sentiments, ce serait pour plus tard! Anaïs ressortit de cette étreinte, apaisée, ragaillardie et soulagée, persuadée que cette première fois pour elle resterait un grand souvenir. Ce fut sans le moindre regret qu’elle pensa qu’il n’y aurait peut-être pas de suite. Ils vivaient dangereusement, risquaient leur vie chacun de leur côté, surtout Fernand dont elle ne connaissait rien des agissements et qui restait absolument mystérieux.
Une longue période les sépara à nouveau.
Anaïs continua allègrement son petit trafic sans jamais être inquiétée. Il était vrai qu’elle prenait des précautions, elle s’assurait que rien ni personne ne soit en mesure de la trahir. Le cloisonnement mis en place par le curé ou par Fernand s’avérait efficace, même ceux qui auraient pu être soumis à la torture ne pouvaient parler que de leur propre action. Qui était vraiment le chef de ce réseau? Le curé, Fernand ou encore quelqu’un qu’elle ne connaissait pas…
Dans le cadre de son travail à la mairie, Anaïs était amenée à avoir des relations avec les officiers allemands. Quelques-uns lorgnaient sur cette jolie célibataire et ne se privaient pas de lui faire la cour, jusqu’à l’interpeller dans la rue lorsqu’elle se déplaçait.
Non contente d’avoir usurpé le poste de secrétaire, voilà qu’elle répondait aux sourires de l’occupant! Cela dérangeait quelques personnages ombrageux de la petite commune.
Anaïs n’y prenait garde, elle considérait que cela faisait partie de sa mission. Elle savait aussi que les amabilités prodiguées par les Allemands pouvaient se transformer en fureur, si par malheur ses activités étaient découvertes. Mais elle ne fut jamais inquiétée. Il lui arrivait de songer qu’elle était doublement protégée par Dieu, en la personne du curé et par le diable, incarné par Fernand. Elle devait sa tranquillité à son intelligence et peut être aussi à quelques personnes qui veillaient sur elle, sans qu’elle fût au courant.
Elle n’en était pas certaine, mais elle avait eu des doutes une fois sur le comportement de Firmin. Firmin était un muletier aussi placide que son attelage. On n’avait pas l’impression de le voir tellement il faisait partie du paysage allant régulièrement de la forêt à la gare, transportant, inlassablement, ce qu’il appelait des poteaux de mine, des bois d’éclaircissage destinés désormais à l’Allemagne. Cela, Firmin ne le savait pas et ne voulait pas le savoir. Pour lui, la destination était toujours l’est et le nord de la France, la Belgique et l’Angleterre.
Firmin était d’une maigreur à faire peur, on eût pu le croire malade. Ses mules, au contraire, avaient le poil luisant, les muscles saillants de bêtes exceptionnellement bien soignées. Cependant, lorsque l’on observait Firmin remuer des billes de bois à longueur de journée, on pouvait constater que c’était une force de la nature.
Il était également adroit et savait s’économiser. Ses mules connaissaient la route, il lui arrivait de faire un somme pendant le trajet, au-dessus de sa pile de bois. Gare au garnement qui jouait à le réveiller en lançant des cailloux! Immanquablement, la lanière du fouet venait tâter le mollet de l’intrépide, en y imprimant une trace rouge et brûlante. Firmin se levait bien avant le jour pour charger les rondins sur sa charrette et les transférer dans les wagons où ils étaient stockés debout. Il était le seul à braver les interdits, notamment le couvre-feu et cela, en toute impunité. Les Allemands l’ignoraient, ils avaient pu le tester à deux ou trois reprises en le réquisitionnant avec son attelage. Ils crurent voir en cet homme, un pauvre innocent, une bête de somme, à peine plus éclairé que les mules qu’il dirigeait. C’était peut-être vrai en ce qui concernait l’instruction, il n’était guère allé en classe, mais pour ce qui était de l’école de la vie, Firmin n’était pas en reste. Il avait une connaissance des hommes qu’il gardait pour lui, mais il ne se trompait pas. Il savait, par exemple, que les expéditions d’Anaïs en forêt n’avaient rien… d’angélique. Il admirait le courage de cette petite. Lui qui ne s’était jamais marié aurait aimé rencontrer une femme de cette trempe. Maintenant, il était bien tard, il s’était fait une raison, jamais il n’avait été capable d’adresser la moindre parole à une fille et les années avaient passé, le laissant au bord de la route de la vie. Heureusement, il avait ses bêtes qu’il choyait comme ses propres enfants.
Firmin savait tout ce qui se passait en forêt, rien n’échappait à son regard d’aigle.