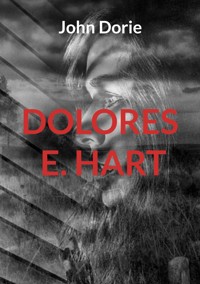Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Mandaté par le département de police de Bellingham, John Snow se rend dans une petite ville du Wyoming pour y retrouver un homme lourdement endetté et le ramener auprès de son créancier. Sur place, il découvre que le père du débiteur est l'homme le plus puissant de la région, avec le maire et le shérif sous son influence. Dans ce climat tendu, John retrouve par hasard Susannah, la gérante d'un bar et une ancienne connaissance pour laquelle il sent renaître des sentiments.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 242
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Avant-propos
Il y a un livre tiré de la collection Hitchcock présente que j’adore. Le titre est intrigant : Histoires à déconseiller aux grands nerveux. C’est un recueil de nouvelles qu’il vaut mieux éviter si l’on est amateur de romance, car les récits y sont inquiétants et angoissants. Ce livre est un florilège d’histoires mettant en scène des personnages finement caractérisés, avec une subtile critique sociale et un portrait désabusé de la nature humaine et de la société américaine.
Quand je vivais à Paris, je travaillais du mardi au samedi. Chaque lundi, j’allais flâner dans les librairies de Saint-Michel à la recherche de polars américains. C’est ainsi que j’ai découvert les histoires qu’Alfred Hitchcock a adaptées au cinéma et à la télévision.
La série télévisée Alfred Hitchcock Présente est composée de 268 épisodes en noir et blanc, d’une durée de 26 minutes, diffusés entre le 2 octobre 1955 et le 25 septembre 1960 sur le réseau CBS, puis entre le 27 septembre 1960 et le 26 juin 1962 sur le réseau NBC. En septembre 1962, la série The Alfred Hitchcock Hour (Suspicion) a pris le relais. Certains épisodes sont un peu bâclés, mais la plupart sont de véritables bijoux. Ce sont des histoires courtes reposant sur des intrigues policières à la fois macabres et humoristiques, avec systématiquement un retournement de situation final. Les épisodes tournent autour d’un concept simple : l’exploration des relations humaines sous un angle cynique. Les idées sont ingénieuses, et l’on ne ressent jamais cette impression de déjà-vu, ce qui est essentiel. Dans chaque épisode, précédé du dessin emblématique de son profil, Hitchcock introduisait les pires horreurs avec son ton pince-sans-rire, n’hésitant pas à se moquer des annonceurs, d’abord furieux, puis rapidement ravis du succès de la formule.
Alfred Hitchcock demeure une source d’inspiration pour les écrivains. Lorsqu’il écrivait The Woman in the Window (La femme à la fenêtre), un des romans les plus vendus de 2018, l’auteur A. J. Finn pensait au grand maître du suspense. Il déclara dans une interview : « Hitchcock a prouvé que le suspense peut être aussi efficace, sinon plus, que la surprise, que la retenue et le bon goût peuvent l’emporter sur les tactiques de peur et les artifices faciles, que le style peut sublimer une histoire plutôt que l’écraser. Par-dessus tout, il a mis l’accent sur la psychologie : du complexe d’Œdipe de Norman Bates à la folie partagée qui aveugle les tueurs dans La Corde, de l’obsession croissante de James Stewart dans Sueurs froides à l’entrée difficile dans l’âge adulte de Teresa Wright dans L’Ombre d’un doute. Avec The Woman in the Window, j’ai essayé de puiser dans cette sophistication intemporelle et cette profondeur psychologique légendaire. »
« Le terme hitchcockien a été créé pour décrire certaines qualités qu’il a illustrées », explique Paul D. Marks, un auteur de romans policiers récompensé. « Il ne les a peutêtre pas toutes inventées, mais il les a sûrement faites siennes. Des éléments comme des innocents accusés ou pris au piège d’événements qu’ils ne comprennent pas et dont ils doivent se sortir. Des gens ordinaires emportés dans des situations vertigineuses jusqu’à ce qu’ils retrouvent leurs repères et un semblant de normalité. »
Michael Mallory, historien du cinéma et auteur de romans policiers, a lui aussi reconnu l’influence d’Hitchcock et des écrivains qu’il a adaptés. Il inclut Robert Bloch, auteur du roman Psychose, qui a inspiré le film devenu un classique de l’horreur. Selon Mallory, son histoire la plus « hitchcockienne » se déroule sur un bateau, comme le long métrage Lifeboat d’Hitchcock. Elle met en scène un homme qui invite un ami pour une aprèsmidi de pêche, qui devient le cadre d’une sanglante vengeance impliquant une machette et des eaux infestées de requins.
À l’époque où il était critique aux Cahiers du cinéma, François Truffaut défendait les cinéastes américains comme John Ford et Howard Hawks, perçus comme des « artisans » aux États-Unis et comme des « auteurs » en France. Alfred Hitchcock, en particulier, était admiré par les futurs instigateurs de la Nouvelle Vague. Truffaut, notamment, se passionna pour l’oeuvre du maître du suspense, tout comme ses collègues Claude Chabrol et Éric Rohmer.
En 1962, alors réalisateur acclamé pour Les 400 Coups, Tirez sur le pianiste et Jules et Jim, Truffaut écrivit à son idole pour organiser une série d’entrevues fleuves. De cet exercice est né le livre définitif sur Hitchcock. Kent Jones retrace la création et l’impact de cet ouvrage dans le documentaire Hitchcock/Truffaut, en s’appuyant sur plusieurs témoignages. Ce livre, structuré de manière chronologique, est un long échange de questions et de réponses où les deux réalisateurs revisitent l’oeuvre entière d’Hitchcock. Truffaut publia une version actualisée peu avant sa mort. Les propos d’Hitchcock, précis et sincères, sont inestimables pour les amateurs de cinéma.
Dans Le Visage du passé, je me suis moi aussi inspiré d’Alfred Hitchcock et des écrivains qu’il a adaptés dans ses films et la série Alfred Hitchcock Présente. Il s’agit d’une nouvelle aventure de John Snow, le héros de mon précédent roman Un Désir de vengeance. John est mandaté par le département de police de Bellingham pour ramener un homme lourdement endetté auprès d’un créancier. Il débarque dans une petite ville du Wyoming et découvre que le père du mauvais payeur est l’homme le plus influent de la région. Le maire et le shérif semblent à sa solde. Dans cette même ville, John retrouve Susannah, la gérante d’un bar et une ancienne connaissance dont il tombe à nouveau amoureux.
Sommaire
Avant-propos
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Chapitre 7
Chapitre 8
Chapitre 9
Chapitre 10
Chapitre 11
Chapitre 12
Chapitre 13
Chapitre 14
Chapitre 15
Chapitre 16
Chapitre 17
Chapitre 18
Chapitre 19
Chapitre 20
Chapitre 21
Chapitre 22
Chapitre 23
Chapitre 24
Chapitre 25
Chapitre 26
Chapitre 27
Chapitre 28
Chapitre 29
Chapitre 30
Chapitre 31
Chapitre 32
Chapitre 33
Chapitre 34
Chapitre 35
Épilogue
REMERCIEMENTS
1
Silver Rock commençait à se refléter progressivement sur les vitres du bus qui ralentissait. D’abord, apparurent des rangées de maisons isolées d’un étage, puis une partie plus avenante de la ville, avec des façades modernes de magasins et des immeubles aux murs de brique rouge.
Comme c’est fréquent en été, la chaleur, dans ce paysage vallonné au milieu de la campagne, engendrait peu à peu un sentiment de vastitude et de vide. Pour l’instant, cela ne faisait que rendre les journées plus difficiles, mais si la pluie tombait en fin d’après-midi — la météo paraissait incertaine —, la chaussée serait comme de coutume inondée. De toute façon, le chauffeur de bus n’y prêtait pas attention. Au moment où il stationna, il annonça :
— Silver Rock. Arrêt, dix minutes.
John Snow, un passager de taille moyenne, la trentaine, vêtu d’un costume gris foncé, se leva de son siège, tira une petite valise du compartiment au-dessus, et se fraya un chemin le long du couloir jusqu’à la porte. Il descendit les marches de fer puis tomba face à un homme grand et mince, vêtu d’une combinaison grise avec son prénom, « Hector », brodé dessus.
— Bienvenue dans le Wyoming, fit-il. Pas de bagages en soute ?
— Non, répondit John.
— Vous avez fait bon voyage ?
— Ç’aurait été mieux avec des sièges plus confortables.
Hector émit un sourire et haussa les épaules d’un air désinvolte.
— Je m’occuperai de ça quand je serai le patron, plaisanta-t-il.
John remarqua qu’il boitait.
— Vous savez où habite Steven W. Robinson ? demanda-t-il.
Soudain, le sourire du porteur s’effaça.
— Je n’ai jamais entendu parler de ce nom-là.
— Et où est le meilleur hôtel ?
Hector se dérida de nouveau.
— Le Green Diamond, par là.
Il attendit que John s’éloigne un peu avant de se rendre au bureau du shérif. Il peinait à marcher d’un bon rythme à cause de sa jambe boiteuse.
Il n’était pas encore midi, mais une dizaine de clients se pressaient déjà au restaurant de l’hôtel. Aux frais de la princesse, pensa John. Comme il traversait le hall, il frôla un client légèrement éméché. Il garda un instant en mémoire le visage blafard de cet homme, puis l’effaça de son esprit.
— Bonjour. Bienvenue au Green Diamond. Je suis Richard Ramsey, le gérant de l’hôtel.
Ramsey avait les cheveux grisonnants, et les traits aigus de son beau visage paraissaient presque émaciés.
— Bonjour. Je souhaite réserver une chambre, dit John.
— Il ne m’en reste qu’une. La 8, au premier étage. Elle coûte dix dollars de plus.
John hocha la tête, perplexe :
— C’est d’accord.
— J’aurai besoin d’une pièce d’identité et d’une carte de crédit, s’il vous plaît.
John sortit deux cartes de son portefeuille et les déposa sur le comptoir. Ramsey les examina rapidement et dit :
— C’est une chambre fumeur avec vue sur la grande rue de Silver Rock, monsieur Snow.
John signa le registre et jeta un coup d’oeil vers l’escalier. Il y avait une machine à sodas indiquant : « FAIRE L’APPOINT » ; et une machine à confiseries pleine de barres chocolatées et de sachets de chips derrière des ressorts métalliques rappelant des spirales de sommier.
— Je vais vous montrer la chambre, annonça Ramsey.
John le laissa passer devant, attrapa la rampe et gravit l’escalier marron. L’étage était aussi accueillant que le rezde-chaussée. Le couloir était en parquet, du même marron que l’escalier. Avec le temps, de la poussière s’était infiltrée dans les fentes du plancher, et ses pas soulevaient quelques particules.
Arrivé devant la porte numéro 8, Ramsey l’ouvrit et laissa entrer John.
— Cela vous convient ? demanda-t-il.
— C’est parfait, merci.
John fut immédiatement attiré par quelques objets asiatiques curieux posés sur une table dans un coin de la pièce ; il se mit à les examiner sans prêter attention au gérant.
— Vous restez longtemps ?
John observa Ramsey un instant, puis répondit :
— Tout dépendra.
— Le petit-déjeuner est compris. La salle de restaurant est à gauche au rez-de-chaussée.
John regarda par la fenêtre et aperçut un homme en train de discuter avec Hector.
— Qui est cet homme dans la rue ? Celui de droite ?
Ramsey s’approcha pour regarder et dit :
— Le shérif, Peter Lawson.
John hocha la tête.
— Vous n’êtes pas en cavale ?
— Non, répondit John.
— Tant mieux.
John continua à examiner les divers bibelots asiatiques disposés dans la pièce.
— Connaissez-vous un certain Robinson… Steven W. Robinson ?
Ramsey parut étonné et hésita.
— Vous lui voulez quoi ?
— Vous le connaissez ?
— Oui, répondit Ramsey en faisant mine de partir.
— Où pourrais-je… ?
— Excusez-moi, je dois m’en aller.
John déboutonna sa veste et posa sa petite valise au pied du lit. Quand il s’assit, les pans de sa veste s’écartèrent comme une jupe ample. Il alluma une cigarette, prit le téléphone, puis se souvint du mandat d’amener. Il le sortit de sa poche.
Un cendrier était posé sur la commode en face du lit, où se trouvait aussi la télévision. Il prit le cendrier, posa sa cigarette dans l’encoche et ouvrit le document. Il parcourut les pages recto verso, puis se mit à fouiller dans la poche de sa veste. Il y trouva un ticket de bus, un flacon de paracétamol et, au fond, un stylo à bille bleu, blanc et jaune sur lequel on lisait : Days Inn, Bellingham, Washington.
Il se pencha sur le document, studieux, si bien que la page se retrouva dans l’ombre. Il hésita à le signer. Il remit le stylo dans la poche de sa veste, se demandant pourquoi il exerçait encore le métier de policier. Il reprit sa cigarette, tira une bouffée, la reposa dans l’encoche du cendrier et continua à feuilleter le document.
John avait souvent songé à arrêter pour écrire un livre à ce sujet. Juste un livre. Le premier titre qui lui était venu à l’esprit était L’histoire d’un flic, mais il trouvait cela trop commun et banal. Sans compter que ce titre avait déjà été utilisé par une dizaine d’auteurs avant lui. Il s’était finalement convaincu qu’un titre, en plus d’une bonne couverture, revêtait une importance cruciale pour le succès d’un livre. Celui qu’il avait retenu était inspiré d’un graffiti aperçu dans les toilettes d’une station Mobil, près de Laurel Grange, au nord de Bellingham, sur la nationale 539 : La traque des loups voyageurs. Un titre mystérieux, accrocheur, digne d’un western. Mais il ne l’avait jamais écrit. L’idée même de s’y essayer lui semblait présomptueuse. Il n’était qu’un flic, après tout, un flic jouant au justicier.
De retour au bureau de la réception, Ramsey trouva le shérif Lawson, apparemment en train de l’attendre, accompagné de Clint, son adjoint.
— Shérif ? Que puis-je pour vous ?
Lawson était grand et élancé, avec une expression singulièrement impassible, comme sculptée dans du bois. Clint, plus jeune, était petit et trapu.
— Dans quelle chambre se trouve le nouveau venu ?
Ramsey se gratta le front et répondit :
— J’ai accueilli trois nouveaux clients aujourd’hui.
— Ça va, rétorqua Lawson, agacé.
Ramsey répondit avec lenteur, puis déclara enfin :
— La 8. Mais je ne veux pas de problèmes dans mon hôtel.
Le shérif esquissa un sourire étrange.
— Qui vous dit qu’il y en aura ? Attends-moi ici, Clint.
Dans l’escalier, Lawson croisa le client au visage blafard, qui lui sourit aimablement. Une fois à l’étage, il marcha jusqu’à la porte de la chambre 8 et frappa.
— C’est ouvert, répondit John.
Le shérif entra.
— Bonjour, dit John.
Lawson l’observa avec une certaine hésitation et demanda :
— Qu’est-ce qui vous amène à Silver Rock ?
— Vous posez toujours cette question aux nouveaux venus ?
— Seulement à ceux qui cherchent Steven W. Robinson.
— Je ne dois pas être le premier, soupçonna John.
Lawson acquiesça.
— Cela dépend de ce que vous lui voulez.
— J’ai de quoi vous renseigner.
John lui tendit un document.
— Un mandat d’amener de l’État de Washington. Du comté de Whatcom. Cela ne vaut pas grand-chose ici.
— Une personne libérée sous caution ne peut pas échapper à son jugement, déclara John.
Les yeux graves et perçants de Lawson rencontrèrent les siens.
— Avez-vous l’autorité nécessaire pour dire cela ? demanda-t-il en se glissant rapidement dans un fauteuil.
— Oui, je l’ai, répondit John, qui s’assit en face de lui en recoiffant d’une main sa tignasse brune soigneusement peignée.
— Êtes-vous assermenté ou délégué ?
— Assermenté, fit John en montrant sa plaque d’officier de police.
Lawson acquiesça.
— Un chèque sans provision, commenta-t-il. Quel est le montant du préjudice ?
— Trente-deux mille neuf cent soixante dollars.
Le shérif souffla.
— Vous cherchez du sang ou de l’argent ?
Les grands yeux noisette de John se voilèrent.
— L’argent me suffira.
Lawson, pensif, contemplait le document. Ses joues brûlaient.
— On pourrait s’arranger, dit-il.
John sourit.
— Cela fait partie de votre mission d’arranger les choses pour lui ?
— Si cela peut maintenir la paix, oui.
— Cet homme m’a l’air bien important.
— Son père l’est…
Lawson se leva brusquement du fauteuil et se dirigea vers la porte.
— Je vous tiens au courant, dit-il.
— Attendez, shérif. Je garde le document jusqu’à ce que les choses s’arrangent.
Lawson le salua respectueusement et partit.
John demeura un instant cloué sur place, puis secoua la tête, l’air interrogateur.
2
Une fois sortis de l’hôtel, Lawson et son adjoint traversèrent la grande rue en direction de la mairie, un bâtiment en briques ocres de deux étages.
— Retourne au bureau, Clint. Je ne serai pas de retour avant trois heures.
Le maire et juge de la ville, Robert D. Webb, avait un caractère moins emporté que celui du shérif, mais sa patience n’en avait pas moins des limites, assez vite atteintes. Il était assis derrière un grand bureau couvert de paperasses, préoccupé par les problèmes de températures grandissants chaque année.
Si pratiquement tous les habitants bénéficiaient de la climatisation chez eux, dans leur voiture, dans les magasins ou au travail, ce n’était pas le cas des sans-abri. Webb avait mis en ligne une carte indiquant cinq centres de rafraîchissement, de répit et d’hydratation offrant cinq cents kits pour lutter contre la chaleur : des bouteilles d’eau isothermes, des chapeaux à larges bords, de la crème solaire, des brumisateurs individuels et des serviettes rafraîchissantes. Encore fallait-il que les sans-abri aient un téléphone pour consulter cette carte ou que celui-ci fonctionne encore malgré la chaleur.
Dora, une employée à la corpulence un peu enrobée, frappa à la porte sur laquelle il était inscrit : « Défense d’entrer ». Elle l’ouvrit, s’effaçant pour laisser passer Lawson.
— Bonjour, shérif, fit Webb. Une question juridique ardue ? Ou est-ce une visite de courtoisie ?
Lawson s’assit docilement.
— Rien de tout ça. Un officier, mandaté par le département de police de Bellingham dans l’État de Washington, recherche Steven Robinson.
Webb se balança en arrière, les mains derrière la nuque.
— Et alors ? Je ne suis pas son père.
— Moi non plus, mais j’en ai assez de jouer la nourrice et de réparer ses bêtises.
Webb le regarda, étonné.
— Vous ne pouvez pas protester, shérif. Lui servir de nourrice est votre devoir, comme d’écrouer les ivrognes pour les relâcher le lendemain.
— Parfois, je me demande si le jeu en vaut la chandelle.
— Vous êtes amer parce que Steven vous a chipé votre petite amie.
Toute l’amabilité de Lawson disparut soudainement. Son visage devint rouge de fureur, et de grosses veines saillissaient sur son front. Il se pencha en avant et lança :
— Vous allez trop loin, Monsieur le Maire.
Webb, absolument stupéfait, garda néanmoins sa présence d’esprit.
— Peut-être bien, mais à mon âge, les goûts changent. Je vous conseille de l’oublier.
— Vous voudriez que je fasse comme vous : me payer les services d’une entraîneuse de bar.
Les yeux de Webb clignèrent.
— Vous ne connaissez pas Rosita.
— Peut-être bien, mais d’après les rumeurs, c’est une arriviste, une dissidente qui défie l’ordre moral. Pour vous, elle incarne un imaginaire revendiquant la liberté sexuelle.
Webb secoua la tête.
— N’écoutez pas les rumeurs, clama-t-il. Rosita est une femme au grand coeur, qui se garde pure et digne, sachant aimer jusqu’au sacrifice, voire au péril de sa vie. Elle m’a raconté ses expériences. Elle m’a décrit sa vie misérable au Mexique, son arrivée sans le sou au Texas, son initiation dans une maison close à Seligman, en Arizona.
Soudain, Lawson se rappela la dernière fois où il avait couvert le maire avant que son épouse Deborah ne trépassât…
— Allô, shérif Lawson, murmura-t-il en décrochant le téléphone.
— Bonsoir, shérif. Excusez-moi de vous déranger, dit Deborah.
Elle était assise dans le salon, buvant un verre de bourbon et occupée à faire quelque chose de tellement ordinaire que cela en était ridicule : elle tricotait un pull en laine.
— Mais vous ne me dérangez pas, madame Webb. Que puis-je pour vous ?
— Je voulais seulement savoir si vous saviez où Robert peut bien être. Mon téléphone n’avait plus de batterie. Je crains qu’il n’ait pas pu me joindre. Et je suis très inquiète.
Embarrassé, Lawson hésita un instant, puis répondit :
— Non, je l’ignore, madame Webb. C’est étrange qu’il ne soit pas encore rentré.
Quelque chose cogna contre sa fenêtre. Elle pensa que c’était sans doute un oiseau en levant les yeux. Ses doigts s’arrêtèrent. La chose parut être plus grosse qu’un oiseau avant de disparaître dans la nuit et le vent. La lumière était trop faible pour qu’elle puisse en être sûre.
— Aurait-il une raison quelconque de travailler aussi tard ?
— N… non. Je suis passé le voir à son bureau en fin d’après-midi. Quand je l’ai quitté, il semblait prêt à rentrer chez lui.
— Vous en êtes sûr, shérif ?
Lawson hésita de nouveau.
— En fait, quand je l’ai quitté, une femme l’attendait, et je ne l’ai pas revu depuis.
— Une femme ?
— Oui. Une femme qui a attendu plus d’une heure avant qu’il ne la reçoive. Elle paraissait très nerveuse, oui, très nerveuse.
Deborah demeura assise, la tête inclinée, le tricot toujours entre ses doigts immobiles. Un pull bleu marine. Puis elle demanda d’une voix tremblante :
— Est-ce… est-ce que c’était quelqu’un que mon mari connaissait ? Quelqu’un qui était déjà venu ?
— N… non. Elle n’était jamais venue. Je ne crois pas. Et Robert semblait ne pas vouloir la recevoir.
Le vent soufflait fort dehors.
— Vous vous rappelez son nom, shérif ?
— C’était Lane. L.A.N.E. Je crois qu’elle se prénommait Rosita.
— Et alors, qu’ont-ils fait ? demanda Deborah dans le silence de la nuit, qui n’en était plus un.
Lawson se gratta le front pour essayer de trouver une réponse plausible.
— Robert avait l’air un peu embarrassé. Mais enfin, j’ai vu qu’il essayait de s’en tirer le mieux possible. Il a dit à madame Lane qu’il avait rendez-vous et lui a demandé si elle pouvait repasser un autre jour. Elle a répondu que non, que c’était important. Alors Robert a accepté de la recevoir. Du coup, je suis parti.
— Eh bien, dit faiblement Deborah, tout cela est bien étrange. Mais je suis sûre que si c’était important, Robert me l’aurait dit. Il me raconte toujours tout ce qui se passe au bureau.
— Oui, madame Webb.
L’ombre d’un sourire embarrassé passa sur le visage de Lawson pendant qu’il disait cela.
— Je vous remercie, shérif. Excusez-moi de vous avoir dérangé.
— De rien, madame Webb.
Blafarde et agitée, Deborah retomba sur ses oreillers. Ainsi, c’était ça ! Ce qui ne devait plus arriver était encore arrivé ! L’idiot ! Le parfait nigaud ! S’empêtrer dans une aventure pitoyable avec une femme qu’il connaissait depuis un an. Se faire prendre de nouveau. C’était inconcevable ! Et pourquoi l’avait-il trahie encore une fois ? Essayait-il de la rendre folle ? Tentait-il de la faire succomber à une dernière crise cardiaque ?
Le lendemain matin, le corps nu et sans vie de Deborah Webb fut retrouvé par sa gouvernante. L’épouse du maire était entourée de plusieurs bouteilles d’alcool et d’un flacon de somnifères. À sept heures vingt-cinq, la police découvrit des flacons vides de ces médicaments à côté de son lit. Il n’y avait aucun signe de blessures externes ou d’ecchymoses sur le corps. Les conclusions de l'enquête furent publiées quarante-huit heures plus tard. Le coroner en chef du comté de Lincoln qualifia la mort de Deborah Webb de « suicide probable » …
Webb frappa violemment le bureau, ramenant Lawson à la réalité.
— Assez plaisanté ! Qu’a encore fait Steven ?
— Un chèque sans provision. Je vais aller trouver son père. Vous venez avec moi ?
Webb dévisagea Lawson, les sourcils froncés.
— Non, merci.
Le shérif se leva et se dirigea vers la porte.
— Très bien, fit-il. Je vous tiendrai au courant de ce qu’il en est.
Il sortit, refermant la porte derrière lui.
3
Depuis son intégration au sein de l’unité des crimes majeurs (le MCU), chargée d'enquêter sur les affaires criminelles, le salaire annuel de John Snow s’élevait à soixante-dix-sept mille dollars, plus une rémunération additionnelle d’environ six mille dollars. En général, les affaires sur lesquelles le MCU enquête concernent les crimes violents, les vols, les cambriolages, les fraudes et les infractions pénales commises sur Internet.
Mais ce travail, bien que mieux rémunéré que son précédent poste, ne lui procurait plus vraiment de satisfaction. Comme il l’avait confié à son amie et collègue Erin, il ne se faisait aucune illusion sur ses chances de continuer dans cette voie jusqu’à soixante ans. Que pourrait-il alors faire ? Devenir garde d’honneur, comme Erin ? Non. Il était bien trop actif pour se contenter d’un emploi où la mission principale consiste à assister aux cérémonies de décès.
Tout en vivant confortablement de ses revenus, John jouait les fourmis en économisant pour les jours difficiles. Au cours des quatre dernières années, il avait placé entre cinq et six mille dollars par an dans un portefeuille de valeurs mobilières. Le total n’était pas aussi conséquent qu’il l’aurait espéré — en raison des fluctuations des marchés financiers —, mais il pensait que, grâce aux achats étalés dans le temps, il finirait par réaliser un bon profit.
En plus de ces revenus et placements, il exigeait de pouvoir se rendre en voiture ou en bus sur les lieux de ses missions. Non qu’il craigne de prendre l’avion ou le train, ou qu’il rechigne à facturer ses frais de déplacement à l’administration qui l’employait ; il détestait tout simplement les vols intérieurs, l’affluence dans les aéroports et dans les gares. Sans compter l’attente, les retards et le fait qu’il n’avait aucun contrôle à bord d’un engin volant ou roulant à vive allure sur des rails. C’était aussi vrai sur la route, en voiture ou en bus : un chauffard pouvait perdre le contrôle de son véhicule, griller un stop ou un feu rouge, et causer une collision fatale.
La plupart du temps, John aimait conduire. Cela le dépaysait. Il devait être chauffeur routier dans une autre vie. Il aimait imaginer une existence où, au lieu d’être un homme vêtu d’un costume trois-pièces, le visage sérieux, le sourire forcé, et travaillant dans un bureau, il serait un justicier aux joues mal rasées, le stetson rabattu sur un front bronzé par le soleil, parcourant les routes des États de Washington, de l’Oregon, du Montana, de l’Idaho et du Wyoming. Sa nouvelle mission correspondait d’ailleurs parfaitement à ses exigences : 1 500 km séparaient Bellingham de Silver Rock, ce qui représenterait un trajet de deux jours…
En fin de journée, à environ cent ou deux cents mètres du Green Diamond, John commença à entendre un martèlement sourd et rythmique qui semblait venir du trottoir sous ses pieds. Sa première pensée fut qu’il s’agissait d’un tremblement de terre sur fond de musique des Rolling Stones, mais deux minutes suffirent pour déterminer l’origine du son. Il ne venait pas du sol, mais de l’air, et c’était un son qu’il connaissait bien : le battement d’une grosse caisse et d’une guitare basse.
À mesure qu’il avançait, toute la musique se fondit autour de lui. L’orchestre jouait Paint It, Black, et il entendait des rires. Des rires d’ivresse joyeuse, ponctués de cris de fêtards. Cela lui redonna l’envie de chanter.
Le bar, un vieil hôtel transformé en cabaret avec un parking plein, s’appelait le Susannah Café. Intrigué, John s’arrêta à la limite de l’éclat aveuglant projeté par les lumières du parking. Pourquoi tant de voitures ? Puis il se rappela que c’était vendredi soir. Apparemment, le Susannah Café était l’endroit où se retrouver si on habitait Silver Rock ou les environs.
L’orchestre enchaîna sur Wild Thing, une chanson des Troggs. Bon sang ! pensa John, ils jouent encore ces morceaux. Ceux qu’il chantait, il y a quinze ans, avec son propre groupe. À l’adolescence, bien avant de devenir policier, il avait commencé à jouer de la guitare et à chanter dans un groupe de rock baptisé The Reckless (les téméraires). Mais sa carrière n’avait jamais décollé. Il tenta sa chance à Seattle et obtint quelques dates dans des salles de seconde zone, puis il finit par abandonner.
Une fois à l’intérieur du bar, John se dirigea vers le comptoir. La salle était faiblement éclairée, mais on pouvait distinguer ce qui se buvait et ce qui se mangeait. Des photos de paysages du parc national du Grand Teton ornaient les murs. Elles n’étaient pas immédiatement reconnaissables, mais cela n’avait pas d’importance : en noir et blanc, elles avaient un certain charme.
— Qu’est-ce que je vous sers ? demanda le barman, un rouquin d’une vingtaine d’années.
— Une bière, s’il vous plaît.
— Une pression, une !
John se méfia du barman dès le premier regard, dès qu’il lui adressa la parole. Il y avait quelque chose qui clochait. Sur tous les félons du monde occidental plane l'ombre de Judas. Comme tous les traîtres, Judas ne pouvait qu’être roux, et au fil des siècles, il l’était devenu. Ce faisant, il avait rejoint un petit groupe de félons et de traîtres célèbres, que les traditions médiévales avaient pris l’habitude de distinguer par une chevelure ou une barbe rousse : Caïn, Dalila, Saül, Ganelon, Mordret et quelques autres.
— Comment vous appelez-vous ? demanda John.
— Ken.
— Ken, servir un fond de cuve est un crime.
Le barman sourit légèrement et lui servit une bouteille de Coors.
— Goûtez celle-là.
John but une gorgée et fit :
— Hum !
— Ce n’est pas souvent que je sers un connaisseur.
Une femme brune s’approcha de John et lança :
— Ce n’est pas marrant de boire tout seul.
Il se retourna et la toisa de la tête aux pieds.
— Ça ne se fait pas quand on est bien élevé… Ken, appela-t-il.
Le barman se rapprocha.
— Servez mademoiselle.
— Rosita, se présenta-t-elle.
— Que désirez-vous boire, Rosita ?
— Une coupe de champagne.
Ken acquiesça tandis que Rosita se rapprochait de John.
— Vous êtes nouveau ici ? Vous connaissez quelqu’un ?
— Non.
— Ça viendra.
Ils trinquèrent.