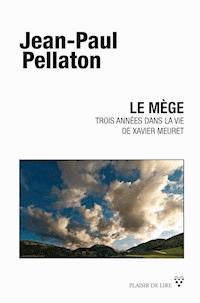Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Plaisir de Lire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Quand un ancien camarade de classe se présente chez eux, Laurent et Marianne font preuve d'hospitalité...
Un soir, un homme frappe à la porte du narrateur et de son épouse. Il s’agit d’un ancien camarade de classe qui, pour des raisons obscures, demande l’hospitalité pour une durée indéterminée. Après plusieurs jours, au moment où sa présence commence à peser à ses hôtes, il leur explique enfin les raisons de son comportement étrange...
Jean-Paul Pellaton nous dresse ici les portraits tout en finesse des différents protagonistes du roman: le « visiteur » et les femmes de sa vie, son copain d’enfance, hôte malgré lui, et son épouse au rôle plus important qu’il n’y paraît au premier abord. Un magnifique roman à faire (re)découvrir dès que possible!
Un roman psychologique à l'atmosphère pesante, où se débat un trio de protagonistes ambivalents.
EXTRAIT
Pierre Baud avait sonné chez moi vers six heures, un mercredi. Il n’était pas entré aussitôt, restant quelques secondes à stationner sur le paillasson, muet. Sans doute imaginait-il que je reconnaîtrais d’emblée son visage que verdissait la mauvaise lumière de l’escalier...
J’avais pu observer à loisir son corps empaqueté dans un imperméable de couleur mastic, de longs bras tombants à quoi les mains s’attachaient un peu comme des bêtes étrangères. Un demi-sourire flottait à la hauteur de la bouche.
– Bien sûr, je dérange... fit sa voix.
– Pas du tout, monsieur. Donnez-vous la peine...
Je m’effaçais pour le prier d’entrer lorsqu’un hoquet, de rire ou de confusion, me força à dévisager mieux ce visiteur.
– Ma parole ! Je ne me trompe pas : tu es Baud ?
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
Grand écrivain suisse disparu en 2000, Jean-Paul Pellaton nous sert une intrigue étrange, chargée de non-dits, et il nous plonge dans une atmosphère lourde et chargée où partout l’on peut ressentir le malaise des gens et les remords qui rongent les vies. -
David Campisi, La Cause Littéraire
Sans feux d’artifice, c’est un roman très fin qui nous laisse en suspens et fait énormément réfléchir. -
Les lectures de Lux
À PROPOS DE L'AUTEUR
Jean-Paul Pellaton est né à Porrentruy le 10 août 1920 et il est décédé le 21 avril 2000. Enseignant secondaire dans un premier temps, il sera ensuite nommé directeur d’école. Parallèlement, il suit des études de Lettres à Berne, Genève et Neuchâtel. Il obtient une licence ès Lettres à l’Université de Neuchâtel en 1953. Dès 1957, il enseigne à l’École normale de Delémont, et pendant une vingtaine d’années, est lecteur en philologie à l’université de Berne. Son œuvre est riche de récits pour la jeunesse, de pièces radiophoniques, de plusieurs romans et recueils de nouvelles, publiés aux Éditions de l’Aire et à l’Âge d’Homme, notamment. Il a reçu plusieurs prix, dont le prix de la Bibliothèque pour tous en 1982, le prix Schiller en 1985 et le deuxième prix Schiller pour l’ensemble de son œuvre en 1994.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 121
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ainsi que l’aide de la Ville de Delémont, auxquelles va toute la reconnaissance de l'éditeur.
ISBN : 978-2-940486-36-6
© Éditions Plaisir de Lire. Tous droits réservés.
CH – 1006 Lausanne
www.plaisirdelire.ch
Photo de couverture : Michel Pellaton
Version numérique : NexLibris – www.nexlibris.net
JEAN-PAUL PELLATON
LE VISITEUR DE BRUME
RÉCIT
Postface de
Daniel MAGGETTI
Pour les petits-enfants
de Jean-Paul Pellaton
I
Pierre Baud avait sonné chez moi vers six heures, un mercredi. Il n’était pas entré aussitôt, restant quelques secondes à stationner sur le paillasson, muet. Sans doute imaginait-il que je reconnaîtrais d’emblée son visage que verdissait la mauvaise lumière de l’escalier...
J’avais pu observer à loisir son corps empaqueté dans un imperméable de couleur mastic, de longs bras tombants à quoi les mains s’attachaient un peu comme des bêtes étrangères. Un demi-sourire flottait à la hauteur de la bouche.
– Bien sûr, je dérange... fit sa voix.
– Pas du tout, monsieur. Donnez-vous la peine...
Je m’effaçais pour le prier d’entrer lorsqu’un hoquet, de rire ou de confusion, me força à dévisager mieux ce visiteur.
– Ma parole ! Je ne me trompe pas : tu es Baud ?
– Ah ! mon vieux Laurent ! exultait Baud, ses lourdes mains enfermant les miennes et les pétrissant.
Il paraissait m’avoir fait la meilleure des surprises ! A mon tour, j’eus quelques mots pour l’accueillir, et la porte fut refermée. Avant d’entrer, Baud avait ramassé une serviette et un chapeau que je n’avais pas aperçus tout à l’heure : une serviette jaune à nombreux soufflets, comme en achètent les hommes d’affaires ; un chapeau gris et ancien, les plis très accusés. Dans le corridor, il dépouilla son imperméable qu’il suspendit au porte-manteau. Je le poussai dans mon bureau et l’obligeai à s’asseoir.
J’avais eu Baud en face de moi, mal à son aise dans un fauteuil, les yeux agrandis par un bonheur qu’il s’efforçait de me faire partager, mais sans paroles. Il portait des lunettes de myope à solide monture noire. Derrière les verres, son regard bleu, que je me rappelais moins mobile, voltigeait de la bibliothèque à un tableau, stagnait un moment à la fenêtre pour revenir à moi – on eût dit vers une sécurité. Son visage n’avait pas changé : large, osseux, la peau sèche et comme usée, une bouche aux lèvres fortes, un peu molles.
Puis Baud parla, me demandant si je me portais mieux. Sa question ne me surprit pas. Les dernières fois que je l’avais rencontré, je mijotais dans les maladies. Heureusement, ma santé ne me donnait plus d’inquiétude.
– Tu as réellement meilleure mine, conclut Baud. Ça me fait un rude plaisir de te revoir, tu sais !
Et sans transition, il s’enquérait, avec une espèce d’avidité :
– Tu te souviens ?
Quelles frasques, quelles discussions voulait-il que je me rappelle ? Je n’étais pas en humeur de m’attendrir sur ces années mortes et je dis, à tout hasard :
– Nous étions des amis épatants, Pierre, autrefois. Un peu dommage que tout cela change... Chacun va son chemin dans la vie, un petit chemin égoïste et le plus souvent si maladroit ! Il faudrait se soutenir un peu. Que sais-je, moi ? Se revoir...
J’avais lancé ces paroles comme des cailloux dans la nuit. Pouvais-je me figurer que Baud s’arracherait à son fauteuil, bondirait vers moi et, ses grosses mains enfermant mes épaules, me dirait, avec ce même hoquet du début que je pris, cette fois, pour un sanglot :
– Oui, bien sûr, Laurent, je n’attendais pas moins de toi. Mais tout de même, il faut que je te le dise : tu es un copain merveilleux !
A cette explosion, je soupçonnai que Baud était venu me demander un service. Mais lequel ? Lorsqu’il se rassit, la tête basse, comme s’il regrettait déjà de s’être ainsi livré, je le questionnai :
– Et ton travail, Pierre ? Tu es satisfait ?
– Ça n’est pas trop mal, dit-il sans beaucoup d’enthousiasme. Tu sais que j’habite Saint-Fromont, maintenant ?
J’acquiesçai, comme si j’étais au courant, mais en fait, je l’avais perdu de vue depuis quelques bonnes années.
– Bien entendu, continuait Baud, on pourrait trouver mieux. Même beaucoup mieux. Mais il faut aussi savoir se contenter.
– Tu es dans le commerce, n’est-ce pas ?
– Mais oui, le bureau d’une usine de textiles.
Et c’est même le bureau qui m’envoie chez toi...
– Chez moi ?
– Façon de parler ! Je veux dire que j’ai des affaires à régler ici pour la maison. C’est grâce à cela que j’ai passé chez toi. Il y a si longtemps...
– Ah ! oui, je comprends.
C’était un de ces jours où l’on se croit en droit de tout comprendre. Une lucidité généreuse me portait vers Baud. Je demandai :
– Tu es ici pour plusieurs jours ?
– N...on. Tout au plus deux ou trois, je pense.
Et après un temps, il corrigea :
– Cela dépendra de l’avancement de mon travail.
Baud désirait-il s’installer chez moi, les quelques jours qu’il aurait à vivre ici ? Je crus le deviner et, tout bonnement, je lui offris de le loger. Il me semblait qu’ainsi je m’acquittais envers un ancien camarade d’un élémentaire devoir d’hospitalité. Je précisai d’ailleurs qu’il ne devait attendre rien de spécialement confortable. Du moins, il n’aurait pas à se mettre en quête d’un hôtel.
Baud pouvait refuser, et je dois dire que je m’attendais à ce refus. Il sembla tout au contraire hésiter, ouvrit la bouche une ou deux fois puis, avec un sourire qui lui remontait bizarrement une seule des commissures, il me dit, la voix humble :
– Comprends bien, Laurent, que je ne tiens pas à déranger. Tu vas croire que je suis venu exprès pour ça. Je ne voudrais surtout pas...
Sur ses genoux, ses doigts nerveux se frottaient l’un contre l’autre, comme pour se débarrasser d’une glu. De toute ma force, je le rassurai : je le recevais en ami, ce serait un plaisir pour ma femme et pour moi de l’avoir chez nous, et il n’était nullement question de déranger.
Son teint s’éclaira. Peut-être même qu’une buée ternit un bref instant la surface de ses yeux clairs. Il avait l’attitude pitoyable de ceux qu’une pudeur retient de clamer leur misère, mais qui vous l’offrent là, dans un regard insistant, dans un sourire trop soutenu. Quelle misère ? Je remis à plus tard de m’en inquiéter.
Quand je lui tendis une boîte de cigarettes, son corps se ramassa dans le fauteuil, comme pour exagérer encore la valeur de mon offrande à un personnage aussi infime. Il fumait sans hâte pourtant et commença, en regardant les anneaux bleus planer entre nous, de bavarder sur le passé.
C’était un paradis qu’il évoquait, avec des détails menus et touchants que ma mémoire n’avait pas su conserver. La sienne s’était imprégnée de tout. Il réveilla la silhouette endormie d’un vieux professeur barbu qui m’aurait injustement puni. Je retrouvai le porte-plume aux moires rouges et vertes que je lui avais prêté, un jour qu’il avait oublié le sien. Il me rappela aussi que nous faisions de longues promenades à bicyclette et que j’avais plus d’une fois réparé sa machine.
– Mais oui, Laurent, souviens-toi donc ! Tu avais une véritable adresse de professionnel, dans ces petits travaux !
Baud, par sa verve qu’on eût dite emprisonnée jusque-là, par sa jubilation naïve tout accordée aux années enfantines qu’il ressuscitait, me remerciait des services que je lui avais alors rendus !
Marianne rentra que Baud, assis de guingois dans mon fauteuil, écrasait au fond du cendrier sa quatrième cigarette. Comme elle entendait bavarder, elle s’était abstenue d’entrer. Je quittai pour quelques minutes le bureau et, priant Marianne de nous rejoindre, je lui appris qu’un ami d’autrefois était venu me voir : je pensais bien faire en le retenant.
Les présentations furent cordiales. Marianne s’empressa, tourna vers moi, puis vers Baud, le bel ovale de son visage grave où l’âme semblait apparaître par une remontée subite, renouvelant un miracle familier.
Baud avançait une main hésitante et sourit, le coin gauche de sa bouche relevé, comme tout à l’heure. Et avant qu’il eût rien dit, Marianne s’informait, avec une joviale assurance de maîtresse de maison :
– Vous nous resterez bien quelques jours, j’espère ! Chez nous, ce n’est pas grand. Mais pour un ami, il y a toujours de la place.
– J’ai déjà promis à Laurent, fit Baud. Je ne sais comment remercier. Tout l’embarras...
Il y avait eu ce soir-là un souper sans beaucoup d’allant, autour d’une table où nos gestes se perdaient. Baud se taisait. Est-ce que ma femme l’intimidait ? Ou bien les souvenirs de notre vie d’enfant pouvaient-ils seuls l’animer ? Je l’interrogeai sur la petite ville qu’il habitait maintenant. Il s’efforçait de me répondre avec précision, cherchait longuement sa pensée.
– Saint-Fromont ? faisait-il, ouvrant largement ses yeux clairs. Comment vous dire ? C’est un gros bourg, bien sage, bien assis. Il ne s’y passe presque rien, et ce n’est pas moi qui m’en plaindrai. Pour être franc, je ne m’y sens pas encore tout à fait à l’aise.
– C’est plaisant, au moins ? s’enquit ma femme. On peut y vivre ?
– Plaisant ? Peut-être... Bien des gens le prétendent. Pour moi, c’est surtout l’hiver que j’apprécie cette ville...
Elle lui demanda s’il se moquait.
– Pas du tout, madame. La neige, c’est si pur ! Ça cache si bien les laideurs ! Alors on voit beaucoup moins que tout le pays n’est rien d’autre qu’une sorte de cuvette, de dépression. Un fond de marais, en somme.
Ce brusque surgissement d’éloquence étonna Baud lui-même. Il se remit à manger, le reste du temps, et je ne pus tirer de lui que des monosyllabes polis.
Après le repas, Marianne transforma mon bureau en chambre d’amis, comme elle le faisait dans ces occasions. Baud nous souhaita une bonne soirée : il se sentait un peu las et désirait dormir. Sous son bras, il pressait la serviette en cuir jaune qu’il avait déposée à son arrivée et qui devait contenir tout son nécessaire de voyage.
La porte refermée sur lui, un long corridor nous séparant de son logis, il nous parut, à Marianne et à moi, que nous respirions un air plus allégé. Elle me regarda, les sourcils hauts :
– Pas très bavard, dis donc, ton ami !
J’essayai d’expliquer :
– Non, j’en conviens. Il y a comme ça des gens qui se livrent peu et que gênent les étrangers. Baud, vois-tu, je l’ai toujours connu timide, réservé. Un brave garçon. Un sensible, probablement...
– C’est à l’école que vous étiez camarades ?
– Mais oui, surtout à l’école. Et puis, plus tard aussi. Nous nous retrouvions assez souvent, même, quand il habitait encore ici. Après son mariage, on s’est un peu perdus. Je crois ne plus l’avoir revu depuis qu’il travaille à Saint-Fromont, ce qui fait bien quatre ans.
Marianne s’exclama, comme si une période aussi longue eût été l’éternité :
– Quatre ans ? Et il se souvient de toi après tout ce temps ? Vous deviez être particulièrement liés, alors ?
Je réfléchis un moment. J’essayais de soupeser la qualité de nos liens.
– Non, il ne me semble pas que nous étions très liés. De bons camarades, voilà tout. Oui, c’est à peu près ça : nous étions de bons camarades.
– Entre hommes, fit encore Marianne, ces choses-là sont probablement plus simples.
Étaient-elles vraiment plus simples ? Je n’aurais pu en jurer. Marianne ne dit plus rien de la soirée, alla s’installer près de la fenêtre avec un ouvrage. Pour moi, je pris un livre.
Il me plaisait que Marianne eût si bien accueilli Baud. Elle-même devait être satisfaite de sa gentillesse. Deux ou trois jours, nous aurions chez nous cet hôte dont je devais bien m’avouer que je ne savais pas grand-chose. L’on croit exhumer, intacts, des sentiments endormis. En fait, aucun n’est pareil après quelques années, et il faut un miracle pour en retrouver la fraîcheur. C’était peut-être un tel miracle que j’avais secrètement espéré en retenant Baud.
Tout en réfléchissant, je regardais Marianne, son front lisse baissé sur son ouvrage. L’aiguille luisait avant de percer la toile. Une respiration plus profonde lui soulevait parfois tout le haut du corps. Son visage basculait aussi et, un instant immobile, s’éclairait par l’intérieur d’une flamme chaleureuse. Nos yeux se croisaient, Marianne souriait. C’étaient nos soirées. J’avais la certitude que c’était le bonheur !
Au moment d’aller nous coucher, en passant près de mon bureau, nous avions entendu un souffle rauque et régulier : Baud dormait.
II
Les deux jours qui suivirent, je ne revis Baud que le soir, à l’heure du repas.
Marianne m’avait appris qu’il quittait l’appartement vers dix heures, ayant avalé le petit déjeuner qu’elle lui servait chez lui, sur la table de mon bureau où elle jetait une nappe. Son imperméable mis, le contenu de sa serviette vérifié, il frappait discrètement à la porte vitrée de la cuisine. Quand Marianne apparaissait, Baud la remerciait de son hospitalité et la priait de me présenter ses sentiments bien amicaux. Un peu de rouge devait lui tacher ses joues ternes.
Presque tout de suite après, il avertissait ma femme par téléphone qu’il n’arriverait pas à temps pour le déjeuner. Il s’en excusait, avec une abondance de politesses. Vers le milieu de l’après-midi, il revenait pour s’enfermer un quart d’heure ou une demi-heure dans la chambre prêtée, après quoi il repartait, s’excusait encore très humblement parce qu’il avait dû sonner : déranger !
Le soir, il s’installait quelques moments au bureau dont il laissait la porte ouverte. Dans le fauteuil même où il s’était assis le premier jour et qu’il semblait s’être réservé, je reconnaissais sa nuque grêle et ses oreilles rosées de chauve-souris.
– Ah ! je vous ai ennuyés, n’est-ce pas ? commençait-il dès qu’il m’avait aperçu.
Il me fallait user presque de véhémence pour apaiser mon ami et le persuader que sa présence ne nous gênait pas, qu’il n’avait d’ailleurs nullement l’obligation de partager tous nos repas.
– Voyons, Pierre, sois raisonnable. Nous te recevons avec plaisir. Ça ne veut pas dire que nous voulions t’enchaîner. Tu as toute ta liberté !
– Oui, je sais, mais ...
– Et puis, il y a tes affaires, ton travail. C’est ça qui compte, d’abord.