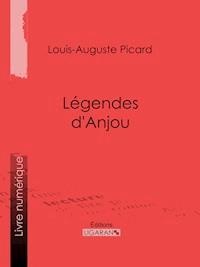
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "Les légendes angevines qui ont trait aux époques préhistoriques ne sont guère que des explications simplistes, candides ou audacieuses. Les vestiges retrouvés de ce passé nébuleux sont attribués, suivant la tournure d'esprit des interprètes, au Diable, aux Saints ou à quelque personnification mythique des contes : fée, enchanteur, magicien ou sorcier, ayant acquis droit de cité dans le pays."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 242
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Les légendes abondent en Anjou. Pittoresques et intéressantes, elles sont, pour la plupart, des broderies fantaisistes sur quelques bribes de la vérité historique. Elles en colorent la trame sèche, naïvement, comme de vieilles tapisseries dont le dessin confus met du fabuleux aux personnages et au milieu où ils sont représentés.
Les unes sont des traditions populaires qui, en passant de bouche en bouche, ont subi des altérations multiples.
Les autres sont des récits merveilleux, accrédités par les chroniqueurs anciens, qui étaient dominés par l’intention de mettre en relief les hommes et les faits de leur province.
D’autres encore sont nées spontanément de l’imagination ou d’une interprétation erronée.
Les guérisons extraordinaires des thaumaturges, les miracles des saints, comme les méfaits des sorciers et des magiciens, y tiennent une large place, à côté des prouesses mirifiques des héros.
Si l’Anjou s’est signalé par son zèle pour le christianisme, il n’en a pas moins gardé l’empreinte des antiques superstitions du paganisme. Les fictions et les contes du Moyen Âge y survivent. Des coutumes, héritées de la Féodalité, s’y prolongent, à peine déformées. Des usages et des habitudes de temps plus rapprochés y subsistent.
La fontaine a conservé son pouvoir thérapeutique spécial. L’empirique rebouteux a gardé son prestige.
Il y a du merveilleux accroché à chaque vestige. Le dolmen à sa fable fantastique ; le château sa légende l’abbaye son miracle.
Toutes ces légendes ont leur charme savoureux.
L’histoire est la tradition pédagogique. Réaliste, elle analyse les faits.
La légende est la tradition populaire. Idéaliste, elle synthétise les croyances.
L’histoire est la prose.
La légende est la poésie.
Les légendes angevines qui ont trait aux époques préhistoriques ne sont guère que des explications simplistes, candides ou audacieuses. Les vestiges retrouvés de ce passé nébuleux sont attribués, suivant la tournure d’esprit des interprètes, au Diable, aux Saints ou à quelque personnification mythique des contes : fée, enchanteur, magicien ou sorcier, ayant acquis droit de cité dans le pays.
Sauf de rares exceptions, elles ne diffèrent que peu des naïves interprétations qui ont cours dans les autres contrées. Mais notre paysan d’aujourd’hui affecte de s’en tenir à sa propre interprétation.
Quand il ramasse dans son champ un coquillage fossile, qui affirme que la mer était là, il ne s’en étonne aucunement et date aussitôt sa trouvaille du Déluge universel. Si c’est l’ossement d’un animal énorme, il ne s’en étonne pas non plus : c’est du temps où il faisait beaucoup plus chaud ou beaucoup plus froid. Si c’est un débris d’outil ou d’arme de pierre : c’est une simple preuve que l’industrie a progressé.
Les carriers, qui sont les mieux placés pour faire de ces découvertes, bien qu’ils soient impitoyables à briser ces reliques des premiers âges, montrent un respect superstitieux, par exemple, pour ces coquillages fossiles bivalves, qu’ils appellent des cœurs, parce qu’ils en affectent la forme. C’est que, suivant la légende, ou plutôt des légendes, car il y a des variantes, ce sont de vrais cœurs pétrifiés.
Les jolies Ammonites en forme de spirales ont également trouvé grâce devant les casseurs de pierres, ainsi que les Bélemnites, mais beaucoup plus à cause de leur forme d’escargots et de cigares géants que pour les fables, trop modernes et manquant de surnaturel, qui ont cours à leur sujet dans les carrières.
Notre population angevine ne s’étonne pas de l’habitation des premiers humains dans les cavernes et les grottes. N’est-elle pas restée elle-même troglodyte pour une partie, surtout sur la rive gauche de la Loire. Cette survivance de l’habitation dans la roche est un des caractères les plus curieux de la région saumuroise. Mais que quelque légende ténébreuse se raconte sur ces cavernes, elle trouve toujours des auditeurs attentifs.
Il est, en effet, curieux de constater combien les ignorants, les plus vaniteusement sceptiques, sont enclins à prêter l’oreille aux récits les plus invraisemblables, dès qu’il s’y attache du merveilleux. C’est avec la plus complète indifférence qu’ils foulent ou repoussent du pied ces éclats de silex, qui ont été les instruments de nos ancêtres, et c’est avec le plus grand intérêt qu’ils écoutent les contes fantastiques qui prétendent les expliquer. Ils passent insouciants ou même défiants à côté de l’histoire, mais ils s’arrêtent volontiers à la légende, et c’est ce qui explique que tant de fables se soient attardées dans notre pays et y aient foisonné.
Les interprétations scientifiques des vestiges préhistoriques ne sont-elles pas elles-mêmes des légendes ? disent les sceptiques, qui leur reprochent leurs hésitations et leurs tâtonnements, les meilleures preuves pourtant de la prudence de leurs auteurs.
La préhistoire est un domaine dont l’exploration ne date que d’hier et où l’on ne peut trouver que des témoins matériels, qu’il faut faire parler. Toutes les traditions qui s’y rapportent sont trop vagues pour qu’on puisse en tirer une aide.
Les révélations que les préhistoriens offrent à notre curiosité peuvent cependant satisfaire les amateurs de merveilleux. Quelle est l’énigme qui puisse valoir ce problème du processus de l’humanité depuis les époques les plus reculées ? Quelle est la légende qui peut valoir la muette éloquence des fossiles ?
Nos lointains ancêtres avaient aussi leurs légendes, que ne peuvent-ils nous les raconter !
À défaut de leurs confidences, on a pu relever des preuves de leurs superstitions : talismans, amulettes, fétiches, qui dérivent de leurs croyances : sabéisme, thériolâtrie, totémisme.
Les grottes peintes, les restes de dessins ou de sculptures sont l’illustration de ces croyances. Ce sont leurs traditions, leurs légendes, sur lesquelles on a brodé toutes sortes de conjectures, devenues elles-mêmes légendes devant les progrès de la science préhistorique.
Les animaux contemporains de cette première humanité habitant notre pays : le mammouth, le mastodonte, les éléphants, le rhinocéros, le renne, le lion, l’ours, etc., ne nous semblent-ils pas eux-mêmes légendaires, malgré qu’on nous montre leurs ossements trouvés dans nos terrains ?
Les plus anciennes sépultures, par leur mobilier funéraire, nous révèlent une croyance à une survie. La mort et la préoccupation de l’au-delà ont dû enfanter, dans les esprits de ces hommes primitifs, de multiples légendes, que la science s’efforce d’inférer des rites funéraires indiqués par ce mobilier des tombes. Les croyances des populations primitives, nos contemporaines, qui en sont encore au même degré de civilisation, peuvent nous en donner une idée.
L’emploi exclusif des instruments de pierre pour les sacrifices religieux, qui persista si longtemps dans les mœurs des populations successives, malgré l’usage généralisé du bronze, de l’airain et du fer, est une tradition évidente des anciens usages cultuels.
Cette tradition, comme toutes les traditions, prit avec le temps une patine légendaire, et la hache de pierre, l’instrument ancestral, eut son culte particulier, qui dégénéra en superstition, par ignorance du passé. La hache en silex devint alors un talisman, dont l’origine oubliée prit dans l’esprit populaire une autre interprétation.
C’est ainsi que les haches en silex, selon une croyance qui s’est perpétuée jusqu’à nos jours, furent considérées comme descendues de la nue sur la terre avec l’éclair. C’était dès lors un talisman contre l’orage, qui porta le nom de « pierre du tonnerre », comme aux temps gaulois, où c’était l’arme et le symbole du dieu Tarann, le dieu de la foudre. Tant il est vrai qu’une superstition, si imaginaire qu’elle soit, révèle toujours une filiation.
Dans nos campagnes de l’Anjou, on peut voir encore ces primitifs paratonnerres fichés dans les murs de quelques vieilles maisons.
Nombreuses et variées sont les légendes attribuées aux monuments mégalithiques laissés par les ancêtres préhistoriques : menhirs, peulvans, cromlechs, roulers, dolmens, galgals, carnéioux. Mais on peut dire qu’aucune n’a un fond de vérité. Toutes ont été bâties sous l’impression, énigmatique déjà, de ces œuvres grandioses, que l’imagination populaire attribue à des géants, à des fées, ou au diable. Curieuses sans doute, pour leur naïve affabulation, elles n’ont aucun intérêt quant à la déformation historique. Originaires, pour la plupart, des superstitions du Moyen Âge, elles pourraient être aussi bien inventées par les faiseurs de contes, nos contemporains. En un mot, elles ne sont dignes d’attention que pour la crédulité de ceux qui les rapportent.
Les menhirs ou peulvans, c’est-à-dire les pierres dressées debout, ont eu chacune leur interprétation populaire, que leur nom vulgaire décèle encore quand la fable ne se raconte plus.
Les menhirs qui se présentent isolés, comme le menhir de la prairie de Chacé, sont attribués au Diable « qui les a laissés choir alors qu’il les emportait pour se construire une maison », ou à telle autre intention. D’autres disent que c’est saint Christophe, ou Gargantua, ou quelque autre géant légendaire, qui les a laissés là « en décrottant son sabot ».
Le plus souvent, la légende reflète l’explication que les érudits en ont donnée en les considérant comme d’antiques gnomons, indicateurs de l’heure.
C’est ainsi que tel menhir passe pour sonner douze coups à midi ou à minuit, il est vrai à de telles conditions que personne n’a jamais entendu sa sonnerie. Le nom de « pierre du coq » du menhir d’Échemiré dérive de la même idée. Il en est de même des noms de « pierre qui vire » ou « pierre tournisse ». C’est devenu la pierre qui tourne au lieu de son ombre
Comme tout paysan a coutume de se régler sur le soleil et sait vous dire l’heure très approximativement d’après sa hauteur, il n’y aurait rien d’étonnant que la tradition remontât tout simplement à l’observation de l’ombre du menhir. Les vieux carriers ont encore coutume de dresser une pierre ou un bâton dans leur chantier, pour avoir l’indication de l’heure par son ombre.
Les cromlechs, ou menhirs en cercle, ont presque tous leur légende de cadrans solaires, à moins que de plus savants n’en aient fait des zodiaques, ou que de plus imaginatifs n’y aient vu les stalles des juges du tribunal antique.
Les dolmens, dans la légende, ont généralement la réputation d’habitations de fées ou de gnomes gardiens de trésors souterrains. La découverte qui a été faite d’amas d’ossements en certains d’entre eux n’a pas découragé cette croyance naïve, elle l’a simplement fait dévier : les squelettes ont été attribués aux audacieux qui avaient voulu violer la demeure des génies.
Les pierres branlantes ou roulers étaient, à ce que l’on croit, des pierres fatidiques et probatoires. Ce sont d’énormes rochers mis en équilibre sur une base étroite et qu’un effort relativement très faible peut faire osciller.
Les traditions, qui se rattachent presque partout aux pierres branlantes, indiquent qu’elles avaient un emploi tout pratique dans les coutumes religieuses et judiciaires. On a signalé plusieurs roulers dans le seul arrondissement de Cholet. Ils ont tous leur légende.
Les pierres branlantes doivent probablement leur origine à une superposition naturelle. Ce sont des noyaux dont la base s’est exfoliée et les a ainsi laissés en équilibre. Une superstition devait fatalement s’attacher à cette disposition qui semblait tenir du prodige, et il n’est pas douteux qu’elle a été exploitée. C’est ce qui a fait penser que les hommes ont dû aussi créer des roulers, en aidant au travail de la nature.
Ce sont surtout les pierres à bassins ou à cupules qui ont exercé l’imagination populaire et aussi bien celle des savants. On y a vu des autels à sacrifices humains et on a montré les rigoles par lesquelles ruisselait le sang des victimes. Des interprètes moins exaltés les ont présentées comme de primitifs pressoirs ou des auges à écraser le grain.
En Anjou, on n’a pas trouvé auprès des roches les pilons ou broyeurs utilisés, mais on en a trouvé à Châtillon, à Pouzauges, à Loudun. Ce sont des demi-sphères en granit que l’on pouvait tenir à la main et promener circulairement à l’intérieur des cuvettes.
Dans certaines de ces cupules, on a voulu reconnaître des empreintes, qui ont donné motif à des légendes.
À l’entrée de la commune d’Allonnes, en bordure de la route d’Angers à Tours, est une roche en forme de siège à dossier, où se remarque une empreinte, qu’on montre pour celle de la main de saint Doucelin. Elle passe encore pour avoir le privilège de préserver Allennes des orages de grêle venant de l’ouest.
Sur le bord d’un chemin aboutissant au Vieil-Baugé par le nord-ouest, on peut voir une roche à cupule légendaire.
Cette roche est signalée par une inscription, qui présente cette cupule comme l’empreinte du pied du cheval du duc de Clarence, qui aurait fait un bond formidable de la hauteur pour sauver son maître lors de la défaite des Anglais, le 22 mars 1421. Cette pierre a été placée là, en évidence, vers 1840.
Des pierres, creusées de façon bizarre sur leur face supérieure, ont été signalées un peu partout en Anjou. Elles abondent surtout dans le Choletais, ce qui tient à la nature de la roche. Leurs légendes se sont un peu évaporées et les plus crédules hésitent maintenant à les répéter. Mais elles subsistent plus vivaces sur les confins de notre province, dans les Deux-Sèvres et la Vendée.
Dans la commune de Largeasse (Deux-Sèvres), le Pas-du-Bœuf, à Boussignoux est le nom donné à une excavation en forme de croissant, de 17 centimètres de diamètre. Sur la même pierre sont deux cuvettes cylindriques et un bassin de 30 sur 50 centimètres.
« Autrefois, les fermiers des Cochardières avaient un bœuf très malade qu’ils laissèrent dans la lande pour ne pas le voir mourir. Le pauvre animal se traîna jusqu’aux rochers à cuvettes. Il mit son pied dans l’empreinte, but à long trait l’eau bienfaisante et fut guéri. »
L’eau des bassins de Boussignoux ne tarit jamais. Cette eau guérit aussi les humains.
Le grand trou aurait été creusé par un saint des environs, probablement saint Bodet, lequel est vénéré à Vernoux, où il a sa fontaine.
« Dans le grand trou oblong, imitant une jardinière, j’ai compté – dit M. Gabillaud – neuf petites croix rustiques plantées par les solliciteurs de grâces surnaturelles ».
Le Chiron du Pas de la Vierge, dans la commune de La Chapelle-Saint-Laurent, est un rocher qui attire tous les ans, au mois de septembre, une foule de pèlerins. Sur sa vaste plate-forme, on remarque cinq longues fissures parallèles « empreintes des griffes du Diable », et une petite cuvette oblongue « le Pas de la Vierge ».
« Un jour, la Vierge était poursuivie par le Diable ; fatiguée, elle aperçut ce rocher et s’y reposa sur un pied ; puis, sur le point d’être saisie par le démon, elle s’envola d’un trait en criant “Pitié” jusqu’à l’endroit précis où s’élèvent maintenant le village et la chapelle qui portent le nom de Pitié, lieu de pèlerinage célèbre dans toute la Gâtine.
L’Esprit malin, furieux de voir échapper sa proie, saisit le rocher si fortement que ses griffes s’y enfoncèrent et firent trois rainures longues d’une cinquantaine de centimètres. »
Le pieux voyageur, qui met son pied dans le Pas de la Vierge, se trouve immédiatement délassé. De plus, il s’assure une provision de bonheur pour toute l’année.
Le Rocher de la Dame des Bourguinières est un bloc de 8 mètres sur 7 m 80, portant douze bassins (six de chaque côté) séparés par un canal de 0 m 60 de largeur moyenne et de 1 m 10 de profondeur.
D’après la légende, ce rocher, situé près de l’église de La Verrie, servait de siège à une fée curieuse, la Dame des Bourguinières, qui épiait les faits et gestes des habitants du bourg. On y montre la double empreinte laissée par la partie la plus charnue de son auguste personne.
Bien autrement intéressante est la tradition du culte des pierres, longtemps prolongé dans notre pays, qui résista à tous les anathèmes du clergé chrétien, et qui se retrouve encore dans certaines coutumes de nos jours. Et il en fut de même pour les autres cultes primitifs, notamment pour celui du soleil dont de nombreux vestiges nous révèlent les transformations et les déformations.
Quelles belles légendes nous fourniraient les propres interprétations des fidèles de ces cultes, si nous pouvions les entendre, au lieu de nos incertaines conjectures ! Quelles superbes fictions devaient être propagées par tous les envahisseurs successifs de notre pays, qui ont implanté si fièrement leurs croyances et leurs superstitions, en même temps que leurs mœurs. N’ont-ils pas été jusqu’à donner de mystérieuses explications de la première fabrication des métaux, pour en garder le monopole.
Les monuments des âges métalliques ne nous ont pas encore livré toute leur signification. Les tombeaux, les ponnes et les puits funéraires nous ont fait constater un mélange confus d’incinération et d’inhumation, avec des restes d’animaux, mêlés aux restes humains, et un mobilier funéraire très varié, quelquefois grandiose, qui indiquent d’étranges croyances dont le mysticisme nous échappe.
Combien pâles sont les interprétations qu’on en a tirées en regard de la flamme de foi qui a inspiré ces rites compliqués.
Pourtant, on retrouve la survivance de beaucoup de ces pratiques dans nos coutumes et cérémonies funèbres, qui reflètent leur antique tradition dans leur lente évolution. Nos rites et notre architecture funéraires en portent encore l’empreinte.
Les refuges souterrains si nombreux en Anjou, plus particulièrement dans le Saumurois, où leurs vestiges restent apparents, et même encore utilisés, évoquent des légendes cent fois plus suggestives que les histoires de brigands dont on les a affublés dans les temps modernes.
Les temps préhistoriques, malgré les efforts de la science pour les éclairer de son flambeau, restent encore si mystérieux dans notre pays, qu’ils sont plus légendaires que toutes les légendes qu’on leur a attribuées.
Les légendes qui se rapportent aux temps protohistoriques, c’est-à-dire aux époques sur lesquelles on possède déjà quelques renseignements, écrits par des contemporains, ne sont pas moins nombreuses et variées. Les documents, qui pourraient aider à vérifier ces légendes sur l’aurore de notre histoire, sont eux-mêmes entachés de fabuleux, car les chroniqueurs du Moyen Âge n’ont pas été les premiers à semer du merveilleux dans leurs écrits.
Nos plus vieux chroniqueurs angevins ont accueilli ces traditions et y ont ajouté beaucoup de leur imagination, sous prétexte d’explications. Dès lors, leurs légendes se répétèrent jusqu’à une époque bien proche de nous. Plus légendaires qu’historiens, ils ont déployé une science singulière, mais si savoureuse qu’on regretterait vraiment qu’ils aient eu moins de naïveté et d’assurance
L’un prend Dieu pour premier roi de la Gaule et Adam pour deuxième. Un autre fait à la Gaule une dynastie antédiluvienne.
Bourdigné, l’annaliste angevin qui écrivait en 1529, se contente de faire remonter l’Anjou à Noë et donne sa généalogie avec des dates.
Sans vouloir chercher plus que de raison quelles vérités servent de bases à cette prétention historique, il faut cependant relever quelques rapprochements intéressants.
« Le premier roy – dit-il – était surnommé Dis ».
Or, César a écrit dans ses Commentaires que les Gaulois prétendaient descendre du dieu Dis « Galli se omnes ab Dite patre prognatos prædicant ». Le dieu supérieur des Gaulois était selon lui le « Dis pater » qu’il assimile, à tort d’ailleurs, à Pluton.
Un autre roi, toujours selon Bourdigné, s’appelait « Magus », qui fut un grand édificateur.
Ceci, c’est le Pirée pour un nom d’homme. Magus était l’appellation par laquelle on désignait un territoire habité et, par extension, un centre d’habitations. Julio-Magus fut le nom romain d’Angers.
Voici d’autres noms de ces rois primitifs de la Gaule, toujours d’après le même auteur : « Druius, Bardus, Jupiter Celte ». On voit clairement où le légendaire les a puisés ; mais laissons-le l’expliquer lui-même :
« Druius, quatrième roy, par Berosus est appelé plein de sçavoir, dont prindrent nom et auctorité une secte de philosophes appelez Druides fort prisez et renommés en Gaule.
Bardus, cinquième roy, inventeur de rymes, réthorique et musique, mist sus une manière de poètes nommez Bardes, qui par leurs doulx chants et langaige, povoient retarder et apaiser deux armées prestes à combattre.
Jupiter Celte fut neuvième roy, lequel on dit avoir donné nom à la Gaulle Celtique ».
Après Jupiter Celte, le sceptre de la Gaule aurait passé en mains de sa fille Galathée, qui épousa le grand Hercule de Lybie.
Hercule, c’est la personnification des Phéniciens. Toute la légende d’Hercule s’explique par les gestes des Phéniciens sur le territoire de la Gaule. Le mariage de la reine gauloise avec le chef ou dieu lybien, c’est l’image en raccourci de la fusion des mœurs des indigènes et des immigrants venus par le sud.
Passons de suite au dix-huitième roi, que Bourdigné dit être Pâris :
« Paris, dix-huitième roy. De ce roy porte le nom la royalle et très fameuse cité de Paris, jadis dicte Lutesse, ville principale du roy aulme de France ».
Ceci est plus osé et ne supporte pas de commentaires :
« Namnès fut vingt-deuxième roy, et fonda la ville de Nantes ».
Nantes, comme les côtes de Bretagne, fut incontestablement peuplé par les premiers navigateurs qui ont visité les côtes de l’Atlantique ; Bourdigné les a recherchés parmi les peuples les plus réputés de l’Orient, et a choisi les Troyens.
Il appelle les premiers Angevins : Egadiens.
« Gens de leur nature industrieux, bien naiz et soubz bénin horoscope, et partie du ciel doulce et tempérée ».
Ils vivaient, selon lui, en nomades, et ce ne serait que sous le roi Sarron, troisième roi de la Gaule, qu’ils auraient obtenu l’autorisation de construire une ville, la future Angers, qui s’appela Andes.
Il vaut de laisser Bourdigné le conter :
« À donc retournez lesditz philosophes et théologiens en leur région de Egada, avecques exprez congé et privilège du roy de construire une cité pour leur demeure, entrèrent en la verdoyante et délectable forest de Nid d’Oyseau ou de Merle, et furent dedans par quelques jours tousjours enquérant et cherchant le lieu où plus communément habitoient et hantoient les oyseillons d’icelle forest. Et quand ilz eurent trouvé lieu tel que ilz demandoient, sçavoir est le plus peuplé et habité d’oyseaux qui fust là entour ilz jugèrent lors l’aer y estre plus doulx, plus pur et plus modéré que ailleurs. Parquoy commencèrent à bastir et édiffier maisons et loges, lesquelles ils cloyrent de bons et fors palliz de boys en lieu de muraille. Et à cecy accorde bien le poète Appolonius, qui dit que Angiers fust édiffiée, le roy Sarron régnant, et là habitèrent lesdicts Egadiens sur la profunde et navigable rivière de Mayenne, nommant leur ville nouvellement construite Andes.
Et fust ainsy faicte la première édification d’Angiers, l’an du monde deux mille, et après le déluge l’an trois cent quarante et quatre ou environ. Et ne fust pas la dicte ville édifiée par brigans larronneaulx, mais par gens d’honneur et de sçavoir. »
Cette première ville, selon Bourdigné, aurait duré plusieurs siècles, puis ses habitants l’auraient laissée tomber en ruines : « estant habitateurs plus adonnez aux lectres que à bastiements ».
C’est alors que l’imaginatif auteur fait arriver une bande de Troyens, qu’il appelle Angiens, et qui, fuyant leur ville dévastée, avaient vogué vers le couchant.
« Ilz descendirent par la Gaule Celtique, costoyant du costé deça la rivière de Loyre, tant quils parvindrent jusquesau pays des Andes, et en la délectable et umbrageuse for est de Nid d’Oyseau. »
Ce seraient ces Angiens qui auraient relevé la ville et lui auraient donné son nom d’Angiers, dérivé du leur.
Remarquons que le nom d’Angiers ne date que du XIIe siècle.
Hiret, dans ses Antiquités d’Anjou, édition de 1618, fait un récit assez semblable, sauf qu’au lieu de Troyens il dit des Grecs. Mais il adopte la généalogie des rois et y ajoute :
« Sous le roi Magus, l’Anjou étoit tout couvert de forêts et habité d’une quantité de philosophes. Magus leur fit construire une ville, qui fut nommée de son nom Juliomagus ».
Bruneau de Tartifume, se posant en correcteur, donne une autre explication, non moins aventurée, du nom de Juliomagus, qui, comme on le sait, est d’origine romaine.
« Angers fut nommé Juliomagon ou Juliomagus de Magus diction persique qui signifie sage, comme étant cette ville de retraite des sages et mages, qui étoient les philosophes, druides et astrologues de ce temps-là, et non pas de Magus deuxième roi de Gaule »
Barthélemy Roger, moine bénédictin d’Angers, qui écrivait en 1674, tout en raillant ses devanciers, et en prétendant les rectifier, n’est pas moins extravagant quand il parle des origines de l’Anjou, pour lesquelles, d’ailleurs, il adopte bonne partie des dires de ceux qu’il critique, mais en les commentant.
« Le déluge étant arrivé l’an 1656 du monde, et toute la terre habitable ayant été noyée, il a fallu beaucoup de temps pour la repeupler. Quelques auteurs, néanmoins, remarquent que, dès l’an 1760 de la création du monde, qui fut environ cent ans avant le déluge, Noë ayant donné sa bénédiction à ses enfants, leur départit les principales parties du monde, et qu’à Japhet il donna l’Europe où celui-ci vint habiter et la peupla ; et que, peu après, l’Italie et la Gaule commencèrent à l’être par les enfants de Japhet. Ils disent que cette peuplade et partage précédèrent la confusion des langues et le bâtiment de la tour de Babel, par Nemrod.
Je trouve cela assez douteux ; car s’il était vrai que Japhet fut venu en Europe avant le bâtiment de la tour de Babel et la confusion des langues, il y a apparence que Japhet ne nous eût apporté qu’une même langue, qui devait être l’hébraïque ou chaldaïque ancienne, et qu’elle y eut subsisté longtemps, ce qui n’a pas été.
Quoi qu’il en soit, et de quelque façon que la Gaule ait été peuplée d’habitants, et par qui et comment elle en a pris le nom, il est certain que l’an 2000 de la création du monde, la Gaule étoit déjà remplie d’habitants, qui vivaient dans la douceur et l’innocence de l’âge qu’on a appelé doré, et de ces bonnes gens la contrée qu’on a depuis appelé l’Anjou, fut aussi habitée, et c’est la première origine des Angevins.
Les anciens historiens racontent que, dès ce moment-là, la Gaule eut des rois dont ils marquent la succession. Sous Magus, fils aîné de Dis Samothes, qui avait été le premier roi de la Gaule, plusieurs contemplatifs et philosophes s’élevaient en Gaule, qui s’adonnaient à l’étude de la philosophie naturelle ».
C’est ainsi que transparaissent, dans Bourdigné comme dans Hiret, les allusions aux Druides et aux Bardes, aux Phéniciens et à la fondation de leurs comptoirs.
Les trouvailles si nombreuses, qui ont été faites, en Anjou, d’armes et d’ustensiles de bronze, ont inspiré à nos légendaires des conjectures fabuleuses, qui ne méritent pas d’être rapportées, parce que trop fantaisistes.
Nos premiers historiens ont été mieux inspirés en adoptant les récits d’Hérodote et de Strabon, qui font des « Sigynes » les premiers importateurs du bronze. Ces sigynes étaient, selon eux, des tribus nomades, originaires de la Caspienne, qui s’étaient vouées au transport des marchandises tout le long de l’Ister (Danube), jusqu’à Marseille.
« Les Sigynes se servent de méchants petits chevaux au poil épais, mais beaucoup trop faibles pour être montés. Ils en attellent quatre à un même chariot. Ce sont les femmes qu’on exerce dès leur enfance à conduire ces attelages. »
Devons-nous à ces Sigynes les petits chevaux dont on a retrouvé les squelettes et dont la race existe encore aujourd’hui en Limousin et en Bretagne ?
Des caravanes d’étameurs parcourent encore de nos jours l’Asie et l’Europe. Ils viennent, comme les hommes des fonderies de bronze, s’installer pour quelques jours dans les champs, autour des centres habités. Ils sont désignés par des appellations différentes, suivant les pays : Tziganes en Hongrie, Zingari en Italie, Bohémiens ou Romanichels en France, Gitanos en Espagne, Gypsies en Angleterre. Ils font encore le commerce de chevaux. Formant une corporation dépendant d’un chef unique, ils ne sont pas en concurrence les uns avec les autres. C’est de ce chef résidant à Pesth, qu’ils reçoivent le métal, et ce chef le reçoit lui-même d’un autre qui réside à Temeswar.
Dans son livre : « Edom ou les colonies Iduméanes en l’Asie et en l’Europe : colonies d’Hercule Phénicien et de Tyr, Paris 1626 », Pierre Leloyer prétend que l’Anjou fut au nombre de ces colonies des asiatiques.
Il faut se défier des étymologies de cet imaginatif annaliste angevin. Il est possible que les Phéniciens, qui se servirent de la Loire et de la Seine pour voies de commerce à travers la Gaule, aient eu un comptoir en Anjou ; cependant c’est aller un peu loin que de supposer une colonie phénicienne. D’ailleurs, les preuves qu’en donne Leloyer sont sujettes à caution. Il avait la manie des découvertes de ce genre. Ne s’était-il pas reconnu annoncé lui-même dans l’Hébreu et dans le Grec. Il citait volontiers un vers de l’Odyssée, qui n’aurait été que l’anagramme de ses noms et de ceux de son pays natal.





























