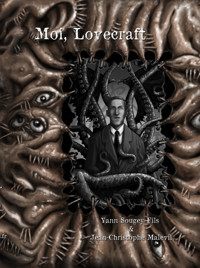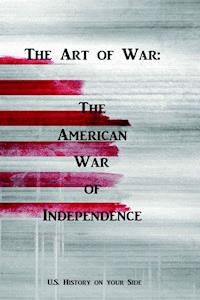Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions des Tourments
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Quand l'amour et la mort sont liés, jusqu'où aller pour retrouver sa bien-aimée ?
L’homme raconte son histoire près du chêne, la plume se gorge d’encre et de souvenirs est noirci le papier. C’est l’histoire d’une vie qui va mal, d’une rencontre, d’une passion et d’un inexorable destin. Sa dernière nuit aura été bien longue… et cette ombre qui plane dans le ciel de Londres... Mais continuer à écrire aux côtés de celle qui l’attend et puis, la rejoindre, dès l’aube… pour toujours.
Un roman à l'atmosphère sombre et mélancolique qui ravira les amateurs du genre !
EXTRAIT
Le jour s’éteint. Un noir attelage avait commencé sa course inexorable à travers les territoires de l’Europe. An de disgrâce 1700. La Mort Noire s’était répandue et dans ses serres, l’agonie, la souffrance et le désespoir œuvraient à la destruction de cette humanité rongée par le péché. Car rien ne dure pour toujours. Des âmes s’inquiètent, accusent, prient, et certains, même, jeûnent pour s’acquitter de leurs fautes et … on meurt aussi. L’humanité aliénée serait-elle jugée ? Je ne sais pas, je ne sais plus.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Fan de Lovecraft, Hyusmans, Leblanc, Ray, D'Aurevilly,
Jean-Christophe Malevil aime les atmosphères et les âmes torturées, l'horreur, le fantastique ainsi que les errances intestines mélancoliques et dramatiques... Ses textes ne sont pas à mettre entre toutes les mains.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 183
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jean-Christophe Malevil
Les Abysses Bleus
Livre premier
« … il tombait sur les figures levées de ces roses qui rendaient, en retour de la lumière d’amour, leurs odorantes âmes en une mort extatique ; il tombait sur les figures levées de ces roses qui souriaient et mouraient en ce parterre, enchanté par toi et par la poésie de ta présence. Tout de blanc habillée, sur un banc de violette, je te vis à demi gisante, tandis que la lune tombait sur les figures levées de ces roses, et sur la tienne même, levée, hélas ! dans le chagrin. »
Edgar Poe, à Hélène.
« Au milieu du chemin de notre vie je me retrouvai par une forêt obscure car la voie de droite était perdue. »
Dante, La divine comédie, L’enfer.»
« … Parce que toi et moi devons nous séparer Reste, ou sinon toute joie chez moi mourra
Et périra dans sa prime enfance »
John Donne, Reste, O ma douce, ne te lève pas !
Le jour s’éteint. Un noir attelage avait commencé sa course inexorable à travers les territoires de l’Europe. An de disgrâce 1700. La Mort Noire s’était répandue et dans ses serres, l’agonie, la souffrance et le désespoir œuvraient à la destruction de cette humanité rongée par le péché. Car rien ne dure pour toujours. Des âmes s’inquiètent, accusent, prient, et certains, même, jeûnent pour s’acquitter de leurs fautes et … on meurt aussi. L’humanité aliénée serait-elle jugée ? Je ne sais pas, je ne sais plus. Doit-on accuser le ciel ou les hommes ? Et tous ces gens qui pleuraient ; la Mort Noire, maîtresse du Diable, avait enfanté avec lui, la plus immonde des fins pour cette folle humanité qui pouvait bien prier de toutes ses dernières forces. Il fallait se rendre à l’évidence, tout ce que nous connaissions alors, allait s’éteindre pour de bon. Tout se devait de disparaître comme pour laisser place nette. Dieu et le Diable avaient choisi d’un commun accord de laver la surface de la terre de ses pauvres hères. Mais moi, il me reste encore assez de vie pour écrire mon histoire. Un peu de temps encore, juste assez pour décrire ce qu’il est advenu de ma triste destinée et de ma merveilleuse et troublante passion avec un ange sublime qui faisait pâlir le soleil lui-même de jalousie.
1670
Je … je ne vous donnerai pas mon nom, mais ma famille était l’une des plus vieilles de cette région de … où nos terres s’étendaient à perte de vue, à travers vallons, collines et forêts grouillant de gibiers. Une eau pure serpentait à travers nos domaines. Je me souviens de moi encore enfant et déjà en proie à la mélancolie, venir m’asseoir sur une grosse pierre tout près de cette eau chantante ; j’y plongeais ma main, l’eau froide caressait ma peau, j’oubliais tout et alors je pouvais communier avec la nature tout autour de moi. Je devenais attentif au moindre bruit, l’éclat de l’eau et sa musique berçaient mon âme et je me surprenais même à sourire. Tout devenait si calme, si simple, si beau ; de la chaleur enveloppait tout mon être, j’étais si bien, plus rien n’avait d’importance, juste le bruit de l’eau et ses caresses. Le temps n’avait plus cours, le temps n’était plus ce cadre familier de toutes ses maudites et longues minutes qui s’écoulent, inéluctables et souvent cruelles. Pour moi, le sablier du temps qui passe n’existait plus dès lors qu’enfant, j’étais là, silencieux, près de l’eau qui court sur les galets endormis. Et je pouvais rester là des heures entières, mon esprit errait ça et là à travers mes pensées les plus sombres, les plus secrètes. Et j’aimais tant vagabonder sur ces terres qui m’avaient vu naître, puis dépérir et qui maintenant me devinent vouloir mourir près de celle qui fut la seule vraie lumière ayant jamais illuminé mon cœur et mon âme.
Je suis né un matin d’avril 1665, dans cette ville de Londres. La pluie frappait les fenêtres de cette chambre qui me vit naître. Dehors, un ciel ténébreux pesait de tout son poids et semblait vouloir étouffer la vie. Cette pluie s’écrasait sur les pavés comme pour balayer crasse et ordures amoncelées. Et ce vent qui frappait les visages, ralentissait la marche d’hommes trop pressés voulant fuir une certaine réalité … la réalité crue de l’existence elle-même. L’humanité évolue dans un parfait mécanisme de sombre réalité. Je nais, je suis enfin moi, et pour combien de temps ? Avril, une pluie en furie, si forte, si glacée ; elle voulait assurément assouvir un noir dessein. Frapper encore et encore ces visages, leur faire mal. Elle qui désirait tant brouiller leur réalité tout en obscurcissant les formes spectrales de leur environnement familier. La pluie tombant en trombe qui déforme la rue, renforce ses secrets, trompe le passant. La pluie qui efface tout repère. Et l’on peut avoir peur, car la pluie battante, frappante et noire se déverse, gangrenant la ville. La pluie sombre s’abat tel un cortège funèbre qui avance à grands pas pour célébrer la Mort et ses paires. Et moi, je nais.
Ma famille, pour quelque raison obscure que je ne sus jamais, des hasards de fortune peut-être, resta à Londres et ce, jusqu’au jour de mon baptême. Et en cette grande église de … en plein cœur de Londres, le 3 septembre 1666, je fus baptisé. On avait préparé mon âme pour le paradis. On m’avait sauvé, sauvé du péché originel, mais peut-être aurait-on du m’immerger entièrement dans cette eau lustrale et m’oublier afin que je ne puisse jamais regarder la lumière. Et nous rejoignîmes nos terres situées à des lieues et des lieues de Londres, capitale d’une moitié du monde. Et Londres s’éloignait. Et si l’on avait fait attention à mon regard ce jour-là, on aurait pu y voir une étrange lueur dans mes yeux, comme s’ils étaient dévorés par des flammes, ardentes et belles, et qui dépassaient le ciel pour annoncer une nouvelle mortifère aux anges perdus dans les cieux, ceux-là mêmes, faisant sonner leur trompette de mélodies pleines de louanges à Dieu. Ces flammes dans mes yeux étaient comme le prélude à une vie faite de déceptions, de désillusions et de tristesse malgré la passion qui allait bouleverser la fin de ma vie.
1671
Un manteau lactescent recouvre mon royaume. J’aime le blanc de la neige, j’aime quand elle n’est pas souillée par des traces de pas, j’aime la voir immaculée. Je me souviens, je suis non loin du château, je pouvais entendre les cris de ma mère qui m’appelait. Moi, je restais muet à ses suppliques, et à la croisée d’un chemin, le visage levé vers le gris du ciel, les bras en croix, les paumes de mes mains offertes à la voussure céleste, je recevais la neige qui tombait, froide et pesante. Moi, les bras en croix, les prières de ma mère, la petite colline où je me tenais près du château, j’étais entouré d’un linceul de blancheur. Je ne pouvais plus bouger, j’étais comme sous l’effet d’un charme. La douceur glacée de la neige qui fondait sur mes mains m’enivrait, j’expérimentais sans en avoir conscience, sans pouvoir mettre un mot sur cette sensation, un moment de bonheur, fragile, fugace. Je souriais. Je sentis un poids sur mon épaule. La main de mon père qui était là, je devais rentrer au château, je ne devais pas attraper froid, je devais rassurer ma mère. Tout d’un coup, le paysage blanc s’était transformé. Sorti de la rêverie par la brusquerie de mon père, je ne voyais plus la beauté de la neige. En un geste, il avait réussi à inverser mon extase. Je regrettais qu’il fût venu me chercher, je regrettais qu’il fût là, avec moi ; car il avait brisé le charme sous lequel j’étais, sous lequel j’aurais voulu rester pour une éternité. Arrivés au château, la neige ne tombait plus.
On me frictionna devant la grande cheminée de la salle à manger et les flammes dans mes yeux esquissaient la peine que j’éprouvais. A ces silhouettes, j’aurais voulu dire toute ma déception, mais je restais muet ou n’osais parler. Le feu dans la cheminée crépitait, des étincelles venaient piquer ma peau nue, je tendais les paumes de la main vers ce feu, mes yeux étaient clos, je levais la tête vers le haut plafond sinistre de la pièce, mon esprit murmurait mille choses que je n’arrivais pas à déchiffrer. Je me mis à genoux devant ce feu, les paumes toujours tournées vers lui, le regard maintenant sur ce même feu grimaçant de douleur, je me mis à verser une larme qui s’écoula jusqu’à ma bouche et seul son goût salé me fit prendre conscience de sa présence sur mon visage. Je brûlais d’une fièvre intérieure, d’une vive agitation qui assombrissait mes états d’âme. A quoi bon finalement appartenir à cette humanité. Je n’en voulais pas.
Je me suis approché de la fenêtre, celle tout près de la cheminée, son feu semblait deviser dans mon dos avec les flammes des lourds chandeliers tout à côté. Et j’admirais un soleil périssant qui semblait vouloir emporter avec lui le manteau de neige. De larges bandes rougeoyantes parcouraient un sol froid et laiteux et j’imaginais cet astre incandescent et d’or triste tirant sur ces bandes afin de les attirer vers lui. J’imaginais ce soleil vouloir me ravir un peu de ce qui avait été pendant un instant, mon moment de bonheur. Mais le soleil disparaissait et la nuit croissait dans le déclin de ce jour, la neige se remit à tomber, je souris, j’étais seul dans cette grande pièce, j’aurais voulu de nouveau sortir et sentir la neige choir sur moi. Mais je restais à ma fenêtre, incapable de bouger, bercé et charmé par le spectacle de cette neige qui tombait, la vie à l’extérieur se résumait à une couleur noire surprenante, belle et à du blanc que la lune dans son infinie tendresse rehaussait de sa propre lumière blanche. Les deux couleurs représentaient un rêve encore flou à l’époque, l’union antinomique peut-être de deux personnes. Je ne sais pas. Et ces souvenirs d’enfance qui me déchirent, c’est si loin, je ne sais plus si j’ai vraiment vécu tout ceci. Je la regarde encore, encore et toujours et je ne peux m’empêcher de lui dire qu’elle est belle, qu’elle est lumineuse. Je soupire, je prends une autre feuille de papier, je trempe ma plume dans l’encre noire, je continue car je sens ma volonté faiblir, il me tarde tant … et je ne veux pas prolonger son attente …encore des mots, encore des phrases … encore des larmes … toujours la nuit autour de moi, autour de nous …
1672
Je termine un livre de contes. Je pose mon recueil sur la grande table en bois du salon et je me mets à observer ces personnages enfermés sur des toiles accrochées au mur. Je les dévisage, je considère leurs habits, je trouve des ressemblances avec mon père. Je prends un des deux chandeliers posés sur la table et je me rapproche des peintures. J’essaie de m’expliquer les lourds nuages qui flottent dans les airs, je me demande pourquoi tant d’hommes et de femmes se cachent le visage avec les mains, je me demande pourquoi personne ne regarde personne ; il n’y a aucun sourire. Les visages graves sont distordus alors que je me rapproche un peu plus d’eux avec le chandelier. Les flammes semblent ranimer les personnages figés sur la toile. Des ombres sinistres s’esquissent autour d’eux, individus prisonniers dans un décor halluciné et blafard. J’aurais dû avoir peur de tous ces effets d’optique mais je me demandais si je n’étais pas moi-même peint dans un salon, tenant à la main un chandelier et promenant les yeux sur des toiles … car ainsi ma vie n’aurait été qu’une simple illusion, ce que j’aurais vécu n’aurait pas été vrai. Oui, une simple illusion.
Ma vie aurait pu être le songe d’un peintre tourmenté par les affres de l’ennui et du chagrin. La contrition par la création. Libérer des énergies intestines et secrètes pour tenter d’atteindre l’inaccessible rêve de la création parfaite et équilibrée à travers la souffrance et la terrible appréhension du temps qui prend son temps mais qui ne vous laisse pas le temps. Mais nulle main d’un créateur, je ne dois ma conscience qu’à moi-même, je tiens le chandelier, je regarde les tableaux, je vis. Ou du moins, j’ai plutôt l’impression mortelle d’exister à moitié, et je relis ma vie à demi-mots. Terrifiante sensation que celle de revivre sa vie sur le papier blanc et sali par l’encre qui marque d’un sceau indélébile son appartenance à cette race humaine. Mes larmes mouillent ce papier, mes larmes me brûlent les yeux. Je dois continuer. Il faut que j’aille au bout de ma peine, au bout de ce testament de papier et de larmes qui ne sèchent pas, qui ne sèchent plus. Je relis ses derniers mots, je tiens tendrement sa dernière lettre d’une main tremblante, je souris. Elle est là, tout près de moi, qui me parle et me caresse de son souffle.
1673
Il y a une grande réception au château. Beaucoup de monde, de la famille, des amis. Beaucoup de bruit aussi, on discute, on parle fort, on rit, on mange, on boit, des enfants courent dans les couloirs du château, certains essayent de m’entraîner dans leurs cris, dans leurs rondes, dans leurs chants. Mais tout cela m’ennuie. J’aimerais tant participer à leurs jeux, mais je me demande si je sais encore m’amuser. Alors, je les laisse à leurs cris, à leurs rondes, à leurs chants. Je sors du château et tous les cris s’estompent derrière moi. Encore quelques pas, le silence comme dictame qui calme mon âme. Ma solitude me rassure peut-être aussi. Je passe près du ruisseau, je contemple mon chêne, je traverse ma forêt. Je m’arrête de temps en temps pour écouter les bruits de la nature et du vent qui siffle dans mes oreilles. Je me perds en moi … je me perds en toi … je …
Et le vent me fait goûter aux odeurs, aux parfums de ce triste printemps qui recrée années après années cette lourde exhalaison si particulière des champs de fleurs et qui n’appartient qu’à mon royaume. Et l’été va surprendre ce même royaume de senteurs fruitées, un temps seulement car les arbres sur mes terres ploieront sous le poids des fruits qu’on ne ramasse pas, qui tomberont à terre et qui pourriront sous ce même soleil qui m’accable et me tourmente. Et l’automne arrachera de ses mains les feuilles moribondes de mes arbres qui à leur tour iront pourrir et nourrir la terre déjà molle. Et enfin l’hiver, l’hiver qui fera taire les odeurs que son vent glacé expulse de mon royaume jusqu’au prochain printemps, un triste printemps.
Je traverse un champ de blé, mes mains caressent les épis alors que je marche le dos face à un timide soleil d’été. Des insectes chantent et louent l’astre terrible qui m’éreinte et pourtant synonyme de vie. Je marche droit devant, le château s’éloigne derrière moi, toujours ; le champ semble s’étendre à perte de vue. La récolte ne devrait tarder. Du soleil pour le blé, du blé pour le pain, du pain pour que les hommes vivent. Je suis en son centre maintenant, le soleil n’est plus aussi timide et s’acharne sur moi. Je marche plus vite, plus vite en direction de mon arbre qui m’offrira, c’est certain, un abri contre ce soleil. Sous sa frondaison, un peu d’ombre rafraîchit mon être. Je m’allonge sous les branches imposantes et belles de mon chêne, les yeux fermés, et j’entends les murmures agréables et magiques de ses rameaux agités par le vent, je m’assoupis, les murmures ne s’arrêtent pas et pénètrent mes rêves. Ces murmures sont l’histoire d’une rencontre. C’est comme si quelqu’un marchait dans mes rêves. Quelqu’un, une silhouette rêvée qui s’estompe et se liquéfie en moi, pour faire partie de moi, de ce que je suis, pour que je sois une partie d’elle, une alliance absolue, inconcevable, et pourtant… Un vent inquiet agite les feuilles de papier, je continue mon histoire, je la regarde, elle est si belle, toujours bien plus belle que la nuée hadale d’étoiles qui alors nimbe mon royaume de peine.
1674
La forêt m’offre un refuge. Je me perds parmi les ombres des grands arbres centenaires. Je prends à gauche, je longe ces longs sentiers vers nulle part. Je connais ces bois, je marche, droit devant, le soleil s’acharne à vouloir traverser les épaisses couches de branches. L’astre n’aura pas raison de ma forêt profonde. Je poursuis mon chemin. De la sueur perle de mon front. Ma promenade laisse des traces éparses sur les chemins. Ils sont noirs et semblent vouloir agir sur moi tels des sables mouvants. Pourquoi ne pas me perdre en eux ? Se laisser engloutir par les nappes sombres des feuillages qui règnent tout autour. La sueur obscurcit mon regard. La nature tente de m’entraîner dans sa folle euphorie. Et puis finalement, au milieu des couleurs et des arbres, des buissons et des fleurs, des plantes, j’ai cru deviner qui j’étais. Mais pour un instant seulement. Aveuglé par un rêve, orgueil familier de nuits à me morfondre, je suis un prédateur sans proie, je n’assouvis pas mes désirs, je me suis vu parmi d’autres ombres dans un univers qui ne m’a jamais été familier, je reste en marge de cette humanité succombante mais je continue à marcher près d’elle dans sa course insensée.
Le rêve, j’ai cru deviner qui j’étais vraiment. Mais ce fut trop fugace. La vérité me fuit. J’essaie de rassembler les pièces d’un puzzle qui me semblait de prime abord parfait. Des morceaux s’enchâssant dans d’autres morceaux, la géométrie parfaite des formes et des choses, la perfection du souvenir. Ce n’est qu’un rêve. J’ai dû rêver d’un rêve à l’intérieur duquel tout ne serait que réalité. Celle en laquelle je veux croire. La vivre. Être enfin et sortir du rêve. Non, je ne me souviens pas. Ma mémoire m’abandonne. Je pars. Je voyage dans les plus profonds recoins de mon âme, je cherche, je scrute. J’essaie d’organiser ces formes. Je ne sais plus qui je suis. Je sors du bois et la chaleur, le feu d’un soleil, m’accable à nouveau. J’écris la main tremblante mais assurée. Son sourire, son visage, son âme, je voudrais… la rejoindre.
1675
Le château que j’aperçois au sortir de la forêt me jette la réalité au visage. Je dois rentrer. Fini le rêve, fini les rêveries solitaires d’un jeune garçon de dix ans. Je dois rentrer au château consoler ma mère du départ de mon père à la guerre. Je sais que je n’aurai pas besoin de mots pour cela, ma présence avait suffi. D’ailleurs, je n’aime pas parler, que ce soit à mes parents ou bien … non, à qui pourrais-je bien parler, je suis seul. J’entends des cris, des pleurs, je ne vois pas ou plus de gestes tendres. Je me réfugiais dans la lecture. J’essayais de comprendre la poésie métaphysique de Donne, j’aimais lire et relire ses vers. Je ne comprenais pas encore pourquoi More s’était laissé mourir. Je ne comprenais pas encore, en lisant la Divine Comédie de Dante, qu’il fallait aller au plus profond du mal, de la souffrance et des enfers pour enfin voir la lumière du jour et se sortir de toute cette peine. Je touchais du bout des doigts les reliures dorées, je lisais à haute voix le nom des auteurs, le titre des livres. Je soufflais sur la tranche des lourds volumes et voyais s’envoler la poussière grise. J’aimais lire des biographies, j’aimais découvrir l’enfance des auteurs, je voulais me nourrir de leurs bouts de vie, la disséquer et tenter de percer le mystère de l’origine de leur création. Y avait-il de la souffrance en eux ? N’y avait-il que le goût de l’écriture, car peut-on raisonnablement n’écrire que pour ce plaisir ? Non, les auteurs accouchent les mots dans la détresse et le tourment, aussi douloureusement que la femme met ses enfants au monde, d’abord de la souffrance et ensuite cette espèce de soulagement, d’incommunicable bonheur ou arrogance du bâtisseur de phrases. J’avais également acquis la certitude que pour créer quelque chose, il fallait très certainement détruire une part de soi. Et je pouvais rester de longs moments dans cette grande bibliothèque familiale, orgueil de mon père qui lui aussi lisait beaucoup, mais ne parlait pas. En tout cas, pas à moi.
1676
Je me souviens, je suis dans les combles du château. Je voulais fuir la couleur du ciel d’automne. C’était l’endroit le plus sombre du château, le plus intimiste aussi, et je savais que je n’y serais pas dérangé, personne n’y venait jamais, seules, quelques araignées y avaient élu domicile et quelques rats perdus dans les dédales de mon illustre demeure s’y retrouvaient de temps en temps. J’avais gravi les marches usées, j’entendais le bruit de mes pas résonner, j’avais senti un froid sournois s’infiltrer en moi, j’avais ouvert la lourde porte grinçante. Je pénétrais la pénombre. J’habitue peu à peu mes yeux à ce nouvel environnement. J’ai du papier, un encrier, des plumes. J’allume alors les quelques bougies que j’y avais laissé la dernière fois alors en proie à une angoisse douloureuse, et au milieu des formes vacillantes, je veux écrire mon premier poème.
Mais les flammes attirent mon attention, je n’arrive pas à détourner le regard de leur danse ensorcelante, surnaturelle. Un craquement me sort de ma transe hypnotique. J’essaie de m’appliquer, je pense à tous ceux que j’ai lus dans notre bibliothèque, aux sonnets de Shakespeare, et cela même si je ne comprenais pas encore l’atticisme de son écriture. Je dois trouver quelque chose à raconter, je regarde autour de moi, des vieux manuscrits, des vieux tableaux, des malles, du bois pourri, l’humidité qui désagrège les murs, pas de bruit. Pas une once de vie. J’ai l’impression d’être dans un cachot dont j’aurais la clef. Mais ma tourmente intestine m’aura fait oublier cette clef. Et alors que j’entends la triste musique de la pluie qui tombe, c’est comme le prélude à un requiem pour mon âme. Je regarde encore autour de moi. J’ai comme un pressentiment désagréable que je ne m’explique pas. Je commence à noircir une feuille de papier et je débute ma poésie ainsi : « L’espoir est mort. »
1677