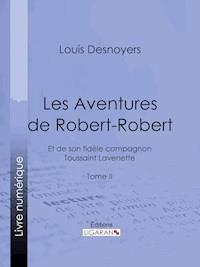
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "Où le flot, où le vent devaient-ils les pousser ? C'est ce qu'ignoraient les malheureux qu'un fragile amas de planches ballottait ainsi sur l'immensité ; mais, tel avait été le péril passé qu'ils se croyaient sauvés dans le présent, bien qu'une simple distance de quelques lignes les séparât de cette mer qui, sous leurs yeux, depuis si peu d'heures, avait dévoré tant de leurs camarades !"
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 448
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Le radeau. – Un complot. – Suite de la suite à la suite de l’Histoire fantastique de mon cousin Laroutine et de son grand voyage au fin fond de la Lune. – Une révolte.
Où le flot, où le vent devaient-ils les pousser ?
C’est ce qu’ignoraient les malheureux qu’un fragile amas de planches ballottait ainsi sur l’immensité ; mais, tel avait été le péril passé, qu’ils se croyaient sauvés dans le présent, bien qu’une simple distance de quelques lignes les séparât de cette mer qui, sous leurs yeux, depuis si peu d’heures, avait dévoré tant de leurs camarades !
Leur joie allait jusqu’au délire. Ils riaient, sautaient, se pressaient la main, se félicitaient, s’embrassaient avec la plus sincère effusion de cœur. Ils étaient d’ailleurs si las d’émotions terribles, si énervés de jeûnes, si épuisés de travaux, qu’ils n’avaient plus la force de penser à l’avenir.
Le Commandant leur fit distribuer, pour cette fois seulement, double ration de biscuit et d’eau-de-vie. Ils trinquèrent joyeusement à sa santé, à celle de l’Empereur, à la gloire de la France, à l’heureuse navigation de leur fragile véhicule. Après quoi, n’ayant rien de mieux à faire que s’abandonner à la Providence, ils s’étendirent pêle-mêle sur l’humide couche que leur offrait le radeau, et y dormirent, peut-être, du plus paisible sommeil qu’ils eussent goûté jamais.
Le docteur allait de l’un à l’autre, employant le peu de bandelettes et de charpie qu’il venait de sauver avec sa trousse, à panser ceux qui avaient reçu les plus fortes contusions, les plus graves blessures. Son admirable dévouement ne se démentait non plus en aucune circonstance.
Lavenette était fort content, sans doute, d’en avoir été quitte pour quelques meurtrissures ; mais ses habits imprégnés d’eau refroidissaient singulièrement sa joie, depuis surtout que la nuit était venue. L’étroit lit de bois où le confinaient ses voisins, rappelait peu d’ailleurs l’élasticité du jeune duvet des oies de la Bretagne. Ce lit même, çà et là, était rembourré de quelques clous. On eût remarqué notamment, à la hauteur de son dos, une petite pointe qui l’aiguillonnait vivement. Il avait beau changer de position et se retourner sans cesse, comme la carpe sur la poêle où elle frit : il ne pouvait se soustraire aux piquantes atteintes de cette importune ennemie. Le pauvre homme continuait donc de maugréer.
« – Mais, au nom de Dieu, le Père tout-puissant, quand donc finira cette avalanche de catastrophes qui m’écrase sans relâche, depuis que j’ai eu la sottise de tomber dans leur ville flottante ? Elle est jolie maintenant, leur ville flottante ! Va la chercher, ta ville flottante ! Va la repêcher !… Je serais curieux de savoir comment M. de La Harpe aurait appelé l’espèce d’écuelle plate où nous sommes en ce moment !… (Maudit clou !…) Tu l’aurais sans doute appelé un bourg flottant, imposteur ! (Oh ! là là…) Et dire qu’il ne m’a pas même été possible de sauver la moindre pantoufle, la moindre robe de chambre, le moindre bonnet de nuit ! Moi qui crains tant le serein ! Et le froid aux pieds ! Et l’humidité surtout !… (Aïe !…) Moi qui suis si délicat, et qui ne devrais jamais sortir d’une boîte de coton !… Aussi, gare les rhumes !… Si du moins j’avais quelque lait de poule pour me réchauffer un peu, je passerais encore sur le reste ! (Satanée pointe !…) »
Ainsi se lamentait Lavenette.
Son jeune compagnon se livrait en ce moment à des réflexions moins sybarites.
L’air était frais, mais pur ; le ciel avait repris toute sa sérénité ; la lune resplendissait sur l’azur des tropiques ; la mer ne grondait plus : elle berçait mollement le dernier asile de ses victimes ; de faibles vagues, dont l’œil rasait horizontalement la surface, simulaient une vaste plaine de pierres précieuses, enchâssées d’argent, dont les brillants monceaux se seraient éboulés sans cesse.
Ce spectacle avait un charme poétique dont la jeune imagination de Robert-Robert ne pouvait se défendre. Il s’assit près du Commandant, se coucha à demi, appuya sa tête sur sa main, et s’abandonna curieusement à cette mélancolique contemplation. Et alors, d’extase en extase, de rêve en rêve, de souvenir en souvenir, sa pensée s’envola, à travers les espaces, vers ce toit maternel d’où, en ce moment même, de touchantes prières s’élevaient au ciel pour lui, doux parfum, doux encens de l’âme.
Quant au Commandant, il s’assit gravement au gouvernail, en face de sa boussole, et veilla seul au salut de tous.
Et Griffard, que faisait-il ?
La haine le tenait éveillé.
Il s’était placé à l’écart, comme font d’ordinaire les méchants, et continuait de rouler dans sa tête les plus coupables desseins. On eût dit, à la sinistre clarté de ses petits yeux, qu’il assassinait déjà du regard et le Commandant et Robert-Robert. Car désormais il leur en voulait mortellement : – à l’un, pour le juste châtiment qu’il en avait reçu ; – à l’autre, pour l’immense service qu’il venait d’en recevoir.
L’état moral de l’équipage lui permit bientôt de mettre ses projets à exécution. La gêne, l’ennui, les mécomptes, les souffrances, les privations de toute sorte, ne tardèrent point d’aigrir les cœurs, et de faire succéder un sombre désespoir à la joie fraternelle du premier moment.
Afin de ménager, pour un avenir qui pouvait être si long, le peu de vivres qu’on avait emportés, et dont la plupart étaient même avariés par l’eau de mer, le capitaine fixa prudemment à la moindre quantité possible la ration quotidienne de chacun. Tout le monde, sans exception, était soumis à ce maigre régime, qu’il observait plus scrupuleusement qu’aucun autre. Mais la faim, dit-on, est une mauvaise conseillère. Ce fut elle que fit parler Griffard pour jeter des idées de révolte dans l’âme de ces malheureux.
« – Vous êtes bien sots, » leur disait-il secrètement en toute occasion, « vous êtes bien sots de vous laisser rationner comme des bêtes de somme ! Vous êtes bien sots de vous laisser mourir de faim, pour que lui et les siens fassent de meilleures bombances ! Voyez : ils sont une douzaine de favoris qui ne le quittent jamais d’un instant. Ils ont tout accaparé. C’est de leur côté qu’ils ont placé les vivres, sous prétexte de les garder. Il faut être bien simple pour croire à de telles mystifications ! Chaque soir, tandis que vous revenez par ici l’estomac vide, les gaillards se gobergent là-bas. Pas plus tard que ce matin, ils avaient tous une pointe de vin. Je l’ai parfaitement remarqué. Mais le plus curieux, c’est que c’est le ventre plein qu’ils vous prêchent l’abstinence. Ils disent que nous sommes à plus de deux cents lieues de la terre la plus proche, et que, par conséquent, il faut faire vie qui dure. Ah ! pardieu ! ils doivent bien rire de notre crédulité !… S’il est vrai qu’il y ait deux cents lieues, raison de plus pour ne point les laisser dilapider vos faibles ressources, et pour tâcher d’en profiter vous-mêmes. En vérité, je ne sais ce qui vous retient ! La discipline ?… Sa qualité de commandant ?… Joli commandant, ma foi !… Commandant de quoi donc ?… De quelques planches mal assemblées !… À qui la faute, d’ailleurs ?… À lui seul !… Vous avez tous rempli votre devoir, vous autres. Il n’y a que lui qui n’ait pas rempli le sien. Le sien, c’était de sauver sa frégate. Il ne l’a pas fait. Il s’est destitué lui-même. Il n’y a donc plus de discipline, plus de commandant, plus de chef, après une telle maladresse. Vous auriez le droit de le mettre en jugement. À plus forte raison pouvez-vous lui désobéir. Mais non, vous êtes des trembleurs ! Vous êtes déjà victimes de son impéritie : vous voulez l’être aussi de sa voracité. Soit ! mourez de faim, puisque cela vous amuse ! Quant à moi, je sais bien ce que je ferais à votre place !…
– Et que feriez-vous ?
– Ce que je ferais ? Écoutez ! »
Et l’astucieux Griffard initiait ses auditeurs à l’odieux complot qu’il avait médité. Ses perfides suggestions furent repoussées d’abord ; mais elles germèrent peu à peu dans ces âmes ulcérées, et bientôt la conspiration n’attendit plus qu’une circonstance propice.
Le Parisien était loin d’imiter la criminelle conduite de Griffard. Il ne contribuait pas peu, au contraire, à reculer, sans s’en douter, l’occasion impatiemment attendue par les conjurés.
Rien ne pouvait attiédir le zèle de ce brave et loyal matelot. Il avait recours à de singuliers calmants, pour apaiser l’irritation morale, en même temps que l’inanition physique de ses camarades. Dès que le soir arrivait, et l’appétit par conséquent, il se hâtait de leur narrer quelqu’une de ses nombreuses historiettes en guise de réconfortant. Il leur en débitait ainsi jusqu’à ce qu’ils s’endormissent ; et, plus d’une fois, il arriva que la voix facétieuse du conteur favori leur fit momentanément oublier d’intolérables souffrances.
Un soir donc (c’était le neuvième jour de leur triste navigation), le Parisien ayant remarqué, parmi les groupes qui se tenaient à l’ayant du radeau, un peu plus de mystère encore et de sourde agitation que d’habitude, il se hâta de crier à haute voix :
« – Allons, enfants, venez ici ! Je vas commencer ma distribution ordinaire de farces. Qui est-ce qui en veut ? Qui veut que je lui serve un plat de ma façon ? »
Après cette invitation séduisante, le Parisien s’assit à l’arrière du radeau. Ses pâles auditeurs s’étendirent autour de lui ; et alors, sur l’invitation expresse de Lavenette, il reprit ainsi la parole :
SUITE DE LA SUITE À LA SUITE DE L’HISTOIRE FANTASTIQUE DE MON COUSIN LAROUTINE. ET DE SON GRAND VOYAGE AU FIN FOND DE LA LUNE.
« Or donc, » dit le Parisien, nous avons laissé mon cousin Laroutine sur la cime du gros diamant où le déposa son ballon, après quinze heures trente-cinq minutes d’ascension de Paris à la Lune.
Mon cousin jeta les yeux autour de lui, du haut de ce magnifique bijou, qui était trois fois plus haut que les plus hautes montagnes de la Terre. Un instant lui suffit pour se convaincre que ce nouveau séjour ne ressemblait nullement à celui qu’il venait de quitter. Les formes, les goûts, les odeurs, les nuances, tout était différent. Il trouva tout stupide.
D’abord et d’une, le soleil de la Lune lui parut être d’un violet tendre, ni plus ni moins que s’il l’eût regardé à travers des lunettes de cette couleur.
La grandissime campagne qui s’étalait devant ses yeux, lui parut aussi fort cocasse. Il y vit deux rivières, dont l’une ressemblait à du rhum et l’autre à du cassis. Il y vit une foule de villages qui resplendissaient comme s’ils eussent été bâtis avec des perles, et recouverts de larges émeraudes en guise de tuiles. Il y vit des forêts de citronniers, dont chaque arbre était dix fois plus grand que nos peupliers, et dont les fruits étaient gros comme de grosses barriques.
Les arbres qu’il aperçut, près de lui, sur la cime de son diamant, et qui en couvraient tous les alentours, lui semblèrent également des plus originaux. Ils n’avaient guère que cent pieds de hauteur. C’étaient, pour ainsi dire, les broussailles de l’endroit. Leur petitesse tenait sans doute à ce que le diamant n’est pas un aussi bon terrain que l’or mêlé de rubis qui formait le sol de la plaine. Il y en avait du reste de toutes les nuances : les uns étaient gris, les autres jaunes, ceux-ci amarante, ceux-là coquelicot. C’était un coup d’œil enchanteur.
Mon cousin tendit la main vers le plus proche, et cueillit un de ses fruits. C’était une prune, ou plutôt un pruneau, car certains fruits poussent naturellement cuits dans la Lune. Mon cousin le porta à sa bouche, par la force de l’habitude, puis le rejeta avec horreur. Il n’avait jamais rien mangé d’aussi succulent, mais c’était du nouveau.
Le geste qu’il fit alors éveilla l’attention d’une foule de petits oiseaux qui dormaient dans le feuillage de ce prunier. Il y en avait de toutes sortes : de petits aigles, de petits vautours, de petits éperviers ; tous, pas plus gros que le pouce, et gentils à croquer vifs, tant leur plumage était flatteur. Ces petites bêtes ne l’eurent pas plus tôt aperçu qu’elles vinrent s’abattre familièrement sur ses épaules, sur sa tête, sur ses mains, et le béquetèrent avec amitié. Un seul petit corbeau demeura tranquillement sur son arbre, où il se mit à gazouiller infiniment mieux que nos rossignols d’ici-bas. Malheureusement un énorme canari, dont les ailes avaient au moins cinquante pieds d’envergure, vint à paraître dans les airs. La vue de ce canari de proie effraya les aigles, les éperviers et les vautours, qui se sauvèrent dans le feuillage. Le jeune corbeau cessa ses mélodieux croassements.
L’hébétement de mon cousin augmenta encore lorsque, s’étant senti piquer à la joue, il y porta vivement la main, et en retira un petit éléphant de la grosseur à peine d’une fourmi de nos climats. C’était cet éléphant, parfaitement conformé du reste, qui s’amusait à le picoter avec sa trompe, et à prendre sur lui sa nourriture. Mon cousin l’écrasa de colère entre ses deux pouces. Mais il n’était pas quitte de l’espèce ! Il regarda, et se vit tout couvert d’autres petits éléphants semblables, qui avaient formé une traînée depuis le collet de son habit jusqu’au pied du prunier où ces intéressants insectes avaient placé leur nid.
« – Mais, mon Dieu ! où suis-je donc ? » s’écria-t-il ; « où suis-je ? où suis-je ? où suis-je ? Ça ne s’est jamais vu. »
« La peur le talonna bien plus encore lorsqu’il entendit une espèce de froufrou dans les airs, et que deux grandes ombres rasèrent vivement le sol, en même temps que ce colloque parvenait à son oreille. »
« – Vois donc, ma femme, quel bizarre animal, là-bas, sur ce rocher ! Qu’est-ce donc que cela peut être ? »
« – Je ne sais, mon ami, » répondit une voix plus flûtée que l’autre, mais qui cependant eût suffi à briser toutes les vitres d’une de nos maisons.
« – Ma foi ! » reprit la première, « je suis vraiment fâché de n’avoir pas sur moi ma paire de canons de poche : je l’aurais volontiers abattu, pour en faire présent au cabinet d’histoire naturelle de Krrrrstvlmpfbchqdngzx. »
(NOTA. Ce dernier mot, qui est le nom de la capitale de la Lune, ne peut pas se prononcer dans notre langue, par la raison qu’il n’est composé que de consonnes ; mais c’est un des plus harmonieux qui se puissent imaginer.)
« – Ce serait, en effet, un véritable cadeau à lui faire, après l’avoir empaillé, » repartit la seconde voix ; « car c’est un animal bien curieux ! Et d’abord ça ne s’est jamais vu. »
Ici mon cousin Laroutine n’entendit plus rien. Il leva les yeux pour voir d’où partait cette conversation étrange, mais il n’aperçut que deux énormes masses qui s’envolaient avec une incroyable rapidité, là-bas, là-bas, par-dessus la plaine. Quoique leurs paroles ne fussent qu’une espèce de patois, relativement au français, il en avait suffisamment compris le sens, et se doutait bien que la menace s’adressait à lui.
Peu rassuré par cette rencontre, et ne pouvant d’ailleurs demeurer là toute sa vie, mon cousin se décida à quitter la cime de son diamant. Il mit plusieurs heures à le descendre, quoiqu’il marchât très vite. La nuit ne le surprit pas en route, car le jour dure six mois pour chaque moitié de la Lune ; et, pendant ce temps, au lieu de se lever d’un côté et de se coucher de l’autre, le soleil tourne continuellement autour de l’horizon.
Laroutine rencontra plusieurs ruisseaux qui tombaient en cascades des flancs de son diamant. Il goûta de l’un : c’était d’excellent lait ; il goûta de l’autre : c’était de la limonade ; il goûta d’un troisième : c’était de l’orgeat. Mon cousin fit une grimace de possédé, car tout cela lui parut délicieux.
Enfin, non loin d’une fontaine d’eau sucrée, ombragée de framboisiers et de fraisiers de trente pieds de haut, il remarqua, sur les émeraudes qui en tapissaient les bords au lieu de sable, une centaine de jolies grenouilles, divisées par petits groupes, et qui paraissaient diversement occupées. Les unes se promenaient et conversaient aussi gravement entre elles que des diplomates qui parlent chorégraphie. Les autres coassaient un duo, entremêlé de chœurs, avec autant de justesse que des chanteuses d’opéra. Celles-ci jouaient à la patte chaude, au collin-maillard, à cache-cache, aux quatre-coins, au cheval-fondu aux barres, à une foule d’autres jeux innocents. Celles-là valsaient ou dansaient, avec force entrechats. La musique était composée d’une demi-douzaine de cricris et de cigales, qui paraissaient être les virtuoses de l’espèce.
Les débris d’un copieux festin, tels que framboises, fraises, petites mouches, petits insectes de toute sorte, étaient encore gisants, et témoignaient que la compagnie n’était point à jeun.
Autant qu’il en put juger par l’ensemble de ces circonstances, mon cousin pensa que cette société amphibie était composée de deux familles qui célébraient les noces d’une jolie grenouillette. Le maintien réservé de celle-ci, ses yeux timidement baissés, son air candide, les hommages délicats dont on l’entourait, tout donnait de la vraisemblance à cette chimère. Les manières de ses compagnes étaient d’ailleurs du dernier bon goût, et n’auraient point été déplacées dans les plus élégants salons de Paris. Aucune d’elles ne jurait ni ne fumait.
Mais Laroutine n’était pas à bout de surprises. La première chose qu’il rencontra dans la plaine, au bas de son diamant, ce fut une carrière dont les alentours étaient couverts d’immenses blocs de sucre naturellement raffiné.
Il aperçut ensuite, dans un taillis de citronniers, une meute de lièvres qui couraient à la piste d’un énorme bouledogue.
Il aperçut enfin, dans une prairie située à l’opposite, un troupeau de loups, de tigres, de lions, de panthères et de rhinocéros. Un gros mouton, accroupi près du berger, veillait à la conduite de ce singulier troupeau, et courait çà et là, de temps en temps, pour ramener dans la bonne voie quelque tigre échappé, ou telle autre de ses ouailles, en pinçant à belles dents les pattes du réfractaire.
Laroutine crut aussi voir, un peu plus loin, une bande de renards que conduisait une poule. Toutefois il m’a confessé vingt fois qu’il n’oserait lever la main en justice touchant la réalité de ce dernier fait. Le trouble toujours croissant où le jetaient tant de nouveautés supercoquentieuses, a pu le rendre dupe d’une illusion. Cette réserve fait le plus grand honneur à sa franchise, et témoigne hautement de sa véracité sur tout le reste.
Or donc, la route même que suivait mon cousin conduisait à la capitale du pays, à la superbe ville de Krrrrstvlmpfbchqdngzx. Des poteaux en acajou l’indiquaient de distance en distance pour empêcher le voyageur de s’égarer. Cette route était parfaitement entretenue, ainsi que tous les chemins vicinaux qui venaient y aboutir. Comme unique différence, elle était pavée de gros diamants et bordée d’un trottoir en porphyre, tandis que les chemins vicinaux étaient tout bonnement couverts d’un épais gravois de perles fines. Mais, à cela près, même propreté. Mon cousin n’en pouvait revenir, lui qui ne connaissait que la France, et il s’écriait très justement cette fois : « Ça ne s’est jamais vu ! »
La seule chose qui l’incommodât un peu, c’était la poussière d’or que soulevaient des voitures publiques traînées par de grosses fourmis. Sa vue effraya les fourmis en question, et il y en eut plusieurs qui prirent le mors-aux-dents.
Du reste, on jouissait sur cette route d’un spectacle fort agréable. Les champs voisins offraient l’aspect de la plus riche végétation. On y voyait des betteraves de cent soixante-cinq pieds de haut, du blé dont chaque épi eût dépassé la flèche de nos cathédrales ; des pommes de terre qui pesaient trois quintaux ; et aussi des concombres, des citrouilles et des potirons, dont il ne fallait pas moins de cinq minutes pour faire le tour. Les légumes, les fleurs et les fruits étaient en proportion.
« – Mais, juste ciel ! » s’écriait mon cousin, qui s’arrachait les cheveux d’étonnement, « quelle fertilité ! quelle sève ! quelle surabondance ! On sèmerait donc des boutons de culotte dans un pareil terroir, qu’il y pousserait des pantalons tout faits ? Mais c’est stupide ! mais ça ne s’est jamais vu ! »
Cependant, les deux Lunatiques que mon cousin avait eu le malheur de rencontrer avaient déjà semé la venette dans le pays.
« – Plaît-il ? » interrompit ici Lavenette qui crut que le Parisien lui adressait la parole. « Qu’y a-t-il pour votre service, Parisien ? »
« – Vous faites un coq-à-l’âne, mon vénérable, reprit le conteur. Mais je reviens à mon cousin. »
Toutes les cloches de cette partie de la Lune sonnèrent, les tambours battirent, les trompettes jouèrent, le canon d’alarme fut tiré. Mon cousin vit arriver peu à peu, en travers de la route qu’il suivait, toutes les forces publiques de ce magnifique royaume.
Comme on n’osait pas attaquer en face une bête si étrange, on usa de ruse : on cacha le long de la route quelques-uns de ces pièges dont on se sert dans la Lune pour attraper les féroces hannetons. Mon cousin ne se douta pas de la supercherie, et crac ! il mit le pied dans un de ces perfides traquenards. Il s’y trouva pris par le gras du mollet. (Il n’y a pas six ans qu’il m’en montrait encore les marques.) On se jeta sur lui, on le garrotta, et on l’emporta en triomphe dans la ménagerie royale de Krrrrstvhnfbchqdngzx, dont il devait faire les délices et l’ornement.
« Or donc, quand mon cousin Laroutine eut été placé dans sa cage d’or… »
Le Parisien en était là, quand sa fantastique narration fut interrompue par une détonation d’arme à feu qui se fit entendre non loin de l’endroit où il pérorait, et qui changea bien tristement le caractère de la scène.
C’était contre le Commandant que l’arme avait été tirée dans l’ombre.
On ne sut jamais par qui.
Le capitaine ne fut que légèrement atteint au bras gauche ; mais cette détonation était enfin le signal de la révolte qu’avait si longtemps complotée Griffard, et pour le succès de laquelle l’attention qu’on prêtait alors au Parisien avait paru aux conjurés l’occasion favorable.
Leur projet ne visait à rien moins qu’à massacrer inopinément tous ceux de leurs camarades qui n’étaient point affiliés.
Ils se précipitèrent, les armes à la main, à l’arrière du radeau, en poussant les sinistres vociférations qui leur servaient de mot d’ordre :
– À bas le Commandant ! À bas les accapareurs ! À bas les requins !
« – À moi, les amis ! les braves marins ! les bons Français ! » s’écria de son côté le commandant Flottard, d’une voix qui domina toutes les autres.
Le Parisien, Simon Barigoule, le docteur, l’Écureuil, Robert-Robert et quelques autres, au nombre d’une douzaine au plus, s’élancèrent à l’appel du Commandant, saisirent la première arme qui leur tomba sous la main, et se rangèrent intrépidement autour de lui.
« – Halte-là ! » reprit-il alors en s’adressant aux insurgés, dont la croupe, si supérieure en nombre, enveloppait son bataillon sacré ; « halte-là ! Pas un pas de plus !
– À bas les accapareurs ! À bas les requins ! À bas le Commandant ! » continuèrent les mêmes voix.
– Halte-là ! vous dis-je, répéta celui-ci ; « ou malheur à vous ! »
Un de ces forcenés ne tint pas compte de l’avertissement, et s’avança en brandissant son sabre : – d’un coup de hache le capitaine lui fendit la tête.
Un second mutin osa le mettre en joue : – d’un coup de carabine le Parisien l’étendit mort.
Un troisième, voulant user de ruse, se glisse derrière l’intrépide chef, et lève déjà son coutelas pour l’en frapper : – Robert-Robert l’aperçoit, se retourne, se jette au-devant du coup, le pare d’une main, et appuie de l’autre le canon de son pistolet sur la poitrine de l’assassin, qui s’arrête immobile.
Un quatrième veut ranimer l’ardeur de la bande, et l’excite à marcher en avant : – Simon Barigoule s’élance, va chercher celui-là jusqu’au milieu des siens, et d’un coup de poignard le renverse à leurs pieds.
De si terribles exemples jettent enfin l’incertitude dans l’âme des révoltés. C’est vainement d’ailleurs qu’ils cherchent parmi eux le lâche qui vient d’armer leurs bras, et que son grade, autant que son rôle, appelait naturellement à les commander ils se croient trahis, ils hésitent, ils reculent.
« – Bas les armes ! » leur crie énergiquement le capitaine.
Et ils mettent bas les armes, et ils se jettent à genoux, et ils demandent grâce.
« Malheureux ! » ajoute-t-il, « vous mériteriez qu’on vous fusillât ! Mais je me borne au plus coupable. Il est un lâche instigateur, que je devinerais à sa neutralité seule en un pareil moment. Celui-là payera pour tous ! »
Et ce disant, le capitaine dirige, à la clarté de la lune, le canon de son pistolet contre l’infâme Griffard qui, pendant toute l’affaire, s’était caché à l’autre extrémité du radeau. Le bras du capitaine est sûr, son œil est juste, son adresse merveilleuse, et, malgré l’éloignement, il va lui planter une balle dans la poitrine, lorsque, n’écoutant que son instinct de générosité, Robert-Robert se précipite, détourne l’arme qui porte à faux, et s’écrie d’un ton suppliant :
« – Vous ne m’en voudrez pas, Commandant : j’en ai fait autant pour vous tout à l’heure ! »
Ainsi se termina ce sanglant épisode.
Il y avait une heure que tout était rentré dans l’ordre, lorsqu’on découvrit deux individus qui s’étaient blottis derrière les encombrements de l’arrière :
« – Pardon ! disait l’un.
– Grâce ! disait l’autre.
– Je ne suis pour rien dans tout cela !
– Je suis étranger à tout ceci !
– Je partage complètement votre opinion !
– J’approuve tout à fait votre manière de voir !
– Je suis des vôtres !
– Je ne suis pas des leurs !
– Épargnez-moi !
– Accordez-moi la vie !
– Tout ce que j’ai vous appartient !
– Tout ce que je possède est à vous !
– Grâce !
– Pardon ! »
C’étaient Lavenette et le grand Flandrin qui s’imploraient mutuellement de la sorte.
Dès les premiers bruits de la bagarre ces deux poltrons s’étaient réfugiés dans ce pacifique asile, et là, se rencontrant sans se reconnaître, et se prenant réciproquement pour ennemis, ils s’étaient agenouillés l’un devant l’autre, joignant piteusement les mains, et se demandant merci à qui mieux mieux. On eut beaucoup de peine à les tirer de cette burlesque position.
Suite de la suite à la suite de la suite de l’Histoire fantastique de mon cousin Laroutine, et de son grand voyage au fin fond de la Lune. – Les ménageries et les académies savantes de l’endroit. – Des étranges cancans dont mon cousin s’y voit l’objet, et de la vogue colossale dont il y jouit. – Véritable portraicture des habitants de la Lune et des animaux qui en font l’ornement. – De la grande dispute de mon cousin avec une puce gigantesque. – Comment on délibère dans la Lune, et de l’immense péril que font courir à mon cousin les lumineuses discussions de l’Académie des Sciences. – Halte ! – Sa Majesté Brrrrrr. – Mon cousin à la cour de ce puissant monarque. – Grand gala. – Remarquable entrevue de Laroutine et du vertueux et gras Brrrrrrr, un des plus puissants potentats de la localité.
La discipline avait repris momentanément son empire. Le temps était beau d’ailleurs et la brise favorable. Le radeau glissait légèrement sur une mer paisible, et le capitaine lui imprimait habilement la direction qui, d’après sa boussole, ses cartes marines et ses compas de route, le conduisait probablement vers la côte d’Afrique.
Mais deux cents lieues au moins séparaient les naufragés de cette terre si ardemment désirée ; mille dangers les entouraient ; les privations de toutes sortes, déjà presque insupportables, les menaçaient plus cruellement encore dans un avenir prochain ; tant de funestes circonstances entretenaient naturellement, dans l’âme de ces infortunés, les plus sinistres craintes.
Ce fut pour les en distraire que le Parisien eut de nouveau recours au puissant dérivatif de ses contes. Son esprit naturel, le long séjour qu’il avait fait à Paris, la demi-éducation qu’il y avait reçue, son imagination, sa verve comique, tout le rendait éminemment propre à triompher des plus sombres mélancolies.
La scène et le but donnaient à ce rôle, peu grave en apparence, quelque chose de digne et même de touchant. Le Parisien souffrait intérieurement, autant et plus, peut-être, qu’aucun de ses camarades ; mais ce brave marin sentait que le moment était venu d’avoir de la gaîté pour tous, car la gaîté, en pareil cas, c’est encore du courage.
Le lendemain de la déplorable révolte que nous avons décrite, il les appela donc, comme aux plus beaux jours de leur voyage ; il s’assit au milieu d’eux, et reprit en ces termes sa burlesque et philosophique narration :
SUITE DE LA SUITE À LA SUITE DE LA SUITE DE L’HISTOIRE FANTASTIQUE DE MON COUSIN LAROUTINE. ET DE SON GRAND VOYAGE AU FIN FOND DE LA LUNE.
« Or donc, » dit le Parisien, il paraît que dans la Lune on aime aussi à posséder de grandes collections d’animaux de toute espèce pour récréer les badauds et les bonnes, et fournir aux savants les moyens de s’instruire.
Mais du moins on y tient plus au contenu qu’au contenant. On ne bâtit pas aux animaux de magnifiques palais, tandis qu’il y a des individus qui n’ont pas même d’asile ; on ne les bichonne pas comme des petits maîtres, tandis qu’il y a de pauvres diables qui n’ont pas même de quoi se vêtir ; on ne les nourrit pas à bouche-que-veux-tu ? tandis qu’il y a des familles entières qui n’ont pas un morceau de n’importe quoi à se mettre sous la dent. On se borne à leur donner le strict nécessaire. C’est bien fait ! attrape !
Quand Laroutine eut été colloqué dans une des cages de la ménagerie, il se sentit une faim des plus intempestives, étant à jeun depuis le morceau de galette qu’il avait savouré la veille, au Champ-de-Mars, à Paris. Comme il possédait parfaitement son Jardin des Plantes, et que, presque chaque jour, il avait pu remarquer avec quelle attention délicate on y traite les bêtes, l’espoir de faire bientôt un excellent dîner aux frais des contribuables de la Lune le consola momentanément de la mortification que lui causait une pareille résidence. Malheureusement il comptait sans son hôte, c’est-à-dire sans l’Académie des sciences du pays.
Car la superbe ville de Krrrrstvlmpfbchqdngzx est ornée de presque autant d’académies que de bornes.
Il y a d’abord l’Académie littéraire, sur laquelle les naturels de l’endroit ont beaucoup cancané. Ce qu’il y a de vrai au fond, c’est que dans la Lune, ce corps est généralement recommandable, et qu’il se recrute tôt ou tard de presque tous les hommes qui ont montré des moyens dans un genre quelconque. C’est comme qui dirait l’hôtel des Invalides pour les vieux grognards de la littérature. Vous avez commis jadis de beaux ouvrages ?… Bon ! une, deux, partez, muscade ! On vous expédie vers le Panthéon des génies cacochymes. C’est très bien vu : ça encourage les uns, ça décourage les autres. Jamais de faveur là-haut, ni d’intrigue, ni de passe-droit. Aussi n’y a-t-il plus guère qu’une espèce de Lunatiques qui fassent fi de l’institution : ceux dont l’institution fait fi elle-même. Quant aux gens d’un vrai mérite qui n’y sont point admis (et ceux-là sont par malheur beaucoup trop nombreux encore), eh bien ! cela même leur constitue une distinction tout aussi bien que d’en être. On dit des uns : « Il fut de l’Académie ; » on dit des autres : « Il ne fut pas de l’Académie. » C’est également flatteur dans les deux genres. Il n’est rien de tel que savoir s’accommoder de tout.
Il y a ensuite l’Académie des Inscriptions, qui passe son temps à déchiffrer les vieilles pierres, les vieux pans de murs, les vieux morceaux de vases, les vieux débris de ferraille. Apportez-lui n’importe quoi : pourvu que ce soit usé, rapetassé, cassé, et couvert d’un pied de poussière, elle vous dira tout de suite d’où cela vient, quel âge cela doit avoir, à qui cela appartenait, qui l’a fait, pour qui, pourquoi, comment, parce que, peut-être, et autres vérités non moins utiles à la gloire et à la prospérité de la Lune. Les Lunatiques lui ont joué parfois de drôles de tours. Des farceurs l’ont invitée à déchiffrer des vieilleries de leur fabrique, sur lesquelles il n’y avait absolument rien du tout. L’Académie leur a soutenu que cela remontait bien au-delà du déluge, et y a lu des choses mirobolantes.
Il y a ensuite l’Académie des sciences morales et politiques, laquelle est destinée à faire florir ces ingrédients dans la Lune. De là vient que les gens de la Lune s’accusent tous, réciproquement, de n’avoir pas le sens commun en politique, et d’être immoraux comme on ne peut pas dire.
Il y a ensuite l’Académie des beaux-arts, celle qui est chargée de conserver les saines traditions, et de propager ce qu’elle appelle les règles du bon goût. Or, elle s’acquitte si bien de sa besogne, que, s’il faut l’en croire, le goût des Lunatiques est tout à fait perverti, et que leurs beaux-arts s’en retournent incessamment vers la barbarie. Elle reçoit un traitement pour cela.
Il y a ensuite l’Académie des sciences tout court. Celle-là aussi rend de vrais services à la chose dont elle est chargée. Seulement, les Lunatiques lui reprochent de se méfier un peu trop de l’inconnu, de s’amuser souvent aux bagatelles de la porte, d’être lambine, de bâtir quelquefois d’énormes théories sur la pointe d’une aiguille, d’inventer des inventions déjà inventées, de travailler dans le vieux neuf, et même de discuter pendant des années entières sur la nature d’un phénomène qu’on découvre ensuite n’avoir jamais été découvert. On reproche aussi à quelques-uns de ses membres de n’être pas toujours très bien embouchés les uns vis-à-vis des autres.
Il y a ensuite l’Académie… Mais à quoi bon ? C’est une rage ! Il y en a de chantantes, de dansantes, de buvantes, de mangeantes, de jouantes, de chevauchantes, de labourantes, de négociantes, de conspirantes, de pérorantes et surtout d’endormantes. Cette fureur d’académies, d’associations, de réunions, de clubs, est certainement un des inconvénients de la Lune. Pays charmant du reste !
Or donc, l’Académie des sciences apprit par la rumeur publique qu’un animal étrange venait d’être arrêté par la gendarmerie, dans les environs de Krrrrstvlmpfbchpdngzx, et déposé à la ménagerie royale. La plupart de ses membres avaient même été témoins de la chose. Elle en était donc parfaitement sûre ; mais, comme elle n’en avait pas encore été prévenue administrativement, elle fit semblant de n’en rien savoir, et ne s’occupa pas plus de régler la nourriture de l’animal, que si l’animal n’eût pas existé, car l’animal n’existait pas encore officiellement.
Cette manière de procéder paraît être commune à tous les corps délibérants de la Lune. C’est ce qu’on appelle l’étiquette, la hiérarchie, les formes, la filière administrative, etc. C’est très agréable pour ceux qui font attendre ceux qui attendent.
Un message de l’autorité compétente lui arriva enfin, après avoir passé par trente-sept bureaux différents. Ce message l’instruisait authentiquement du fait. On pouvait dès lors s’en occuper conformément à toutes les règles.
L’Académie s’assembla ; mais, ne se trouvant pas en nombre suffisant, elle s’ajourna au lendemain pour donner le temps de venir à ceux de ses membres qui dînaient en ville ce jour-là, ou qui étaient allés battre la campagne.
Le lendemain, après quatre heures d’attente, le message fut lu, puis renvoyé à une commission chargée d’en faire son rapport.
Mon cousin, dont l’appétit désordonné ne s’accommodait guère de la régularité de ces lenteurs, fût certainement mort d’inanition, sans les petites friandises que les curieux, les bonnes, les tourlourous et les petits enfants s’amusaient à lui jeter pour rire. Ces friandises consistaient en bonbons du pays, c’est-à-dire en pommes de terre confites à l’ail, en haricots glacés et remplis d’émétique, en coloquintes recouvertes de moutarde au lieu du sucre qui recouvre nos dragées, et en pastilles d’ipécacuanha que les dames portaient dans d’élégantes bonbonnières. Quant aux enfants, ils mangeaient pour la plupart de longues tartines de poivre en compote, ou bien suçaient des queues d’artichaut en guise de bois de réglisse. Il ne fallait rien moins qu’un appétit de quarante-huit heures pour décider Laroutine à déguster de pareils comestibles. On les lui tendait à travers les barreaux de sa cage, et il fallait voir avec quelle frayeur les Lunatiques retiraient leurs mains, lorsqu’il avançait la sienne pour recevoir leurs atroces présents !
« – Mon Dieu, » s’écriait-il, « que ces gens-là sont donc idiots ! De quoi ont-ils peur ? que me veulent-ils ? à qui en ont-ils ? pour qui me prennent-ils ? qui sont-ils ? Je rêve ! J’ai le cauchemar ! Tout cela n’est pas ! c’est une illusion ! c’est impossible ! Ça ne s’est jamais vu !
Les Lunatiques ne tenaient pas de leur côté de moins sceptiques discours ; car il y en avait dans le nombre qui étaient presque aussi badauds que mon illustre cousin, et qui ne pouvaient revenir de leur surprise à la vue d’un être qu’ils n’avaient jamais vu non plus.
– Il faut convenir, » disait l’un, « que la nature est souvent très originale ! Quel étrange animal ! quel singulier plumage ! »
(C’était le costume de mon cousin que l’orateur prenait pour un plumage.)
« – Vous n’avez peut-être pas remarqué le plus extraordinaire, » interrompait l’autre : c’est que l’animal a deux yeux placés de chaque côté de son bec. Deux yeux, hein ! voilà qui est curieux ! Toutes les créatures animées ont deux yeux, il est vrai, mais l’un par devant, l’autre par derrière. La nature, toujours ingénieuse, a voulu que nous pussions voir de deux manières en même temps. Mais deux yeux, l’un à côté de l’autre ! À quoi bon ? c’est un luxe que rien ne justifie. Ce ne peut être qu’une erreur de sa part. Et pour preuve, cela ne s’est jamais vu !
« – Ma foi ! » continuait un troisième, on me dirait que celui-ci est tombé de la Terre, que je n’en serais point étonné ! J’amènerai mon épouse pour le voir : ça l’amusera.
« – Titi ! Titi ! » interrompait une bonne en volant après son marmot ; venez ici, monsieur ! Et ne volez pas si vite ! Vous pouvez tomber ainsi et vous casser une aile. Un malheur est sitôt arrivé ! Donnez-moi la patte et restez là. Si vous n’êtes pas sage, je le dirai au monstre, et il vous croquera !
« – Allons, » se disait mon cousin, en haussant les épaules, « voilà qu’ils me prennent pour un croque-mitaine ! Ces gens-là sont d’une stupidité !… On voit bien qu’ils ne sont jamais sortis de leur trou. »
Bref, toute la population de Krrrrstvlmpfbchqdgnzx se pressait chaque jour devant sa cage. Chacun voulait voir l’étonnant animal. Beaucoup de gens furent écrasés, étouffés, et, qui pis est, volés à cette occasion.
« Sa personne causa même une sensation si profonde dans la Lune, qu’on accourut des royaumes voisins, et qu’un journal fut créé tout exprès pour rendre compte de ses moindres actes. Cette feuille quotidienne, dont le besoin se faisait généralement sentir, était “rédigée par une société de savants, d’industriels, de jurisconsultes et même de gens de lettres,” avec cette épigraphe, tirée d’un économiste illustre : “La richesse est l’opulence des nations. ” Capital social, vingt-cinq millions ; avec intérêts, primes et dividendes antichipés. Les dix mille premiers souscripteurs reçoivent chaque jour, avec le journal, des livres, du cirage, des gravures, de la pommade, une côtelette pour leur déjeuner, et une pierre de taille pour se bâtir une maison, peu à peu, sans s’en apercevoir. Le tout, sans augmentation de prix. Qu’on se le dise ! » Ce journal perdait nécessairement sur chaque abonné ; mais il faisait d’énormes bénéfices sur la quantité.
Je crois inutile d’ajouter que le buste et le portrait de mon cousin figuraient par la ville à tous les étalages des marchands de gravures et de bric-à-brac. C’est par là que les renommées commencent dans la Lune. C’est souvent par là qu’elles finissent sur la Terre.
Cependant mon cousin étudia de plus près l’intéressante population lunesque. Aux observations qu’il avait déjà faites, il put ajouter les suivantes :
Les Lunatiques avaient généralement les cheveux bleus, les yeux rouges, la peau verte, les lèvres violettes et les dents d’un beau noir d’ébène. Plus leur teint était vert, leurs yeux rouges et leurs dents noires, plus ils se croyaient beaux.
Une autre condition de la beauté selon leurs goûts, c’était d’avoir de longues oreilles à la façon de nos baudets, une bouche d’un demi-pied et le nez en trompette. Ceux qui étaient doués de ces avantages naturels en paraissaient extrêmement fiers, et se pavanaient avec cette prétention qui n’est pas moins ridicule en haut qu’en bas.
La longueur, le poli et le brillant des griffes, qui ornaient leurs pieds et leurs mains au lieu d’ongles, étaient aussi des qualités très appréciées, surtout chez les personnes de distinction. Cela prouvait leur fainéantise, et, chose bizarre, il n’y a pas d’apparence plus recherchée dans la Lune, que celle d’une parfaite inutilité. On y est extrêmement flatté de ne servir absolument à rien.
Tout le reste de leur individu était couvert d’un manteau, dont les plis dessinaient gracieusement la taille, sans gêner les mouvements du corps. Ce costume est bien préférable au nôtre, qui est si gênant, si disgracieux. Leur coiffure offrait le même avantage. Ils n’avaient point de coiffure. Le chapelier est inconnu chez eux, et le marchand de casquettes y passerait pour une chimère. La nature les a pourvus de cheveux longs, soyeux, épais, dont ils n’ont pas la sottise de cacher les boucles onduleuses, sous de difformes coiffes ou de hideux bonnets de coton.
Enfin, outre des jambes aussi lestes que solides, la nature leur a donné des ailes qui se diaprent au soleil des plus brillantes couleurs. Mon cousin les voyait avec surprise, tantôt se promener autour de lui, à pied, tantôt s’élever dans les airs, le parasol à la main, comme ces groupes d’oiseaux qui voltigent librement au-dessus de la cage où gémit un camarade captif.
Ajoutez, pour comble d’agrément, que les Lunatiques avaient la tête carrée, le corps carré, les jambes carrées, les bras carrés, tout carré. Pourquoi pas ? Supprimez l’habitude : en quoi le rond sera-t-il préférable au carré ?
On est généralement injuste envers le carré.
Les animaux de l’endroit n’étonnaient pas moins mon cousin. Il voyait de jolis petits rhinocéros courir à travers tout ce monde, comme les chiens de nos contrées ; de jolis petits dromadaires, que les dames portaient sous le bras en guise de roquets ; de jolis petits chameaux, pas plus grands que nos carlins, qui suivaient leurs maîtres à l’attache ; enfin, de jolis petits chevreaux, autre variété de caniches, qui s’en venaient flairer sa cage, et lui bêlaient contre, comme s’ils eussent voulu le mordre. Le chevreau paraît être là-haut un animal des plus hargneux.
Quant au reste de la ménagerie, on y remarquait des volières remplies d’énormes chardonnerets, d’énormes serins, d’énormes rossignols, d’énormes pinsons, d’énormes linottes ; tous oiseaux de proie, au bec crochu desquels il n’eût pas fait bon confier son doigt. Il y avait surtout un dindon à qui sa taille gigantesque, non moins que son air fier et méchant, assignait le premier rang parmi ces volatiles. Le dindon semble être là le roi des airs : c’est le grand aigle, de même que le canard en est l’épervier, et le corbeau le rossignol, comme nous l’avons vu.
La partie occupée par les pluripèdes renfermait des bœufs aussi petits que nos souris, des souris aussi grosses que nos bœufs, des cigales, des papillons, des mouches d’une taille colossale et d’un caractère excessivement féroce. Le public ne les regardait qu’en tremblant. Ces animaux poussaient des rugissements affreux, surtout un hanneton, qu’on appelait le farouche à cause de son humeur sauvage et de ses goûts carnassiers. Il était placé seul au fond d’un large trou. Un grand poteau s’élevait au milieu. Le hanneton grimpait contre, et, malgré la forte chaîne qui l’y retenait, il semblait toujours prêt à s’élancer sur les spectateurs. On n’avait jamais pu l’apprivoiser. Il avait fini par manger tous ses professeurs de civilisation. Les annales de la ménagerie contenaient des histoires fort lamentables à son sujet. C’était triste à entendre raconter par les bonnes qui venaient le voir. Aussi, comme il arrive toujours, on le traitait infiniment mieux que tous les autres animaux présents, c’était le plus aimé, car c’était le moins aimable.
Celui qui habitait la cage voisine de mon cousin n’avait pas non plus l’humeur très philanthropique. C’était une puce de quatre pieds de haut sur cinq de long.
La chair fraîche de mon cousin l’affriandait vivement. Elle fit si bien qu’elle força deux des barreaux qui les séparaient, et que, subito, elle se dressa devant lui, toute prête à l’attaquer.
Attention !
Mon cousin eut heureusement la présence d’esprit de dégainer sa rapière et de se mettre en garde.
C’était la première fois qu’il avait à lutter de cette manière contre des puces.
Il s’en acquitta parfaitement.
La foule prit un vif plaisir à cet horrible duel. Ce fut un magnifique spectacle. Homère n’a rien de plus beau en fait de combats singuliers.
La puce faisait des bonds forfantesques ; elle sautillait autour de mon cousin, s’élançant à droite, à gauche, en avant, en arrière, par en bas, par en haut ; s’accrochant quelquefois aux barreaux de la cage, quelquefois lui passant par-dessus la tête, cherchant toujours le moment favorable de se jeter sur lui pour le dévorer, mais rencontrant toujours la pointe de sa mobile épée.
Bref et d’une, la puce s’élance une dernière fois : mon cousin la frappe ; l’épée glisse d’abord sur l’impénétrable écaille de la bête ; mais mon cousin redouble, et, d’un bras à transpercer une porte-cochère, il la lui plante enfin jusqu’à la garde, dans une de ses jointures. La puce tombe alors, se débat, et rend le dernier soupir aux applaudissements des spectateurs.
Je recommande le fait aux poètes épiques et aux mélodramaturges du Cirque.
Or donc, que faisait pendant ce temps l’Académie des sciences ?
L’Académie des sciences ne faisait rien du tout, pensant que c’était là ce qu’elle avait de mieux à faire.
Elle avait entendu le rapport de son rapporteur, et s’était mise à en discuter gravement les conclusions. Ces conclusions, comme d’habitude, ne concluaient d’aucune façon.
Il y eut des orateurs pour.
Il y en eut contre.
Il y en eut sur.
Il y en eut aussi à côté. Ce fut même le plus grand nombre.
Quoiqu’ils eussent vu de leurs propres yeux le monstre dont il était question, les uns prétendirent que ce monstre n’existait pas réellement, parce que son existence était contraire à tout ce qu’on avait vu jusqu’alors.
Quoiqu’ils ne l’eussent pas vu, les autres prétendirent, en revanche, qu’il leur suffisait, pour y croire, que les premiers n’y crussent pas.
Enfin, qu’ils l’eussent vu ou non, les plus modérés prétendirent qu’il n’était pas impossible que ce fût possible, mais qu’il était possible que ce fût impossible ; et que, par conséquent, jusqu’à ce qu’on eût fait valoir pour ou contre, non pas des preuves matérielles, ce qui n’a aucune valeur en bonne philosophie, mais un syllogisme, un dilemme, un argument quelconque, ils resteraient sagement dans le doute, c’est-à-dire s’abstiendraient de croire, sans toutefois ne pas croire.
Ces différents orateurs alléguèrent de si éloquentes raisons en faveur de leurs différentes thèses, qu’après avoir entendu chacun d’eux, on ne pouvait s’empêcher de penser comme lui, alors même qu’il ne pensait d’aucune manière.
Il y en eut aussi quelques-uns qui ne prirent point part à ces intéressants débats : ils dormirent pendant toute leur durée, et même encore longtemps après
C’est ainsi que les choses se passent ordinairement dans les assemblées délibérantes de la Lune.
Enfin, après plusieurs jours de lumineuses discussions, les doctes académiciens s’aperçurent qu’à force de s’expliquer sur le point en litige, ils arrivaient à n’y plus rien comprendre. Ils allèrent aux voix, et, chose singulière ! ceux qui avaient parlé pour votèrent contre, tandis que ceux qui avaient parlé contre votèrent pour.
Quant à ceux qui s’étaient montrés les plus ardents, ils ne votèrent d’aucune façon.
Le résultat de tout ce grabuge fut la nomination d’une commission d’enquête qui se transporterait à la ménagerie, vérifierait le fait, déterminerait la nature du monstre, et prescrirait le régime le plus propre à le maintenir en bonne santé.
Car c’est encore une des manies des Lunatiques, que de nommer des commissions à tout propos :
Commission pour faire ceci.
Commission pour voir si la première a fait cela.
Commission pour voir si la seconde a vu ce qu’a fait la première.
Commission pour vérifier si la première a montré à la seconde ce qu’est chargée d’examiner la troisième.
Ainsi de suite.
C’est par là, du reste, que les académiciens eussent dû commencer ; mais on ne pense jamais à tout, et particulièrement à l’essentiel.
Les académiciens qui composaient la commission n° 1, se transportèrent dans la cage où mon cousin Laroutine continuait d’avoir une faimvalle d’autruche, malgré les friandises qu’il y grapillait de l’un et de l’autre.
Ces savants décidèrent :
Que son espèce leur était tout à fait inconnue ;
Qu’il était vivipare, à moins qu’il ne fût ovipare ;
Qu’il était vertébré, si toutefois il n’était pas invertébré ;
Et qu’il était carnivore, ou herbivore, pourvu cependant qu’il ne fût point l’un et l’autre.
Ils déclarèrent aussi que ses habits faisaient partie de son corps, que c’était une espèce de peau dont la nature l’avait orné, et que l’épée, qui lui pendait au côté, était un aiguillon dont elle l’avait armé, à l’instar des aspics et des guêpes.
Ils déclarèrent, en outre, qu’il était fort méchant, puisqu’il s’était défendu contre la puce sauvage qui l’avait attaqué. Ils recommandèrent, en conséquence, d’avoir pour lui tous les égards qu’on doit aux bêtes féroces.
Quant à sa nourriture, ils jugèrent à propos de suspendre toute décision sur ce point secondaire, jusqu’à ce que l’Académie eût décidé s’il convenait mieux de garder l’animal vivant, que de le disséquer dans l’intérêt de la science, et de suspendre son squelette à la voûte de leur palais.
Ils se bornèrent à lui faire donner provisoirement une botte d’orties crues, quelques grosses pattes de mouches, et un baquet de vinaigre pour boisson.
Ils se retirèrent ensuite, fort satisfaits d’eux-mêmes et des progrès de la science.
Mon cousin Laroutine se trouvait donc dans une fâcheuse alternative : être tué ou mourir de faim. Il n’y avait pas de milieu.
Heureusement, le roi de ce beau royaume, le vertueux Brrrrrr (c’était son glorieux nom), eut envie de voir à son tour cette bête curieuse dont on parlait tant, et qui faisait, sous le rapport de l’attention publique, une si fâcheuse concurrence à ses ministres eux-mêmes.
Comme c’est bien le moins que ce soient les animaux qui se dérangent en pareil cas, mon cousin Laroutine fut transporté, avec sa cage, dans le palais de ce respectable monarque. C’était une grande montagne de cristal de roche qu’on avait taillée, creusée, ciselée, et à travers les murs transparents de laquelle on voyait parfaitement, du dehors, tout ce qui se passait dedans.
Il en était ainsi du domicile de tous les grands fonctionnaires de l’État. Ils habitaient des maisons de verre, afin que chacun pût les voir en passant dans la rue, et s’assurer par soi-même qu’ils ne commettaient aucun tripotage.
Or donc, il y avait une grande fête au palais ce jour-là. Toute la cour avait pris place autour d’un superbe festin. Les convives étaient douze mille deux cent quarante-trois, car il y a des fonctions de toutes sortes à la cour, depuis le titulaire qui n’a rien à faire, jusqu’au suppléant qui est chargé de l’aider à cela.
Il y a là des gens qui paraissent n’être venus au monde que pour fermer les portes, ouvrir les fenêtres, suivre Sa Majesté ou la précéder.
Il y en a qui ont pour mission confidentielle de brosser son manteau, ou de nettoyer son tuyau de pipe.
Il y en a pour tout, sans compter le reste.
Ces fonctions domestiques sont fort recherchées par les familles les plus distinguées de la Lune. C’est à ce point que, lorsqu’on ne peut parvenir à servir Sa Majesté elle-même, on se fait un honneur de servir du moins ceux qui servent ses serviteurs. Le tout, aux frais de l’État, car on assure que cela fait marcher le commerce.
Le commerce des consciences, c’est possible.
Quoi qu’il en soit, tous ces gens-là, hommes et femmes, étaient vêtus avec un luxe que mon cousin prit d’abord pour une indigente simplicité.





























