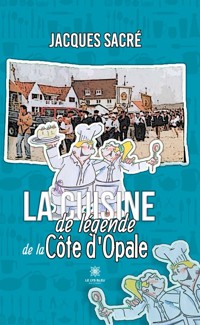Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Les enquêtes incomplètes du commissaire Georges
- Sprache: Französisch
Paul Georges revient avec sa sympathique équipe. De nouvelles enquêtes les conduisent dans des endroits charmants où la fine gastronomie s’allie toujours à un brin de mystère. Avec une détermination sans faille, il mène ses investigations à un rythme effréné. Le commissaire Georges parviendra-t-il à résoudre l’affaire et à dévoiler les vérités qui souvent lui échappent ?
À PROPOS DE L'AUTEUR
Jacques Sacré a rapidement été saisi par le virus de l’écriture. Il compte à son actif des articles d’information grand public publiés dans ses Carnets vétérinaires, une BD, Léonardo et Gambrinus, ainsi qu’un abécédaire français-créole à l’usage de Haïti. Il offre ici au lecteur le second volet des aventures du commissaire Georges.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 126
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jacques Sacré
Les enquêtes incomplètes
du commissaire Georges
Tome II
Roman
© Lys Bleu Éditions – Jacques Sacré
ISBN : 979-10-422-0246-0
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122- 5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122- 4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335- 2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Biographie d’un commissaire
Paul Georges naquit le 24 avril 1937 sur le premier plateau du Jura, dans la charmante petite ville de Poligny, réputée pour ses vignobles fameux.
Son père, Louis Georges, tenait l’hôtel de Genève place Nationale. C’est lui qui inculqua au petit Paul le goût du bien manger et du bien boire. C’est de lui aussi, Jurassien de pure souche, que Paul hérita d’un caractère têtu, entier, mais bon enfant. Ses vagabondages dans l’hôtel familial avaient déclenché en lui la passion d’observer les gens, tentant par-là de percer l’anonymat de leurs existences, passion qu’il continuera à cultiver dans le petit restaurant de son oncle à Paris. Sa mère, Julie Perraud, descendante d’un sculpteur jurassien renommé, était enseignante à l’École Nationale Professionnelle Ménagère de Jeunes Filles, plus brièvement l’École H. Friant, installée dans un ancien couvent. D’elle, il tenait une grande compréhension de l’âme humaine, le goût du travail bien fait et une certaine sensibilité.
Après des études au collège Jules Grévy de Poligny, situé dans l’ancien couvent des jacobins (ce qui valut au jeune Paul une brève crise de mysticisme), il réussit son bac et retourna place Nationale seconder son père à l’hôtel.
C’est son oncle, Jean-Baptiste Perraud, qui allait provoquer un changement radical d’orientation dans sa vie. L’oncle Jean-Baptiste tenait un « bouchon » dans le quartier des Halles à Paris. Un de ses habitués, inspecteur à la PJ, lui avait appris que la « Maison » recrutait, et ce à des conditions intéressantes pour les jeunes. L’oncle avait proposé à son neveu gîte et couvert s’il descendait dans la capitale.
Paul s’était retrouvé à l’École de Police de Paris, puis avait bien vite trouvé une place à la PJ où il avait gravi les échelons posément, en bon Jurassien qu’il était.
À l’époque où il commença à faire parler de lui, c’était un homme bâti en force, la cinquantaine vigoureuse. Un nez busqué et une petite moustache conquérante soulignaient un visage coloré aux traits fermes.
Toujours habillé de gris et chapeauté de même, il cultivait cependant la fantaisie de cravates originales et chatoyantes. Il tenait à ses pipes, d’authentiques pipes de Saint-Claude, héritées de son grand-père. Pour rien au monde, il ne s’en serait séparé et il en suçotait toujours une qu’il allumait rarement. Ce qui accentuait sa ressemblance avec un célèbre confrère qu’il admirait beaucoup.
Il s’était marié sur le tard avec une petite du pays qui fréquentait le bouchon de son oncle. Ils avaient eu un enfant qui n’avait pas vécu bien longtemps. Sa femme n’avait pu enfanter par la suite et avait reporté toute son affection sur son cher mari. À la PJ, passé commissaire, il s’était constitué une solide équipe de collaborateurs. Son préféré était sans conteste le jeune Bruno Mayence dont l’impétuosité le faisait souvent sourire. Arthur Avril était rentré un peu après lui dans le service, mais sans ambition, il était demeuré simple inspecteur ; une grande complicité unissait les deux hommes.
Récemment, Georges s’était vu attribuer une jeune inspectrice, profileuse de formation. Jolie et très intelligente, Anahita Pohjola avait le don de l’agacer et de l’émerveiller à la fois : sans être misogyne, il digérait parfois mal les petites victoires professionnelles de sa coéquipière. Thierry Cuypers, un Belge, était le scientifique de la bande. Féru d’ordinateurs, il était souvent en formation, ce qui faisait dire au commissaire qu’il avait un équipier aussi virtuel que ses programmes.
Tout aussi fugaces, les inspecteurs Mahieux et Martens étaient venus grossir l’équipe le temps d’un stage.
Au labo, il pouvait compter sur le fidèle Constantin Peyrolles qu’il avait si souvent réveillé au beau milieu de la nuit, et dont le savoureux accent avait toute la saveur du Midi. Sans compter sur le jeune docteur Pierre-Yves Sorgue, ami d’enfance de Mayence, qui avait la mainmise sur la morgue et y exerçait en tant que médecin légiste.
Un trait commun soudait cette équipe : la gourmandise. Georges, épicurien dans l’âme (c’était son côté bourguignon), féru de bons plats et de bons vins, particulièrement ceux du Jura, les avait bien souvent entraînés dans de fins restaurants qu’il repérait à chacune de ses enquêtes.
Souvent chargé de missions délicates en dehors de Paris, il s’était particulièrement fait remarquer une première fois dans l’affaire dite « de la lune rousse ». Ce fut à cette occasion que son biographe se rendit compte qu’une enquête était rarement close, qu’elle pouvait toujours cacher d’autres vérités, bien loin des conclusions officielles. Peu d’enquêtes sont complètes. Mais cela, il ne devait jamais le faire remarquer au commissaire Georges.
Le baiser du fugu
C’était la deuxième jeune japonaise dont on retrouvait le cadavre au Bois de Boulogne, et ce en moins de vingt-quatre heures.
Il faut dire que depuis la découverte du premier cadavre, Paul Georges, commissaire à la PJ parisienne, n’avait pas avancé d’un pas. La jeune femme devait avoir dans les vingt-cinq ans, était probablement Japonaise au vu de son physique et de l’origine nipponne de ses vêtements. Elle ne portait aucun papier, et le commissaire ne savait même pas de quoi elle était morte. Le jeune docteur Pierre-Yves Sorgue, qui régnait en maître sur la morgue, n’avait pu que constater un arrêt cardiaque, et l’expert du labo, Constantin Peyrolles, s’en arrachait les cheveux.
— Pourtant, le Bois de Boulogne n’est pas un endroit où l’on aime se retirer pour mourir, reprit Bruno Mayence, le jeune adjoint du commissaire.
— D’autant plus qu’elle n’était guère habillée pour une balade au Bois : pas de manteau, pas de sac, de légères chaussures de ville, peu indiquées en ce mois de novembre pluvieux. De plus, je mettrais ma main à couper que ce n’est pas une prostituée, fit remarquer l’inspectrice Anahita Pohjola, jeune profileuse détachée depuis quelques mois au service de l’équipe.
Arthur Avril, un inspecteur qui avait fait ses armes en début de carrière avec le commissaire, entra dans la pièce, y apportant son éternelle odeur de célibataire.
*
En fait d’inspecteur, c’était une délicieuse inspectrice qui pénétra une demi-heure plus tard dans le bureau de Georges. Celui-ci, l’œil rond et la bouche ouverte, ne put que bafouiller :
Mais que diriez-vous de parler de tout cela devant une bonne table japonaise ? Je crois que c’est la coutume pour un nouveau venu d’offrir un pot.
*
Le commissaire Georges était quelque peu rassuré. Non seulement on ne lui avait pas fait enlever ses chaussures (il avait horreur du négligé en chaussettes), mais on l’avait fait asseoir à une table normale. Il avait craint tout un temps se retrouver assis en tailleur à une table basse, les reins perclus de douleur.
Par contre, il était encore sous le coup de l’étonnement. L’intégration de Soso s’était faite le mieux du monde. Trop bien, peut-être. Elle et Anahita s’étaient trouvées de nombreux points communs et avaient tout de suite sympathisé. À son grand effarement, il avait vu Anahita discuter avec Sosei en japonais et en anglais. Décidément, sa profileuse l’étonnerait toujours.
Mais le cours de ses réflexions avait bien vite été distrait par le spectacle qui se présentait devant lui.
Le Ginsen était un restaurant japonais mis quelque peu aux normes occidentales. Il croyait revoir le film « L’aile ou la cuisse ». Mais cette fois, c’était lui qui était en face du teppan, une vaste plaque en acier inoxydable derrière laquelle officiait un chef élégamment coiffé d’une toque à l’occidentale.
Comme dans le film, les morceaux de viande virevoltaient au milieu d’une multitude de légumes taillés en cubes.
— Vous êtes sûre qu’ils ne sont pas toxiques, au moins ?
Georges la regarda en coin, se demandant si elle ne se moquait pas de lui, mais Sosei ne pensait déjà plus au commissaire et regardait avec gourmandise les délicieux morceaux atterrir dans son assiette. Là aussi, Georges avait été rassuré quand il avait vu, à côté de sa paire de baguettes, de bons vieux couverts européens.
Mais le spectacle continuait. Devant le commissaire, une jolie serveuse en kimono avait apporté un étrange dôme perforé, posé sur un petit réchaud.
Le commissaire Georges, gourmand et gourmet, se laissait peu à peu séduire par cette cuisine si peu habituelle pour lui, et avalait goulûment les morceaux de légumes et de viande qu’il trempait avec componction dans sa sauce ponzu dont le nom, faut-il le dire, l’avait tout d’abord inquiété.
*
*
Le seigneur Nakamura était inquiet. En vingt ans de malversations, de crimes et de trafics de tout poil, jamais il n’avait été serré d’aussi près. Certes, ses yakuzas avaient bien travaillé, proprement, mais on n’était à l’abri d’aucun grain de sable. Visiblement, la police ne croyait guère à la thèse d’une mort naturelle. Ce refus d’inhumer l’inquiétait.
Il fallait suivre ces policiers de près, l’affaire était trop importante. Et il faudrait agir si nécessaire.
*
On avait fini par mettre la main sur le suspect du Bois de Boulogne. L’inspecteur Avril avait débarqué avec son bonhomme menotté dans le bureau du commissaire. C’était un déséquilibré connu des services de police. Un xénophobe exalté qui jusqu’alors n’avait fait preuve d’aucune violence.