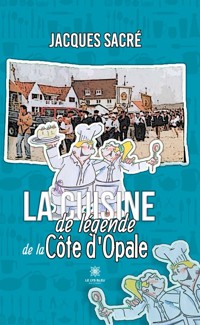Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Devenir un bon écrivain est un guide essentiel pour tous les auteurs, qu’ils soient débutants ou confirmés. Ce manuel explore chaque étape de la création littéraire, de l’inspiration à la promotion de l’œuvre. Il commence par une plongée dans l’histoire du livre, puis oriente le lecteur à travers la rédaction, du choix du sujet au style, en passant par la correction et l’illustration. Il examine aussi les différents genres littéraires, les aspects éthiques, et les voies de publication, qu’il s’agisse d’autoédition ou d’édition traditionnelle. Enfin, il offre des conseils pratiques sur la distribution et les séances de dédicaces pour atteindre et inspirer les lecteurs.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Ancien animateur de mouvements de jeunesse,
Jacques Sacré devient vétérinaire avant d’être captivé par l’écriture. Il publie d’abord des carnets vétérinaires pour le grand public, puis explore divers genres : bandes dessinées Léonardo et Gambrinus, livres de cuisine, et abécédaires français-créole pour Haïti. Son parcours varié en fait un auteur à la plume vibrante et diversifiée.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 83
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jacques Sacré
Devenir un bon écrivain
© Lys Bleu Éditions – Jacques Sacré
ISBN : 979-10-422-3750-9
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Mieux est de ris que de larmes écrire
Pour ce que rire est le propre de l’homme
François Rabelais
Préface
Voilà que mon vieux camarade Jacques me demande une préface… Serais-je donc si « mûr » pour être crédible dans le rôle ? (Serait-ce dû à la bonne quarantaine de bouquins qui s’affichent à mon tableau de titres – sans citer quelques autres commis en braconnier dans le rôle de nègre – ou aux décennies passées dans les coulisses de la micro-république des belges lettres 2.)
Si Jacques Sacré avait été de formation littéraire, je me serais refusé à signer ces quelques lignes de préface, mais Jacques est un scientifique de terrain, un praticien vétérinaire, ayant donc vécu dans un autre monde que celui des Belles Lettres, ce qui change tout à mes yeux. Ce qu’il sait des livres, il l’a appris en écrivant seul, en autodidacte, en homme curieux et sans préjugés qui se pose les questions premières.
L’auteur britannique R. J. Ellory, un sacré maître du polar anglo-saxon contemporain, répondait récemment à un journaliste : « La meilleure façon de devenir écrivain, c’est d’écrire. ] C’est juste de la pratique. Tu dois t’asseoir, t’autodiscipliner, écrire une ou deux heures par jour. Pour moi, ce n’est pas quelque chose qui s’apprend dans une école. » Jacques Sacré tient le même discours, posant les bonnes questions, proposant des solutions concrètes, jusque dans le tutoiement de son interlocuteur-lecteur.
J’ai connu Jacques il y a vingt ans, parce que je partage son intérêt pour l’immense Simenon (noss’ pitit Georges Sim, notre enfant d’Outremeuse, pour les Liégeois que nous sommes tous deux). Il venait alors de signer un savoureux essai, Bon appétit, commissaire Maigret ; je venais moi-même de rédiger un petit guide, Sur les traces de Simenon à Liège, honoré d’une préface de John Simenon. La passion simenonienne est créatrice de complicité d’intérêts, de fratrie existentielle, de maçonnerie littéraire… Simenoniens de tous les pays, réunissez-vous !
C’est pourquoi je me permets d’ajouter ici un seul conseil à tous ceux qui suivent dans ce vade-mecum de Jacques Sacré : lisez, relisez et relisez encore les quelques deux cents romans de Simenon ! Et si, chose faite, il ne vous a pas enseigné à écrire allègrement, il vous aura au moins appris à vivre moins douloureusement…
Christian Libens
Post-scriptum
Un dernier conseil pour la route, toujours selon l’autodidacte R. J. Ellory : « Le pire livre que tu puisses écrire, c’est celui que tu penses que les autres vont aimer. Le meilleur livre, c’est celui que tu aimerais lire toi-même. »
Introduction
Tu es jeune, ou peut-être moins jeune, et tu désirerais devenir écrivain. Pourquoi pas ? Écrire son livre, c’est possible, à condition de respecter quelques règles et une marche à suivre. Ce guide est là pour t’orienter.
Depuis l’envie d’écrire jusqu’à l’édition, toutes les étapes sont ici reprises très simplement et illustrées d’exemples pratiques pour t’aider à mieux comprendre.
Il y a cependant un secret essentiel pour mener à bien l’écriture d’un livre : le travail et la persévérance. En effet, on devient écrivain… en écrivant ! On dit toujours qu’un livre, c’est dix pour cent d’inspiration et quatre-vingt-dix pour cent de transpiration. Mais rassure-toi, c’est une transpiration bien agréable que d’améliorer l’œuvre d’art que deviendra ton livre.
L’écriture te permettra de mieux te découvrir toi-même : es-tu un comique, un mystérieux auteur de polars, un acteur né, un futur enseignant, un conteur… Tu pourras ainsi te rendre compte que l’on a chacun des dons à exploiter. Ta meilleure garantie de réussite sera ton envie de créer une belle œuvre et de la proposer aux autres.
Ce livre s’adresse non seulement à toi, jeune écrivain, mais aussi à tes parents, tes enseignants ou toute autre personne désireuse d’écrire ou de faire écrire un livre. Chacun trouvera dans cet ouvrage tous les renseignements nécessaires.
Maintenant, à ta plume !
Quelques notions à connaître
1 / Un peu d’Histoire
a - Le livre et son évolution
Les différents supports à l’écriture
L’homme, désireux de faire perdurer ses idées et ses connaissances dans le temps et de les transmettre aux générations suivantes, les confia d’abord à la pierre (de -2460 à nos jours) grâce à des dessins, tels que ceux de la préhistoire (- 10 000 acn) et des signes, il laissa des témoignages dans des grottes (comme celle de Lascaux) ou sur des rochers (comme celui du Tassili).
L’homme utilisera cette méthode jusqu’à nos jours. On retrouve encore aujourd’hui des stèles commémoratives. Plus facile à graver, mais plus fragile, l’argile, crue ou cuite, sera utilisée par les premières civilisations (notamment les Sumériens et les Akkadiens ; 3000 acn). L’apparition d’un des premiers alphabets, l’alphabet cunéiforme, aura lieu à la même époque (soit 3000 acn). Dotée de qualités semblables, la cire, étalée dans des tablettes de bois depuis les Romains, connaîtra la même utilisation avec l’avantage de pouvoir effacer et réécrire son texte. Son usage perdurera jusqu’au XVesiècle.
Les Phéniciens, eux, écriront sur des tablettes de bronze. À certaines occasions, l’argent et l’or étaient aussi utilisés.
Le bois, un matériau bon marché et d’usage courant (VIe s acn), sera également largement utilisé. Pour désigner le bois, et particulièrement l’écorce de l’arbre, les Grecs utilisaient le mot « biblos » (d’où découlent les mots français, bible, bibliothèque) et les Romains, le mot « liber » (à l’origine du mot livre). En Asie, le bambou sera utilisé comme support à l’écriture, de même que la soie dont les Chinois avaient le secret, surtout utilisée à partir de 200 acn pour remplacer les tablettes de bois interdites.
Les Égyptiens, quant à eux, utiliseront plutôt le papyrus (2600 acn jusqu’au XIIe siècle), que tu connais sûrement. Le papyrus, support végétal, était fait de roseau détaillé en très fines lamelles que l’on entrecroisait et que l’on écrasait. On pouvait ainsi réaliser des rouleaux de six à dix mètres sur lesquels on n’écrivait que d’un seul côté. Parfois, on grattait l’encre et on réutilisait le papyrus : c’est ce qu’on appelle un palimpseste.
Le parchemin (du latin pergamineum), fait de peaux d’animaux nettoyées, tannées (traitées avec différents produits pour éviter que la peau ne pourrisse) et lissées avec des pierres, sera inventé à Pergame, d’où son nom (IIIe s acn). On pouvait écrire sur ses deux faces, puis effacer le texte en le grattant quand ce matériau devenait rare et cher. Le vélin est de la peau de veau mort-né.
Ce sont les Chinois qui inventeront le papier en 105 pcn. Le secret sera ensuite emporté par les Mongols, qui le transmettront aux Perses, qui eux le transmettront aux Arabes. Les Italiens et les Espagnols s’en empareront et le feront découvrir aux Européens au XIIIe siècle.
Les écritures
Le livre se présenta d’abord sous forme de rouleaux, appelés volumen, puis sous forme de feuilles pliées ou de cahiers, qu’on appelle des codex.
Les parchemins et papiers servaient de support aux écrits des copistes érudits (instruits et savants) principalement, surtout des moines. Ils étaient ornés d’enluminures. Les principaux thèmes copiés au moyen-âge furent d’abord des livres saints, puis l’étude de la grammaire, le chant et les textes des auteurs anciens.
Il existait différents types d’écriture en Europe depuis les Romains, qui créèrent le caractère… romain. Parmi eux, on trouvait la minuscule, la majuscule, la cursive (écriture courante), l’onciale (une écriture particulière des alphabets latin et grec). La lettrine ou l’initiale (la lettre débutant un chapitre) était très courante également. Un type d’écriture peut désigner une époque : la Caroline du temps de Charlemagne.
Les choses changèrent à la moitié du XVe siècle, quand Johannes Gensfleish, surnommé Gutenberg, inventa officiellement l’imprimerie à caractères mobiles, après de nombreux essais et tâtonnements. Le principe était le suivant : on gravait une pièce en cuivre, dans laquelle on coulait un métal mou : le plomb. Le plomb en relief était alors couvert d’encre, un mélange de gomme et de noir de fumée (un pigment noir à base de carbone) et permettait d’imprimer le caractère sur la feuille. Les tout premiers livres imprimés, avant 1500, étaient appelés les incunables.
Avant Gutenberg, on imprimait déjà des dessins, des idéogrammes (en Chine) ou des plaques de bois entièrement gravées de texte : cette technique s’appelle la xylographie. Sache que les plus anciens livres imprimés ont été trouvés en Asie vers 800 après Jésus-Christ.
Le livre
La matière première utilisée
Le papier, lui, était fabriqué à partir de vieux chiffons. On les faisait pourrir puis on les broyait en pâte. On rajoutait de l’eau savonneuse pour dégraisser le mélange et on obtenait ainsi de la pâte à papier que l’on déposait sur un grillage de fils de laiton (ce qui donne les vergeures, les petites lignes en relief), on le faisait égoutter sur feutre, puis on le séchait avant de l’encoller (pour que l’encre ne s’y répande pas comme sur un papier buvard).
Plus tard, ce sera le bois qui sera utilisé dans la pâte à papier. On utilisera aussi la paille, des papiers recyclés, du carton.
En plus du papier vergé, on peut trouver du papier vélin (bien lisse), du papier bouffant rugueux, pour l’aquarelle par exemple, du papier satiné, glacé, pelure, carbone, japon (nacré et quasi indéchirable).