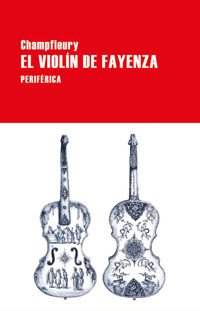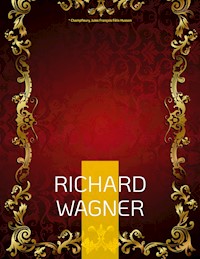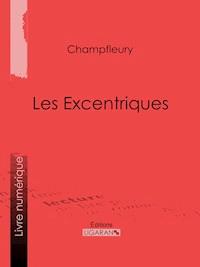
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Les Excentriques de Champfleury est un livre captivant qui nous plonge dans un univers fascinant et déroutant. Écrit par Champfleury, un écrivain français du XIXe siècle, ce recueil de nouvelles nous transporte au cœur de la société parisienne de l'époque, où se côtoient des personnages hauts en couleur et hors normes.À travers ces récits, Champfleury nous dépeint avec une plume acérée et un regard critique les excentricités de ses contemporains. Que ce soit le peintre déjanté qui se prend pour un génie incompris, la vieille dame excentrique qui collectionne les chats ou encore le poète maudit qui se complaît dans sa solitude, chaque personnage est dépeint avec une justesse et une profondeur qui ne laissent pas indifférent.
Les Excentriques de Champfleury est un livre qui nous invite à réfléchir sur la notion de normalité et sur les limites de la société. À travers ces histoires, l'auteur nous pousse à remettre en question nos propres préjugés et à nous interroger sur ce qui fait la différence entre la folie et la créativité.
Ce recueil de nouvelles est également un véritable voyage dans le Paris du XIXe siècle. Champfleury nous décrit avec minutie les rues animées, les cafés bruyants et les salons mondains de l'époque, nous plongeant ainsi dans une atmosphère à la fois pittoresque et envoûtante.
Les Excentriques de Champfleury est un livre à la fois divertissant et profond, qui nous fait réfléchir sur la société et sur nous-mêmes. À travers ces histoires, l'auteur nous offre un regard unique sur les excentricités de l'âme humaine, nous invitant à embrasser notre propre singularité.
Extrait : "On ne lit pas assez les travaux de Charles Bonnet sur l'histoire naturelle, surtout son Traité d'insectologie qui renferme un chef-d'œuvre : Observations sur les Pucerons. Que de dévouement à la science ! quelle cruauté immense pour ces petits êtres qui manquaient de biographes ! Il faut voir le savant Suisse, armé de sa loupe, étudiant les sexes des pucerons, décrivant avec sa chaste plume les agaceries du puceron, les coquetteries de la puceronne."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 415
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
N’avez-vous pas rencontré plus d’une fois sur le pavé de Paris des êtres qui s’emparent de votre regard, que vous ne pouvez oublier quand vous les avez vus ?
Quelquefois ces personnages n’ont rien de surprenant ni d’étrange dans leur costume ; tout est dans leur physionomie, que les utopies, les rêves, les idées ont rendue bizarre. À ce métier, le masque devient étrange, le corps suit la marche de l’esprit. Swedenborg l’a dit en une phrase ineffaçable :
« L’homme extérieur est moulé sur l’homme intérieur. » Profondes paroles qu’il vous est donné plus qu’à un autre de comprendre. Et un étranger, M. Pechméja, a délayé à votre intention l’idée du mystique Suédois :
« Il nous est enseigné par ce Juvénal de la lithographie comment l’égoïsme plisse une lèvre ; de quelle façon l’avarice serre les tempes et les grime ; comment l’astuce vulgaire, la gourmandise native, les béatitudes de la matière, l’âpreté du gain, la soif de l’injuste, l’inintelligence du beau, la terreur du grandiose et toutes les grossières appétences peuvent, au grand dépit de Dieu, faire clignoter la paupière, boursoufler le nez, crevasser les joues, aiguiser le profil, aplatir le front, torturer les sourcils, creuser les narines, déchausser les dents, avachir la mâchoire, écarquiller les yeux, empâter le menton. »
Si les vices et les passions déforment la figure de l’homme comme la pluie déforme un chapeau de soie, les habits ne voudront pas être en désharmonie avec l’homme. Des savants, des philosophes et des romanciers ont prouvé par des découvertes récentes que tout ce qui entoure l’homme se modèle sur lui : les femmes et les enfants, les animaux, les choses animées et les choses inanimées.
Le chat d’un serrurier et le chat d’un apothicaire ne se ressemblent pas ; regardez-les un instant de votre œil fin et malicieux, et vous verrez que ces deux animaux offrent la différence profonde qui distingue un atelier de forge d’une boutique de pharmacie.
Les habits de ces inconnus offrent des rapports avec les rides de ceux qui sont dedans. Mais dans les différentes pièces de leur costume, le désaccord et la désharmonie sont encore plus frappants que les trous et les coutures. Ils pourraient prendre pour eux l’épithète de crotté, si longtemps accolée au mot « poète », et ils en ont gardé la faim, car ils ne sont guère plus riches.
Pour vous et pour quelques-uns qui trouvent que chaque jour est une mine de curiosités, la rencontre d’un être semblable est une représentation à votre bénéfice qui dure toute la journée. Sans avoir jamais étudié les travaux de Le Brun, de Porta, de Lavater sur la physiognomonie, vous en savez plus que ces auteurs ; vous vous dites que l’inconnu n’est ni un tailleur, ni un droguiste, ni un avoué, ni un poète, ni un marchand, ni un danseur, ni un employé, ni un charcutier, ni un peintre, ni un maçon, ni un avocat, ni un cordonnier, ni un filou, ni un notaire.
Qu’est-ce ?
Ce qu’est-ce devient alors une question bien plus ardue à résoudre qu’un problème ; mais la question est intéressante, elle s’est logée dans le cerveau et rien ne l’en ferait sortir.
L’inconnu a été aperçu à Paris par deux cents personnes. Les deux cents curieux se sont tous posé le même problème et ne l’ont pas résolu. Mais il y a un lien entre ces deux cents curieux qui les réunit à un moment donné, et qui les fait se rencontrer et causer entre eux, de même que tous les bourgeois de Paris amateurs de pigeons se connaissent. Deux membres de cette bande, plus versée que la police secrète dans tous les mystères de Paris, se rencontrent dans un salon, dans un cabaret ou dans un atelier.
– J’ai vu à tel endroit, dit l’un, un individu singulier…
– N’était-il pas, dit l’autre, habillé de telle façon ?
– Oui, avec un nez comme ça…
– Et pas de chapeau.
– Je l’ai rencontré hier, il regardait par-dessus le pont.
– Moi, je l’ai vu il y a trois mois, il regardait aussi par-dessus le pont.
– C’est bien le même.
– Vous le connaissez ?
– Pas du tout, et vous ?
– Pas davantage, mais j’en parlerai à un tel…
– Moi aussi, je connais quelqu’un qui doit le connaître.
Un forçat dangereux s’est échappé du bagne : on envoie son signalement à toutes les autorités, à la gendarmerie ; souvent un portrait lithographié est joint au signalement. Quelque fin que soit un mouchard, il ne se mettra jamais un signalement en tête comme les deux cents curieux parisiens.
Un jour je parlais d’un type bizarre que j’avais rencontré dans un restaurant du boulevard, et qui troubla mon dîner par sa cruelle voix de perroquet. – Est-ce celui-là ? dit un peintre en reproduisant en quatre coups de crayon la silhouette exacte de mon homme.
Ces hommes, étudiés par la bande invisible des deux cents curieux, sont des Excentriques.
Le public est quelquefois en rapport avec eux par leur profession ; mais ceux-là ne sont pas les plus intéressants, car ils font comme le marchand de crayons qui a une robe rouge, se coiffe d’un casque en acier à plumes écarlates, descend la visière, monte sur sa voiture, et étonne ainsi les paysans du marché des Innocents.
« Si je m’habillais comme tout le monde, dit le marchand de crayons, je ne vendrais pas mes crayons. » Il ne craint plus de livrer son secret, il a fait venir la foule. Quelques-uns de mes excentriques offrent ce double caractère, curieux à observer, et pour lequel il faudra créer un mot.
Les uns disent : – Oh ! qu’il est rusé !
Les autres : – Qu’il est naïf !
Et on ne s’entend pas, parce que cet excentrique n’est ni rusé ni naïf, il est rusé-naïf ; il a la foi, il a cherché à entraîner des esprits à sa suite, il n’a pas réussi, quoiqu’il ait lutté longtemps. Alors l’instinct le pousse à la ruse : tous les moyens lui sont bons pourvu que son idée triomphe. Il méprise la société plus que la société ne le méprise, et il cherche à la tromper en se disant que c’est pour faire son bonheur. Ces êtres bizarres dont les plans sont si nébuleux, si peu pratiques, d’une application difficile, pour ne pas dire impossible, comprennent merveilleusement le mécanisme de la vie civilisée ; ils saisissent les vices ou les défauts d’un individu avec beaucoup de finesse.
J’ai vu de ces convertisseurs commencer par flatter un individu, puis, ne réussissant pas, tourner à la brutalité : il l’insultait et lui dévoilait ses mauvais instincts. Cet excentrique clairvoyant n’était rien moins que naïf, puisque, comme un disciple de Gall et sans tâter les bosses, il déshabillait un homme du regard et savait trouver la fenêtre de son âme ; il n’était rien moins que rusé, puisque, malgré toutes ses combinaisons, ses discours, ses démarches, ses publications, son immense activité, il n’arrivait tout au plus qu’à un morceau de pain chèrement acheté.
Et cependant l’homme se faisait vieux et cassé ; il comprenait que de longtemps ses rêves ne se réaliseraient pas. S’il avait voulu cesser sa vie errante et vagabonde, sa famille l’attendait les bras ouverts pour le recevoir comme l’enfant prodigue. Qui le retenait, lui, sa femme et ses enfants, dans la misère, au sein du Paris misérable ?
LA CROYANCE.
Était-il rusé ? Était-il naïf ?
Quand Jean-Jacques Rousseau s’habillait en Arménien dans les rues de Paris et qu’il était regardé autant que nous avons regardé Carnevale, n’était-ce pas là le procédé vulgaire du marchand de crayons, l’envie de faire parler de soi, et l’orgueil en plus ?
Mais les véritables excentriques s’ignorent ; ils ne se savent pas excentriques, et surtout ne le disent pas ; ils se croient dans le positivisme, dans la raison, dans la coutume, et s’étonnent d’être regardés.
Il a fallu plus de courage qu’on ne croit pour faire poser ces modèles, bohèmes véritables, à l’esprit difficile et chagrin, souvent mystérieux comme des sphinx, et toujours indéchiffrables comme l’obélisque.
Quelques-uns sont compromettants et indiscrets ; vous leur parlez une fois, vous les connaissez pour toujours. N’importe en quelle société ils vous trouvent, ils s’attachent à vous et ne vous quittent plus ; mais ceux-là sont heureusement l’exception. On rencontre dans la vie parisienne d’effrontés cyniques qui avouent crûment leurs passions et leurs vices. Ils ont le bon côté de servir de sujets.
Ils se déshabillent sans se faire prier, vous avez l’homme nu. Ils enlèvent complaisamment l’épiderme, vous avez l’écorché. Ils font bon marché de leur chair, de leur sang, de leurs veines, vous avez le squelette.
Quand on a bien vu ces drôles qui semblent des pièces artificielles d’anatomie artistement construites, ils remettent leurs veines, leur sang, leur chair, leur épiderme, leurs habits. Ils sont charmants. On les quitte, la tête pleine de notes précieuses, on les rencontre dans la rue, et on ne les salue pas.
Ils sont remplis de discrétions et de sens ; si vous avez oublié un détail, vous retournez chez le sujet qui recommence sa leçon d’anatomie avec la même complaisance ; peut-être cette complaisance vient-elle de ce que le cynique sait que l’étude n’est pas perdue et qu’elle profitera à la science.
Tout le Neveu de Rameau est là-dedans. Diderot n’eût pas fait son plus beau livre, si Rameau jeune ne s’était complu dans un déshabillement perpétuel devant le grand philosophe. Combien de neveux de Rameau marchent aujourd’hui sur les trottoirs ? Et que manque-t-il à ces génies ignorés ? Un homme de génie qui sache sténographier.
Je retrouve dans mes notes, si vous êtes curieux de connaître mes procédés, le premier état d’un portrait d’excentrique qui n’a pu être terminé par la malveillance de celui qui posait, par ses soupçons et par sa disparition.
C’était un homme qui tous les jours se promenait sur le Pont-Neuf, gros et gras, avec une belle figure pleine, des yeux illuminés, un peu de ventre, de longs cheveux ramenés derrière les oreilles, et dont les boucles avaient fini par graisser outrageusement le col de la redingote.
Cette belle tête bien construite, et dont les yeux fiers et noirs refoulaient les regards indiscrets des passants du Pont-Neuf, était couverte d’un chapeau que rien, excepté votre crayon, ne saurait rendre. Un auteur dramatique dirait aux comiques les plus baroques de la Montansier : « Vous ferez faire un chapeau de soie vieux, abîmé et désolé, plus abîmé, plus vieux et plus désolé que tous ceux que vous avez portés jusqu’ici dans vos farces », les comiques échoueraient.
Je me laboure la tête, je grimace, je me donne beaucoup de mal pour rendre le chapeau ; je rature, je sens que je n’arriverai jamais ; en ce moment je m’aperçois de l’impossibilité de la description dont nos maîtres ont cependant donné depuis vingt ans des modèles de génie.
Vous avez dû sourire souvent de la peine que se donne le romancier à vouloir dessiner une physionomie avec la prose, vous qui, en quelques libres crayons, donnez la vie pour toujours à des êtres que les historiens futurs consulteront avec joie, pour se rendre compte de l’extérieur bourgeois de notre siècle.
Pour rendre ce chapeau impossible, je ne peux que me servir d’un équivalent :
« Il n’y a qu’une couple d’années, une vieille femme habitait encore une des chambres du château ruiné de Fregeinstein. Un soir, elle vit tout à fait inopinément dans cette chambre un homme qui portait une robe grise, un grand chapeau crasseux et une longue barbe. Il pendit son chapeau à un clou, s’assit à table, sans s’inquiéter de personne, tira de son sac une petite pipe, du tabac, et fuma. Cet homme gris demeurait toujours ainsi derrière la table. La vieille femme ne put pas attendre qu’il lui plût de s’en aller ; elle se mit au lit. Le matin, le spectre avait disparu. – Le fils de Schulz a raconté ce qui suit : « Le matin du jour de Noël, pendant qu’on célébrait l’office divin, à l’église, ma grand-mère était assise dans notre chambre et priait. Au moment où elle détournait les yeux de son livre, et où justement elle regardait vers le jardin du château, elle vit tout à coup un homme en robe grise et en chapeau crasseux. Il était debout et piochait de temps en temps. Nous-mêmes nous l’avons vu, ainsi que tous les voisins. Après le coucher du soleil il disparut. »
Ceci est une légende allemande, courte, précise, sérieuse, ne discutant pas les faits, traitée en procès-verbal, et qui vaut un dessin, n’est-il pas vrai ?
On pouvait appeler l’inconnu l’homme au chapeau crasseux.
Mais sous ce mauvais chapeau se tenait une grosse figure de moine à double menton, originale et pleine de santé. Rarement les excentriques ont de ces figures monacales et d’une bonne graisse, étant habitués à se nourrir à la cuisine de l’occasion. À diverses reprises je rencontrai mon homme se promenant sur le Pont-Neuf, les mains derrière le dos, l’œil droit devant lui ; avec son ventre et sa redingote, il ressemblait un peu à une petite statue que le moulage a répandue partout, l’auteur de Faust en houppelande.
C’était un Goethe mélangé de Chodruc-Duclos.
Il y en a qui sauteraient tout de suite au-devant de l’homme, qui l’interrogeraient, qui lui demanderaient des détails sur sa vie. C’est le moyen de ne rien savoir. Tel est le procédé des journalistes : aussitôt vu, aussitôt conçu, aussitôt imprimé. Moi, je comprends pourquoi les chats ne tuent pas brutalement les souris qu’ils attrapent ; ils s’en font une fête, ils se donnent une fantaisie.
Ainsi je laissais promener mon homme, certain qu’il ne m’échapperait pas, me contentant de l’épier et de surprendre sa vie dans ses mouvements, dans ses habits et dans sa mauvaise cravate blanche roulée en ficelle autour de son cou ; je l’étudiais par derrière en attendant de pouvoir l’étudier par devant. S’il s’était retourné, il aurait vu deux ombres.
Il est important pour de semblables observations de savoir si l’homme conserve toujours son même costume, s’il tient les mêmes gestes, s’il fréquente les mêmes endroits. Dès que la manie est accusée, vous êtes certain de ne pas perdre de vue votre sujet.
À cette époque nous prenions nos repas dans un petit divan, au fond d’un café dont les joueurs de dominos ne s’approchaient qu’en tremblant, car de là mille imprécations s’étaient envolées, les théories les plus audacieuses, littéraires, quelquefois politiques malheureusement, y étaient traitées militairement ; tout y était discuté, hommes et choses, avec une cruauté et un enthousiasme de vingt-cinq ans.
Le hasard qui avait réuni des peintres, des poètes, des philosophes, des savants, des inutiles, des douteurs et des imbéciles, nous sépara. Ce qu’on appelle l’esprit était mal vu et laissé à des endroits plus orgueilleux ; au contraire régnait la brutalité qui ne laissait pas la plus petite place au mensonge.
Dans cet endroit était passé déjà plus d’un homme étrange qui ne pouvait résister à un pareil jury.
Il était presque impossible qu’un excentrique ne trouvât pas au moins un pair dans notre bande, fût-il musicien, chimiste, poète, romancier, mathématicien ou philosophe. Et ce n’étaient pas des experts officiels qu’il rencontrait : des monsieur Prudhomme, des médecins de cour d’assises, des académiciens, des pédagogues, de ces gens qui aiment la convention, la bonne tenue, les compliments, les belles manières et une conversation flûtée.
Tous nous avions cherché, et nous attendions tous les jours un nouveau frère.
Un jour je rencontrai dans le café, assis devant une table de marbre, l’homme au chapeau crasseux. Il prenait du café, regardait fixement la dame de comptoir qui était belle, joignait les mains, et murmurait assez haut des paroles incompréhensibles. Les vieux habilités étaient scandalisés du bruit qui les empêchait de lire leurs journaux en paix ; le maître de l’établissement dépêcha un garçon pour prier l’homme de prendre son café tranquillement. Il regarda le garçon avec colère, et promena sur les paisibles habitués des regards qui les firent se pelotonner derrière leurs gazettes. Quand nous eûmes assez regardé cette comédie, l’un de nous, le plus aventureux, alla inviter poliment l’homme au chapeau crasseux de monter au premier étage où il trouverait à boire et des amis ; là il était assuré de parler à sa fantaisie sans être troublé par d’insolents garçons. Il regarda longuement l’inviteur, ne parut pas comprendre d’abord, et finit par grimper en murmurant l’étroit escalier en colimaçon qui conduisait à notre divan.
C’est l’interrogatoire, et autant que possible, la pantomime des acteurs que j’ai pu noter pendant la séance, car l’homme au chapeau crasseux était trop occupé pour me voir écrire ; d’ailleurs il me parut homme à ne pas s’en inquiéter.
Il resta longuement à fixer quelque chose que nous ne voyions point ; nous le regardions, et il ne nous regardait pas. Au bout d’un quart d’heure :
– À quoi pensez-vous ? dit W…
Il ne répondit pas.
W… continua.
– Vous ne pensez à rien ?
Il devait se passer des orages dans l’esprit de l’homme au chapeau crasseux, car il faisait entendre des onomatopées singulières que rien ne saurait rendre.
– Vous ne pensez à rien du tout ? reprit W…
– Je cherche le bonheur, dit enfin le cynique… le plaisir de voir tous les hommes qui sont vrais… Moi, je vous aime tous, pauvres petits garçonnettes… Mes chers enfants, je vous aime tous.
Il en resta là et ne voulut répondre à un nouvel interrogatoire que pour crier : « À boire ! » Il désira spécialement du vin. Il but. W… le soupçonnait atteint de philosophie et le poussait dans cette voie ; mais qu’il était difficile d’obtenir même des mots sans suite ! Cependant, après avoir balancé la tête, avoir chanté, avoir crié : « Vive la liberté !… à bas les entraves !… jamais… vive la liberta ! », il s’écria :
– Je suis la vérité !
– Moi aussi, dit W…
– Es-tu vrai ? demanda le cynique.
– Oui.
– Tant mieux, dit l’homme au chapeau crasseux, à ta santé !
W… l’entraînait toujours dans les sentiers de la philosophie, et l’autre haussait les épaules sans répondre, ou bien il disait :
– Vois-tu, mon petit garçonnette, tu n’es pas plus haut que ça. Il levait la main d’un demi-pied de la table de marbre, et se plaisait à montrer son mépris pour la philosophie de notre ami. Enfin, pressé de questions :
– Regarde-moi bien ! s’écria-t-il.
W… le fixa.
– Plus près, dit le cynique en se mettant les coudes sur la table.
Le philosophe, chargé de l’instruction, imita ce mouvement ; les quatre coudes se touchèrent, et les yeux plongeaient les uns dans les autres. Pendant dix minutes ils se regardèrent ainsi sans bouger, sans faire un mouvement. Quelquefois l’homme grondait en dedans, mais il ne baissait pas les sourcils ; je crus qu’il voulait magnétiser W… Nous attendions quelque confidence de ces confidences oculaires, mais il n’en fut rien.
Le cynique en revenait toujours à son thème favori de la vérité.
Tous deux s’étant reposés, car cette tension de l’œil était très fatigante, ils recommencèrent l’expérience, qui dura près d’une demi-heure sans amener de résultat, et qui se termina par ce mot de l’homme au chapeau crasseux :
– Nous avons besoin de satisfaction, tous nous avons besoin de satisfaction.
Et il mettait toujours en doute la science de W…, qui s’offrait comme disciple en philosophie.
– Ah ! dit-il, pauvre raspaillousse, toi étudier la philosophie ! tu veux donc beaucoup maigrir.
Il fut impossible d’en tirer d’autres renseignements, sinon qu’il était du Rouergue et qu’il s’appelait Ginestès, philosophe des écoles. Là-dessus il sortit plein de fierté.
Je ne l’ai plus jamais rencontré depuis cette séance du 5 mars 1840.
C’est dans cette circonstance qu’un dessin eût été utile ; je désespère d’avoir rendu la figure de cet être singulier, qui ne valait pas une biographie, mais un portrait.
Bien d’autres excentriques sont venus dans cet endroit ; mais nous les avions matés, nous en étions maîtres, nous en avions fait des machines de guerre. J’entends quelquefois dire des excentriques qu’ils sont ennuyeux ou tenaces ; le tout est de savoir les prendre. Au début, nous leur laissions expliquer leurs systèmes, leurs théories, avec toute l’indulgence possible ; nous étions de complaisants auditeurs ; mais une fois le système connu, discuté et jugé, il n’était plus permis à l’excentrique d’y revenir. Leur vie, d’ailleurs, est si accidentée, si remplie d’imprévu, qu’elle vaut à entendre le meilleur roman comique.
Un, entre autres, avait fait souscrire un grand poète à une petite rente dont les premiers termes furent payés avec quelque exactitude ; puis ce furent des accomptes, des retards, enfin rien. Il se passa ainsi un an. Notre homme venait d’inventer une nouvelle souscription et il retourna chez le poète qui le reçut à merveille. « – Comment donc ! je vais signer, et ma femme, et mon fils aussi. Mais, dit le poète, qui était un célèbre bohème, nous n’avons pas un sou à la maison. Je négocie dans ce moment un emprunt sur une de mes pièces qui se joue dans huit jours et qui me rapportera au moins vingt mille francs. Repassez donc tel jour, et je vous paierai les trois souscriptions. »
Au jour indiqué, on pense si l’excentrique fut exact ; mais l’emprunt n’était pas négocié, les répétitions de la pièce traînaient, et avaient empêché l’affaire de se conclure. Nouveau rendez-vous pris et donné. À l’heure dite, l’auteur dramatique, qui descendait l’escalier, rencontre son homme qui montait. « – Mon cher, dit-il, votre affaire est prête ; montez, ma femme vous attend ; moi, je suis pressé : je cours à ma répétition. » L’autre monte, plein de confiance, sonne, resonne ; la porte ne s’ouvre pas. Il comprend qu’il a été joué. Mais le domestique du poète remontait chercher quelque chose que son maître avait oublié. – Je ne lâche pas le domestique, pensa l’excentrique qui ne dit rien de ce qui venait de se passer. Le domestique retourne au théâtre ; l’autre entre avec lui. On allait commencer la répétition. L’auteur dramatique causait dans la coulisse avec une actrice : il aperçoit tout d’un coup son homme à la rente qui l’a vu également. Le poète espère se sauver dans l’obscurité : mais il avait affaire à un être aussi clairvoyant qu’un recors, qui l’aperçoit grimpé en haut d’un portant de coulisses. Le poète était tout honteux d’avoir joué un pareil tour à un brave homme : il n’osait plus descendre. « – Venez demain à onze heures précises, lui dit-il. – Non ! dit l’autre, vous m’avez trompé ! je veux mon argent. »
Les garçons de théâtre allaient mettre à la porte celui qu’ils regardaient comme un impudent créancier : – Mon cher directeur, dit l’auteur dramatique, ayez donc la complaisance de donner un louis à mon ami. Tu ne manqueras pas de venir demain.
– Est-ce bien sûr ? dit l’excentrique.
– Très certain.
– Si vous n’étiez pas sûr, il vaudrait mieux me remettre à une huitaine.
– Vous avez raison, mon ami, dit le poète, dans une huitaine. Adieu. »
Ils se donnent des poignées de main, heureux tous deux d’être débarrassés l’un de l’autre. À huit jours de là, l’homme à la rente sonnait à la porte de son ami.
– Monsieur est à table avec du monde, dit le domestique ; si vous voulez entrer dans cette chambre, je vais le prévenir.
L’excentrique attend quelques minutes, et entend un bruit singulier qu’il imitait d’une façon très comique en le racontant. C’étaient des portes qui se fermaient, des bruits de pas pressés. Inquiet, il ouvre la porte, court au salon, personne ; à la salle à manger, personne ; les serviettes étaient dépliées, la viande encore chaude dans les assiettes, les chaises en désordre. Plus de doute, c’est une fuite. Il court à l’escalier, se penche en dehors de la rampe et aperçoit déjà sur le palier d’en bas l’auteur dramatique qui se sauvait, et sa femme, et son fils, et le domestique.
Telle est la vie de ces pauvres excentriques, qui ne gardent pas rancune de pareils tours, et qui sont meilleurs qu’on ne le croit.
La femme ne joue pas un grand rôle dans leur existence ; c’est ce qui enlève un grand charme à leur biographie ; cherchant des problèmes sans fin, ils ont l’instinct de ne pas se marier. La famille ne vit pas de recherches et ne croit pas à l’absolu. Aussi trouverait-on des drames remplis de larmes dans la vie exceptionnelle des excentriques qui ont pris femme ; c’est la lutte du pot-au-feu et de l’avenir. Et quand il faut s’occuper d’aujourd’hui, le chercheur pense que demain est éloigné d’autant, et que chaque concession au pot-au-feu retarde de longtemps ses plans de réalisation.
Quelques types de poètes auraient dû figurer dans ma galerie. Les poètes ne vivent pas selon les lois de la société : ils marchent dans la vie les pieds en l’air, la tête en bas ; gros de manies et de caprices, ils sont l’effroi des gens rangés qui ont construit leur existence suivant les lois de l’arithmétique ; mais les poètes reçoivent déjà assez de coups de pied des ânes qui les entourent, sans les exposer publiquement en compagnie des presque fous, aux risées d’une foule ignorante.
Neuilly, juin 1851.
On ne lit pas assez les travaux de Charles Bonnet sur l’histoire naturelle, surtout son Traité d’insectologie qui renferme un chef-d’œuvre : Observations sur les Pucerons. Que de dévouement à la science ! Quelle cruauté immense pour ces petits êtres qui manquaient de biographes ! Il faut voir le savant suisse, armé de sa loupe, étudiant les sexes des pucerons, décrivant avec sa chaste plume les agaceries du puceron, les coquetteries de la puceronne. Un jour Bonnet s’aperçoit qu’une classe bizarre de ces insectes accomplit tout à la fois les travaux de paternité et de maternité ; aussitôt il s’empare de ce puceron étrange et l’isole ; il le met pour ainsi dire dans une prison cellulaire de verre, afin de l’éloigner de ses frères et sœurs. Le savant inquiet ne bouge plus de sa chambre ; il ne quitte pas une minute sa loupe et la cloche de verre qui renferme le puceron hermaphrodite. La nuit Bonnet se lève d’heure en heure, craignant qu’un insecte de la même famille ne se soit introduit frauduleusement dans la prison de verre destinée à constater un enfantement important pour la science.
Enfin, la chose est certaine : le puceron engendre lui-même sans coopération étrangère. Bonnet désormais veut suivre la destinée de ce petit insecte nouveau-né. Il l’arrache des bras de son père-et-mère, et l’isole sous une nouvelle cloche. Il suit ainsi trente générations de pucerons ; et, dressant minute par minute un journal détaillé de leurs actions, de leurs joies et de leurs peines, il tient un registre de la vie et de la mort des pucerons avec le soin qu’on exige d’un employé de la mairie aux états civils.
Et il ne faut pas croire que ces travaux, parce qu’ils traitent d’insectes minuscules, soient à l’histoire naturelle ce que la miniature est à la peinture à l’huile. Sans ces observations, peut-être Bonnet n’arrivait-il pas à sa palingénésie. L’historien des pucerons est aussi grand que le reconstructeur des animaux antédiluviens. Dans la science, Bonnet occupe sa place à côté de Cuvier.
Da Gama Machado est un savant de l’école de Bonnet. Comme le Suisse, le Portugais vit entouré d’oiseaux et d’animaux qu’il observe perpétuellement ; on verra comment ont été couronnées ces contemplations.
Je donne d’abord ses titres qui sentent le Portugal d’une lieue : « Le commandeur Joseph-Joachim Da Gama Machado, conseiller de légation à Paris, gentilhomme de la maison royale de S.M. Très Fidèle, commandeur de l’ordre du Christ, membre de l’Académie des sciences de Lisbonne et d’un grand nombre de Sociétés savantes. » Son blason porte cinq haches d’argent sur fond d’azur.
M. de Machado appartient à une famille originaire du Portugal. À huit ans, il fut envoyé à Paris pour faire ses études au collège d’Harcourt, sous la direction de l’abbé Coesnon, à qui plus tard fut confiée l’éducation des enfants de Toussaint Louverture.
M. de Machado fit de longs voyages, et n’étudia l’histoire naturelle qu’à cinquante ans.
Et, ce qu’il y a de singulier, c’est de voir un Grand de Portugal, avec des lunettes d’or, fureter sur les quais, et ressemblant, à s’y méprendre, à un simple bourgeois curieux. Plus singulier encore est de trouver au milieu de Paris, en plein quai Voltaire, un homme entouré d’oiseaux et de curiosités de toutes les parties du monde.
Tous les jours, M. de Machado déjeune avec ses animaux. Chaque individu a son langage particulier pour demander le repas.
– Si je veux conserver l’amitié de chacun d’eux, me disait le savant, il ne faut jamais les tromper. Le travail du cabinet exige moins de fatigues que la surveillance que réclament mes petits compagnons ; il faut des soins continuels pour éloigner d’eux les maladies et pour maintenir la paix dans la petite famille, où l’harmonie, de même que chez nous, ne règne pas toujours.
Ainsi, j’ai vu chez M. de Machado cinq roitelets isolés les uns des autres ; ce qui est nécessaire, car il n’existe même pas d’harmonie entre le mâle et la femelle. Un jour, ces roitelets n’ayant pas été séparés, le savant entendit un cri de douleur, suivi d’un chant de joie. Le mâle venait de tuer sa compagne ; il ne manquait pas d’annoncer par une chanson bruyante la victoire cruelle qu’il venait de remporter.
Ceci vient, explique M. de Machado, de ce que les ressorts du cerveau des troglodytes sont montés pour les batailles.
Depuis six ans un rossignol demande à sortir de la volière, le soir, par un petit cri mêlé d’anxiété. « Il exprime ensuite son contentement par ses manières et par un chant gracieux, où l’on reconnaît les accents de sa gratitude. » Quand M. Gama Machado voyageait, il emmenait avec lui sa perruche favorite ; en diligence, en chemin de fer, en bateau à vapeur, en chaise de poste, la perruche ne manqua jamais de demander son déjeuner, par un cri, toujours à la même heure, avec une précision d’horloge de Genève.
Cette perruche est une espèce de veilleur, de garde-malade intelligent. Si un oiseau s’évanouit subitement, la perruche jette un cri d’alarme pour réclamer du secours.
Un petit sénégali rouge pousse encore plus loin le dévouement : quand un de ses compagnons est malade, il le couvre de foin ; il se tient à la porte, et en défend à coups de bec l’accès aux étrangers. Il a pour ami un bengali mâle. Jamais ils ne se quittent ; quoique ayant chacun leur femelle, ils dorment toujours ensemble.
Ces amitiés se voient fréquemment chez les oiseaux. Tout le monde l’a observé chez les hirondelles. Les deux maïas de M. de Machado sont constamment en guerre avec les autres pour leur nid. Ils ont le visage si noir, qu’ils ressemblent à des négrillons. Il est important de constater les soins hygiéniques dont les a entourés le savant.
Chaque oiseau a sa baignoire,
Il y a un endroit disposé en salle de bains. À voir toutes les petites baignoires alignées, on se croirait aux bains Vigier. Le matin, les oiseaux arrivent l’un après l’autre, et se plongent, sans se tromper, chacun dans sa baignoire. Ils sont pleins de complaisance l’un pour l’autre, s’épluchant, se becquetant comme fait une mère chatte pour son chat. Ils prennent encore un bain le soir, avant de se coucher.
On pense bien que M. de Machado, qui s’occupe ainsi du corps de ses oiseaux, n’a rien négligé pour leur nourriture. C’est là, au contraire, qu’il a porté tous ses soins. J’ai voulu copier la formule savante de cette nourriture :
« La pâtée se compose de bœuf bouilli, haché très fin, d’un demi-jaune d’œuf frais, d’un quart de millet mondé et crevé, d’un huitième de chènevis, le tout broyé dans un mortier, sans être mouillé autrement que par l’eau du millet, qui est suffisante pour humecter la totalité de la pâtée. Les vers à farine sont également très propres à la nourriture des roitelets et des rossignols : il en faut au moins un dans la journée ; il convient peut-être mieux que ce soit le matin. Quand mes oiseaux sont malades, j’ai aussi l’habitude d’introduire un ou deux vers dans la pâtée ; elle en devient plus agréable, et ils s’en trouvent mieux. Mais jamais de persil, ainsi qu’on a coutume de le faire ; car je regarde cette plante comme malfaisante, à cause de sa ressemblance avec la ciguë, et Rousseau confesse qu’il n’a jamais mangé d’omelette qu’avec crainte, tant l’appréhension que le cuisinier avait pu se méprendre était grande chez lui. Cette pâtée est plus saine et agréable à l’œil que le cœur du bœuf haché, que l’on donne ordinairement aux becs-fins. »
Feu le marquis de Cussy aurait compris, par l’artistique combinaison des différentes matières qui entrent dans cette pâtée, quel intérêt M. de Machado portait à ses animaux.
Et il ne faut pas s’imaginer que le savant ne garde ses animaux et ne les élève qu’en vue d’en tirer des observations. Il les aime et les respecte en bonne santé autant qu’en maladie. Ainsi, il était un sansonnet hardi, plein de familiarité, qui, sans se gêner, prenait un ton fort haut avec son maître. M. de Machado était forcé en rentrant de causer avec lui, autrement le sansonnet n’aurait pas laissé le savant tranquille. Il parlait aussi clairement que le perroquet, chantait et sifflait quasi comme un rossignol. À toute heure de la nuit, quand son maître l’appelait, il répondait par un air de vaudeville. C’était l’oiseau le plus guilleret qui pût se voir : grand causeur et grand chanteur. Il vécut plusieurs années sans manger de viande ; il était seulement friand des mouches et des insectes. Mais quand l’âge vint l’affaiblir, le sansonnet fut mis à la pâtée ci-dessus.
Je vais laisser expliquer à M. de Machado comment il adoucit les derniers moments de son sansonnet goutteux, âgé de 15 ans, qui ne pouvait plus percher.
Les animaux sont sujets aux mêmes maladies que nous. Les rhumes, les affections de la peau, les maux de tête, les obstructions, la phtisie, la délivrance avec ses douleurs déchirantes, l’enfance avec ses maladies, la première mue, correspondant à notre première dentition et dangereuse comme elle, un dépérissement graduel, les convulsions qui accompagnent nos derniers moments, une lente agonie, enfin, ce retour trompeur et fugitif à la santé qui précède souvent la mort, tout ce cortège de maux s’observe chez les petits oiseaux, avec les mêmes circonstances que chez nous. Les remèdes qu’emploie le savant pour les soulager sont aussi les mêmes que les nôtres.
« Les moyens par lesquels je prolonge depuis deux ans, l’existence de mon vieux sansonnet, m’expliquait Da Gama Machado, sont simples, et les personnes affligées de la goutte pourraient peut-être en tirer quelques soulagements. L’hiver de 1829 à 1830 ayant été extrêmement rigoureux, je lui faisais prendre chaque soir un bain de jambes, préparé avec des fleurs de guimauve, de sureau et de romarin, bouillies pendant quelques minutes, et on l’endormait dans le bain en le magnétisant ; car, sans cela, il eût été impossible de le tenir en repos. »
M. de Machado employa tous les moyens médicaux connus pour guérir ceux qu’il appelle ses petits amis. Quelquefois il s’est servi avec succès de l’homéopathie. Il recommande comme moyen certain la belladone dans l’épilepsie (quelques oiseaux ont des attaques) ; et les globules de safran ont souvent soulagé les oiseaux, à l’époque fatale de la mue. Un sénégali à front fleur-scabieuse ne conserva sa santé qu’à l’aide de nombreux bains de lait ; de plus, on lui faisait prendre quelques gouttes d’éther. Cependant, quelques oiseaux ont une médecine et une chirurgie naturelles, qui peuvent lutter avec celles de l’Académie de médecine. Peu de temps après l’arrivée du sénégali dans la maison Machado, il lui survint au bec une excroissance qui le gênait et le faisait souffrir pendant ses repas. Le sénégali s’était pris d’une belle amitié pour un petit moineau friquet qui allait lui rendre souvent visite. Ils finirent par ne plus se quitter. M. de Machado, qui était toujours aux aguets, fut on ne peut plus surpris de voir le petit friquet qui limait avec son bec l’excroissance du sénégali : celui-ci se prêtait deux fois par jour, à cette opération avec une entière confiance. Le friquet chirurgien continua pendant une huitaine, et le sénégali fut guéri.
C’est après avoir vécu longtemps en famille avec ses animaux, c’est après les avoir observés nuit et jour que Da Gama Machado arriva à formuler son système de la Théorie des Ressemblances, basée sur les moyens de déterminer les dispositions physiques et morales des animaux, d’après les analogies de formes, de robes et de couleurs.
Contrairement aux idées des zoologistes qui regardent les couleurs des êtres comme des nuances fugitives, peu propres à fournir des caractères précis, M. de Machado marchait avec les minéralogistes et les botanistes qui ne dédaignent point de mentionner les couleurs dans leur signalement.
Ainsi est expliquée l’absence du persil dans la fameuse pâtée décrite plus haut : « Le persil doit être malfaisant, pense le savant, il ressemble à la ciguë. »
« J’avais souvent admiré les petits sauts légers et obliques de mes perruches, me disait M. de Machado, sans pouvoir m’en rendre compte. D’où venait donc qu’en opposition avec les habitudes des perroquets, celles de grimper et de voler, mes perruches, lorsque je les fais sortir de leur cage pour monter sur les bâtons de leur petite échelle, ne grimpent pas toujours et emploient souvent un saut latéral et oblique ? L’exemple du friquet me mit bientôt sur la voie, et je vis très clairement des habitudes communes entre deux animaux très différents, mais semblables par la couleur. »
M. de Machado soutient que la pie-grièche n’est grièche qu’à cause de la ressemblance d’une partie de sa robe avec la petite mésange-charbonnière.
« La couleur, dit-il, est le vrai pilote de la nature, pour donner la connaissance de la valeur de ses productions, dans les trois règnes, animal, végétal et minéral. Il est vrai que Bernardin de Saint-Pierre n’était pas éloigné de ces idées. Dans les Études de la Nature, il dit que les couleurs des animaux indiquent, peut-être plus qu’on ne pense, leurs caractères, et que la couleur deviendra peut-être le germe de toute une science. Les fameuses analogies de Fourier partent du même principe. »
Mais il vaut mieux citer des faits curieux observés par M. de Machado : « – J’ai élevé des torcols, dit l’auteur de la Théorie des Ressemblances. Ils sont très familiers, comme les troglodytes ; ils dorment souvent accrochés, comme les colimaçons, et grimpent continuellement, bien que Buffon dise qu’ils ne sont pas grimpeurs. Je n’ai pas réussi à les conserver vivants au-delà de quelques mois. Le bec se couvre d’une matière visqueuse qui les empêche d’avaler, et ils meurent. J’en possède un dans ce moment que je nourris principalement de soupe au lait. Je l’avais mis dehors dans une de mes volières, mais les nuits froides du mois d’octobre l’incommodaient. Je l’ai repris dans l’intérieur, et il est actuellement bien portant. Le torcol, dont la robe ressemble par sa couleur à celle des petits serpents, en a le sifflement ; il tord son cou dans tous les sens, et se cache dans les trous comme les reptiles ; habillé avec les couleurs du roitelet, de la bécasse et de la phalène-agriphine, il en a aussi les mœurs. »
M. de Machado a chez lui un saïmiri très doux qui prend du lait sucré tous les matins : il dédaigne la viande. Ce saïmiri est inconstant ; il ne souffre pas qu’on le tienne trop longtemps dans les mains. Contrairement aux habitudes des singes à queue à demi prenante, il préfère dormir perché, comme les oiseaux. Il s’endort difficilement de même que les ducs et autres oiseaux de proie nocturnes ; et il a le goût le plus vif pour les insectes, ainsi que les reptiles. On remarque les mêmes habitudes chez la chouette et la raine, espèces qui se tiennent sur les arbres. Par là, M. de Machado explique l’analogie de la forme des yeux de son singe avec la chouette. Et ce qu’il y a de plus extraordinaire, le saïmiri a sous les doigts une viscosité comme la raine. D’où l’axiome : « Quelque sorte d’animal que ce soit, qui porte la ressemblance d’un autre animal, il lui est aussi semblable ou en approche en mœurs et naturel. »
Le savant portugais avait un petit-duc qui mourut d’une maladie de cœur, mal très commun parmi les oiseaux. Le petit-duc, qui ressemble à un chat, en avait les mœurs et les goûts. Il faisait entendre un ronron ; il mangeait des souris. Ses yeux avaient quelques rapports avec ceux de la grenouille ; de temps en temps on pouvait entendre un véritable coassement. M. de Machado trouvait à son petit-duc « un avantage sur l’homme, en ce qu’il tourne sa tête tout autour de la colonne vertébrale, tandis que nous ne tournons la tête que d’un tiers. »
M. de Machado a horreur du scalpel ; jamais il ne s’en est servi pour ses observations. Il laisse aux zoologistes de l’Académie la connaissance de la structure intérieure des oiseaux, persuadé que plus importante est la structure extérieure.
M. de Machado s’écrie : « J’ai une passion déterminée pour les animaux ; la tête dégagée de préjugés, je ne me crois supérieur ni à l’homme ni à la plante ; j’ai la connaissance des doctrines de Porta et de Gall ; je m’abstiens des classifications ; pour moi tout a une valeur quelconque dans la nature, et je sais que les différents dessins colorés sur la robe des animaux n’y ont pas été placés pour satisfaire la curiosité et la vanité de l’homme. »
Et il observe non seulement la couleur, mais la forme. Personne avant lui n’avait traité des différentes textures des plumes, de leurs teintes mates, brillantes, changeantes, soyeuses et métalliques. Il va traiter de la couleur des becs.
La loxie fascié est un oiseau paresseux et voluptueux. Il a le caractère querelleur. « Il fallait constamment veiller à la femelle pour la soustraire à la brutalité du mâle, qui la maltraitait parce qu’elle ne voulait pas céder à son amour effréné. » La loxie fascié a le bec du moineau : il ne pouvait être que très méchant.
Cependant quelquefois la couleur l’emporte sur la forme. Le pinson royal a la même taille et le même bec que le cardinal de Virginie. Le cardinal a un chant très beau : le pinson royal ne chante pas. Un autre que M. de Machado serait embarrassé ; mais il s’en tire par l’observation suivante : « Les robes des deux oiseaux sont différentes. Le cardinal a une robe rouge ; sans la couleur rouge le cardinal ne chanterait pas. »
J’avoue que je m’égare dans ce raisonnement : je comprends que la forme soit inférieure à la couleur et qu’un bec d’oiseau soit moins important que le plumage coloré ; mais M. de Machado, qui affirme que c’est la couleur rouge qui fait chanter le cardinal, aurait dû expliquer l’influence du rouge, qui sans doute à ses yeux représente la joie.
Je préfère et j’ai plus de confiance dans l’histoire du ouistiti qui s’élança la tête la première dans un grand bocal de poissons rouges. Ce malheureux singe allait être noyé, victime de sa ressemblance avec les chats, si M. de Machado ne l’eût repêché à temps.
L’illustre Portugais rapporte qu’en 1830 il faisait apporter à son réveil six roitelets qui voltigeaient autour du lit ; ils prenaient grand plaisir à grimper le long des rideaux, à se cacher dans les plis ; quelquefois ils cherchaient tous les trous de la chambre comme une souris. Après examen, M. de Machado reconnut dans leurs yeux le regard perçant de la souris. Leur robe était de la même couleur que celle de ces rongeurs. Leurs ailes étaient placées comme les ailes du papillon ; en voltigeant, les roitelets produisaient un susurrus très faible, de même que le bruit des ailes du papillon. Enfin une ressemblance frappante fut démontrée entre les roitelets et le papillon Erycina Thersander, dont la robe offrait également les mêmes couleurs.
Le lièvre a la tête de la même forme que celle de l’écureuil et le même grognement ; ses pattes ressemblent à celles du renard par la couleur ; il grimpe comme celui-ci à une assez grande hauteur. Le lièvre est extrêmement propre ; il a un coin d’habitude. Cette propreté tient à son poil soyeux comme celui du chat, qu’on ne garde dans les petits appartements qu’à cause de sa propreté.
« Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets » dit Da Gama Machado. Ainsi il a deviné les rapports du tabac et du laurier-rose. Ces deux plantes présentent la même couleur rose, le même calice à cinq divisions, la même corolle en entonnoir ; les feuilles ont la même forme. Toutes les deux sont lancéolées. Aussi M. de Machado entend-il ces confidences qui sortent du calice des deux plantes. La nicotiane (tabac) dit : « Une prise de tabac produit quelquefois une heureuse pensée, mais redoutez l’abus. Une goutte d’huile, distillée de ma fleur, donne la mort. » Voici ce que fait entendre le nerium (laurier-rose) : « Ma fleur fait l’ornement des jardins, mais vous ignorez mes qualités pernicieuses ; les animaux périssent sous mon influence délétère, et la poudre sternutatoire, préparée avec ma feuille, cause de graves accidents. »
C’est d’après les mêmes principes que M. de Machado a compris les propriétés d’une fleur de nos jardins, la fritillaire, d’après un damier qui a de l’analogie avec la robe des reptiles. La fritillaire, plante bulbeuse, renferme des principes âcres. Son poison agit avec plus d’activité au printemps, qu’en automne. Elle semble dire : « Évitez mon odeur. »
Le serpent angaha de Madagascar a juste la même robe : « Redoutez mon venin. »
M. de Machado, l’un des fervents disciples de Gall, nie le libre arbitre chez l’homme et chez l’animal. Il a trouvé des exemples assez curieux pour être cités.
Le dioch du Sénégal est occupé toute la journée à travailler et fait des ouvrages d’un tissu remarquable. Il est né architecte. M. de Machado prétend qu’il faut qu’il obéisse à l’impulsion irrésistible de l’organe où siège la mécanique, d’après Gall. Deux de ces animaux construisent d’une manière différente ; l’un bâtit en labyrinthe, l’autre a un penchant pour la forme sphérique. Il arrive souvent que la bâtisse ne paraît pas satisfaisante au dioch ; aussitôt il démolit ce qu’il a commencé, abat ses fondations et recommence pour arriver à une précision mathématique qui ferait l’admiration d’un maître maçon. M. de Machado a fait sur la doctrine de Gall une expérience curieuse. Ses deux diochs, qui habitaient ensemble, avaient construit un immense labyrinthe. L’homme détruisit l’édifice de l’animal, se disant que, si l’animal avait réellement l’instinct de la mécanique, il reprendrait bientôt ses travaux. Les diochs parurent affligés un jour ou deux, mais le troisième ils se remettaient à la construction d’un nouveau labyrinthe.
La seconde observation est encore plus concluante et facile à vérifier. Il s’agit de la tortue, qui cherche toujours à grimper aux murs, quoiqu’elle retombe perpétuellement, avec l’obstination insensée que mettaient les Danaïdes à remplir le tonneau vide.
« La tortue a la tête du lézard, et, comme lui, cherche toujours à grimper ; cependant la forme massive de cet animal n’est point celle d’un grimpeur, mais sa ressemblance avec un autre individu lui ôte son libre arbitre ; il faut donc qu’il monte malgré lui, et qu’il tombe à chaque instant ; la tortue s’apprivoise facilement comme le lézard ; la mienne cherche toujours la société. Les pattes ayant de l’analogie avec celles de l’éléphant, et étant ridées comme elles, il en résulte une marche semblable. Cet animal, quoique classé parmi les chéloniens, n’est dans le fait qu’un lézard portant sur son dos son habitation. »
Il ne nous reste plus qu’à citer quelques maximes de M. de Machado, qui avoue hautement son fatalisme :
« Les guerres de religion vengent bien les animaux du mépris que nous leur témoignons.
Les animaux naissent savants sans passer par l’éducation, tandis que les hommes n’acquièrent leurs connaissances qu’au moyen de mauvais traitements.
Les protubérances représentent les fruits de l’arbre humain, de même que les oranges représentent les fruits de l’oranger.
Il y a contradiction à donner la pensée exclusivement à l’homme, en la refusant à l’animal, qui présente la même conformation que lui.
L’homme est-il véritablement un être intelligent ? S’il faut en croire M. de Paw, le doute sur l’intelligence humaine est bien permis.
La parole manque au singe, cet animal a conservé sa pleine liberté.
Bien loin de s’enorgueillir de sa station verticale, l’homme devrait peut-être la maudire.
Les oiseaux chantent rarement faux ; chez l’homme le chant n’est pas naturel.
La couleur est le mobile des mœurs chez les animaux.
Le corps humain est une machine composée de mauvais ressorts en partie rouillés.
La nature semble avoir privé l’homme du sens commun et l’avoir donné aux animaux. »
On voit que l’homme est assez maltraité par Da Gama Machado ; cependant ses opinions, qui sont bizarres dès l’abord, ont été soutenues plus d’une fois par de grands savants. C’est Linée qui a dit :
« En conséquence de mes principes d’histoire naturelle, je n’ai jamais pu distinguer l’homme du singe, la parole n’est pas pour moi un signe distinctif. »
Seulement les plus audacieux s’arrêtaient au singe. M. de Machado a été plus loin.
« Tout ce qui vit sort d’un œuf », dit-il ; et, s’appuyant sur ces similitudes d’origine, il a fait peindre un tableau qui est une sorte d’échelle des êtres naturels. Dans ce tableau, l’homme ouvre la marche, suivi du sansonnet ; vient la raie torpille, après elle la vipère, ensuite la fourmi, puis la jonquille.
Les premiers seront les derniers.
L’homme est tour à tour insulté, méprisé, vilipendé par les oiseaux, les insectes et les fleurs, qui lui montrent clairement son infériorité.
C’est un morceau d’une haute fantaisie, telle qu’on en rencontre peu dans les livres de science habituels. Je le cite dans toute son exactitude :
L’Homme
Je viens au monde nu ; je conserve, pendant mon existence, ma nudité ; j’emprunte aux animaux et aux végétaux mes vêtements ; je débute par des larmes, je termine par des larmes. L’anatomie comparée me classe le premier parmi les mammifères : mon imagination détruit le travail du scalpel ; je me suis créé être raisonnable. Suis-je bien raisonnable dans l’ivresse de l’amour ? Suis-je bien raisonnable quand je détruis mon semblable ?
Sansonnet