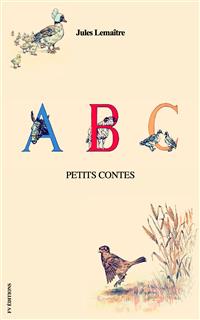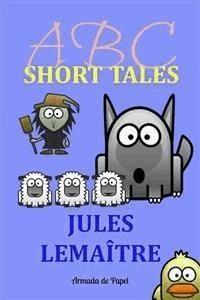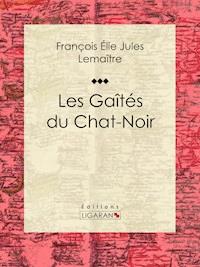
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Les gaîtés du Chat-Noir est un recueil de nouvelles de l'écrivain français Jules Lemaître, publié pour la première fois en 1896. Ce livre regroupe une série d'histoires humoristiques mettant en scène des personnages hauts en couleur, des situations loufoques et des dialogues savoureux.
Lemaître, connu pour son style léger et enjoué, nous emmène dans l'univers du célèbre cabaret parisien Le Chat Noir, où se croisent artistes, écrivains, poètes et autres personnages excentriques. Chaque nouvelle est l'occasion de découvrir des tranches de vie cocasses, des quiproquos hilarants et des rebondissements inattendus.
À travers ces récits, l'auteur nous offre un regard amusé sur la société de son époque, tout en nous faisant rire et réfléchir sur les absurdités de la vie quotidienne. Les gaîtés du Chat-Noir est un véritable condensé de bonne humeur et de fantaisie, à déguster sans modération pour un moment de lecture divertissant et réjouissant.
Extrait : "Par un phénomène bizarre d'association d'idées (assez commun aux jeunes hommes de mon époque), l'Exposition de 1889 me rappelle celle de 1878. À cette époque, dix printemps de moins fleurissaient mon front. C'est effrayant ce qu'on vieillit entre deux Expositions universelles, surtout lorsqu'elles sont séparées par un laps considérable."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 197
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335054897
©Ligaran 2015
Cet ingénieux animal n’est pas mort ; mais on peut dire, sans l’offenser, qu’il est sorti de sa « période héroïque » On publie un volume de ses Gaîtés. Le moment semble donc venu de dire ce qu’il a été et ce qu’il a fait.
Vous connaissez le petit théâtre de la rue Victor-Massé. Au-dessus de la lucarne aux ombres chinoises est peint un chat noir, à la queue en tringle, aux contours simplifiés, un chat de blason ou de vitrail, qui pose une patte dédaigneuse sur une oie effarée. Ce chat représente l’Art, et cette oie la Bourgeoisie.
Mais, contrairement aux traditions, cette oie et ce chat ont eu ensemble les meilleurs rapports. L’oie, reçue chez le chat – non gratuitement – s’est crue en pays de Bohème ; c’est, en somme, le chat qui a galamment « exploité » l’oie, tout en l’amusant et même en lui ouvrant l’intelligence.
Le Chat-Noir a joué son rôle dans la littérature d’hier. Il a vulgarisé, mis à la portée de l’oie une partie du travail secret qui s’accomplissait dans les demi-ténèbres des Revues jeunes.
Il a été des premiers à discréditer le naturalisme morose, en le poussant à la charge. Il a, je ne dis point inventé (car nous avions eu Richepin, Alfred Delvau), mais rajeuni et propagé le naturalisme macabre et farce, par les chansons de Jules Jouy et d’Aristide Bruant. Il a révélé aux gens riches et aux belles madames la « poésie » des escarpes et de leurs compagnes, les boulevards extérieurs, les « fortifs » et Saint-Lazare, et ce que c’est que « pante » que « marmite », que « surin », que « daron, daronne et petit-salé… ».
Et, en même temps, le Chat-Noir contribuait au « réveil de l’idéalisme ». Il était mystique, avec le génial paysagiste et découpeur d’ombres Henri Rivière. L’orbe lumineux de son guignol fut un œil-de-bœuf ouvert sur l’invisible. Mais, au surplus, le conciliant félin nous a appris que le mysticisme se pouvait allier, très naturellement, à la plus vive gaillardise et à la sensualité la plus grecque. N’est-ce pas, Maurice Donnay ?
Au fond, le digne Chat resta gaulois et classique. Il eut du bon sens. Quand il choisit Francisque Sarcey pour son oncle, ce ne fut point ironie pure. Quelques-uns des Schaunards de cette bohème tempérée furent ornés des palmes académiques. Le Chat eut l’honneur d’être loué un jour sous la coupole de l’Institut. Il tenait à l’opinion du Temps et du Journal des Débats. Son idéalisme n’a jamais « coupé » dans la « Rose-Croix » ni dans la poésie symboliste. Il a raillé celle-ci, – oh ! les étonnants vers amorphes de Franc-Nohain ! – comme il avait décrié d’abord le naturalisme de Médan.
Puis, le Chat-Noir a été patriote, et chauvin, et grognard. Comme la vogue des « gigolettes », et comme la piété vague et veule qui nous émeut sur les Madeleines et sur les Izéyls, la napoléonite qui nous travaille est un peu venue de lui. Vous vous rappelez l’Épopée, de Caran d’Ache. Le Chat, sur quelques menus points, fut un précurseur.
Il a, avec ce même Caran d’Ache avec Willette et Steinlen, rajeuni la « caricature » (j’emploie ce mot devenu impropre, faute d’un meilleur). Et il a restauré, en lui donnant une forme neuve, la « vieille gaieté française ».
Car il eut pour nourrisson le bienfaisant Alphonse Allais. (Je veux nommer aussi, tout au moins, George Auriol, ne pouvant les nommer tous.) Allais vaudrait, à lui seul, une étude. Allais a certainement enrichi l’art du coq-à-l’âne et de l’absurdité méthodique. Toujours le burlesque a suivi les évolutions de la littérature dite sérieuse. De même que la fantaisie de Cyrano de Bergerac répercute tout le pédantisme fleuri du temps de Louis XIII, de même qu’un grand nombre de facéties de Duvert et de Labiche supposent le romantisme : ainsi les écritures bizarres d’Alphonse Allais, par leurs tics, clichés et allusions, par le tour indéfinissable de leur rhétorique et de leur « maboulisme », impliquent toute l’anarchie littéraire de ces quinze dernières années…
(Laissez-moi ouvrir ici une parenthèse. Quelques types curieux florirent dans cet illustre cabaret. Tel, le pianiste Albert Tinchant. Il n’était pas sobre, mais il était doux ; il faisait de petits vers tendres et langoureux, pas très bons. Pendant cinq ou six ans il vécut sans jamais avoir un sou dans sa poche, très heureux. Son incuriosité fut telle, ou sa pauvreté, qu’il ne trouva pas le moment, – ou le moyen, – d’aller, en 1889, voir l’Exposition. Le trait me semble rare. Tinchant mourut à l’hôpital. Il avait été autrefois, en rhétorique, un de mes meilleurs élèves. Jamais il ne me demanda rien, qu’une mention dans ma chronique dramatique. Celui-là était un bohème, un bohème authentique. Je suis bien fâché qu’il n’ait pas eu de génie.)
Vous avez vu tout ce que nous devons au Chat-Noir. Ce chat éclectique qui sut réconcilier la bourgeoisie et la bohème, forcer les gens du monde à payer, très cher, tant de bocks, et tantôt les attendrir sur des histoires pieuses, tantôt les scandaliser avec modération et leur donner l’illusion qu’ils s’encanaillent ; ce chat qui sut faire vivre ensemble le Caveau et la Légende dorée, ce chat socialiste et napoléonien, mystique et grivois, macabre et enclin à la romance, fut un chat « très parisien » et presque national. Il exprima à sa façon l’aimable désordre de nos esprits. Il nous donna des soirées vraiment drôles.
Nous prions les futurs historiens de la littérature de ne point refuser un salut amical à cet ingénieux descendant du Chat Botté. Comme son aïeul il connut plus d’un tour et valut à son maître un beau château.
Jules LEMAÎTRE.
We are told that the sultan Mahmoud by his perpetual wars…
SIR CORDON SONNET.
Par un phénomène bizarre d’association d’idées (assez commun aux jeunes hommes de mon époque), l’Exposition de 1889 me rappelle celle de 1878.
À cette époque, dix printemps de moins fleurissaient mon front. C’est effrayant ce qu’on vieillit entre deux Expositions universelles, surtout lorsqu’elles sont séparées par un laps considérable.
Ma bonne amie d’alors, une petite brunette à qui l’ecclésiastique le plus roublard aurait donné le bon Dieu sans confession (or une nuit d’orgie, pour elle, n’était qu’un jeu), me dit un jour à déjeuner :
– Qu’est-ce que tu vas faire, pour l’Exposition ?
– Que ferais-je bien pour l’Exposition ?
– Expose.
– Expose ?… Quoi ?
– N’importe quoi.
– Mais, je n’ai rien inventé !
(À ce moment, je n’avais pas encore inventé mon aquarium en verre dépoli, pour poissons timides, S.G.D.G.).
– Alors, reprit-elle, achète une baraque et montre un phénomène.
– Quel phénomène ?… Toi ?
Terrible, elle fronça son sourcil pour me répondre :
– Un phénomène, moi !
Et peut-être qu’elle allait me fiche des calottes, quand je m’écriai, sur un ton d’amoureuse conciliation :
– Oui, tu es un phénomène, chère âme ! Un phénomène de grâce, de charme et de fraîcheur !
Ce en quoi je ne mentais pas, car elle était bigrement gentille, ce petit chameau-là.
Un coquet nez, une bouche un peu grande (mais si bien meublée), des cheveux de soie innombrables et une de ces peaux tendrement blanc-rosées, comme seules en portent les dames qui se servent de crème.
Certes, je ne me serais pas jeté pour elle dans le bassin de la place Pigalle, mais je l’aimais bien tout de même.
Pour avoir la paix, je conclus :
– C’est bon ! puisque ça te fait plaisir, je montrerai un phénomène.
– Et moi je serai à la caisse ?
– Tu seras à la caisse.
– Si je me trompe en rendant la monnaie, tu ne me ficheras pas des coups ?
– Est-ce que je t’ai jamais fichu des coups ?
– Je n’ai jamais rendu de monnaie, alors je ne sais pas…
Si je rapporte ce dialogue tout au long, c’est pour donner à ma clientèle une idée des conversations que j’avais avec Eugénie (c’est peut-être Berthe qu’elle s’appelait).
Huit jours après, je recevais de Londres un nain, un joli petit nain.
Quand les nains anglais, chacun sait ça, se mêlent d’être petits, ils le sont à défier les plus puissants microscopes ; mais quand ils se mêlent d’être méchants, détail moins connu, ils le sont jusqu’à la témérité.
C’était le cas du mien. Oh ! la petite teigne !
Il me prit en grippe tout de suite, et sa seule préoccupation fut de me causer sans relâche de vifs déboires et des afflictions de toutes sortes.
Au moment de l’exhibition, il se haussait sur la pointe des pieds avec tant d’adresse, qu’il paraissait aussi grand que vous et moi.
Alors, quand mes amis me baguaient, disant : « Il n’est pas si épatant que ça, ton nain ! » et que je lui transmettais ces propos désobligeants, lui, cynique, me répondait en anglais :
– Qu’est-ce que vous voulez… il y a des jours où on n’est pas en train.
Un soir je rentrai chez moi deux heures plus tôt que ne semblait l’indiquer mon occupation de ce jour-là.
Devinez qui je trouvai, partageant la couche de Clara (je me rappelle maintenant, elle s’appelait Clara) !
Inutile de chercher, vous ne devineriez jamais.
Mon nain ! Oui, mesdames et messieurs, Clara me trompait avec ce british minuscule !
J’entrai dans une de ces colères !…
Heureusement pour le traître, je levai les bras au ciel avant de songer à le calotter. Il profita du temps que mes mains mirent à descendre jusqu’à sa hauteur pour filer.
Je ne le revis plus.
Quant à Clara, elle se tordait littéralement sous les couvertures.
– Il n’y a pas de quoi rire, fis-je sévèrement.
– Comment, pas de quoi rire ? Eh ben, qu’est-ce qu’il te faut à toi ?… Grosse bête, tu ne vas pas être jaloux d’un nain anglais ? C’était pour voir, voilà tout. Tu n’as pas idée…
Et elle se reprit à rire de plus belle, après quoi elle me donna quelques détails, réellement comiques, qui achevèrent de me désarmer.
C’est égal, dorénavant, je me méfiai des nains et, pour utiliser le local que j’avais loué, je me procurai un géant japonais.
Vous rappelez-vous le géant japonais de 1878 ? Eh bien ! c’est moi qui le montrais. Mon géant japonais ne ressemblait en rien à mon nain anglais.
D’une taille plus élevée, il était bon, serviable et chaste.
Ou, du moins, il semblait doué de ces qualités. J’ai raison de dire il semblait, car, à la suite de peu de jours, je fis une découverte qui me terrassa.
Un soir, rentrant inopinément dans la chambre de Camille (oui, c’est bien Camille, je me souviens), je trouvai, jonchant le sol, l’orientale défroque de mon géant, et dans le lit Camille… devinez avec qui !
Inutile de chercher, vous ne trouveriez jamais.
Camille, avec mon ancien nain !
C’était mon espèce de petit cochon de nain anglais, qui n’avait trouvé rien de mieux, pour rester près de Camille, que de se déguiser en géant japonais.
Cette aventure me dégoûta à tout jamais du métier de barnum.
C’est vers cette époque, qu’entièrement ruiné par les prodigalités de ma maîtresse, j’entrai en qualité de valet de chambre, 59, rue de Douai, chez un nommé Sarcey.
ALPHONSE ALLAIS.
Le jeune Labobine et moi nous ne faisions qu’un.
Nous faisions en même temps notre rhétorique.
Ou nous faisions semblant de la faire, – ce qui revient absolument au même.
C’est-à-dire que nous assistions irrégulièrement à des cours qui nous embêtaient crânement, – quoique nous concentrassions tous nos efforts à n’en pas entendre un seul mot.
Le plus souvent nous attrapions des mouches auxquelles nous rendions la liberté après leur avoir agrémenté l’orifice caudal d’un bout de papier arraché à un vague dictionnaire latin absolument destiné à cet usage.
Le vieux professeur avait coutume de dire en parlant de nous : « C’est des bons enfants, mais ils sont bigrement paresseux. » Et, de fait, on pouvait plutôt l’être moins que plus.
Nous goûtions médiocrement Cicéron, et Sénèque nous tapait sur le système (sic).
Nous n’avions qu’un regret, c’est qu’ils fussent morts, ce qui ôtait le plaisir de les tuer.
Or un jour, il faisait une chaleur tropicale encore aggravée par la lecture d’un magnifique discours de Cicéron. (Ce n’est pas moi qui le dis.)
Dans l’air bleu, les fenêtres étant ouvertes, tourbillonnaient des nuées de mouches.
Le jeune Labobine s’ingéniait à les attirer dans notre voisinage par le fallacieux appât de morceaux de sucre placés bien ostensiblement sur le coin d’une table surchargée d’inscriptions anti-universitaires.
Décrivant donc dans l’air, avec sa main prête à se refermer, la courbe usuelle que tous ceux dont le passe-temps consiste à attraper des mouches et plus particulièrement les pêcheurs à la ligne connaissent bien, il eut l’horrible le désappointement de rater sa quarante-deuxième victime.
Le professeur, qui surveillait ce manège depuis assez longtemps, se leva de sa chaire, rouge de colère, et cria :
– Est-ce que vous aurez bientôt fini d’attraper les mouches, monsieur ?
Labobine ne parut pas être frappé outre mesure de cette admonestation ridicule (c’est sa propre expression) et tranquillement, répondit :
Je ne l’ai pas attrapée, monsieur.
JULES DÉPAQUIT.
C’était un de nos plus redoutables bicyclistes, un de ces hommes pour qui parcourir des centaines de kilomètres sur les grandes routes avec un dur triangle de cuir entre les jambes, sans seulement regarder ce qui se passe autour de soi, est une âpre volupté. Il était marié depuis peu d’années et c’est au lendemain de sa lune de miel que cette étrange passion l’avait saisi tout entier. Il rêvait de gagner la course de bicycles qu’on ne pouvait manquer d’organiser un jour entre Paris et Pékin, et il s’entraînait avec fureur. Sa femme, qui l’aimait, souffrait un peu de se voir négliger pour le sport à la mode, mais aimait mieux, en réalité, qu’il courût les grandes routes que les cocottes.
Un matin, il se réveilla tout préoccupé. Ayant à peine mis son caleçon, il appela la bonne et lui demanda son bicycle d’appartement, un bicycle qu’il avait fait construire tout exprès pour s’exercer dans son salon.
– Mais tu es fou, mon chéri, lui dit sa femme. Tu n’attends-même plus d’être habillé maintenant !
– C’est qu’il m’est venu une idée, reprit-il. Je me demande s’il ne serait pas possible de rester chez soi sur un bicycle toute la journée, depuis le matin jusqu’au soir, et de vaquer à ses occupations ordinaires. On n’a jamais essayé cela. Si j’y réussissais je considérerais que c’est un tour de force supérieur à celui de la galerie des Machines.
Il n’en voulut pas démordre, quoique sa femme et sa bonne se moquassent de lui, et c’est au milieu de leurs éclats de rire qu’il commença de se vêtir, perché sur sa machine. Mais il était d’une admirable souplesse et le bicycle n’avait plus de mystères pour lui. Il parvint à passer son pantalon et à mettre ses bretelles, puis toujours maniant l’instrument avec une adresse inouïe, il se dirigea vers le cabinet de toilette, et se lava et se peigna suffisamment. Ensuite il lut les journaux et son courrier, et écrivit des lettres jusqu’à midi, sans qu’il lui arrivât le moindre accroc. Madame était émerveillée ; ses railleries avaient fait place à une vive curiosité et elle ne quittait pas de l’œil son époux.
Quant à la bonne, elle était allée raconter l’histoire dans le quartier, et les voisins venaient tous les quarts d’heure, palpitants, prendre des nouvelles chez le concierge.
Il déjeuna en bicycle de la façon la plus naturelle, fuma son cigare et lut des romans dans l’après-midi ; il reçut aussi des fournisseurs et quelques visites dans cette posture. La journée passa comme un songe. Le repas fut très gai. Madame se mit au piano et lui chanta ses airs favoris. À minuit, dernière minute de l’épreuve, il lança son bicycle dans la chambre à coucher.
– Tu as gagné, mon ami. Tu peux descendre.
Il la regarda tendrement :
– Pas encore.
Et il la saisit de son bras gauche et l’embrassa. Alors, il lui parla dans l’oreille :
– Quoi ? mon chéri, fit-elle en éclatant de rire, tu prétendrais…
– Oui, murmura-t-il. Je suis sûr que c’est possible.
Les femmes ont des trésors d’indulgence pour les fantaisies de l’homme aimé. Elle satisfit celle-là avec de véritables merveilles de patience et d’ingéniosité. Et il s’écria, triomphant, en sautant de son bicycle :
– Je suis le premier qui ait établi ce record-là.
ALFRED CAPUS.
I
II
III
IV
MAURICE VAUCAIRE
À Léopold Dauphin.
Je suis allé à Londres quand j’étais grand, mais maintenant je vais chez le pharmacien me faire arracher les cheveux.
(MIMILE.)
– Comment, monsieur le comte, s’écria l’intendant, après cinquante années de lutte, vous abandonnez la partie ? Au moment où tous les atouts sont entre vos mains, vous jetez les cartes ! C’est de la folie !
– Oui, Hans Hinckseck, répondit le comte Pascal Gigault d’Agnel, en souriant tristement, j’en ai assez. C’est que, voyez-vous, la situation n’est plus la même. À la mort de la comtesse, j’avais vingt ans, l’âge des illusions ; aujourd’hui, j’en ai soixante-dix ! Vous-même, lorsque je vous pris à mon service, étiez un jeune homme ; maintenant vous êtes un vieillard. Je passais à Amsterdam ; à la suite de malheurs immérités, vous veniez de perdre votre fortune. Sur ces entrefaites, votre femme – la plus jolie femme de la ville, celle que l’on appelait partout la belle Hans Hinckseck – vous trompa avec un enseigne…
L’intendant fit un geste.
– Oui, continua le comte, j’évoque des souvenirs pénibles, mais cela est nécessaire à la clarté du récit. Votre femme vous trompait donc avec un enseigne. J’appris l’incident et, sans hésiter, je châtiai le drôle. Vous me jurâtes un éternel dévouement et, de ce jour, votre affection pour moi ne s’est pas démentie un seul instant. Cela, je le sais, et je sais aussi que vous vous jetteriez au feu pour moi et pour ceux de ma maison. Mais, croyez-moi, tout est bien fini maintenant, je sens mes forces s’en aller de jour en jour et…
– C’est impossible, répliqua brusquement l’intendant. Il serait criminel d’abandonner la petite Madeleine à ses bourreaux ! Ces gens-là sont capables de tout. Hâtez-vous, ou ils ne tarderont pas à reprendre le dessus. Pauvre Madeleine, si douce, si candide !
– Elle boit ! dit sèchement le comte. D’ailleurs, c’est le vivant portrait, avec tous ses vices, de ma défunte femme !…
En prononçant ces derniers mots, le comte se signa dévotement !…
– Mais, laisserez-vous protester les billets ?… insista Hans Hinckseck.
Et comme son maître semblait fléchir :
– Allons, un peu de courage, monsieur le comte. Suivez-moi, et dans quelques minutes les papiers du cardinal seront en votre possession !
Le comte Pascal Gigault d’Agnel saisit un flambeau et résolument se dirigea vers la porte…
Du couloir qui contournait l’aile droite du château, on montait, par un étroit escalier en colimaçon, jusqu’aux chambres des domestiques.
– Ce couloir conduit au souterrain, dit l’intendant en prenant le flambeau des mains de son maître.
– Un souterrain sous les combles ? interrogea le comte, incrédule…
L’intendant allait répondre, lorsqu’un bruit léger se fit entendre, Hans Hinckseck posa la main sur le bras du comte et appliqua l’oreille sur le parquet… Quelques minutes s’écoulèrent… Le bruit ayant cessé, les deux hommes, rassurés, continuèrent d’avancer.
– Patience ! dit encore l’intendant, nous arrivons.
Et, subitement, une bouffée d’air humide vint les frapper en plein visage.
Presque simultanément le comte heurtait du pied un corps dur. En levant les yeux, il aperçut un escalier monumental.
– Encore ces cent trente marches à monter, dit Hans Hinckseck, et nous toucherons au but. Du courage ; monsieur le comte !…
– J’en ai ! répondit simplement le comte Pascal Gigault d’Agnel.
Si les souvenirs de l’intendant étaient fidèles, les dernières marches de l’escalier monumental devaient aboutir à un palier sur lequel donnait l’entrée du souterrain.
Le souterrain était fermé par une solide porte de fer dont un ressort puissant faisait jouer le pêne.
L’on se trouvait alors en face d’une seconde porte, puis d’une troisième, d’une quatrième, etc.
Le souterrain avait huit portes.
La huitième s’ouvrait sur une neuvième porte, laquelle fermait définitivement l’entrée du souterrain.
Les deux hommes franchirent les derniers degrés de l’escalier ; en arrivant sur le palier, l’intendant poussa un cri de surprise…
L’entrée du souterrain n’était pas libre ; il y avait quelqu’un !
Un génie de bronze aux ailes éployées, gigantesque, barrait l’accès de la première porte.
– Damnation ! nous sommes joués ! hurla Hans Hinckseck.
Puis, plus calme, il ajouta :
– Il ne faut pas que cette misérable statue nous arrête ; si j’avais votre carrure, monsieur le comte, j’aurais déjà enlevé d’un coup d’épaule ce bronze insolent !
– Y penses-tu ?… Ce génie pèse plusieurs centaines de kilos !
– Essayez toujours. D’ailleurs, vous avez fait plus fort que cela. Rappelez-vous ce jour où vous emportâtes un cheval blessé sur vos épaules ! Ah ! pourquoi ne suis-je qu’un chétif avorton ?…
– J’essaierai donc, répondit le comte ; mais c’est uniquement pour te faire plaisir.
Et, raidissant tous ses muscles dans un effort désespéré, le comte saisit la statue…
Sous l’apparence du bronze le plus authentique, la statue – véritable chef-d’œuvre de l’industrie moderne – était simplement en zinc repoussé.
Le fardeau était si léger et l’élan qu’il avait cru devoir prendre tellement irrésistible, que le vieux gentilhomme chancela, perdit l’équilibre et, se renversant en arrière, disparut dans les profondeurs de l’escalier.
On entendit le corps rouler de marche en marche, puis le bruit sourd d’une chute.
Alors Hans Hinckseck se redressa et ricana haineusement :
– Un de plus !… Encore dix-sept !… J’aurai juste le temps avant déjeuner !…
Au pied de l’escalier de pierre, le comte Pascal Gigault d’Agnel s’était relevé, légèrement contusionné. Après avoir lancé par trois fois le cri de la chouette et consulté sa carte d’état-major, il s’enfonça dans les ténèbres.
Le train 117 venant de Lyon entra en gare à 7 heures 45 du soir, avec huit minutes de retard.
Hans Hinckseck sauta de wagon, traversa les salles rapidement et répondit aux douaniers qu’il n’avait rien à déclarer.
Dehors, il héla un fiacre et se fit conduire à l’Hôtel des Trois-Hémisphères, rue des Martyrs.
Chemin faisant, l’intendant répara le désordre de sa toilette. Il ajusta une barbe blonde à son menton naturellement imberbe, mit des lunettes roses et rabattit les bords de sa casquette fourrée. Ainsi transformé, Hans Hinckseck était méconnaissable…
Le fiacre, après avoir traversé un dédale inextricable de ruelles étroites, gravit le raidillon de la rue des Martyrs, dépassa le Cirque Fernando, et s’arrêta enfin devant une haute construction d’aspect imposant.
Sous le péristyle orné de colonnes de marbre, une armée de majordomes en frac guettait l’arrivée des voyageurs.