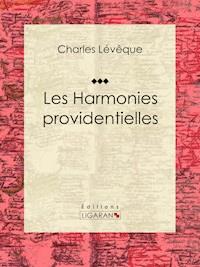
Extrait : "Le spectacle des corps célestes brillant dans un ciel pur est un objet d'admiration pour les hommes. Sans être ni astronome ni philosophe ni poète ; on sent, on juge qu'une nuit étoilée est une belle nuit, et l'on se plaît à contempler au sein des espaces immenses le calme rayonnement des astres lointains. Cette admiration que le scepticisme lui-même ne réussit pas à détruire, cette jouissance qu'un peu d'attention ramène et ravive, d'où viennent-elles ?"
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 405
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335043068
©Ligaran 2015
À Μ. ÉDOUARD CHARTON
CORRESPONDANT DE L’INSTITUT DE FRANCE, DÉPUTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Mon cher ami,
Acceptez, je vous prie, la dédicace de ce livre. C’est vous qui m’avez engagé à l’entreprendre et décidé à le terminer. Quels qu’en soient la valeur et le succès, je vous devrai de m’avoir imposé, par votre insistance à la fois douce et irrésistible, l’accomplissement de l’un des devoirs les plus urgents du philosophe en ces jours de crise intellectuelle.
J’avais commencé, cet ouvrage en 1867 ; je ne l’achève qu’en 1872. Pourquoi ce retard ? Vous en connaissez les causes. Je ne vous en rappellerai que deux, parce que celles-là, même à une époque de paix et de calme, auraient suffi pour me faire procéder avec lenteur.
J’étais résolu, en abordant ce sujet, à renouveler, autant qu’il était en moi, la démonstration de la Providence divine et, en même temps, à la rendre accessible à tous les esprits dont vous m’aviez vous-même proposé le type. Ce type, c’était un jeune ouvrier de seize ans, ayant reçu une bonne instruction primaire. Il n’était pas facile de remplir ces deux conditions. J’ai cru cependant que ce n’était pas impossible, pourvu que je ne fusse avare ni de mon temps, ni de mes soins.
On ne peut aujourd’hui répéter la démonstration de la Providence sans essayer de la mettre en rapport avec l’état présent des esprits. Quand une vérité aussi éclatante que celle de l’existence et de la bonté de Dieu ne frappe plus aussi fortement qu’autrefois toutes les intelligences, ce n’est nullement qu’elle ait cessé d’être vraie ; c’est que l’heure est venue de la présenter sous un jour quelque peu nouveau. Un de nos maîtres les plus chers l’a dit en termes pleins d’autorité et de vive éloquence :
« L’antique vérité doit être sans cesse redite, sans cesse accommodée aux nouveaux besoins, aux infirmités, nouvelles de l’humanité, sans cesse retournée sous toutes ses faces, repourvue de toutes ses armes, justifiée par de nouvelles expériences, par de nouvelles découvertes. »
Je me suis pénétré de ces préceptes. En redisant l’antique vérité, j’ai tenté de l’accommoder aux nouveaux besoins de la raison humaine. De ces besoins intellectuels, le plus évident, le plus impérieux est de faire cadrer la croyance avec la science. Croire à rencontre de ce que l’on sait ; savoir à l’encontre de ce que l’on croit, c’est un supplice et une cause de perturbation morale. Quand on enseigne d’une part à des esprits à peine instruits que Dieu a créé le monde et qu’il l’a organisé avec une sagesse infinie, et que d’autre part certains savants leur crient chaque jour que Dieu n’est qu’une hypothèse surannée et inutile, quel embarras pour des âmes honnêtes, et comment en sortir ? Depuis douze ans, j’étudie les sciences en vue de les concilier avec la philosophie. Je me suis convaincu que, bien loin d’ébranler ou seulement d’obscurcir la notion du Dieu-Providence, la science moderne, la science, la plus récente consolide et éclaircit cette notion. Partant de là, j’ai rassemblé et coordonné les faits les plus certains, les plus frappants, les plus nouveaux et j’en ai formé la base de ce travail. J’en aurais produit bien davantage, s’il n’avait fallu se borner et choisir ; car ceux que j’ai omis ne sont pas moins concluants que ceux que je cite.
Tous ces faits se rattachent les uns aux autres par des rapports tantôt prochains, tantôt lointains, toujours réguliers ou régulièrement variables. Ainsi liés, ils composent un fait général, immense, merveilleux : l’unité, harmonieuse du monde. Cette harmonie, les savants la reconnaissent ; ils la proclament même alors qu’ils ne vont pas au-delà, ou même alors qu’ils en méconnaissent la cause. Mais la conclusion est forcée : elle s’impose à la raison. Il n’y a pas un seul être qui ne soit en relation avec le tout, qui ne se compose avec l’ensemble.
Pour mettre chaque être en harmonie avec lui-même et avec le tout, il a fallu un esprit capable de tout concevoir, de tout embrasser, de tout créer, de tout ordonner. Ainsi nul être particulier n’est à lui-même sa cause, car pour qu’il fût sa cause à lui-même, il serait nécessaire qu’il fût la cause de tout. L’unité harmonieuse du monde proclame une cause unique et supérieure au monde.
C’était là le premier point à rétablir, et, s’il se pouvait, à renouveler. Afin d’y réussir de mon mieux, j’ai mis au pillage la science de tous les pays. Disons mieux et davantage : c’est la science qui seule a la parole dans les cinq premiers chapitres de ce volume : Elle dicte, j’écris ; elle démontre, je n’ai qu’à conclure.
Je cite beaucoup de noms illustres et de travaux considérables. Mais je n’ai pu toujours citer : les notes auraient étouffé le texte. Je veux du moins nommer ici ceux de mes confrères et collègues, qui m’ont été le plus utiles. Ce sont MM. Faye, Delaunay, Puiseux ; – MM. Würtz, Berthelot, Henri Sainte-Claire Deville ; – MM. Claude Bernard, Milne-Edwards, E. Blanchard, de Quatrefages, Ernest Faivre. J’ai aussi fait de larges emprunts aux savants étrangers, notamment à MM. Secchi, Carpenter, van Beneden, Henri Helmholtz, et surtout à Μ. Louis Agassiz. J’ajoute, afin de n’engager personne, que je ne leur ai demandé que des faits et des lois. Or c’est là une richesse qui appartient à tout le monde, même au philosophe. J’ai pris ce bien à pleines mains partout où je l’ai rencontré.
Les sciences morales, sociales, politiques, m’ont fourni leur concours nécessaire. Sans elles, et malgré l’appui des sciences physiques et naturelles, je serais resté à moitié chemin.
En effet, l’harmonie du monde embrasse à la fois l’univers physique et l’univers moral. On doit étudier ces deux univers, si l’on veut comprendre, selon la mesure des forces humaines, l’harmonie du tout.
D’ailleurs, si l’argument tiré de l’ordre et de l’harmonie de la création prouve une cause supérieure à l’univers et immensément plus grande que la totalité même des êtres, cet argument ne démontre pas l’existence de la cause infinie en perfection.
C’est la présence dans notre raison de l’idée du parfait qui prouve la cause parfaite. L’argument cosmologique, comme on le nomme, prépare l’esprit à concevoir, puis à affirmer la cause parfaite. C’est l’idée du parfait et l’harmonie qui existe entre cette idée et son objet qui achève et couronne le travail religieux de la raison.
Ici encore, je me suis applique à rajeunir un peu l’antique vérité.
Le second point était de se rendre, très accessible, facilement intelligible. J’ai donc écarté les arguments qui, dans un livre tel que celui-ci, eussent été en quelque sorte de luxe. Au surplus, je pense, comme le maître que je citais plus haut, que toutes les preuves de l’existence de Dieu se ramènent à deux, et qu’on peut les exprimer ainsi : « L’ordre du monde prouve une cause intelligente. L’idée de Dieu dans l’esprit humain prouve son objet. » C’est à ces deux preuves que je m’en suis tenu.
Afin de les rendre bien claires, j’ai fait ce que j’ai pu : j’ai pris pour moi presque toute la peine. Je dis presque toute, car enfin faut-il encore que le lecteur consente au moins à lire avec attention. Il est un niveau au-dessous duquel la science, même la plus élémentaire, ne saurait descendre. On ne fait grandir personne en l’abaissant. « La vérité, – a dit Bossuet, – est semblable aux eaux des fontaines publiques que l’on élève pour les mieux répandre. »
Il n’est pas permis non plus d’aplatir, encore moins d’estropier la langue, sous prétexte de vulgariser les connaissances et les idées. La règle est peut-être celle-ci : pas de technicité inutile ; l’honnête langage français, sans platitude ni enflure. Le style sans-gêne, avec ses allures débraillées, humilie souvent ceux qu’il vise à flatter et qui sont blessés qu’on les traite comme une espèce inférieure. En outre, il fausse le goût, qui tient de si près à la conscience morale. Quant à l’emphase, elle fait pulluler les déclamateurs, dont on a assez. La vérité n’a que faire des haillons dont l’affublent les uns ni des costumes de théâtre dont la chargent certains autres. Son vêtement naturel lui suffit, et ce vêtement c’est la lumière.
Vous ne trouverez point ici de polémique. Notre cadre n’en admettait pas. Pour ceux auxquels nous parlons, il n’y a pas lieu de discuter les grandes erreurs de la métaphysique transcendante. Il en est une cependant qu’il fallait combattre parce qu’elle se fait populaire aujourd’hui. Elle est réfutée dans ces pages, mais beaucoup moins par des procédés de dialectique que par la démonstration directe de la vérité contraire. J’ai dû cependant consacrer un long chapitre aux difficultés que soulève le problème de la Providence, parce que ces difficultés sont de tous les jours et naissent tôt ou tard dans tous les esprits.
Je vous donne ces explications, mon cher ami, pour que vous sachiez à quel point j’ai pris à cœur la lâche que vous m’aviez confiée. Maintenant, je souhaite à mon livre de faire aux jeunes âmes françaises un peu de ce bien que vous n’avez cessé de leur faire vous-même pendant tout le cours de votre vie.
Je vous serre la main.
CH. LÉVÊQUE.
Bellevue-sous-Meudon, 19 octobre 1872
Le spectacle des corps célestes brillant dans un ciel pur est un objet d’admiration pour tous les hommes. Sans être ni astronome ni philosophe ni poète, on sent, on juge qu’une nuit étoilée est une belle nuit, et l’on se plaît à contempler au sein des espaces immenses le calme rayonnement des astres lointains. Cette admiration que le scepticisme lui-même ne réussit pas à détruire, cette jouissance qu’un peu d’attention ramène et ravive, d’où viennent-elles ? Le sens commun en soupçonne à peine les causes ; une science imparfaite voit trop souvent ces causes où elles ne sont pas, et ne les aperçoit pas toujours où elles sont ; une science plus avancée les met en évidence, même sans le vouloir, en décrivant ces mondes supérieurs dont elle n’aurait pas un mot à dire si l’ordre qui y règne ne les rendait jusqu’à un certain point intelligibles. L’unité, en effet, s’y marie à la diversité avec une merveilleuse harmonie. Cette harmonie est essentiellement ce qu’on appelle l’ordre. Pour saisir dans la réalité même et à leur place quelques-uns des grands traits qui dessinent l’unité d’où l’univers a tiré son nom, considérons d’abord la prodigieuse multiplicité des corps semés dans l’étendue.
Cette multiplicité accable l’intelligence ; elle déborde les nombres où l’on essaye de l’enfermer. Pour la compter il faudrait une arithmétique gigantesque qui n’est point à l’usage de notre entendement. La profondeur de la couche stellaire, selon le R.P. Secchi, est réellement insondable. Il est probable que la réunion des grandes étoiles qui environnent notre soleil, n’est qu’un des vastes amas qui forment la voie lactée et que, vu d’une certaine distance, ce groupe d’astres apparaîtrait seulement comme une tache plus blanche dans la voie lactée elle-même. En arrivant à cette limite, on sent que l’imagination est confondue. En vain tenterions-nous d’entasser comparaison sur comparaison et d’accumuler métaphore sur métaphore pour donner une idée « de cette sphère infinie dont le centre est partout et la circonférence nulle part. » Multipliez les chiffres, répétez indéfiniment les zéros, invoquez les signes puissamment abréviatifs de l’algèbre, l’abîme restera sans mesure comme sans rives et sans fond. D’ailleurs à la quantité numériquement inexprimable des astres se joint la bizarrerie des dispositions, l’étrangeté des groupements, les rapprochements fantastiques, les éloignements arbitraires qui semblent, au premier aspect, fournir un argument à l’appui de l’existence du hasard.
Et pourtant la science s’oriente dans ce dédale. Elle en suit les détours, en trace les méandres. Bien plus, elle en dresse la carte. Cette carte, je le sais, est chaque jour modifiée ; jamais les géographes du ciel n’auront fini d’y apporter des changements et d’y marquer des régions nouvelles. Néanmoins tout n’y varie pas. Plus d’un point y reste fixe. Le travail du lendemain, loin de toujours démentir celui de la veille, l’a souvent confirmé. Que dis-je ? on a pu sans folie concevoir le dessein de dénombrer l’innombrable. Les deux Herschell ont entrepris d’énumérer les étoiles, ils ont sondé, ou pour parler leur langage, jaugé (star gauges) la profondeur des cieux. Et quoique le nombre d’étoiles compris dans chaque sonde soit très variable, on a pu y surprendre et y déterminer une loi de continuité. D’où viennent donc ces possibilités que découvre le savant d’appliquer jusqu’à un certain point au ciel l’évaluation géométrique des surfaces et des volumes ? Comment n’est-ce point de la déraison de prétendre arpenter l’étendue indéfinie ? Si une main invisible déplaçait chaque nuit les bornes d’un champ, le mesurage en serait impraticable. De même, si chaque étoile sautait à chaque instant du nord au sud, de l’ouest à l’est, il n’y aurait plus de constellations, plus de points de repère, partant plus d’astronomie. Malgré d’incontestables variations, tantôt visibles, tantôt invisibles mais démontrées, il y a dans le ciel des jalons relativement fixes ; il y a des rapports de distance, un dessin constant dans sa mobilité, un plan stable en ses limites élastiques. Tout se meut à travers ces plaines éthérées, nous le dirons plus bas ; pourtant, quelle que soit cette mutabilité universelle, c’est une seule même grande Ourse, un même Orion, un même Bélier, un même Scorpion, un même Soleil enfin, avec son cortège de planètes, que voyait il y a deux mille ans Hipparque et que nous voyons encore aujourd’hui. De là une première espèce d’unité imposée à la multiplicité des mondes et un premier élément d’ordre dans la constitution de l’univers.
Cependant, sans la lumière, ces constellations qui partagent le ciel en régions et en provinces seraient pour nous comme n’existant pas. La lumière est la magicienne incomparable qui, chaque soir, évoque ces scintillantes apparitions. Or cet agent mystérieux et puissant, cette lumière a, elle aussi, sa diversité soumise à l’unité, son harmonie, ses lois, son ordre enfin.
Envisagés par rapport à leur puissance lumineuse, les astres ont entre eux de nombreuses différences. La différence d’éclat, qui est la plus facile à constater, est très importante, car elle sert à classer les astres d’après leurs apparentes dimensions qu’il ne faut pas confondre avec leur grandeur réelle. On peut se former une idée de cette diversité d’intensité lumineuse d’après les chiffres suivants. On a compté dans les deux hémisphères, 18 étoiles de première grandeur, 60 de la seconde, 200 environ de la troisième ; il y en a 500 de la quatrième grandeur, 1 400 de la cinquième et 4 000 de la sixième. Au-delà, notre vue est impuissante et il faut recourir au télescope. À mesure qu’on avance, la progression numérique s’accroît rapidement. D’après Arago, il faudrait compter 9 566 000 étoiles de la treizième grandeur ; 28 697 000 de la quatorzième, et évaluer à 47 millions le nombre total des étoiles de toute grandeur visibles jusqu’à la quatorzième. En admettant seize grandeur, Lalande, Delambre et Francœur reconnaissaient un nombre total d’à peu près 75 millions d’étoiles visibles ; et d’autres astronomes ont élevé ce nombre jusqu’à 100 millions.
À la différence d’éclat s’en ajoute une autre. Les astres ne sont pas tous les foyers de leur propre lumière. Les soleils brillent par eux-mêmes : les planètes et leurs satellites n’ont qu’une lumière empruntée. Les étoiles du ciel sont autant de soleils ayant leur éclat propre et il y en a qui sont plus grands et plus radieux que l’astre principal de notre système. On voit par là que notre soleil est bien loin d’être, comme on le pensait autrefois, la source de la lumière universelle. Vu de la distance qui nous sépare de Sirius, il tomberait au rang d’une étoile de troisième grandeur. Quel flambeau cependant, et que de degrés entre le feu de cette masse incandescente et la faible clarté que répand le satellite de la terre !
La coloration des astres a aussi sa diversité. Sirius est une étoile blanche, il y en a qui sont orangées ou jaunes ou rouges, d’autres paraissent bleues ou vertes ou pourprées. L’un des soleils de Gamma du Lion est jaune d’or, l’autre vert rougeâtre. Bêta du Cygne se dédouble en deux compagnons dont l’un est jaune, l’autre bleu de saphir. Gamma d’Andromède se compose de trois astres, l’un d’un orangé splendide, les deux autres d’un magnifique vert d’émeraude.
Ce n’est pas tout : dans une même étoile, l’intensité, de l’éclat et la couleur subissent soit insensiblement, soit tout à coup des variations plus ou moins considérables qui multiplient encore leurs diversités déjà si nombreuses. L’astronomie a vu diminuer l’ancien éclat de certaines étoiles. Plus d’un siècle avant J.-C., Hipparque notait comme très belle l’étoile du pied de devant du Bélier ; cet astre est aujourd’hui descendu à la quatrième grandeur. L’Alpha de la grande Ourse, qui a été de première grandeur, n’est plus qu’au deuxième rang. Sans perdre de leur éclat, d’autres étoiles ont changé de couleur : tel Sirius qui depuis l’antiquité a passé du rouge vif au blanc pur. D’autres se sont éteintes si complètement qu’il n’en reste aucun vestige ; dans la constellation du Taureau, la neuvième et la dixième étoile ont disparu. Pendant l’année 1782, l’astronome Slough vit, en six mois, agoniser et mourir la cinquante-cinquième d’Hercule qui de rouge devint pâle et finit par s’évanouir. Inversement, il y a des astres dont la lumière croît en intensité, témoin la trente-huitième de Persée qui est montée de la seizième grandeur à la quatrième. L’éclat de certaines autres reçoit un accroissement et un décroissement alternatifs, mais contenus dans des limites fixes, ainsi le Chi (χ) du Col du Cygne oscille entre la cinquième et la onzième grandeur dans une période de treize mois et demi. La trentième étoile de l’Hydre d’Hévélius va, en cinq cents jours, de la quatrième grandeur à l’extinction. Quelques étoiles ont eu une apparition soudaine ; puis, après avoir jeté un éclat resplendissant, elles sont tombées dans les ténèbres pour n’en plus sortir. Par exemple, en 1572, trois mois environ après, la Saint-Barthélemy, un astre éblouissant s’ajouta à la constellation de Cassiopée. Il fit pâlir Jupiter, Véga et Sirius lui-même : pendant les premiers jours de sa présence, on put l’apercevoir en plein midi. Peu à peu cependant il atténua sa lumière et, s’effaçant de degré en degré, il disparut après avoir rempli le monde d’épouvantes superstitieuses. Plus intéressante encore fut l’étoile du Renard qui se montra inopinément en 1604 et disparut bientôt. Avant de s’évanouir, semblable à une lampe dont l’huile est consumée, elle affaiblit et ranima plusieurs fois ses mourantes flammes.
Ces singularités astronomiques échappent à l’ignorance ou l’effrayent. Une science timide s’en embarrasse, elle les dissimule parfois, souvent elles les néglige de peur de déranger d’anciennes idées. La science sérieuse les regarde en face, elle avoue sincèrement, quand il y a lieu, qu’elle n’a pas encore découvert toutes les lois qui imposent l’unité à ces diversités, la règle à ces exceptions, l’harmonie à ces apparentes dissonances. Mais elle se souvient et elle rappelle à qui l’aurait oublié qu’elle a déjà posé quelques-unes de ces lois, et que celles-ci sont si vastes, si belles, si constantes que l’existence des autres, est assurée, comme la connaissance ultérieure en est certaine.
Si l’on regarde l’ensemble du ciel, la première pensée qui se présente naturellement à l’esprit, c’est que dans ces espaces sans bornes où roulent les astres, la nuit est l’accident, tandis que la lumière est la chose permanente et universelle. À travers l’immensité, elle tend ses fils d’or qui rattachent les astres les uns aux autres. Ainsi reliés entre eux, éclairant et éclairés, et, qui sait ? peut-être voyant et vus, ils composent un tout qui a son unité lumineuse. Cependant, plus une encore, dans son essence et dans la constante identité de ses mouvements, est cette lumière qui jaillit du sein des soleils.
Quand on fait passer la lumière du soleil à travers un prisme de verre à section triangulaire, elle se décompose en sept espèces distinctes de rayons qui donnent sept couleurs différentes, rangées dans l’ordre suivant : violet, indigo, bleu, vert, jaune, orangé, rouge. La lumière solaire garde invariablement cette composition essentielle. Puisez, si vous voulez, un faisceau de rayons non plus à cette source, mais au foyer des planètes qui réfléchissent la lumière du soleil, vous n’y distinguerez que les mêmes éléments. Prenez maintenant au hasard dans les espaces célestes tels rayons qu’il vous plaira, et soumettez-les à l’analyse, ils ne fourniront jamais une huitième couleur autre que les sept couleurs fondamentales qui forment le spectre du soleil.
Mais comment donc Newton a-t-il pu diviser la lumière et la contraindre à se résoudre en ses éléments irréductibles ? C’est grâce à une loi remarquable. Si la lumière solaire traverse un prisme à section triangulaire, les rayons de chaque couleur se réfractent selon des angles constants, d’abord au point où ils pénètrent dans le corps transparent, puis au point où ils en sortent. En vertu de cette loi, les couleurs du spectre conservent sans changement leurs positions respectives. Même constance, même régularité dans la loi de la réflexion. Quand, au lieu de rencontrer un corps qui l’absorbe ou qui se laisse traverser par lui un rayon lumineux frappe une surface qui le repousse, l’angle sous lequel il atteint ce plan est égal à celui qu’il fait avec ce même plan en revenant en arrière. Et cette dernière loi de la lumière en multiplie à l’infini la puissance et les effets.
La lumière marche ; donc elle se meut, et en dehors des cas de réfraction, elle se meut en ligne droite, soit à la façon d’une substance lancée en avant par le foyer lumineux, comme le pensait Newton, soit plutôt à la façon d’un ébranlement transmis rapidement, d’une ondulation promptement propagée de proche en proche, comme on le soutient depuis Fresnel. Ainsi la lumière a sa marche et sa vitesse, et cette vitesse n’est point tantôt lente, tantôt prompte, tantôt intermittente : elle demeure à chaque moment identique à elle-même et mathématiquement uniforme. Tout impalpable, tout mobile et subtil qu’il soit, cet agent obéit à l’ordre, il se maintient dans des voies inflexibles : aussi a-t-on pu compter le nombre des pas dont il avance en une même unité de temps. Struve avait calculé que la vitesse de la lumière était de 507 794 kilomètres, soit près de 77 000 lieues par seconde. Au moyen de miroirs rotatifs, M. Fizeau a réussi à mesurer cette vitesse à la surface même de la terre, il a obtenu le chiffre 314 840 kilomètres, soit plus de 78 000 lieues par seconde. Enfin un expérimentateur éminent, récemment enlevé à la science et à l’Institut, M. Foucault, en employant un ensemble d’appareils rotatifs ; a cru pouvoir affirmer que la lumière parcourt 298 000 kilomètres, soit 74 000 lieues et demie par seconde. Et telle était la délicatesse de ses instruments qu’il estimait ne s’être pas trompé de 500 kilomètres. La lumière céleste a donc sa chronométrie. D’où qu’elle vienne, que ce soit de Sirius, du Centaure ou de l’étoile Polaire, la lumière franchit la même distance dans le même temps. À raison de l’ancien chiffre, désormais reconnu trop bas, de 70 000 lieues par seconde, un rayon lumineux met trois ans et huit mois à venir de l’Alpha du Centaure jusqu’à nous. Pour nous arriver de Véga, il emploie douze ans et demi ; de l’étoile polaire trente et un ans ; de la Chèvre, soixante-douze ans ; il est vrai que la Chèvre est à 170 trillions de lieues de la terre. À travers les immensités du temps et de l’espace, la lumière suit sa course, garde son pas, reste dans l’ordre qui est le sien. Si l’éblouissant Sirius s’évanouissait à l’instant même, sa lumière lancée en avant poursuivrait son chemin, et, dans vingt-deux ans, les habitants de la Terre verraient encore briller dans le ciel, à sa place, l’astre depuis vingt-deux ans éteint.
La forme des astres manifeste avec une évidence particulière l’unité du plan qui règle l’architecture de l’univers. La rondeur des principales planètes de notre système et celle du soleil, dont elles dépendent, est un fait constaté par l’observation directe. Pour les étoiles très éloignées, les instruments les plus grossissants ne permettent jamais de les voir sous la forme d’un disque, mais seulement comme des points lumineux. En augmentant la puissance des télescopes, on n’obtient qu’un accroissement dans l’intensité de la lumière. La science n’en est pas moins certaine de la rondeur des corps célestes, de ceux du moins qui ne sont ni des comètes ni des amas flottants de matière cosmique. Elle est pareillement sûre que ces sphères, mues autour d’un axe, sont toutes aplaties à leurs pôles. Il est impossible de ne pas remarquer que cette forme sphérique, si une et si simple en elle-même, est aussi celle qui se prête au plus grand nombre de relations harmonieuses entre les différents astres. Un corps sphérique incandescent rayonne sa chaleur dans tous les sens à la fois ; et s’il occupe le centre d’un système, il n’est pas un lieu, pas un astre de ce système qui ne reçoive une part de cette chaleur. Il épanche sa lumière avec la même égalité, mais en la lançant à des distances énormément plus grandes dans toutes les directions de l’étendue ; en sorte que son existence est connue partout où ses rayons parviennent et trouvent des yeux pour les apercevoir. De leur côté, grâce à leur forme sphérique, les planètes et les lunes qui les accompagnent, tournant autour du centre brûlant et lumineux, présentent successivement les régions diverses de leurs surfaces à l’action du foyer qui les réchauffe et les éclaire à la fois. On comprend que ni des cylindres, ni des cônes tronqués ou non, ni des polyèdres réguliers à surfaces planes, fussent-ils semblables, ne pourraient soutenir entre eux un aussi grand nombre de rapports. L’harmonie se trahit ici non seulement dans la similitude des formes astronomiques, mais encore et surtout dans la richesse et dans la beauté des conséquences qui en résultent.
Les similitudes extérieures des astres enveloppent des analogies intimes, comme, chez les enfants d’une même famille, à la ressemblance fraternelle répondent de secrètes conformités physiologiques. Il s’en faut que la matière dont se composent les astres, quoique diverse, soit spécifiquement et absolument différente dans chacun d’entre eux. Au contraire ; à mesure que la science connaît mieux la substance des sphères sidérales, elle voit s’allonger la liste des propriétés physiques et même celle des corps simples qui se rencontrent et dans ces globes et dans le nôtre. Le philosophe Anaxagore prétendait que le soleil était non un dieu, mais une pierre, et ce trait d’audace lui coûta cher. On enseigne aujourd’hui sans péril et sans contradiction que les astres sont choses volumineuses, pesantes, denses, tantôt solides, tantôt gazeuses, semblables en ces points à la matière d’ici-bas. Ce n’est pas tout ; on en sait un peu plus long. Des fragments de corps célestes brisés ont traversé l’étendue et sont tombés sur notre terre. Soumis à l’analyse chimique, ils ont fait voir qu’ils étaient formés de nickel, de fer, de manganèse, de cobalt, de cuivre et d’autres métaux et métalloïdes représentant à peu près le tiers des substances que la science a jusqu’ici distinguées dans la pâte du globe terrestre. Mais ces premières indications devaient recevoir de la science actuelle la confirmation la plus éclatante et la plus inattendue.
On eût bien étonné nos pères en leur prédisant, entre autres merveilles prochaines, qu’un jour viendrait où l’œil des savants lirait dans les rayons que projettent le soleil et les étoiles ; le nom de plusieurs au moins des substances dont ils sont pétris. On en est pourtant arrivé là. Une méthode d’observation nouvelle et qui, depuis 1815, a été graduellement, perfectionnée par MM. Wollaston, Fraunhofer, Foucault, Kirchhoff et autres, produit en ce moment d’admirables résultats. Ce n’est pas ici le lieu de décrire les procédés délicats et compliqués de l’analyse spectrale. Les maîtres seuls ont le droit de les exposer. Il est permis toutefois à la philosophie d’en indiquer les circonstances essentielles, et les voici.
On a étudié la lumière du soleil et des astres au moment où, après avoir traversé un prisme à section triangulaire, elle est décomposée en ses couleurs fondamentales. Sur ces images spectrales, on a remarqué des raies caractéristiques, tantôt brillantes, tantôt noires. Ensuite, par les comparaisons les plus minutieuses et les rapprochements les plus précis, on a pu reconnaître que ces raies dénotent constamment la présence, dans l’atmosphère de l’astre observé ; de certains métaux à l’état de gaz ou de vapeur. M. Kirchhoff a établi avec certitude qu’il y a dans l’atmosphère solaire d’abord du fer à l’état gazeux, puis encore du calcium, du magnésium, du sodium, du chrome, du nickel et probablement, mais en moindre quantité, du baryum, du cuivre, du zinc. D’autres observations très nombreuses ont été enregistrées. « Le résultat général de ces recherches, – a dit M. W.-H. Miller, – c’est que les étoiles sont des corps construits sur le même plan que notre soleil, possédant chacune une constitution différente de celle des corps voisins, mais tous formés, en apparence ; d’une matière en partie identique avec celle qui compose notre globe. »
Gardons bonne mémoire de ces conclusions. Ce n’est pas la métaphysique cette fois, c’est l’astronomie, appuyée sur l’observation positive, qui reconnaît un seul et même plan jusque dans la matière constitutive des astres. Je prends acte de cet aveu : j’en déduirai ultérieurement les conséquences.
Il nous reste à parler de la manifestation la plus imposante de l’unité dans le monde astronomique. Cette manifestation, c’est l’harmonie que réalisent les mouvements des sphères célestes.
Partons de ce point que les astres sont pesants : c’est de là que résulte toute l’organisation de la machine. Avec le nombre et la mesure, il y a dans le ciel des poids, des contrepoids, des balancements, un équilibre enfin qui naît non d’une immobilité universelle, mais d’une perpétuelle mobilité dont le caractère est d’engendrer à chaque instant un ordre excellent, alors même qu’elle semble l’altérer ou le détruire.
Les astres sont donc autant de masses pesantes. S’il existait des balances assez grandes pour contenir dans leurs plateaux les globes célestes, s’il y avait quelque part un clou assez fort pour qu’on pût y suspendre cet appareil, voici quelques exemples des évaluations qu’on obtiendrait par le pesage des mondés. On trouverait que Saturne pèse 100 fois et Jupiter 538 fois autant que notre globe. Quant au soleil, son poids serait de deux nonillions de kilogrammes, ce qui s’exprime au moyen du chiffre 2 suivi de trente zéros :
Or on doit savoir, que le poids des astres, comme celui des corps, quels qu’ils soient, consiste essentiellement en ce qu’ils tendent à tomber les uns sur les autres, et cela parce que, tous, ils s’attirent mutuellement. Newton a découvert et posé la double loi de l’attraction : Deux corps quelconques s’attirent en raison directe de leurs masses et en raison inverse du carré de leur distance. Ainsi, en termes ordinaires, plus un corps est gros, plus grande est là force avec laquelle il attire les autres corps. En conséquence, tous les astres de notre système, étant de masse moindre que le soleil, devraient se précipiter sur cet aimant qui les attire avec une puissance énorme. Il n’en est rien cependant. Pourquoi ? Parce que le mouvement propre et initial de chaque planète, mouvement qui la pousse en ligne droite, contrebalance incessamment les attractions qui à chaque moment de sa course l’attirent vers le soleil. Ainsi, de la combinaison de ces deux mouvements produits par deux forces différentes, résulte un mouvement elliptique qui est l’orbite de la planète, et qui l’empêche de se précipiter sur la masse solaire. Grâce à cette mécanique merveilleuse, des milliards de masses colossales demeurent suspendues dans l’espace, sans que l’univers s’écroule et se brise sur ses propres ruines.
Et cependant l’équilibre des mondes n’est ni immobile, ni même uniformément mobile autour de certains points absolument fixes. En dépit de certaines apparences, tout dans le ciel est toujours en mouvement. La science ne reconnaît plus d’étoiles fixes, un grand nombre de ces étoiles que l’on croyait uniques se sont résolues en groupes de deux, trois et quatre astres formant des systèmes particuliers qui ont certainement leurs révolutions périodiques. À ne parler que du soleil et de son cortège, il est démontré que, malgré sa puissance et sa majesté, le roi de notre monde n’a point le privilège de mouvoir sans être mû. Il ne lui est point permis de se reposer dans une orgueilleuse inertie : sa loi, comme la nôtre, est de tourner. Lui-même, il roule autour du centre de gravité du système qui n’est pas en lui, mais seulement près de lui. Sa rotation autour de ce pivot invisible s’effectue eu vingt-cinq jours. Il y a plus encore : le soleil avec tous ses sujets, est emporté par un mouvement très lent, mais continu, dans la direction de la constellation d’Hercule. Mais de même qu’en se maintenant il maintient, de même aussi en se mouvant il meut. Sans cesse il fait, défait, refait, l’instable équilibre des masses sur lesquelles il règne. Gardant pour lui-même les jours sans nuits, il donne du moins à ses planètes les successions alternatives des ténèbres et de la lumière ; et à la plupart d’entre elles la variété régulière des saisons. Mercure a son année qui dure 87 de nos jours, 25 heures et 24 minutes. Son mouvement diurne est de 24 heures, 5 minutes, 28 secondes. L’année de Vénus est de 224 jours, 16 heures, 41 minutes ; ses saisons ne sont que de deux mois chacune. On connaît assez l’année, les saisons, les journées de la terre. Pour la planète Mars, l’année s’accomplit en 686 jours, 22 heures, 18 minutes ; son jour en 24 heures, 59 minutes ; 21 secondes. Jupiter tourne autour du soleil en douze de nos années, et sur lui-même en 10 heures, de sorte qu’il n’a que 5 heures de jour ; il jouit d’un printemps éternel. L’année de Saturne égale trente fois la nôtre ; chacune de ses saisons se prolonge pendant 7 ans et 4 mois ; sa journée s’achève en 10 heures, 16 minutes. L’année d’Uranus est de 84 ans et 3 mois. Enfin Neptune, la dernière planète connue du système solaire, se meut autour, du centre commun en 164 ans et a des saisons de 41 années chacune. J’ai reproduit ces chiffres non certes pour les faire connaître, car ils sont partout, mais afin de mettre en relief les similitudes que laissent apparaître les mouvements d’ailleurs si variés des planètes. Évidemment ces globes différents ont tous été conçus d’après un type unique. Soumis à une même force principale, régis par les mêmes lois, ils offrent dans leurs courses et leurs retours périodiques, de plus en plus vastes mais toujours concentriques, le modèle idéal de l’harmonie dynamique. Aussi les anciens frappés de cette eurythmie que pourtant ils ne connaissaient qu’à demi, l’ont-ils appelée tantôt une danse, tantôt un concert, tant ils y sentaient et admiraient l’accord des parties opérant l’unité magnifique de l’ensemble.
Contre la réalité de cette incomparable ordonnance, on ne saurait alléguer ni les phénomènes surprenants que l’ignorance a souvent pris pour les signes avant-coureurs de prochains cataclysmes, ni les anomalies moins visibles qui excitent vivement la curiosité des savants. Peu à peu, ces prétendus désordres se sont résolus ou se résolvent quotidiennement en faits astronomiques d’une régularité directement constatée par l’observation on naturellement déduites des lois déjà connues.
D’abord les éclipses, longtemps redoutées, ont été de bonne heure expliquées et mises au nombre des constantes habitudes des astres qui les produisent et les subissent. Chacun le sait désormais : les occultations périodiques qu’on nomme éclipses du soleil ou de lune sont tellement normales que bien loin de craindre quand elles arrivent, il faudrait trembler si elles n’avaient pas lieu. En fixer le jour, l’heure, la minute, en déterminer la durée à une seconde près, n’est plus aujourd’hui qu’une des opérations élémentaires de la science.
Malgré leur nom de mauvais augure, les perturbations causées dans les mouvements de certains astres par leurs satellites obscurs, ne sont pas davantage des désordres. On inclinait à les regarder comme des phénomènes en tout semblables à nos éclipses. Les dernières découvertes, dit le P. Secchi, ont pleinement démontré la justesse de cette prédiction. Par exemple, les irrégularités observées dans le mouvement propre de Sirius ont fait soupçonner longtemps l’existence d’un satellite obscur circulant autour de cette étoile splendide. Bessel en avait annoncé la présence ; Adam Clark a été assez heureux pour le découvrir vingt ans après : il est lumineux par lui-même, mais n’a que l’éclat d’une étoile de sixième grandeur. Ce qui efface pour nous sa lumière, c’est le rayonnement de l’étoile principale. D’autres faits que l’on pourrait citer prouvent que ces perturbations seraient plus justement appelées des variations mathématiquement normales.
Les comètes sont en quelque sorte les nomades du ciel ; on dirait qu’elles ont l’humeur inconstante et l’instinct vagabond. Légères en leur masse, ou plutôt ténues à l’excès, elles se partagent quelquefois en deux ; quelquefois elles se dissipent et disparaissent. Il en est qui se sont permis de manquer au rendez-vous que leur avaient assigné les astronomes. Ainsi, en 1866, la comète de Biéla dont on attendait le retour, n’a pas reparu. La reverra-t-on ? Peut-être oui, peut-être non. De ce fait et d’autres semblables qu’on ne conclue pas trop vite que les choses vont là-haut à l’aventure. Les fantasques voyageuses ont aussi quelque régularité d’habitudes. La grande comète de 1811 met 3 000 ans à accomplir sa révolution. Celle de 1680 revient au point de départ après quatre-vingts siècles. De récentes observations ont signalé des éléments fixes dans les mouvements cométaires. Schiaparelli a découvert des rapports intimes entre la route de la troisième comète de 1862, et la marche des étoiles filantes d’août. La comète vue par Tempel à Marseille en 1866, répond aux météores de novembre. Au surplus, les comètes peuvent disparaître sans que le grand équilibre en éprouve la moindre secousse. Il nous arrive même de traverser d’outre en outre à notre insu ces nuages de poussière cosmique. Rien de dangereux et un ordre de plus en plus distinct, voilà ce que la science actuelle aperçoit dans la capricieuse mobilité des comètes.
Une objection tout autrement grave, du moins au premier aspect, est tirée de la déformation des orbites planétaires. Les planètes décrivent comme on sait autour du soleil, non pas un cercle mais une ellipse dont le soleil occupe un des foyers. Cette ellipse qui est ce qu’on nomme l’orbite, tantôt s’allonge et tantôt se rétrécit. Ces perturbations, seraient-elles autant de démentis donnés, à la loi de l’attraction universelle ? On se l’est demandé quelquefois. On a reconnu qu’il n’en est rien. Dans les mouvements planétaires, un seul élément reste absolument fixe : la longueur du grand axe. C’est bien, peu, mais cela suffit. Grâce à cette permanence, l’ordre est assuré, car aussi longtemps qu’elle subsistera, toute conjonction fatale demeurera impossible. Enfin, il y a des astres qui tout à coup se brisent et volent en éclats dans l’espace. D’autres s’allument subitement, flambent comme une poignée de branches sèches et rentrent dans les ténèbres. N’est-ce pas un monde sans ordre que celui ou se déploient tant d’énergies destructives ?
Ce qu’il y a de certain, répond la science, c’est que l’harmonie céleste n’a point à souffrir de ces sortes d’accidents. Quelques faits en fourniront la preuve. Il y a entre l’orbite de Mars et celle de Jupiter, une zone large de 80 millions de lieues où certains calculs faisaient pressentir la présence d’une planète que Kepler, au surplus, avait annoncée. Au lieu de cet astre, on a découvert, semés dans cet espace interplanétaire, un nombre assez considérable de fragments cosmiques. Sont-ce les épaves d’un globe brisé ? Sont-ce les germes d’une sphère en voie de formation ? On ne sait. Mais quoi qu’il en soit, ces astéroïdes accomplissent correctement leur mouvement de rotation autour du soleil. Ou l’harmonie se fait à cet endroit, ou elle s’y refait : dans l’une comme dans l’autre hypothèse, l’harmonie est sauve. Elle persiste même après ces conflagrations qui, pareilles à de prodigieux incendies, semblent d’abord révéler, puis consumer les sphères célestes. Une étoile brillante parut à l’improviste, en mai 1860, dans la constellation de la Couronne boréale. Après quelques jours d’incandescence, elle disparut, comme si l’aliment de ses flammes eût été entièrement dévoré. Que s’était-il passé ? L’analyse spectrale, – disent d’une même voix MM. Huggins, Miller et Secchi, – nous apprend que par suite de quelque convulsion intérieure, d’énormes quantités d’hydrogène se sont enflammées ; et ces masses de gaz une fois consommées, l’incendie stellaire a pris fin, sans laisser après lui huile trace de désastre. On le voit : ce phénomène, loin de troubler les lois de la nature, les a seulement vérifiées une fois de plus ; et il a si peu altéré l’harmonie du ciel, que le gracieux contour de la constellation où il s’est accompli n’en a subi aucune altération apparente.
Il n’y a donc pas moyen de méconnaître l’harmonieuse unité de l’univers astronomique, pas moyen de la révoquer en doute. La ressemblance des sphères et des mondes en est le plus frappant témoignage ; elle paraît vivement dans les dissemblances qui ne sont que les aspects ou variés ou moins fréquents des mêmes types et des mêmes lois. À la similitude dans la puissance lumineuse, à l’identité de la forme, l’observation scientifique a peu à peu ajouté les analogies profondes qui se révèlent dans la concordance des mouvements pareils et jusque dans la constitution chimique des astres. Et qu’on veuille bien ne pas prétendre ou insinuer que c’est là une harmonie rêvée, une unité poétiquement imaginée, quelque chose de littéraire, un sujet épuisé d’amplifications oratoires. C’est, – on vient de s’en assurer, une unité réelle, positive, scientifiquement reconnue et constatée. La poésie et l’éloquence s’en inspireront tant qu’il y aura des hommes capables d’en sentir et d’en célébrer la beauté ; mais cette unité c’est la science qui la démontre. On avait pu croire que les récentes découvertes avaient rejeté l’idée de cette harmonie parmi les fictions surannées. C’est le contraire qui s’est produit. La science moderne a fait éclater, sans le vouloir et quelquefois même en en répudiant les conséquences, l’harmonie du monde astronomique ; elle a dû la signaler sous les variations, sous les anomalies, sous les perturbations qui d’ailleurs ne la voilent au premier aspect que pour la manifester bientôt avec une évidence saisissante. Elle a, il est vrai, ruiné définitivement la fausse conception d’une unité monotone, uniforme, où l’immobilité jouait un trop grand rôle et tenait trop de place ; mais ç’a été pour y substituer la notion d’une autre unité à la fois fixe et mobile, consistante et souple, inflexible et élastique, qui tout en maintenant invariablement ses lignes principales et ses grands contours, se prête admirablement à des modifications innombrables et incessantes. La science moderne, en étudiant mieux que jamais l’architecture du monde, y a découvert une unité que les monuments de l’architecture humaine n’ont jamais présentée, je veux dire une sorte d’organisme comparable jusqu’à un certain point au mouvement vital des corps organisés, car cette puissance infuse dans les astres fait, défait, refait, forme, déforme, reforme les mondes et qui sait ? les perfectionne peut-être par son labeur incessant. Ce qui ressort des récents travaux astronomiques, c’est la démonstration d’un ordre plus profond, plus savant, plus magnifique cent fois que celui devant lequel les anciens s’étaient inclinés.
Que conclure de là ? Résisterons-nous obstinément à la lumière ? Goûterons-nous je ne sais quelle joie bizarre à appeler noir ce qui est blanc et désordre ce qui est ordre ? Le besoin d’éprouver toutes nos convictions, de vérifier toutes nos idées, la crainte salutaire d’être dupés, ces dispositions excellentes des intelligences mûres auraient-elles dégénéré en une impuissance maladive de saisir l’évidence ? L’usage systématique du doute aurait-il émoussé et finalement paralysé en nous le sens du vrai ? Si nous n’en sommes pas tombés à ce degré d’anémie rationnelle, voici ce qui est incontestable, ce qu’il faut bien confesser. Il y a un plan dans le monde ; on y surprend un même dessein, une même unité, une même harmonie, par conséquent une seule et même pensée ; je n’ose dire une seule et même main. Pour embrasser l’universalité des mondes, pour les maintenir en paix, en bonne entente, en équilibre, il faut une force pensante absolument une. Pour mettre leur état passé en rapport avec leur état présent, et leur état présent d’accord avec leurs positions, leurs mouvements et leurs changements futurs, il a fallu, il faut une seule et même puissance prévoyante, toujours préexistante, toujours supérieure à son œuvre. Cette puissance, serait-elle le hasard ? Mais le hasard, s’il existe, est l’idéal même de l’ineptie, incapable de savoir ce qu’elle fait et de se répéter elle-même quand, par distraction, il lui échappe de bien faire. – Cette puissance, sera-ce la matière ? Mais la matière est indéfiniment multiple et divisible, tandis que l’intelligence, reine du monde, est nécessairement une. – Cette puissance, sera-ce seulement une idée de l’homme ? mais l’univers existait avant l’homme et la cause ne saurait être postérieure à son effet. Cette intelligence, qu’est-elle donc enfin ? Elle est, voilà qui est assuré. Nous tenterons plus tard d’entrevoir si elle est infinie, si elle est parfaite, en un mot de démêler, selon nos forces, ce qu’elle est.
Vus sous un certain jour, les corps inanimés, simples ou composés, solides, liquides ou gazeux, semblent dépourvus de cette unité sans laquelle il n’y a aucun ordre, aucune harmonie. Examinons-les d’abord à ce point de vue.
C’est aujourd’hui une opinion universellement admise par les savants que les corps les plus simples, c’est-à-dire ne renfermant qu’une seule espèce de matière, sont en même temps multiples, c’est-à-dire formés d’un nombre variable de particules infiniment petites. Il leur manque donc cette première sorte d’unité qui est l’unité numérique.
Ont-ils du moins cette autre unité que leur attribue l’ignorance ou l’inattention, et qui consisterait, si elle existait, dans la juxtaposition mathématique des parties sans aucun intervalle ni solution de continuité ? Pas plus celle-là que la précédente. La compressibilité des corps en est la preuve. Sous une pression suffisante, le volume des gaz éprouve une diminution ; il en est de même des liquides, quoique à un degré moindre ; les solides sont compressibles aussi. Pour que les corps diminuent de volume, il faut évidemment que les molécules qui les forment se rapprochent les unes des autres. Dès que cesse la pression, le volume reprend ses dimensions primitives ; pourquoi ? Parce que les molécules reprennent leurs distances. Il y a donc entre elles des intervalles qui les séparent et qui tour à tour s’étendent et se resserrent. Ainsi les corps ne sont pas des continus.
Ce sont des groupes ou, comme disent les savants, des systèmes de molécules douées du double pouvoir de s’attirer et de se repousser. Elles s’attirent assez pour rester ensemble ; elles se repoussent assez pour demeurer distantes et distinctes ; et les corps se maintiennent par l’équilibre de ces deux forces.
On le voit : l’unité numérique et l’unité d’étendue des corps ne sont guère que des apparences. En y réfléchissant davantage on reconnaît que ces apparences sont plus vaines et plus fuyantes encore qu’on ne l’avait cru au premier aspect.





























