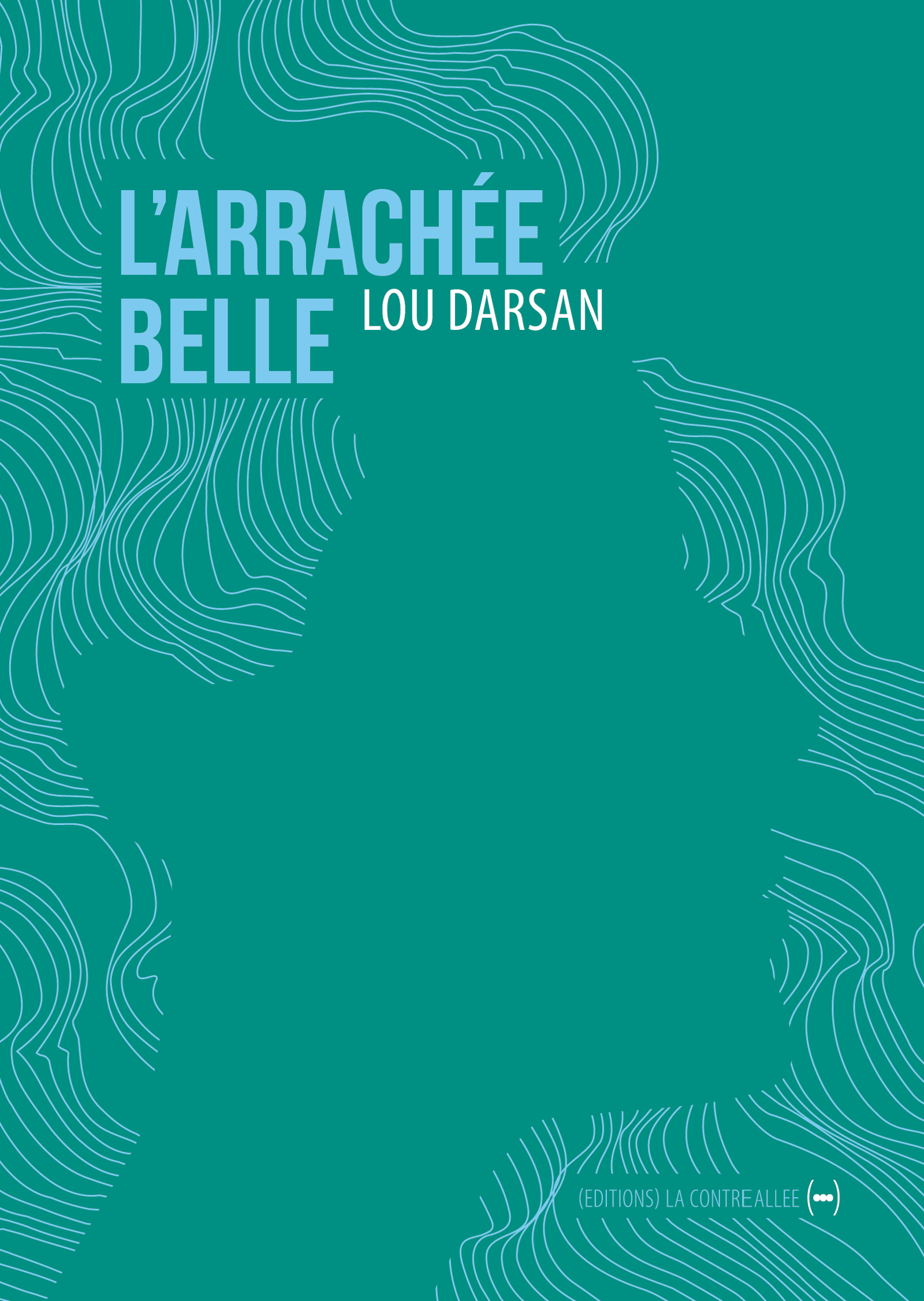Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: La Contre Allée
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Dans un golfe étroit veillé par des montagnes jumelles et des forêts ogresses, un couple traverse l’obscurité de l’hiver boréal. Deux solitudes, deux funambules qui marchent à gestes et pas comptés sur une ligne, entre sauvagerie et civilisation, monde animal et humain.
Lou Darsan cartographie avec finesse nos désirs et nos failles, révélant brillamment les tensions qui nous parcourent.
Voyage au cœur d’une nature sublime, mais aussi voyage introspectif aux échappées oniriques, qui sont comme autant de fenêtres ouvertes sur nos imaginaires, la lecture des
Heures abolies nous fait l’effet d’une ample respiration salvatrice dans nos quotidiens balisés.
À PROPOS DE L'AUTEURE
Née en 1987,
Lou Darsan poursuit des études de Lettres modernes puis exerce le métier de libraire quelques années avant de devenir nomade & écrivaine.
Après
L’ Arrachée belle (La Contre Allée, 2020), nommé pour de multiples prix (prix du premier roman 2020 des Inrockuptibles, prix Hors concours 2021, prix révélation de la SGDL),
Les Heures abolies est son deuxième roman.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 179
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Les Heures abolies
Lou Darsan
© (éditions) La Contre Allée (2023)
Collection La sentinelle
Les Heures abolies
Lou Darsan
I’m counting the gulls that sit on the waves
Surrounding the boats in the bay
I’m counting the miles till we’re there
Where the sun and the rain and the snow
Fall on the seeds and make them grow
Fall on the rocks and make them crack
Into pebbles and into sand
Which is where I like to stand.
Where I like to stand,
Vashti Bunyan (feat. Lucie Baratte)
J’ouvrirai le ventre du jardin, je grifferai la terre, je l’aérerai, je sèmerai. Une graine pour chaque jour d’enfermement, une graine par vie qui s’essouffle, une graine par peur.
Je mettrai à nu le sol noir, j’aiderai une abeille à sécher ses ailes, j’enfouirai les vers avant que les poules ne les dévorent, je réenterrerai les carabes dorés et les larves de longicornes que la houe aura exposés.
J’arracherai l’herbe, sarclerai, tracerai du doigt les sillons.
Je penserai à manger et je sèmerai fèves, épinards, navets, carottes, laitues, quatre rectangles noirs dans un carré vert.
Je verrai le lierre terrestre, les pissenlits, les nombrils-de-Vénus, les orties, le plantain & les violettes — une assemblée qui murmure, qui croît dans les interstices, dans les zones d’ombre.
Ce qui est sauvage et dont j’oublie de me nourrir.
Estivales
Des paysages s’étendent dans mes pensées. La peur de ne plus circuler me paralyse, je l’évite et la chasse comme un nuage.
Je pense aux lapereaux effrayés dans leurs cages, que l’on nourrit à la pipette. Aux nichées d’écureuils récupérés dans les arbres abattus, à tous les petits que l’on enferme pour les soigner. Aux oiseaux blessés, s’envolant au-dessus des marais quand on ouvre la boîte à chaussures percée qui les contient, à tire-d’aile loin des sauveurs et de la contention. Je voudrais m’envoler avec eux, une ligne droite vers la cime des pins.
Il y a des tamaris qui me peuplent, et une hirondelle, je ne sais pas les écrire. Des paysages brouillons. Le goût du sel, des morceaux de posidonie séchés sur la plage (sable grossier), on aurait presque envie de balayer les fragments d’algues qui collent à la peau et s’accrochent aux cheveux, rien n’est arrangé en ligne, pas de laisse puisque c’est la Méditerranée dont je me souviens. (Si je pense à l’Atlantique, ce sont les vélelles dans une pluie d’écume qui reviennent, les rochers noirs striés, les fracas des vagues, les oiseaux nichés dans les falaises.)
Je repense aux lueurs vertes dans le ciel à la tombée de la nuit, une kyrielle de points lumineux en suspension. Il m’a fallu longtemps avant de penser aux lucioles ; en ville, on ne les connaît plus, à l’exception de celles du Tombeau, qui nous font pleurer. Sous les lucioles, c’était une prairie verte entre deux collines, quelque part entre une lagune et l’Adriatique. Sur la lagune, une île ; sur l’île, un monastère orthodoxe. En marchant entre les roseaux et la colline, j’ai vu décoller un pélican, une tache blanche floue un peu lointaine qui s’est transformée en oiseau immense dans les jumelles. Face à moi, ailes déployées, corps massif.
Pour que l’on voie la poche sous le bec, l’oiseau doit voler de profil, en augure. Sur les plages californiennes, on trouve autant de plumes de pélicans que celles des goélands sur les grèves de la Manche. Une colonie de pélicans est une pensée heureuse : j’imagine les grands becs qui claquent, je ne verrai pas le sang couler à longs flots de leurs poitrines ouvertes. (Les poètes ne connaissent rien aux lagunes et les dictateurs les assèchent.)
Le premier pélican, c’était : une marche le long de la plage sans fin, si large qu’on ne voit pas la mer (on la sent, on l’entend), le soleil se couche, il faut franchir une rivière et une dune (les pieds s’enfoncent et glissent, des avalanches infimes), un olivier de Bohème sucre l’air. Le pélican m’a survolée, après lui il a fait nuit très vite et juste avant l’obscurité un serpent noir s’est dressé devant mes pieds. Il a disparu sans un bruit, mon cœur battait trop fort.
Je n’ai toujours pas mis en phrase l’hirondelle près des tamaris, elle glisse. Là où je l’ai vue, on ne pouvait pas suivre le golfe longtemps — pas de sable, des broussailles puis un muret presque effondré, encore un marais, comme si des marais bordaient tous les rivages où je dors. Pas de pélicans : des grenouilles dans un fossé. Sous l’eau, une couleuvre les guette, au loin le chien noir aboie ; le matin, deux hommes chargent de galets la remorque d’un vieux pick-up, les pneus patinent dans le sable, tout le monde rit. L’hirondelle a décollé.
Je réalise que je ne sais plus porter mon regard vers les lointains : les yeux proches de l’écran, du téléphone, de l’ordinateur, du livre, toute la journée. Dehors, je fixe un point flou à proximité de moi, quelques mètres, le sol. (Herbes, fleurs, talus.) Je dois me morigéner pour penser à lever les yeux vers le large, et lorsque je fixe l’horizon une sensation de brûlure et de tiraillement doublée d’un vague malaise s’empare de moi. Même quand je m’efforce de contempler le point le plus distant, je glisse vers le bas et j’achoppe sur une irrégularité du paysage. (Îlot, maison, arbre, oiseaux.) Cela me semble lié à une diminution de ma concentration, mais peut-être est-ce au niveau musculaire que le problème se situe.
J’ai dû rire dans le noir, je ne sais plus où ni quand, lors de cet été méditerranéen qui me hante. Cela devait être un soir où la nuit s’était couchée plus tôt que la veille et où je buvais une bière sous un arbre en compagnie d’autres humains de passage, avec le bruit des vagues, et les étoiles qui bougeaient trop vite, et moi qui parlais plus fort que les sons de la nuit. Des gouttes de sel suintaient des tamaris, parce que le soleil avait brûlé le jour ; des vaches placides, blanches comme les galets, broutaient les plumetis roses, certains les chassaient de leur bâton. Sur le tronc, la sauterelle était immense.
Ce soir-là, j’ai vu un cheval marcher sur les galets blancs sans se fouler les chevilles, il a nagé vers le large et une fille s’est accrochée à sa crinière, elle a plongé depuis son dos. Sur la rive, quelques types en short, les cheveux mouillés, criaient dans une langue étrangère des phrases d’encouragement, au cheval ou à la fille.
D’autres chevaux : un troupeau, au galop, sur une route étroite. Sur une vieille mobylette, un jeune homme tenait la jument de tête par la longe, les autres suivaient au trot en hennissant. J’avais soif, des pick-up rouillaient dans les champs, pas d’ombre, un village en pierre grise au loin, des tours de guet. Quelque part dans mon dos, la mer invisible au pied des falaises ; sous les yeux, les montagnes pelées. Même pas un aigle.
Dans la cour d’une maison, un chacal efflanqué cherchait de l’eau, je roulais trop vite, je n’ai pas vu ses yeux, c’était peut-être un chien ensauvagé. Ceux que j’ai croisés aux sorties des villages somnolaient sur le bitume chaud des routes peu fréquentées ou dans les friches enherbées. Ils fuguent des fermes et des villas pour vivre dans les collines, mais leurs petits meurent jeunes et, chaque été, des empoisonnements massifs préviennent la prolifération de ces chiens sans maîtres. Pourtant, leurs meutes grossissent.
Au pied d’une montagne boisée, au nord-est du chacal et des chevaux, errait une chienne pouilleuse blessée à la patte, une vilaine plaie noire. Elle dormait en haut de l’escalier étroit qui menait à un torrent et à une minuscule chapelle au-dessus d’une grotte, elle suivait jusqu’en bas les promeneurs et les pèlerins, peinait à remonter les marches, je n’avais pas envie de l’aimer, je voulais la chasser, sa misère était trop grande pour l’empathie. Un soir, une voiture rutilante s’est garée à l’entrée du chemin, l’homme qui en est descendu a cherché la chienne puis l’a nourrie, il a caché des médicaments contre les parasites dans la nourriture, il est reparti sans descendre à la chapelle.
Au même endroit, deux chats roux apparaissent la nuit. Si on laisse les couvercles beiges des conteneurs ouverts, les chats dévoreront les restes de sandwiches jetés par les touristes. Quand le couvercle est fermé, ils se cachent dans les bâtiments à l’abandon, des cubes en parpaings aux angles peuplés de guêpes maçonnes, au bout d’une allée grise initiée par une entrée prétentieuse. Dans les bois de l’autre côté de la route, d’autres bâtiments collectifs sont éparpillés dans une clairière clôturée, mais je n’ai pas franchi le fil barbelé et ma mémoire les a floutés. Leur destination initiale m’est inconnue, j’ai imaginé un monastère, un lieu d’accueil pour des pèlerins venus rendre hommage à la jeune sainte anonyme de la grotte, ou une colonie de vacances désaffectée, comme celle perchée sur la falaise maritime et qui dominait la baie, loin à l’ouest, à l’exact opposé du continent.
Là-bas, dans la colonie vide de l’Ouest, à l’intérieur de ma petite chambre au sol cimenté sans matelas, la nuit était silencieuse. Le souvenir des enfants regroupés et occupés là l’été, loin de leurs familles, avait quitté ce lieu où ne persistaient que l’air iodé, la liberté de ceux qui passent, s’arrêtent et repartent, le regard distrait des randonneurs depuis le sentier douanier. L’écho des éclats de rire et des courses-poursuites dans les couloirs s’était éloigné — sur les murs, des inscriptions à demi effacées remplaçaient le règlement déchiré : prénoms, étoiles, masques grimaçants.
Une baie vitrée immense emplissait de lumière la salle commune du corps principal, il restait un piano désaccordé, quelques marins, un chevrier ; on jetait une pièce dans une boîte de conserve pour payer le gaz quand on tirait de l’eau chaude ou que l’on réchauffait son repas. Une marmite de soupe bouillonnait sur la gazinière à la peinture écaillée, les cornes d’un chevreau en dépassaient, un couteau reposait au fond de l’évier. Les légumes et l’odeur flottaient, pas la tête (des lambeaux de chair se détachent l’un après l’autre). De l’autre côté de la vitre, les sardiniers s’éloignaient vers l’horizon blanc, sur une mer métallique.
Je marche d’une ruine à l’autre et mes nuits tracent une ligne entre l’Atlantique et la mer de Thrace. Le long des falaises, j’ai vu les squelettes d’immeubles dominer des plages parsemées de pieds de parasols et de paillotes fermées. Des hommes descendaient de pick-up cabossés pour récupérer les matériaux et démanteler ce qui pouvait l’être — les rectangles vides des grilles de béton découpaient la mer trop bleue comme une kyrielle de fenêtres ouvertes.
Partout sur les rivages de la Méditerranée, les bâtiments dédiés à l’accueil des vacanciers s’écroulent et se repeuplent de squatteurs et de réfugiés qui se lavent lors d’après-midi pourtant brûlantes dans les sources chaudes naturelles, à l’extérieur de complexes thermaux délabrés ou dans les baignoires taguées des sous-sols où l’on parle pachtou en foulant des mandalas peints à la bombe, au milieu du verre brisé des fenêtres et de l’odeur soufrée de l’eau qui jaillit des tuyaux.
Dans les hauteurs d’une ville au nom mythologique, je suis entrée à quatre pattes dans le hall d’un hôtel à travers l’ouverture offerte par le panneau inférieur arraché à la porte en bois. Le sol en marbre était resté blanc, rien n’était posé sur le comptoir, je ne me souviens pas d’une sonnette, mais du palmier en plastique et de cannettes de bière et de soda vides oubliées sur le canapé d’angle. Toutes les portes étaient fermées à clef, aucune n’avait été fracturée, l’on devinait un toit-terrasse après l’escalier qui desservait l’étage. Derrière le comptoir, la seule porte qui n’était pas verrouillée s’ouvrait sur une salle de bains, il restait du savon, la température extérieure frôlait les quarante-cinq degrés et la douche fraîche que j’ai prise dans le silence de cet espace vide et sombre a réparé ma peau de ses crevasses, a dissoutmon sel qui a coulé dans les canalisations. L’eau lisse le corps et l’allège, et même s’il faut ressortir en marchant sur les genoux et les mains, s’il faut se heurter au mur de la chaleur extérieure, ce moment liquide et calme existera dans le souvenir du lieu.
Tout comme existeront la salle de bains neuve de la suite parentale d’une maison de vacances bâtie face à un monastère orthodoxe médiéval au cœur des collines de la Serbie centrale, et le luxe de l’eau courante offerte par un homme qui réarrange à sa façon l’histoire des peuples, mais dont la générosité permet de rincer la poussière de la route et le dépôt noirâtre lâché par les gaz d’échappement des berlines qui traversent la Bulgarie sans la voir, d’oublier la fatigue de l’attente trop longue à la frontière — une ligne autoroutière de la Turquie à l’Allemagne, des kilomètres de poids lourds à l’arrêt de chaque côté des postes de douane. Le paysage est vide des trains de marchandises disparus, longues files de wagons-silos qui sillonnaient l’Europe, je les ai vus traverser Nanterre à travers les anciennes friches et les tours HLM, où s’évaporent-ils et atteignent-ils jamais Edirne ?
Plus tôt, pour atteindre les lucioles et les pélicans, il m’avait fallu rouler sur la seule route rapide du pays des Aigles, une route côtière le long de laquelle s’égaillent des hôtels neufs jamais achevés, construits pour blanchir l’argent d’un quelconque trafic, des incongruités aux silhouettes de châteaux forts ou de temples égyptiens. Ils m’avaient rappelé les pastiches aux abords des parcs d’attractions et la peinture lavande du Magic Castel Motel d’Orlando. Des cars de touristes envahissaient leurs parkings, attirés par les tarifs compétitifs et la promesse de piscines, pourtant perpétuellement vides, dites en réfection ; de l’autre côté du ruban gris s’étendaient des acres de serres en verre, brisées et inutilisées, vestiges d’une politique agricole coopérative révolue. Sous les hôtels, sous les serres, le souvenir des marais asséchés persistait à côté de celui des soldats enfouis dans la tourbe depuis soixante-dix ans, appelés chaque nuit par le fantôme du général italien qui a si longtemps cherché son armée de morts dans la boue noire des montagnes, sous des villages oubliés. Entre la route et la mer, des villes chaotiques débordaient sur le paysage comme les lotissements de gratte-ciel en carton-pâte que j’ai vus émerger de la plaine céréalière de la Thrace orientale, des centaines de kilomètres plus à l’est.
Je ne peux plus conduire sans que les paysages de ma mémoire se superposent à ceux que je vois, en surcouche. Le calque de toutes les montagnes contemplées s’ajoute à celles qui apparaissent à l’horizon et, après chaque virage, la surprise remplace l’image projetée par l’imagination.
Les fragments de route se combinent en une seule, qui parcourt un territoire intime, composite, fractal : chaque détail l’agrandit, il s’expand quand je me penche sur lui. Une succession d’enseignes et de panneaux, de villages, de virages, de déserts, d’odeurs, de musiques écoutées, toutes les gorges traversées par des routes étroites et sinueuses, les yeux rivés sur la chaussée pour ne pas dévier — deviner le vide en contrebas sans le voir tout à fait, ne pas s’arrêter. Je voudrais confondre le Fenouillèdes et le Durmitor, nommer le canyon de la Piva lorsque je longe les gorges de Galamus, et les tunnels sans éclairage ajoutent une note balkanique à mes itinéraires montagnards.
Les jours et les lieux s’emmêlent et des blancs apparaissent depuis que j’ai quitté les rives de la Méditerranée. Jusqu’ici, chaque chose avait sa place, chaque lieu son histoire, son souvenir. Je pouvais pointer le souvenir du doigt et dire : ceci est arrivé là, très exactement là. Depuis quelques semaines, les forêts, les montagnes, les chemins de terre se ressemblent. Si je ne fais pas attention à bien noter le lieu et la date en haut à droite de la feuille, comme on nous a appris à le faire pour les lettres manuscrites de notre enfance, je ne sais plus. Je tourne en rond, je croise ma piste, je courbe la linéarité du parcours, je méandre. Une succession de vallées qui remontent dans un même massif, la ligne droite d’une plaine et de nouveau un dédale de vallées, de gorges ; soudain une plage, des récifs. C’est à y perdre son sens de l’orientation. La montagne passe du nord au sud, de l’est à l’ouest, je ne sais jamais où est mon ombre, alors comment savoir dans quelle forêt j’ai écrit ce poème-ci ou celui-là ? Le nombre de lieux vécus, traversés, ressentis, explose. Une exponentielle de choses vues sature la mémoire que je croyais infaillible. Il a fallu sillonner beaucoup pour la vaincre, jouer à colin-maillard avec moi-même.
La mémoire des lieux devient un bruit rose qui me maintient dans un état de somnolence.
Un jour, je te parlerai de la plaine de Hongrie et des Alpes dinariques, des routes qui défilent, des stations-service fermées, des chiens errants, de l’impact de l’air sec de l’été sur les lèvres, des fleurs sauvages, des plages interminables, et j’orchestrerai la mutation de ce paysage en poèmes, je métamorphoserai nos corps, je guetterai avec toi les signes le long des nationales et les messages cachés sur les poteaux téléphoniques. Quand je dirai les pierres sèches et les scorpions et le bleu du ciel, tu sauras à quelle partie de ton corps je fais l’amour, et combien de temps, et avec quelle délectation.
Ce sera l’une de ces après-midi où la pluie tombe sur le toit — de petites gouttes, un grésillement à peine, qui n’apportent pas de fraîcheur : les nuages s’accumulent sur les sommets de l’ouest (un trait bleu tiré au-dessus de la vallée cachée), masse grise, pas de noir, la lourdeur de l’air, deux jours que les mouches tournent et les moustiques agressent, toujours pas d’orage. Quelques coups de tonnerre dans le lointain, le bruit sans le tambour de l’averse drue ni les éclairs, et quand les quelques gouttes par seconde s’espacent jusqu’à se taire, un vent chaud se lève, juste assez pour que les cheveux dansent en serpents, que la robe ondule sur les cuisses et frôle le creux derrière les genoux. L’inverse d’une brume de chaleur où la forêt exhale l’humidité de la nuit vers le ciel qu’elle éclaircit au niveau de sa cime, où l’horizon se voile et les montagnes pâlissent avant que le bleu éclate à midi.
Le soir, un ciel d’un gris moite, lumière uniforme, la peau sera alourdie — nos peaux qui se mélangent et se collent, nos sexes pulsatiles et repus, nos langues salées comme nos corps humides, hébétés par la tiédeur.
Alors, les yeux fermés, je m’allongerai sur le sol d’une forêt luxuriante, le dos dans le vert spongieux de la mousse, enveloppée de l’odeur humide des feuilles. Des lianes pendront des branches, les cimes s’écarteront au-dessus de moi — regard plongé dans une amande bleue de ciel dégagé, une falaise blanche derrière la tête. (On ne voit pas les arbres qui poussent à son sommet.) La pluie passée, la forêt s’ébrouera et fumera — vapeur pâle au-dessus des branches, un doux arc-en-ciel traversera le bleu de l’amande. Je m’enfoncerai dans le vert, un vol d’oiseaux noirs tracera une diagonale dans mes prunelles. Pas de musique, pas de flûtes, pas de nuages. L’esprit volera avec les corneilles par-delà les falaises et ouvrira la roche pour faire surgir une cascade qui transformera en miroir d’eau le matelas de mousse. À petites lapées, je boirai l’eau cristalline, et de mes lèvres fraîches je soulagerai la brûlure de ton front.
J’ai traversé septembre à tes côtés et les montagnes se sont couvertes de cenelles, de sorbes et d’alises, les baies orange et roses ont dissimulé la transmutation des feuillages de l’émeraude au bronze. Les jours ont raccourci, les passereaux se sont dissimulés dans les épines pour gober les fruits des haies. J’ai voulu marcher sur les sentiers avant que les premières gelées ne m’en éloignent, et d’infimes lambeaux de ma peau sont restés accrochés aux ronces et aux prunelliers, mes bras se sont parés de perles de sang minuscules, luisantes et sombres comme les baies que je convoite et dérobe aux oiseaux.
Ma cage thoracique, parfois, se végétalise, et des feuilles poussent sur mes côtes, de tendres bourgeons vert pâle qui éclosent en feuilles douces et dentelées. Les rouges-gorges curieux s’y perchent, leurs tsîhtsîh aigus sautent d’une côte à une autre, les grappes de baies orange de mon automne se reflètent dans le brillant de leurs yeux noirs tout ronds. J’abrite dans mon cœur une lumière verte et sur ma peau un bocage en deux dimensions, un tatouage qui danse puis s’estompe.
Malgré l’automne que je pressens, j’ai encore dans la bouche le goût du sel et du pétrole, & sur la peau la texture poisseuse de l’air du golfe Saronique encombré de pétroliers attendant leur tour pour emprunter le canal de Corinthe — sel de l’iode et de la sueur qui lavait ma poitrine de la poussière des virages ocre, pétrole des raffineries immenses qui avaient surgi après un tunnel, leurs pipelines tendus au-dessus de la chaussée d’un réservoir à l’autre, des rails de montagnes russes sans les cris de joie ni l’adrénaline. Entre deux courbes de la route, j’apercevais un cargo échoué, couché sur le flanc, laissé là, à l’abandon comme un cachalot au ventre empli de plastique sur une plage écossaise — et qui sait ce qui coule de ces entrailles métalliques. Sur le bas-côté encombré de voitures de pêcheurs où je me suis arrêtée pour contempler la carcasse, l’air vibrait au passage des autocars de tour-operators qui prennent chaque jour d’assaut les ponts du canal. À leur bord, les masques de sommeil cachent les décombres métalliques et ne se soulèvent que sur les ruines de pierres. Penchée sur l’écran, aujourd’hui, je sais que l’épave paraît plus grande sur les vues satellites que depuis la falaise.