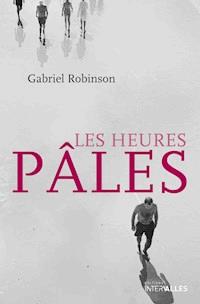
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Éditions Intervalles
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Et si votre père menait une double vie ?
C’est l’histoire d’un père, d’un flic exemplaire, d’un professionnel de la vérité. Pendant dix-huit ans, il a fait le choix d’un étrange mensonge : un autre amour, un autre enfant, à vingt minutes de chez lui, et personne ne le savait, ou presque. Un jour, le scandale éclate et l’un de ses fils, journaliste, mène l’enquête - ou plutôt couvre, comme en reportage, l’implosion du modèle parental - entre Lyon, Paris et le Mali.
Un thriller dont les enquêtes policières ne manquent pas de rythme
EXTRAIT
J’essaie d’imaginer mon père en boubou, en bogolan, ces tuniques en toile de jute assez grossières à motifs géométriques ou représentant des scènes de mariage dans des tons marron ocre noir gris ou blanc. Celui de mon père est orange brûlant jaune vif et ça me fait rire. J’écris ça me fait rire mais je ne suis pas là. Ma mère oui. Ma mère tient la main de mon père et son boubou bleu marine lui va mieux qu’à mon père le sien. Mes parents portent également une casquette, un pantalon de randonnée et une paire de baskets en cuir. Et marchent ainsi dans la savane. Mon père transpire à grosses gouttes, ma mère suit – c’est l’époque où son genou ne lui fait pas encore mal. Leur guide, un adolescent prénommé Édouard qui remplace ce jour-là son père, mène le convoi. Nous sommes en Pays Dogon, au Mali, sous la falaise de Bandiagara, pas loin de la frontière du Burkina Faso, dans la seconde moitié des années 1980. Mes parents cherchent un arbre à l’ombre duquel un heureux événement doit se produire.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
- "... une enquête, une vraie, de celles dont on fait les épopées édifiantes autant que les pansements intimes."
(François Perrin, TGV Magazine)
- "Un premier roman très maîtrisé qui en laisse augurer d’autres de très bonne facture. Une très belle découverte, très convaincante."
(Yves Mabon, Les 8 plumes)
- "En deux mots, c’est drôle et triste - rien de meilleur."
(Philippe Jaenada)
- "Outre un titre très séduisant,
Les Heures pâles possède le charme de la belle littérature."
(Stéphanie Joly, Paris-ci la culture)
- "L’auteur dépeint avec une incroyable justesse et vérité la psychologie de chacun des protagonistes. Un style soigné, une musicalité et un rythme fabuleux."
(Booknode)
A PROPOS DE L'AUTEUR
Gabriel Robinson est le nom de plume d’un auteur né en 1981. Il est journaliste et critique littéraire pour plusieurs médias, notamment Standard et Radio Nova.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 218
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
0.
J’essaie d’imaginer mon père en boubou, en bogolan, ces tuniques en toile de jute assez grossières à motifs géométriques ou représentant des scènes de mariage dans des tons marron ocre noir gris ou blanc. Celui de mon père est orange brûlant jaune vif et ça me fait rire. J’écris ça me fait rire mais je ne suis pas là. Ma mère oui. Ma mère tient la main de mon père et son boubou bleu marine lui va mieux qu’à mon père le sien. Mes parents portent également une casquette, un pantalon de randonnée et une paire de baskets en cuir. Et marchent ainsi dans la savane. Mon père transpire à grosses gouttes, ma mère suit – c’est l’époque où son genou ne lui fait pas encore mal. Leur guide, un adolescent prénommé Édouard qui remplace ce jour-là son père, mène le convoi. Nous sommes en Pays Dogon, au Mali, sous la falaise de Bandiagara, pas loin de la frontière du Burkina Faso, dans la seconde moitié des années 1980. Mes parents cherchent un arbre à l’ombre duquel un heureux événement doit se produire. Il ne fait pas trop chaud : ma mère a peur de ces chaleurs qui frappent la pension comme l’ensemble de la cité de Sévaré dès huit heures, huit heures et demie, même en novembre. Hier elle pensait que cela pourrait nuire à la cérémonie. S’il fait trop chaud, on ne sera pas bien, ils ne nous entendront pas.
Mes parents ne transportent rien sauf un bâton chacun. Un long bâton de bois qui paraît, au premier regard, avoir été choisi pour faciliter leur progression – on pourrait dire pour soutenir la caravane conjugale entre les pierres, les racines, les herbes hautes et les plaques de boue séchées qui se craquèlent à l’infini – bien qu’un œil averti, familier des rituels de sorcellerie, eût reconnu un bâton d’invocation découpé dans l’ébène et qui, à hauteur de leurs visages, se termine en sphère sculptée – un peu comme un crâne, mais ce n’en est pas un – sur laquelle ont été enroulés des colliers de pierres noires pas tout à fait précieuses, sinon pour celui ou celle qui les charrie noblement, tête basse.
De temps à autre, le garçon se retourne pour voir si le couple toubab tient bon, s’ils suivent – ce qu’ils font, sans se plaindre. Oh, il en a déjà vu des comme ça, de quoi remplir quantité d’autocars. Des maris et des femmes, plus si jeunes que ça mais pas si vieux non plus, presque toujours aimables, souvent solennels, qui viennent implorer les dieux d’ici.
« On ne savait jamais réellement d’où ils venaient, ça paraissait capital pour eux, ils étaient si nombreux – tes parents pourtant je m’en souviens très bien. »
Dix-huit ans plus tard, Bamako. Édouard est chauffeur de taxi. À la centrale, ses collègues l’ont surnommé Oreilles courtes, ce qui ne lui plaît pas et représente d’ailleurs très mal, malgré de vrais lobes de bébé, ce gabarit de malabar à rendre patraque n’importe quel type de chaise. Nous buvons de la bière en terrasse du Coup de frein, un café-restaurant proche de mon hôtel. Je l’ai retrouvé finalement assez facilement grâce aux notes prises par mon père durant ce court séjour africain, consignées dans un petit carnet marron enroulé d’une cordelette en cuir ; je m’arrête un instant au sujet de ce curieux document : ce n’était pas du tout dans ses habitudes de tenir un carnet, mon père n’écrivait pas, rien, n’avait jamais eu, je crois, de journal intime, et s’acquitte encore poliment du minimum en ce qui concerne les cartes postales, les vœux de nouvel an, les petits mots ; mais ce cahier oublié, déniché dans les tiroirs d’une commode à l’étage parmi de vieilles photos et des déclarations d’impôts, avait ceci d’étrange qu’y figuraient, en sus de renseignements sur le trajet, le climat, les personnes croisées et ce qu’ils avaient mangé, des illustrations (avais-je seulement vu mon père dessiner quoi que ce fût, un jour de sa vie ?) réalisées aux crayons de couleur, un peu maladroitement – on devinait cependant, à défaut d’un talent qu’il aurait été stupéfiant de découvrir ainsi, une application presque écolière à reproduire une scène de marché, un embouteillage, le tumulte de la capitale malienne ; il y avait également plusieurs croquis d’un animal curieux, un genre de loup gris, de louveteau plutôt. À la seconde bière, j’ai montré à Édouard la page où apparaissaient son nom et le téléphone de son père, qui m’avaient conduit jusqu’à lui. Le louveteau se dressait sur la page d’en face et Édouard dit en riant Oh ! C’est Ogo !
— Le loup, là ?
— Ce n’est pas un loup. C’est un renard.
— Ça n’a rien d’évident.
— Mais si. C’est Ogo. Ou Yurugu. Le renard pâle.
— Le renard pâle ?
— Tu ne connais pas cette histoire ?
— Euh…
— Tu viens au Mali, tu dis que tu veux voir le Pays Dogon et tu ne sais pas qui est Ogo ?
— Attends, c’est marqué dans mon guide, mais je suis parti en coup de vent et…
— Tais-toi donc. Ogo est le fils d’Amma, le dieu créateur. Ogo fut transformé en renard pour avoir trahi son père. Car Ogo était prétentieux, il voulait devenir le maître du monde. Ogo se disait aussi savant que son père. Aussi savant que Dieu. Du ciel il se lança les yeux fermés dans le vide en arrachant un morceau de son placenta qui forma la Terre et sema sur le monde les graines volées au créateur. Dieu, ivre de colère, assécha les champs où ne poussa plus que le fonio rouge et impur comme le sang menstruel.
— Ah !
— Eh !
On trinquait.
— Ogo a été changé en renard parce qu’il s’est révolté contre son père ?
— C’est ça.
— En renard ?
— En petit renard blond des sables.
— Dieu aurait pu pardonner.
— Certes, mais Ogo a introduit le désordre dans le monde ; le désordre, ça fait beaucoup.
— Les fils sont le désordre, les fils sembleront toujours désordonnés aux yeux de leurs pères. Les pères construisent et nous, nous détruisons. C’est l’idée fixe, l’image courante.
— Mais qu’est-ce que tu racontes, toubab ?
— Cette bière me tourne la tête, il faut que je mange un truc.
— Pourquoi tu t’intéresses à Ogo ?
— C’est toi qui en as parlé. En regardant le dessin.
— Qui a fait ce dessin ?
— Mon père.
— Ton père ?
— Enfin, je crois.
— Tu crois ?
— Je crois. Je ne lui ai pas demandé.
— Toubab ! Tu es rigolo. Tu ne sais rien, en fait.
— C’est pour ça que je suis venu, pour que tu me racontes.
— Offre-moi à manger et je te dirai tout ce que tu veux.
En faisant mine de puiser dans sa mémoire, et sans que je puisse réellement savoir si oui ou non il me menait en bateau, Oreilles courtes décrivit mes parents comme volontaires et peu bavards – de bons marcheurs. La randonnée dura cinq heures et ils firent de nombreuses pauses et mon père soutenait ma mère tandis qu’elle se badigeonnait prudemment de crème en souvenir d’une insolation aux Baléares et mon père avait peur de manquer d’eau et demandait souvent si la route était longue et Édouard répondait ça dépend de quoi vous voulez parler, ce qui fit rire mes parents, à force. Un moment ils s’arrêtèrent et mangèrent des bananes séchées assis sur des rochers et Édouard dit qu’ils n’étaient plus qu’à vingt minutes de « l’arbre » qu’on voyait déjà. Mes parents se relevèrent : eux qui s’attendaient à quelque chose comme un immense et totémique baobab furent décontenancés lorsque leur éclaireur pubère montra du doigt ça, en l’occurrence un balanzan de très grande taille dont les feuilles d’un vert vif s’élevaient très en hauteur au-dessus d’une mare. À l’approche mes parents se turent, ils serraient leurs bâtons et semblaient récapituler les raisons qui les avaient décidés à prendre cet avion, ce 4x4 et ce guide, à s’engager sur ce chemin si sec – peut-être n’étaient-ils déjà plus si sûrs de leur choix.
Ils discernèrent alors la silhouette d’un homme, accroupi près de l’eau, auquel Édouard adressait des signes ; un très vieil homme. Mes parents, mon père en particulier, en furent éberlués car sous l’arbre, l’homme, coiffé d’un drôle de chapeau conique, préparait des haricots, des haricots qu’il écossait et mettait à chauffer à l’intérieur d’une marmite en terre cuite. Seul sur ce plateau craquelé !
Édouard présenta l’homme à mes parents et l’homme vint reconnaître leurs bâtons puis sourit. Et ensuite l’homme, qui suait énormément, le nez dans sa marmite – mais quand même moins que mon père – lui tendit six ou sept beignets de haricots qu’il avait fait frire dans l’huile de karité, paraît-il excellente pour la fécondité mais la fécondité masculine seulement, car il fut défendu à ma mère d’y toucher. À ma mère, le cuisinier dogon servit un bol de haricots en purée qu’elle dévora. Puis l’homme, qui n’était pas vraiment cuisinier mais plutôt médecin, décréta qu’il était l’heure en observant le soleil décliner. Il se leva et récita une ode à Nommo, le jumeau d’Ogo, sacrifié par Amma pour purifier la terre désordonnée. Cette prière impressionna ma mère car la voix de l’homme était terrible. Ce dernier s’interrompit. Et invita mon père au bord de la mare en le sommant de plonger dedans.
Mon père posa des questions, voulut savoir quels genres de bestioles pouvaient grouiller sous ces eaux brunes recouvertes de nénuphars, si par exemple il y avait des serpents (car mon père a horreur des serpents) et l’homme lui répéta de plonger. Mon père se déshabilla puis plongea et admit, tout en sentant des machins frôler son corps, que l’expérience était agréable. Au bout de quelques minutes, il lui fut ordonné de sortir de l’eau et ce fut le tour de ma mère, qui n’était pas rassurée. Mon père se doutait qu’il ne fallait pas discuter, que la réussite de leur séjour dépendait aussi de ce bain. Mais ma mère ne savait pas nager et ma mère avait peur et mon père le savait et mon père demanda s’il pouvait l’accompagner dans l’eau, lui tenir le bras. L’homme refusa, ma mère devait entrer dans l’eau seule. Il y eut un silence dont Édouard percevait le sens, accolé contre le tronc gluant du balanzan, et Édouard dit que la mare n’était pas très profonde et qu’il n’y avait que des poissons, des poissons magiques, et que la jolie dame blonde pouvait se baigner sans danger. L’homme jeta un regard noir à Édouard mais les paroles de l’adolescent parurent apaiser ma mère qui retira ses baskets et son pantalon et sa casquette et son boubou et entra progressivement, comme un enfant, dans l’eau, les jambes tremblantes, en se mordant les lèvres. Elle émit des cris aigus, mon père l’écoutait la suivait l’encourageait prêt à plonger si jamais elle glissait, ce qui n’arriverait pas, et ma mère s’immobilisa lorsque le niveau de l’eau atteignit ses épaules et regarda l’homme pour savoir si c’était assez car elle sentait tout de même des formes visqueuses slalomer entre ses genoux, et dussent-elles être des poissons, des poissons magiques, cela ne lui plaisait guère ; l’homme se rapprocha du bord et se baissa et dit non, statuant que ma mère devait immerger complètement sa tête, ce qui la contraria car cela ficherait en l’air son maquillage et sa coupe de cheveux et mon père regarda ma mère avec tendresse pour lui signifier que ça n’avait aucune importance, badouille, et mon père fit une blague en direction de l’homme qui ne la comprit pas au sujet d’un défilé de mode très attendu dans la brousse et Édouard se marra discrètement. Ma mère soupira et laissa fléchir ses jambes et retint sa respiration. Et s’immergea entièrement pour réapparaître six secondes plus tard les cheveux mouillés, son make-up dégoulinant, on aurait cru des larmes mauves et elle était comme choquée par ce qu’elle avait entrevu dans les profondeurs, disait-elle, une myriade de poissons multicolores, ce qui étonna mon père qui n’avait pas ouvert ses paupières sous l’eau.
L’homme ordonna à ma mère de sortir de la mare, ce qu’elle fit laborieusement car ses pieds s’enfonçaient dans la boue. Mes parents séchèrent au soleil et se rechaussèrent puis l’homme leur cria de reprendre leurs bâtons et mes parents ne saisirent pas pourquoi le ton était monté si brusquement. Mais ils ramassèrent leurs bâtons. Et suivirent l’homme sur un large promontoire qui surplombait la mare, face à l’arbre.
Il y eut une autre ode, plus courte que la précédente. L’homme dit à ma mère – sa voix était dorénavant plus aimable – de reculer vers le centre du promontoire. C’était maintenant l’heure d’appeler l’esprit de l’enfant. L’homme demanda à ma mère à combien d’enfants elle avait déjà donné la vie et ma mère répondit un, s’il s’agissait d’un garçon ou d’une fille et ma mère répondit un garçon, si ma mère pensait que l’enfant à venir serait une fille ou un garçon et ma mère répondit une fille, en adressant un sourire à mon père qui le lui rendit. Et l’homme fit « bien ». Et demanda à ma mère de répéter après lui une prière et ma mère répéta la prière, portée par un vent léger qui parcourut toute la Terre. Puis l’homme demanda à ma mère de frapper le sol de toutes ses forces avec le bâton ; ma mère fut surprise car le bâton, jusqu’ici, était considéré par tous comme un objet très précieux et elle avait peur de le casser en tapant trop fort. L’homme lui dit de se taire et de frapper le bâton sur le sol de toutes ses forces en pensant à l’enfant. Alors ma mère recula de trois pas et souleva son bâton et vit une petite blonde qui babillait et toutes les deux elles s’aimeraient, s’entraideraient, et ma mère frappa le sol très, très fort. Les pierres et les colliers volèrent et le crâne du bâton se fendit et des graines en surgirent, éparpillées sur le sol. Et l’homme fit « bien ». Et dit à mon père de se diriger vers le centre en lui demandant s’il pensait que l’enfant à venir serait une fille ou un garçon et mon père répondit que pour lui c’était la même chose, qu’il serait heureux dans les deux cas et l’homme lui dit qu’il n’avait pas répondu à la question et mon père répondit qu’on ne pouvait jamais vraiment savoir et le ton de l’homme se fit de nouveau dur et mon père répondit enfin ce sera une fille je pense. L’homme demanda à mon père s’il élèverait cet enfant comme il avait élevé le précédent, quoi qu’il arrive, et mon père répondit je l’élèverai comme le précédent, quoi qu’il arrive. Alors l’homme ordonna à mon père de frapper de toutes ses forces avec son bâton le sol à l’endroit où étaient tombées les graines. Mon père ne se fit pas prier et recula avec joie de trois pas et leva son bâton qu’il éclata en morceaux sur la terre, libérant un liquide ocre, consistant, qui se mélangea aux graines. Et l’homme fit « bien ». Et mes parents se regardèrent avec satisfaction. Mais il y eut un problème.
— Un problème ?
Édouard marqua une pause et trempa son pain dans ce qui restait d’un bœuf mafé nappé d’une sauce au beurre de cacahuète. J’étais captivé. Et soucieux.
— Au lieu de l’esprit de l’enfant, c’est le renard pâle qui est venu.
« Elle a jeté ses bras autour de son cou. Je les ai regardés un moment. Alors tout est devenu clair dans mon esprit. Toutes ces semaines, les choses que je voulais dire, les choses que je désirais écrire – maintenant je pouvais les écrire, et les émotions de mon sang se mêleraient à l’encre, s’étaleraient d’elles-mêmes sur le papier blanc. Je me suis précipité dans ma chambre, assis devant ma machine, et ça a coulé comme d’une source magique. »
John Fante, Le Rêveur (1947)
1.
C’est un blouson de cuir marron, épais, lourd, modèle aviateur, proche de ceux portés par les Marines pendant la guerre du Pacifique. Deux grosses poches à l’avant lui donnent un côté rétro, un peu plouc, usé, eighties – plutôt costaud. Ça fait flic. Ajoutez deux épaulettes pour l’aspect militaire, un zip en argent (rayé) et une seconde fermeture Éclair, à l’intérieur, pour la doublure que j’oublierai de prendre en quittant la friperie.
— Qu’il pleuve ou qu’il neige il ne peut rien vous arriver, moi je fais de la moto avec.
Le vendeur l’essaye devant moi et ce blouson lui va si bien (je ne fais pas de moto) qu’il est tenté un instant de le garder pour lui. Je sors mon chéquier – une brûlure de cigarette, un petit trou, me vaut une ristourne. C’est un accessoire urbain, très urbain, un peu râpé aux extrémités ; une manche est abîmée, je m’en rendrai compte assis sur mon lit. En somme, une erreur cet achat, mais lorsque je l’enfile, j’ai l’impression de partir en mission. Aux feux, dans les rues, sur les trottoirs trempés, le quai du métro, je me sens comme en planque, le regard sombre, tendu, justicier, les sourcils en alerte. Incognito, je fais comme si la marée de mes semblables n’était composée que de pickpockets, de dealers et d’assassins. Je me prends pour mon père ou plutôt : pour l’idée que je me fais – que je me faisais – de mon père. Mon père est flic. Commandant, à la PJ. Passé par divers services, la crim’, les stups, les étrangers, les mœurs. Les mœurs, c’était le pire et le soir, il rentrait parfois très abattu. Ma mère l’écoutait. Il lui arrivait de pleurer ; une affaire l’avait amené à traquer un réseau de notables immondes qui filmaient des jeunettes, les séquestraient. Mon père visionnait les vidéos qui circulaient afin de trouver des pistes, remonter la filière.
Côtoyer la lie de l’humanité, tu parles d’un métier.
Lorsqu’on me demandait, gosse, ce que je voulais faire quand je serai grand, deux personnes répondaient pour moi la plupart du temps ; n’importe qui disait comme son père, comme si la police était un corps héréditaire, une vocation contagieuse ; puis, en retrait, ma mère rectifiait : certainement pas.
Ses amis et ses collègues disaient que mon père était un homme courageux. Tout ceci contribuait à faire de lui, dans mon esprit, une figure héroïque ordinaire, un mec bien, comme tous les pompiers, comme tous les médecins.
Mon père n’a jamais porté l’uniforme, sauf une fois je crois, lorsque Jean-Louis Debré, alors ministre de l’Intérieur, lui remit une médaille, ainsi qu’à son équipe, pour l’arrestation d’un terroriste. La photographie de mon père épinglé par Debré (qui, lui, embrassa le même emploi que son papa) trône encore dans la salle à manger : mon père se marre ; il se dit que Debré, quand même, a une tête d’andouille – le père de mon père fut boucher-charcutier pendant plus de vingt ans, cela laisse des traces. Bien sûr, il mettait cravate et costume bon marché lorsqu’il s’agissait de se rendre au palais de justice pour témoigner lors d’un procès, mais bien avant qu’il ne soit nommé divisionnaire, puis commandant, et bien avant qu’on ne lui conseille de prendre ses distances avec le terrain pour raisons cardiaques, je l’ai toujours vu partir au boulot (il ne disait pas au travail) dans des blousons de cuir épais, lourds – mon père fait de la moto – proches de ceux de Depardieu dans Police ou Inspecteur la Bavure (qui joue, dans le second cas, le voyou, puisque le flic, c’est Coluche), ou de longs imperméables beiges, trench-coats de coupe américaine. Ça façonne une image paternelle d’enfer, si vous voyez ce que je veux dire. Même si le père a toujours été plutôt pudique ; volontiers cabot, surtout lorsqu’on avait des invités, mais pas frimeur. Et quand je me coltine ce cuir pourri, seyant mais pas très sexy, pratique mais pas du tout chic, j’ai l’impression d’entrevoir son quotidien, son quotidien de flic.
J’étais tenté, pour couronner la panoplie, de me coiffer d’un feutre gris très anglais mais je me ravisai : certainement pas. Déguisé en mon père, j’étais rentré chez moi pour jeter dans un sac quelques bidules étalés sur mon clic-clac : cahier, stylo, dictaphone, carte bleue, passeport, du linge de rechange et le carnet marron. Ainsi que deux ou trois romans. J’étais mûr – du moins, le supposais-je – pour ma propre enquête, qui me permettrait de comprendre quel genre de flic était mon père, quel genre de père était mon flic, pour qui battait son cœur et comment diable un renard blond des sables avait pu mettre un tel souk dans la vie de mes parents et, par ricochet, dans la mienne. Je prendrais des trains, des avions, reverrais la mer et mes repères. Mais avant, je devais donner de l’ordre à mes souvenirs.
2.
L’horizon de mes parents m’a toujours paru figé. Ils se sont rencontrés dans une boum à 18 et 20 ans, ma mère portait une jolie robe jaune et mon père revenait du rugby ; il lui apparut tout frais, grand et mince, élancé, la peau brillante comme au sortir de la douche, les muscles saillants sous la chemise cintrée. Tous deux avaient les yeux bleus et de longs cheveux blonds et lui, déjà, cette moustache hippie qui permettait de ne pas les confondre. Ils se sont vus, ils se sont aimés, ils en ont profité cinq années avant de se marier, puis de nouveau cinq années avant de se reproduire, ils ont pris cette maison reliée par le jardin à celle des parents de mon père – leur meilleure erreur – et c’est à peu près tout. Presque par hasard, mon père tenta le concours d’inspecteur de police, obtint un poste sans difficulté, et ma mère, seulement titulaire du certificat d’études, tisseuse en usine dès l’âge de 14 ans, attendait d’avoir un enfant, la suite logique.
Très poliment, je suis né.
Mon frère aussi, huit ans plus tard.
À ma naissance, ma mère quitta son emploi et se fit nourrice, au noir ; officiellement pour augmenter les revenus du ménage, officieusement, j’imagine, pour s’occuper. L’homme donnait le tempo, disparaissait plusieurs jours, rentrait tard ; lessivé. La femme entretenait sa maison comme un modeste royaume, avec soin, choyait ses petits, veillait sur d’autres. Ma mère possède ce don : peu de minots lui résistent, elle sait les prendre. Nous avons eu de tout, des neuneus des cinglés des angelots, des précoces des marrants des empotés. Tous recevaient la même attention.
Chacun de leur côté comme ensemble, mes parents renvoyaient l’image exacte d’un couple joyeux, chaleureux, sollicité. Mon père plaisantait souvent à ce sujet : Pour nous inviter ? Prenez rendez-vous : nous ne sommes pas libres avant trois mois. Mon goût pour la fête et surtout pour la danse, de préférence en appartement, des heures durant, transpirant, pur amateur, party animal, pour rire et se détendre, en rythme, taper dans les mains tout en sachant que c’est démodé, second degré qui rejoint le premier par l’épanouissement de la carcasse et donc de la tête, mouvements spectaculaires et genoux qui twistent à se rouler par terre, hurlant parfois jusqu’à frôler la rupture d’anévrisme… mon seul sport régulier, ma sociabilité transcendée, c’est à eux que je le dois. Tous les week-ends, ils chantaient s’excitaient déconnaient, enfilaient des perruques des lunettes fantaisie, tous les week-ends ils s’amusaient, faisaient la bringue les uns chez les autres avec une bande qui, dommage, s’étiola d’année en année, de séparations en lassitudes. Ma mère le constatait avec étonnement, fierté, inquiétude : de tous leurs proches, ils étaient les seuls à n’avoir pas divorcé.
Le club de 4x4 que présidait mon père emportait ce qui lui restait de temps libre : trois jours par-ci par-là, rallyes, courses, mille rivières. Il tentait cependant de nous impliquer dans sa marotte. Je suis parti avec lui, quelquefois, copilote en K-way, infichu de lire une carte, tout juste bon à raconter des blagues sur les ondes de la CB, content d’être là, côte à côte à gagner des coupes, dormir dans des gîtes ou casser la croûte au bord d’un lac – un jour, en me tendant mon sandwich au jambon blanc, il m’avait dit qu’il m’aimait, j’avais souri, c’était mon père. Mais contrairement aux autres garçons, la vitesse et les moteurs ne m’intéressent pas. Souvent j’ai peur et je suis malade. Lors des épreuves, je ne restais pas dans le Mercedes : je préférais les paysages désolés, monts de poussière, carrières et marécages abandonnés où ses copains, leurs femmes et leurs machines se remorquaient au treuil, surmontaient les bosses, évitaient les trous, traversaient les bourbiers. Tous les pièges. Je regardais. Mon père était heureux et moi, je ne m’ennuyais pas trop. Quant à ma mère, elle a toujours eu des problèmes de dos, de jambes, de cartilage, ce qu’elle regrettait. Elle venait de temps en temps ; ça ne la branchait pas non plus, mais elle souhaitait vivre un bout du truc avec lui. Et si j’écarte l’escapade africaine, ils ne sont plus jamais partis en voyage – les vacances, c’était toujours au même endroit.
3.
Il n’y a, selon mon père, trente-deux ans de carrière et bientôt à la retraite, que deux films valables sur la profession : L.627, réalisé en 1992 par Bertrand Tavernier, sur un scénario de Michel Alexandre pour sa vision quasi documentaire de la précarité de la police française et du spleen de ses représentants, et Le Cousin, réalisé en 1997 par Alain Corneau sur un scénario de Michel Alexandre, un ancien de la maison, sur les rapports des flics avec leurs indics. Dans Le Cousin





























