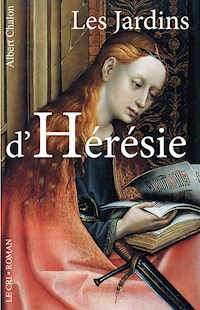
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Cri
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
L’empereur
Charles Quint règne. Le jeune Érard est envoyé par son père à Bruxelles au service du seigneur de Brederode en qualité de clerc. Pour plaire à sa jeune maîtresse Amelia, et dorer son blason, il suit son seigneur aux armées, revient défait, va chez le prince d’orange où il rencontre à Breda le jeune Palamède, cousin et pupille du prince, à qui il enseigne les préceptes Érasmiens. La fortune lui sourit, ainsi que l’amour de deux femmes, Amelia et sa nièce Polyxène. Il cèdera à la folie de favoriser les amours de Polyxène en l’aidant à s’enfuir de la geôle de son oncle Brederode, et retrouver Palamède qui a du s’exiler en Angleterre. De là surviendront ses déboires, bien qu’il se soit gardé d’entrer dans la querelle des religions. À l’arrivée du duc d’Albe et ses Tercios, Amelia a suivi son époux en exil, comme le prince d’Orange et bien d’autres. Nanfal, son frère d’armes, qui s’est converti à la réforme, est arrêté, torturé, et décapité. Érard prend parti et s’enfuit en Allemagne à la recherche d’Amelia, avec le dessein de se joindre à l’armée des Geux…
À PROPOS DE L'AUTEUR
Albert CHALON est né à Wanlin en Famenne namuroise le 12 juin 1922. Enfance rurale, études cahotiques, métiers rustiques, guerre de quarante, ministères et retraite.
Les Jardins d’Hérésie est son premier roman. Mais quel roman !
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 510
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Les Jardins d’Hérésie
Albert Chalon
LES JARDINS D’HÉRÉSIE
Roman
Catalogue sur simple demande.
www.lecri.be [email protected]
(La version originale papier de cet ouvrage a été publiée avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles)
La version numérique a été réalisée en partenariat avec le CNL
(Centre National du Livre - FR)
ISBN 978-2-8710-6795-5
© Le Cri édition,
Av Leopold Wiener, 18
B-1170 Bruxelles
En couverture : Jacques Daret,Vierge à l’Enfant entourée de saints dans un jardin clos,vers 1425, détail.
Tous droits de reproduction, par quelque procédé que ce soit, d’adaptation ou de traduction, réservés pour tous pays.
La défaite est le blason
des âmes nobles
(devise desHidalgos)
1
Bruxelles
Il m’aurait plu de garder
à ce récit le ton de l’ironie.
1548.
Il fut joyeux ce matin d’octobre quand le soleil perçant la brume en traits fins émergea des pignons flamands. Lumière dorée d’automne, gloire des ors ternis des balustres, meneaux, angelots, redans, épigraphes dorés, rinceaux colorés, acanthes, iris, à donner le tournis, ravis à l’ombre de la nuit. Moi je n’avais pas d’âge et j’avais dormi en hôtel noble, dormi sans le souvenir des rêves que font les jeunes hommes, sans même la rumeur des grandes maisons qui n’atteint pas les combles où l’on avait déposé mon modeste bagage. Entré la veille sous la porte de Namur, un roulier me guidant, Wollendries, la rue aux Laines et l'hôtel de Brederode. Devant ce porche, trois gentilshommes portant barbiches et chapeaux emplumés, hautes bottes plissées et épée au fourreau m’avaient regardé passer devant eux avec sous le nez ou la moustache, un sourire qui me fit mettre la main au pommeau de la rapière que je traînais, trop longue pour ma taille et relevait le bord de la cape dont je m’étais affublé. Je pensai qu’il irait de mon honneur et dans la bonne tradition de leur demander quel pouvait bien être en ce lieu l’objet de leur amusement, ainsi qu’il sied aux jeunes provinciaux venus du fond de leur campagne se frotter aux dures réalités de la grande ville. Un majordome armé d’une haute canne sumontée d’une boule d’argent en forme de poire, qui devait bien peser douze livres, me détourna opportunément de ce projet dont le moindre risque eût été d’interrompre déjà une carrière prometteuse. Frappant le pavé du bout ferré de son ustensile, le cerbère s’interposa dos tourné aux trois compères, et me pria de décliner mes noms et titres, ce que je fis le regard tourné vers eux, qui déjà n’avaient plus d’yeux que pour un montreur d’ours, son singe sur l’épaule, qui jouait de la flûte en s’approchant de nous. Voilà qui me plaçait dans une hiérarchie de valeurs fort en deçà de ma propre estime.Le massier solennel, sa masse à l’épaule, me précéda sous le porche en procession, et j’y fis une entrée que je jugeai séante.
J’avais clamé haut et fort : « Erard, Pie, Arroy d’Uchy, de cette baronnie et avouerie en principauté de Liège ». Pour moi cette enfilade valait bien un titre. Erard, comme filleul de l’illustre cardinal de la Marck, notre défunt prince-évêque, Pie, ô lèse-papauté, pour Pierre, Arroi notre patronyme et Uchy, cette greffe, pour le nom d’une ville serrée au pied d’une colline boisée dont l’à-pic sert de socle à son château ruiné. Ancienne baronnie, aujourd’hui simple avouerie, enserrée dans des murs ébréchés d’encore cent foyers d’artisans, laboureurs, bûcherons et de quatre villages, hameaux, fermes, terres et bois y attenant. Nous restions ainsi titrés par ancienneté et habitude sans qu’il y parût nulle imposture.
Il y avait certes chez nous une ambiguïté : l’aïeul dont nous avions mémoire était avoué héréditaire, exerçant la justice hautaine, clerc, ainsi qu’ils le furent tous y compris mon père, et tous hommes de lois, greffiers, échevins, même celui-là, secrétaire puis procureur auprès de son Altesse le prince-évèque Monseigneur Adolphe de Waldeck. Car nous étions en terre liégeoise. En des temps qui me paraissaient lointains, mais que mon père se plaisait à rappeler, ce prince, contrairement à bien d’autres prélats avait eu le mérite de se ranger aux côtés du peuple le plus indocile qui fût au temps où la chevalerie française de Philippe le Bel laissa ses éperons dorés dans la vase des marais de Courtrai, deux siècles et demi plus tôt. Savant théologien, à qui la cuirasse séyait autant que les étoles, le prince Waldeck appréciait les belles lettres et les arts, et la conversation de ces dames. Ce qui n’était que médisance, ajoutait mon père pour ce dernier attribut. Suivait immanquablement la geste du prélat, qu’à sept ans j’avais trouvée fort admirable, d’autant que notre aïeul en fut ; en sa bonne ville de Liège l’évêque avait fait un jour irruption aux comptoirs des Lombards, crosse brandie et mitre en tête pour y saisir les objets déposés en gage et les restituer à leurs propriétaires. L’affaire avait de quoi plaire au peuple ; pour faire bonne mesure et plaire aux bourgeois, quelques sévères expéditions contre les écorcheurs ajoutèrent à sa renommée. Notre aïeul était de ces parties aux côtés de son prince et ne rechignait pas non plus à troquer la plume pour l’épée. Pour cela et pour d’autres services non moins insignes, le prince l’autorisa à porter le nom de la ville dont il était issu — Uchy, accolé à notre patronyme — et pourvut l’avouerie d’assez de terres et de bois pour recréer le fief. Par malheur pour les miens, le bon prélat ne vécut pas assez pour relever la baronnie et titrer notre aïeul. Avant que le très vénérable chapitre de Saint-Lambert fût saisi de la cause, il trépassa. Empoisonné dit la rumeur, par les Lombards qu’il avait chassés de la Cité. Tout cela fut écrit en onciales d’Irlande et orné de lettrines dont les couleurs avaient déteint, puis en gothiques cursives, et en bâtardes pour les plus récentes, toutes sur parchemins ou palimpsestes bien enroulés frappés de rubans scellés auxquels il m’était défendu de toucher. Le successeur du prince Waldeck, Adolphe de la Marck nous fut moins favorable. Il eut un règne plus long, si encombré de batailles, de traités et de ripailles, qu’il en mourut dément. Mais, avant son trépas, il avait eu le temps de mettre en pièces quelques chartes anciennes comme de plus récentes qu’il regrettait d’avoir signées. Par un hasard malencontreux — ou excès de zèle de ce tailleur de parchemins — la nôtre fut réduite en charpie. Il y eut procès et longues procédures où excellaient mes aïeux, qui avaient chargé leur écu de deux plumes croisées, l’une blanche et l’autre noire. Ils mirent tant de passion à cette querelle que les revenus du fief n’y pouvaient plus suffire. Mon père y fut moins attentif et la laissa pendante. Mais il m’en entretint longtemps, ne m’épargnant aucun détail, comme d’une épopée.
Par opiniâtreté du sort, les Bourguignons du duc Charles qui s’en allaient châtier Liège avec le roi Louis XI en otage, passant par là, ruinèrent le manoir. Je naquis donc en la maison de l’Évêque, une grande demeure incommode et froide en contrebas des ruines, qui eut l’insigne honneur de loger une nuit un prélat attardé à la poursuite d’un cerf ou bien d’un sanglier. Le lieutenant-prévôt Linard en occupait une moitié ; le bougre pourvut à mon éducation militaire. Il n’avait pas de fils, je n’avais pas de frère, il reporta sur moi le trop-plein de ses vertus guerrières.
J’avais quitté Uchy enfant et les saute-ruisseau dont je partageais les jeux, le cœur arraché, pour l’école de l’abbaye de Waulsort où l’on cloître des garçons destinés à la prêtrise ou au métier de clerc. Je m’étais dépêtré radicalement de la pesante chape de dévotion et de claustration de ce monastère en sautant le mur, et rentré penaud à Uchy, j’avais tenté de persuader mon père que j’y perdais mon temps et son argent et qu’il m’enseignerait aussi bien, sinon mieux que les bons pères, les arcanes de la procédure en plus des philosophes et de la mathématique. Au lieu de quoi il m’expédia à Louvain tâter du droit romain sous la chaire de Mudeus, le plus docte qui fût en cette matière. Je m’étais trouvé là-bas en concurrence avec des séminaristes savants et autant de gentilshommes qui l’étaient moins, aspirant à quelque emploi chez un grand seigneur ou même à la cour de madame la régente Marie de Hongrie, sœur de l’empereur, ou prêts à s’engager faute de mieux dans les compagnies d’ordonnance pour une maigre solde et courtiser la fortune et la gloire.
Les affaires de l’empire avaient de quoi exalter nos jeunes enthousiasmes sinon calmer nos impatiences, bien que déjà les liens de vassalité des comtés de Flandre et d’Artois envers la France eussent été tranchés par le traité de Valladolid trois ans plus tôt au profit de l’empire et qu’à Augsbourg cent éminents juristes tinssent concile à l’effet d’unifier le droit successoral et déclarer les dix-sept provinces des Pays-Bas unies et inséparables. Le grand rêve des ducs de Bourgogne d’une nouvelle Lotharingie enfin réalisé par l’empereur ! Cependant, tout cela passait pour l’instant au second plan de mes préoccupations, je servirais à présent le parti des seigneurs de Brederode en leur hôtel de Bruxelles. Pour provisoire qu’il fût, cet état dérogeait à la tradition paternelle de servir à Liège sous nos princes-évêques, les relents de notre procès insuffisamment dissipés dans l’entourage du prince, et surtout chez quelques chanoines rancuniers, m’y eussent desservi.
Mon propos ici n’est nullement, bien qu’il y paraisse, de narrer ma propre aventure, mais bien celle du sieur Palamède, qui n’entrera dans mon récit qu’à mesure des situations et des événements qui suivront mon entrée chez les seigneurs de Brederode. Tant il est vrai que nos vies sont liées à celles des autres et inversement, comme disait sentencieusement maître Salien sur qui je reviendrai. Il m’aurait plu de garder à mon récit le ton de l’ironie car il me semblait par instants que les événements de la vie arrivassent à un autre qu’à moi dont je partageais les expériences et à qui les conséquences incomberaient aussi — les pires et les meilleures.
Le galetas où le valet avait déposé mon bagage ne me plut pas, j’y étais logé en trop nombreuse compagnie, aussi, passé cette première nuit, je repris mon balluchon et m’en fus chercher un logis plus digne de mon état, une chambre assez misérable en haut de la rue des Chandeliers, mais j’y étais chez moi.
Renaud III de Brederode était de la noble lignée des anciens comtes de Hollande aujourd’hui régnant, mon père m’avait bien averti de l’histoire de ces seigneurs et de la hautesse de mon futur maître, membre du Conseil d’État et conseiller privé de madame la régente. Son second fils Henri, sorti à dix-huit ans des pages de Charles Quint se préparait à entrer aux armées. L’hôtel de Brederode à Bruxelles, en lisière du quartier noble, domine la vieille ville en contrebas. Une vaste esplanade et des jardins le séparent des autres demeures et parmi ceux-là un grand jardin-enclos, dont je parlerai. Au bout de la longue allée, la cour pavée résonne dès le matin au roulement des voitures, sous le pas des visiteurs et au va-et-vient incessant d’hôtes de tous acabits salués selon une juste mesure par le majordome géant ; des dames fort élégantes, des nobles chamarrés entourés de leurs valets, des juristes en robes, des gentilshommes à moustaches comme de montreurs d’ours. De la fenêtre de la chambre des comptes où je rêvais de gloire, quittant mon écritoire, mon regard se perdait dans le prolongement de l’allée par-dessus les toits des hôtels nobles jusqu’à la tour et aux longues toitures de l’église Notre-Dame des Victoires au Sablon toutes luisantes sous leurs ardoises neuves, et vers les jardins de l’hôtel de Nassau en contrebas, et bien au-delà vers les frondaisons du parc de la Warande et qui me rappelait Uchy. Admirable perspective, avait coutume de dire maître Salien, mais dont je fus bien vite lassé. Affecté à l’intendance de ce grand hôtel, où les receveurs des domaines de Hollande venaient rendre compte des revenus et dépenses de leurs états quand leurs maîtres résidaient à Bruxelles, ce qu’ils firent plus souvent du temps de l’empereur que sous son successeur le roi Philippe II. Ce rôle, que je jugeai trop modeste quand on me l’imposa, m’apprit le côté pratique des choses et surtout que l’argent, s’il manque toujours aux gens de condition modeste — ce que je savais déjà —, se gère chez les riches, sauf pour leur train de vie, avec parcimonie.
Les fêtes du mariage du jeune Henri eurent lieu au château de Batestein à Vianen qui est en deçà d’Utrecht au nord du Brabant où j’accompagnai maître Salien, gouverneur de l’hôtel de Bruxelles, et quelques autres scribes et comptables pour la figuration et le cortège, et bien un peu en ce qui me concerna pour la relation détaillée des inventaires de l’argenterie, des ornements de tables, candélabres, tapisserie de haute lice et autres utilités. Tâches que je jugeais très en dessous de mon état, mais je dus bien entendre que, dernier arrivé, de tels devoirs m’incombaient autant qu’aux autres gentilshommes, qu’il n’y a nul déshonneur à servir de si hauts personnages.
Henri de Brederode épousa la très belle Amelia de Neuenahr, d’un lignage moins fortuné mais d’aussi ancienne noblesse et seigneurie voisine. La beauté parut si parée de dentelles, de joyaux et de voiles que je n’en pus juger sauf à m’en remettre aux on-dit. Jamais je n’avais vu autant de grandes dames, si ornées de bijoux, de dentelles et de perles que même les laides me parurent belles. Et leurs époux en portaient autant ; colliers, Toison d’or, pierres, vair et fraises empesées séyaient autant aux mignards qu’à adoucir d'authentiques rusticités. Les fêtes éblouirent l’ingénu que j’étais. J’y vis les plus grands noms des Pays-Bas : ceux des quatre duchés, de Brabant, Limbourg, Luxembourg et Gueldre ; ceux du marquisat d’Anvers, du comté de Namur ; ceux des cinq seigneuries, de Tournai, d’Utrecht, d’Overijssel, de Frise et de Groeningen ; ceux de la principauté de Liège ambassadeurs de mon bienfaiteur Monseigneur Georges d’Autriche. Des princes et seigneurs allemands venus de la proche Rhénanie, magistrats, bourgeois et nobles de moindre importance. C’est là que pour la première fois m’apparut, gracieuse et lumineuse entre toutes, l’enfant Polyxène de Mansfeld, nièce de l’heureux époux et première des petites demoiselles de la traîne de l’épousée. Ce ne furent pendant tout un mois que fêtes et musique. Il y eut des tournois, sans quoi on ne peut concevoir de fête, on y brisa des lances et des membres avec entrain. Qui ne portait un bras en écharpe ou turban en guise de pansements ? J’en revins moi-même meurtri de m’être mesuré à des chevaliers plus éprouvés que moi.
Après la noce il fallut bien se remettre à l’ouvrage et je besognai quelque temps à la chambre des clercs. Ce n’étaient là que tâches indignes de l’idée que je m’étais faite de servir un seigneur. Nonobstant le respect que je devais à mon père, j’avais résolu de prendre congé de mes plumes et de mes encres, quand je fus appelé à paraître devant Monseigneur Renaud III de Brederode.
Je fis antichambre avec des porteurs de parchemins, plus patients que moi, et quand vint mon tour, je dus en appeler à de profondes ressources d’orgueil en m’inclinant devant le vieux seigneur. Il avait le nez fort et un regard d’enfer sous la broussaille grise de ses sourcils, le menton haut prolongé par une barbe en pointe poivre et sel. La Toison d’or en petit collier brillant sur son habit de velours noir, il me parut terrible. L’insolence, en pareilles circonstances, aide à la contenance. Elle me souffla qu’il s’en était fallu d’un mot de l’empereur pour que cette tête-là tint encore sur les épaules de celui qui, au grand déplaisir de l’empereur Charles Quint, avait osé arborer dans les rues de Gand les armoiries complètes des comtes de Hollande comme étant les siennes, et si longuement revendiqué la souveraineté des seigneuries de Vianen et de quelques autres fiefs hollandais, et avec tant de hargne qu’il s’était vu condamner à la peine capitale. Sentence levée par l’empereur qui préférait se faire de puissants adversaires des alliés plutôt que de leur faire trancher la tête. Renaud III m’observa un instant avant de parler. Je soutins son regard. Debout derrière lui, à sa droite, se tenait Henri, son second fils, un grand rouquin maigre au nez et aux pommettes écarlates, à sa gauche un personnage important de poids et de tenue, maître Salien, gouverneur de l’hôtel.
— Monsieur, me dit le vieux seigneur, je suis bien aise que la recommandation de monseigneur votre prince-évêque soit suivie d’un rapport de la chambre des clercs. Élogieux pour vous. Notre gouverneur maître Salien m’en informe et me rappelle que vous portez le nom de baptême de notre illustre frère le cardinal Erard de la Marck, dont vous êtes filleul. Vous savez sans doute ce qui vous a valu cet éminent patronnage ?
Je savais que son éminence, trop tôt décédée, fut le frère de l’épouse de Renaud III, devant qui je me trouvais en train de perdre pied. Je répondis qu’il était d’usage dans ma famille, depuis que nous les servions, d’honorer nos princes en sollicitant leur parrainage pour les fils aînés.
— Vous le devez aussi à cette ancienne promesse que je fis à son éminence le défunt cardinal, à la requête de monsieur votre père.
Il fit une pause et tourna la tête vers son fils, comme pour lui faire un commentaire, mais voyant son désintérêt il revint à moi.
— Votre terre d’Uchy est, et restera, liégeoise, mais qu’à cela ne tienne, monsieur d’Autriche est pour l’heure notre allié et, en nous servant, vous le servirez aussi.
Je ne pus m’expliquer le sens de cette phrase. Tourné vers son fils il poursuivit.
— Il est d’ailleurs temps que l’on vous mette à la tâche. Vous ferez désormais partie de la maison de mon fils Henri, qui sort des pages de Sa Majesté et se prépare à rejoindre l’armée en Allemagne.
Ce présent ne parut pas émouvoir outre mesure le jeune homme qui acquiesça d’un signe de tête à peine esquissé, le regard porté au-dessus de mon chef. Je rougis sous l’offense et, redressant la tête, m’intéressai ostensiblement aux détails d’une tapisserie d’Alost ornant le mur du fond. Le patriarche se détourna de moi, l’entretien avait pris fin. Orgueilleux au point d’offenser sans cause ne peut être le fait que de la sottise, Henri devait n’être qu’un sot, j’en décidai ainsi pour me laver de l’affront. J’acquiesçai d’un signe de tête réticent à cette désignation, et me retirai avec malgré tout un sentiment accru de ma dignité et la satisfaction de quitter bientôt mon emploi sédentaire. Ce que je n’avais pas dit, et que devait ignorer le vieux seigneur, c’est que mon père avait abandonné notre procès, qu’il savait perdu ; abandon assorti de promesses floues de bénéfices et d’usufruits aléatoires, outre un rappel des recommandations promises d’un emploi pour son fils à la hauteur de sa propre estime. Ma vie allait changer ; le jeune Henri s’apprêtait à partir en campagne.
Mais il m’oublia.
J’en appelai sur-le-champ à maître Salien, qui m’exhorta à prendre patience, le temps d’en référer à son seigneur et maître. Il se servait d’un escabeau pour atteindre un siège tarabiscoté, trop haut pour sa taille, mais qui lui donnait une position dominante derrière une table luisante de cire. Il tira d’un coffret quelques pièces d’or et d’argent qu’il se mit à compter de ses doigts boudinés, il en fit une petite pile qu’il poussa devant moi. Comme je ne faisais pas le geste de m’en emparer, il crut utile de préciser que cet argent représentait le fruit de mes services depuis que j’étais de cet hôtel. Nul autre que mon père ne m’avait jamais donné d’argent ! Chez nous, Mathot le vieil intendant s’enfermait pour ces choses-là avec mon père en des messes basses où je n’étais pas sonneur. Je me sentis fort outragé qu’un étranger m’en offrit ; l’on me faisait l’aumône. Que pour le prix de mon dévouement et de plus grands services, des terres, des biens ou des droits me fussent offerts, je l’aurais accepté, mais de la monnaie sonnante. Non ! D’argent, j’en avais pourtant grand besoin, mais il me répugnait d’en accepter ainsi. Maître Salien reprit donc son or, qui serait, me dit-il, ajouté à ce qui me serait dû par la suite et dont j’aurais à apprécier davantage l’utilité. Sauf quelques pièces qu’il m’enjoignit de prendre car, ajouta-t-il, il se considérerait comme offensé que quelqu’un de sa maison s’endettât et lui fît mauvais renom. L’argent dont mon père m’avait muni avait été joué et perdu aux cartes et j’avais jusqu’à présent payé mon loyer et les services d’une concierge-cuisinière en acomptes de promesses, je lui portai derechef les pièces de maître Salien et elle cessa de me harceler. Je rentrai donc à la Chambre des clercs. Le jeune Henri de Brederode n’avait reçu au départ que le commandement de quelques lances et je voulus croire qu’il n’avait pas jugé bon de s’encombrer d’intendance ; ou bien me croyait-il inapte à porter l’épée ? Je ne fus pas étonné de cette négligence. Mais cette fois blessé.
2
Amelia
Elle portait à l’index
une grande améthyste.
Le patriarche s’en retourna sur ses terres de Vianen. Henri son fils avait rejoint l’armée à Aix-la-Chapelle. L’hôtel ne prit certes pas le deuil ; la jeune épousée prit en main tout le train de maison avec un zèle joyeux. Dame Amelia voulut connaître son monde, ce fut mon tour, après bien d’autres de paraître devant elle.
Appuyée, davantage qu’assise, à l’accoudoir d’un haut siège, elle accueillit mon salut, la plume de mon bonnet balayant le parquet et le mollet arqué en soulevant le talon comme je l’avais vu faire. Un rien de moquerie quand elle me parla, une gaieté du regard que n’affectait pas son ton de convenance. Debout, bien en face d’elle à quelques pas, je m’abstins de soutenir son regard, par déférence et, à défaut, je fixai ses mains. Elle les avait fines et souples, qui se joignaient, se quittaient, l’une lissant la soie de sa robe, l’autre remettant en place une mêche de cheveux. La droite portait à l’index une grande améthyste qu’elle faisait machinalement tourner sur la phalange. Les ongles longs, polis et frottés d’une poudre de nacre qui lui parsemait les doigts jusqu’au dos des mains, me parurent du dernier raffinement. À côté d’elle, un peu en retrait, maître Salien, la face rubiconde, lui dit mon nom. Elle l’ignora.
— Présentez-vous, Monsieur, et couvrez-vous.
Je ne me le fis pas redire et me coiffai.
— Erard Arroy de la baronnie et avouerie d’Uchy, Madame, attaché à la maison de Monseigneur votre époux. Votre serviteur.
— Êtes-vous si satisfait de votre sort ici que vous ne l’ayez pas suivi aux armées ?
Cette attaque me surprit, ma parade vint trop tard.
— Je suis à ses ordres, Madame, et aux vôtres, s’il m’y laisse. Je continue donc à manier la plume plutôt que l’épée.
— N’était-ce pas votre choix ? Ne prétendez-vous à rien d’autre ?
Je marquai une seconde pose, puis :
— Je veux rendre à mon père ses titres et ses droits.
— Ah ! la belle aventure. Êtes-vous en procès ?
— Depuis fort longtemps, à vrai dire.
— Alors que faites-vous ici, ce n’est guère l’endroit ? Ce que le droit vous refuse, sinon par force, il faut le mériter autrement.
— Pour l’heure j’obéis à mon père. Mais il y a d’autres voies, la basoche et les comptes sont affaire de gens rangés, et je n’y ferai pas long feu. Je bénis pourtant mon auteur de m’avoir mis ici puisque, Madame, vous y êtes aussi. Rien ne me plairait plus que de vous servir, et que celavousplaise.
Maître Salien, de rouge qu’il était, vira à l’écarlate. Mais Dame Amelia sourit à mon compliment, il en soupira d’aise. Elle reprit moins vivement.
— Le droit, n’est-ce pas votre formation ?
— Certes, je le pratique ici pour des causes fort terre à terre, mais je me tiens au courant des grands procès et des jugements qui sont la source du droit...
— Allez-vous jusqu’à lire les jugements des Conseils de justice et ceux des Inquisiteurs apostoliques ? Est-ce ainsi que l’on dit en français ? fit-elle en se retournant vers maître Salien qui acquiesça gravement.
Elle délaissait sa langue maternelle, le flamand en usage dans le peuple, pour la langue française parlée à la cour et chez les nobles comme chez bien des bourgeois au Nord et dans toutes les provinces du Sud.
— J’en prends connaissance, Madame, pour leur immixtion dans le droit public et privé. Il s’agit d’un droit d’exception...
— Vous intéressez-vous à autre chose qu’à tout cela, à la poésie, aux arts, à la peinture, à la musique, ne fréquentez-vous pas une chambre de rhétorique ?
— La férule de mon père m’en ôtait le loisir. Il me plairait mieux d’étudier la musique, le chant ou la peinture, mais il paraît que cela ne convient pas aux gentilshommes qui n’ont de choix que de servir les princes. Je fréquente à présent les ateliers des peintres, et les offices religieux ont de quoi satisfaire l’amour que j’ai de la musique. Quant à la rhétorique, je n’en sais pas autant qu’il y en a dans les livres. J’apprends aussi l’histoire de nos princes, celle de votre famille.
— Voilà qui est d’un bon courtisan, m’avez-vous dit, Madame, en me congédiant. Et vous avez souri.
Je ne sus pas si ce fut une moquerie ou bien un compliment et je sortis perplexe de cet entretien sans m’attendre à ce qu’il en résultât quoi que ce fût de concret. Il est vrai que je m’appliquais à connaître les familles et la généalogie rapprochée des princes et des grands seigneurs. Nous ne pouvions attendre d’eux que la réussite. Les événements, petits et grands, étaient commentés et discutés à la chambre des clercs ; c’était à qui en saurait le plus de ce qui se passait à la cour et chez les grands. Quant aux idées nouvelles, il fallait en parler avec assez de hauteur et devant qui pouvait bien vous comprendre et se garder de déformer vos propos. Nous avions tous lu l’Adagiad’Erasme et sonÉloge de la Folieet les écrits de Thomas Morus, de Vives ; ils alimentaient nos enthousiasmes. Nous pouvions bien avec de tels maîtres refaire le monde.
Madame de Brederode me fit la grâce d’un second entretien. Il y a si longtemps ! Que pouviez-vous, Madame, avoir encore à me dire ? Déjà chez les clercs, on glosait sur cette faveur. Vous m’avez reçu dans une salle claire qui donnait à voir le jardin — que je n’eus pas l’heur d’admirer —. On le disait fort beau, tout à l’attention que je devais à votre personne. Vous vous êtes assise au bord d’une cathèdre, trop grande pour vous, qui trônait sur une estrade peinte de fleurs stylisées rouges, vertes et or. Vous m’avez désigné, comme par faveur en contrebas, un tabouret de bois dur. Assis droit sur cette sellette, mollets croisés, j’attendis que vous me parliez. Non loin de vous, deux dames appliquées à un ouvrage de lice tentaient d’y intéresser une petite fille qui me lançait des regards en coin. La porte du jardin entr’ouverte sur l’air tiède de mai aidait à l’apaisement de mon cœur qui se mit à battre moins vite. Les yeux baissés, je regardai vos pieds chaussés de petits souliers de fine toile grège brodée de fleurs blanches, sur des chausses soyeuses de la même teinte. Quand vous vous êtes mise à parler, vos chevilles ont eu un balancement dans un bruissement de soies froissées, qui me permit de voir que vous les aviez élégantes, et le pied fin. Je ne sais quelle folie m’a pris alors de désirer m’agenouiller et de saisir ces petits pieds-là pour les baiser. Instant d’égarement exquis, le temps d’un éclair dont on reste ébloui. Vous me parliez, je répondis :
— Certes, Madame, je suis bon catholique. Et humaniste…
Je me sentais désarmé devant elle. Je citai mes lectures. Je ne commettais aucune imprudence à être si sincère tout en trouvant plaisant d’étaler ma culture. Étais-je assez fat ! Vous parliez, Madame, un français appliqué teinté d’accent tudesque, dont la rudesse sur vos lèvres s’atténuait d’intonations légères, presque tendres dans les notes hautes et dont vous usiez comme d’un charme. Vous m’avez dit avec une pointe d’ironie :
— Ne vous destiniez-vous pas à la prêtrise ?
— Non, je ne m’y suis pas senti appelé, mon père n’a d’autre fils que moi. Souffrez ma franchise, je ne suis pas assez pieux et j’ai trop de prévention du vœu d’obéissance et de celui de continence.
Madame de Brederode eut une moue, le ton ne lui convenait pas. Ce ne fut plus un interrogatoire. Elle m’amenait vers une confidence où il me fallait pêle-mêle dévoiler mes goûts en maints domaines et jusqu’à des tendances plus profondes. Mais en même temps, s’en rendait-elle compte, elle dévoilait les siennes. Grande dame, elle partageait avec la haute noblesse — et une bourgeoisie riche — un goût nouveau, mode et contagion pour le quattrocento dans toutes les formes de l’art. J’ai cru comprendre son zèle au culte, à la liberté d’expression des idées et des arts. Elle m’amenait habilement à avouer plus ouvertement mes opinions à l’égard de la réforme religieuse, sujet certes convenable depuis la réconciliation apparente des humanistes avec l’Église, la paix d’Augsbourg avait bien reconnu l’existence de deux confessions religieuses, la catholique et la protestante, bien que l’empereur s’y fût montré hostile par souci d’unité de l’empire. Il n’était certes plus question de la piété extatique ou du mysticisme apocalyptique et révolutionnaire des anabaptistes. Ils avaient disparu sur les bûchers et payé pour les Luthériens et il n’était pas scandaleux d’exprimer que le bas clergé était trop peu instruit, voire ignorant et cupide, que les hôtes de bien des monastères avaient de longtemps délaissé les règles de leurs ordres et que les évêques et les prélats se conduisaient en princes temporels qu’ils étaient. Elle voulait bien entendre que l’indulgence de l’empereur Charles devant l’application peu sévère des sanctions affichées aux placards à l’encontre des hérétiques était la preuve moins d’un parti pris que d’une mansuétude particulière pour ses sujets de Par-Delà. Ce dont elle doutait ; n’avait-il pas humilié Gand sa ville natale et rebelle ? Je n’en voulais pour preuve que ses directives données six ans plus tôt aux Inquisiteurs apostoliques de modérer leur zèle. L’intérêt que je portais au bas de sa personne me fit perdre le fil de l’entretien et je n’y étais plus présent qu’à moitié, distrait par le mouvement de ses jambes qu’elle croisait et décroisait dans le mystère et la profusion des étoffes. Madame de Brederode dut s’en apercevoir car, interrompant son propos au milieu d’une phrase, elle retira ses pieds sous sa robe et dit :
— Je ne suis pas Madame la Régente qu’on ne peut regarder en face sans l’offenser. Faites-moi la grâce, Monsieur, de lever votre regard et venez saluer ma nièce, mademoiselle de Mansfeld.
J’ai quitté la fascination des pieds et des jambes de dame Amelia pour la regarder bien en face.
Quand la plupart des femmes du Nord ont les cheveux et le teint clairs, elle avait ces cheveux d’ocre pâle et cette carnation dorée du visage et du cou. Ses dents intactes, si blanches sous des lèvres tendres, pommettes hautes portant le regard assuré. Mais de quelle couleur donc étaient ses yeux ? La petite fille a rejoint sa tante sur l’estrade, m’a gratifié d’une brève révérence.
— Ma nièce séjournera ici quelque temps. Il vous plaira peut-être d’être son précepteur pour la langue française, le latin et les nombres ?
Que me proposait-on là ? Pensait-on que je n’étais bon qu’à cela ? Je me moquais bien d’enseigner, la dernière chose à laquelle je m’attendais. Mais quoi, étais-je si naïf ? Madame de Brederode m’offrait là le moyen de m’approcher d’elle et, qui sait, de lui plaire. Ce que je prenais pour du dédain pouvait cacher un caprice. Voilà bien une perche qu’il me fallait saisir. Je ne répondais pas, cherchant la répartie qui ne fût pas insolente, mais assurée, mais qui ne me vint pas. Je convenais, non sans réticences, de ce que l’on dit des jeunes gens, qu’ils sont stupides et ignorants, fussent-ils clercs, et parfois d’autant plus que les élans de leur nature, si admirables qu’on les dise, les dépêchent au hasard de chemins éloignés de leurs rêves. La réponse que je fis eut au moins le mérite de m’en persuader car, lorsque la petite fille posa sur moi son regard, ses yeux bleus grands ouverts, chargés de toute l’interrogation du monde, j’acquiesçai.
Je me suis parfois demandé si c’est pour elle ou pour vous, Madame, que j’ai pris ce parti. Je n’en sais toujours rien. Mais dès lors, plus rien ne m’importa que de vous approcher. Et puis tout changea, vous descendiez de votre piedestal, je pus saluer les dames de compagnie et quitter ma sellete pour un siège plus confortable, on me servit une limonade fraîche et je me mis à converser avec l’enfant Polyxène pendant que les dames reprenaient leur broderie. Il me sembla que le monde venait de basculer. Les pieds fins chaussés de blanc reparurent et, avec plus d’aise, je quittais l’enfant des yeux pour un divin profil, si attentif au maniement d’une aiguille qui réglait point par point la pensée secrète sous ce beau front penché.
Le temps d’un inventaire de mon aventure me semblait venu. L’octobre doré de mon arrivée à Bruxelles me paraissait déjà lointain. Les Pays-Bas étaient gouvernés par madame Marie, veuve du roi Louis II de Hongrie, à qui l’on donnait toujours le titre de madame reine de Hongrie. En cette fin d'été, Charles Quint séjournait à Bruxelles entre deux voyages, fatigué, accablé, disait-on, de douleurs osseuses et de gouttes d’humeur viciée. Je désirai voir de mes yeux cet empereur mythique qui régnait depuis tant d’années — au juste, depuis 1515, cela faisait trente-cinq ans —. Mais on n’entre pas sans être convié dans ce palais qui fut celui des ducs de Brabant, puis de ceux de Bourgogne, ces Valois, tout imprégné encore de leur rigide protocole. J’allai le voir, moi aussi, parmi les gens qui venaient là chaque matin lorsqu’il quittait sa petite maison au fond du parc de la Warande et s’en allait vers le palais, entouré des gentilshommes de sa maison. Dos brisé par des chevauchées innombrables, le visage maigre, le nez long, l’œil cave, la barbe soignée qui ne pouvait cacher cette mâchoire pesante, le monarque me parut moins grand que je l’avais imaginé. Était-ce l’idée que je m’étais faite de sa gloire ? Je lui voyais une aura de majesté sereine. Il offrait quelques croutons de pain à des cerfs apprivoisés, saluait de la main et poursuivait son chemin vers le palais pour reprendre son travail, le poids de l’empire. Le roi François Iermort, Henri II, son fils, n’allait pas tarder à repartir en campagne, sans cesse à ronger nos frontières et à lorgner vers l’Allemagne.
Tout cela n’aidait guère à mon gouvernement. Je m’appliquais à rédiger quelques actes de procédure et autres contrats de métayage, mais j’y avais moins de zèle qu’à la salle d’escrime ou à la bibliothèque. La grande horloge au tympan de l’entrée réglait maintenant l’emploi du temps et nous habituait à l’abandon des heures anciennes. Je m’accoutumai volontiers, et pour cause, à mon rôle de précepteur, qui commençait vers la dixième heure jusqu’à celle du repas, au milieu de l’après-midi. Ces matinées, je les passais dans la petite salle, où dame Amelia m’avait reçu pour la première fois. Je me rappelle, comme au premier jour, de l’âtre sculpté, de la grande bibliothèque, du coffre aux ferrures brillantes et de la grande table qui servait d’écritoire. Mademoiselle de Mansfeld venait à mes leçons et sa tante l’accompagnait parfois. Le jour où elle me pria de lui chanter une ballade, ce que je fis sans me faire prier,je fus étonné que mon chant lui fît oublier sa réserve jusqu’à s’en montrer charmée, au point de m’en réclamer d’autres, et de vouloir m’accompagner d’une sorte de mandole dont elle usait avec assez peu de talent. Ses raccords nous faisaient rire et créaient des instants d’une intimité tout à fait improbable en d’autres circonstances.
Je me mis assez tôt à déplorer que dame Amelia fût moins assidue à mes leçons. Ses devoirs à la cour et les hôtes à ses fêtes lui prenaient tout son temps. Mon écolière, elle, montrait une sensibilité et une curiosité de savoir qui étonnaient le néophyte que j’étais. Je lui commentais avec plaisir, et bénéfice pour moi, l’édition du « Courtisan » de Castiglione, manuel de bonnes manières à l’usage des jeunes nobles. Les nombres l’intéressaient peu, mais elle s’en jouait, elle étudiait la langue allemande, l’espagnol et l’italien, que lui dispensaient d’autres maîtres. Elle portait de grands cols de dentelle de Bruges sur de lourdes robes fort ornées qui ne me paraissaient pas convenir à son âge, mais tempéraient à peine sa nature spontanée. Je la regardais m’écouter sagement, devinant sa beauté à venir. Elle interrompait l’entretien, quelquefois, se levait vivement pour courir à la fenêtre au bruit d’une voiture, s’excusant aussitôt. Elle connaissait déjà, pour la plupart, les noms et les titres des habitués de l’hôtel, et me les citait sans que je les lui demande.
Un matin, elle sauta de joie. « Venez voir ! Monseigneur le Prince d’Orange est là ! » J’observai, le temps qu’il sautât de cheval pour escalader l’escalier, le mince jeune homme coiffé d’une toque noire aplatie, ornée d’une houppe d’autruche. Il portait, comme les jeunes élégants, une ample veste noire bordée de vair au-dessus d’un pourpoint clair, des chausses à crevés et des bas de chausses blancs. En sautoir, une chaîne d’or. Comte de Nassau, il avait hérité à onze ans de son cousin la principauté d’Orange, et toute la fortune de ces princes. Cet héritage valait bien qu’il se convertît. De protestant, on le fit catholique, et il reçut à Breda l’éducation d’un prince de son rang. Polyxène n’aurait pu, je le sentis, se remettre à l’étude, tant la vue du jeune homme l’avait surexcitée. Elle fut appelée et me quitta pour aller saluer le prince. Je me remis à mes écritoires.
On chuchotait chez les clercs : ce jeune prince est bien assidu à l’hôtel de madame, pendant que monseigneur est aux armées, et bien galant à ce qu’il paraît. Je feignais de ne pas les entendre. Provoquer les bavards eût donné plus de poids à leurs ragots, quant à tirer l’épée, je n’étais pas le champion de cette grande dame, mais je m’étonnais qu’ils fissent grandir en moi une alarme inconnue.
3
Luxembourg
Les chemins de mon enfance.
1551, septembre.
Quand au printemps mademoiselle de Mansfeld s’en alla rejoindre son père au gouvernement de Luxembourg, la maison perdit de son attrait. Je ne vis plus guère madame de Brederode. Je m’étais donc mépris, elle ne m’avait choisi ni pour mes beaux yeux, ni pour mes ronds de jambes. Les grands seigneurs sont ainsi, il n’accordent que des miettes. Si l’on veut davantage, il faut le leur arracher. Que faisais-je ici ? Le printemps à coup sûr me travaillait.
Les chemins de mon enfance avaient un horizon : le sommet d’une crête qui barrait le ciel et, du côté opposé, le tournant du chemin qui menait au bois. Je lisais des romans de chevalerie et franchissais, en rêve, ces frontières inventées pour découvrir des pays de légendes hantés par des chevaliers en quête d’aventures, de princesses captives, qu’ils allaient délivrer, ayant occis les loups et autres monstres imaginaires. Mes horizons s’élargirent plus tard, aux Amériques, j’écoutais, attablé au bois souillé de bière de la table d’un cabaret, les récits des aventuriers qui étaient revenus. Là-bas, des Indiens nus, parés d’or, vivaient dans des villes étranges, perdues dans une nature grandiose et des forêts sauvages. Les noms de Cypango, Cathay, Chersonèges, qui sont les trois Indes, cités mythiques de l’or, enflammaient mon imagination. Les Indiens avaient pris ces aventuriers pour des dieux, chevauchant des animaux étranges, dont les armes avaient apprivoisé la foudre. Pizarre avait remonté le cours de fleuves aux berges inconnues, qui charrient des gemmes mêlées à la boue de continents fabuleux. Des caravelles en reviennent encore, chargées d’or et d’épices. J’écoutais aussi les récits des soldats de fortune qui ont suivi l’empereur d’Innsbrück à Naples, jusqu’à Tunis, garrotté Barberousse, grelotté dans les Alpes, mangé la poussière des pays du soleil, bu le vin à ses sources, borgnes, culs-de-jatte ou manchots, se rappelant des heures exaltantes, des victoires et des femmes.
Je m’étais juré, dès l’enfance, de rendre à mon père ses droits à la baronnie et de porter après lui le tortil. Ces rêves de jeunesse ne m’y aideraient guère. Il me fallait servir un prince puissant, ou du moins bien en cour. Prendre conseil chez mon père ne m’avancerait guère, il ne voyait d’autre voie que la sienne, et que je serve comme lui par ma plume. Je me dis que je ne pourrais, sans lui faire affront — ni à notre prince-évêque —, chercher l’appui d’un autre grand seigneur. Henri de Brederode m’ignorait mais j’étais de sa maison, et je n’avais pour l’instant d’autre choix que de me rappeller à lui de l’une ou l’autre manière. L’intérêt que je portais à son épouse ne serait ni la plus favorable ni la moins périlleuse. Et, comment, à présent que ma galanterie avait échoué, que m’apparaissait — tardivement je le concède — la bassesse du procédé, agir sinon en montrant ma valeur sur les champs de bataille ? Mon parti était pris. Je m’ouvris — à nouveau — de ce projet au gouverneur de l’hôtel, maître Salien, personnage régnant sur tout et sur tous.
Cet homme respectable portait sur une fraise empesée une énorme face couperosée que son barbier lissait chaque matin. Son petit nez rond s’ornait d’une paire de verres grossissants, tenue par un cordon, qu’il redressait sans cesse. Pétri d’orgueil, couvert quel que fût le temps de dentelle et de moire, ses doigts boudinés chargés de bagues attestant de sa fortune, je devais me garder d’attenter à sa dignité. Il me fit l'offrande de l’expérience qu’il avait de jeunes fous dans mon genre délaissant le confort d’un hôtel bien agencé pour les aléas d’intendances de campagne, revenus le prier, comme le fils prodigue, mais qui n’avaient joui ni du rang ni des avantages délaissés. Je persistais, soit, libre à moi, pourvu que j’eusse assez d’esprit pour tenir la plume plutôt que la lance. Si madame de Brederode ne s’y opposait pas, je pourrais m’en aller avec le prochain convoi vers Marche ou Luxembourg.
Il est plaisant, à dix-huit ans, de penser à la guerre où l’on part à cheval, botté, plumet au chef et bannières au vent, quand sifflent les fifres et battent les tambours. Vous ne vous êtes pas, Madame, opposée à mon départ. Vous avez approuvé que je veuille rejoindre l’armée comme s’y obligent les gentilshommes de cœur. J’osai vous demander un gage et je vous jurai que vous seriez ma Dame et que je combattrais pour vous comme les chevaliers d’autres temps. Vous avez ri, accepté et promis. S’il n’y avait eu autour de vous ces importuns dont les sourires me hérissaient, je vous aurais pris la main. Fûtes-vous gagnée par la ferveur, ou n’était-ce que jeu ? Vous m’avez donné vos doigts à baiser. Le lendemain, vous me fîtes tenir un pli cacheté que j’aurais à délivrer en mains propres, à Luxembourg, à madame de Mansfeld, sœur de votre époux. Je ne vous revis plus avant mon départ. Je m’en consolai en m’efforçant de porter cette disgrâce non au compte de l’ingratitude qu’ont les grands pour ceux qui les servent mais à un rien de bouderie de votre part.
Je chevauchais une mule, qui en principe n’est monture que d’ecclésiastique ou de dame, portant sur sa croupe mon bagage, toute ma fortune, plus heureux que fier de marcher vers le sud parmi l’attirail de guerre de son excellence le comte Pierre Ernest de Mansfeld. Ce n’était pas la saison de partir en campagne — nous étions en octobre —, mais il faisait encore sec, une brume de poussière soulevée par les cavaliers, puis par les piétons qui suivaient, flottant autour du charroi, couvrait les bâches des chariots, asséchait les gosiers et la bouche des chevaux et des hommes, recouvrait les abords du chemin d’une teinte uniformément grise. Cette pesante armée avançait aux seuls cris des cochers, au martèlement des pas des chevaux et des hommes, aux grincements des roues cerclées de fer, sur les abrupts chemins schisteux de la Famenne. Au loin le battement des tambours rythmant le pas des fantassins se confondait avec la rumeur confuse de mille autres sons assourdis. Les bannières pendaient le long de leurs hampes à défaut de vent. Ma mule suivait, docile, un chariot de bagages dont j’avais la garde. Le cocher, à l'avant, se retournait de temps en temps, crachait dans la poussière et tirait sur les rênes, sans besoin ni effet, par simple contenance.
La guerre annoncée n’avait pas affolé Bruxelles. Des cortèges d’hommes armés en diable, portant bannières, avaient bien provoqué quelques enrôlements de garçons sans emploi ou, comme moi, en mal d’aventure. Le lieutenant des gardes des abords du palais, un vieux soldat couvert de cicatrices et de médailles, disait à qui voulait l’entendre que Henri II de France, s’il suivait la politique de son père, le fastueux François Ier, devait aussi servir sa propre rancune. « Après Pavie, l’empereur n’a rendu au roi sa liberté qu’en échange de ses deux fils, qu’il a retenus en otages en Espagne pendant quatre années, avec bien peu d’égard quoique fils de roi. Je le sais moi qui fus leur geôlier... »
Le gouverneur obèse de l’hôtel de Brederode m’avait fait enrôler dans le train de munitions de messire Henri, que je revis pour l’occasion : tête petite, regard impérieux, roux comme un écossais, la face rougie par le grand air, grand, maigre, vigoureux et, dans ses yeux gris, une expression souvent exaltée. Je doutai qu’il m’eût remarqué, et il ne me plaisait pas de me présenter à lui. Au regret d’avoir quitté ma maîtresse, j’opposais le contentement qu’il fût, lui aussi, éloigné d’elle. Le jour du départ, j’avais trouvé, posé sur mon bagage, un objet emballé dans une grande écharpe. C’était une épée à fil et tranchant double, arme de gentilhomme à poignée guillochée et garde finement ciselée. Le fourreau était de cuir et de bois ouvragé de filigranes d’argent. Un bout de parchemin plié en long en tomba lorsque je l’en tirai : « Qu’ElleVous gardeÀNous ». Les majuscules étaient enluminées,E V A N. J’y lus aussitôt ses initiales et les miennes, accordées par un g en forme d’enlacement. Une chaleur inconnue m’envahit alors avec un sentiment d’orgueil insensé. Je pouvais, avec ce talisman, m’en aller à la conquête du monde.
J’avais enfin admis que l’argent pût se révéler utile, parfois nécessaire. J’emportai donc les quelques piles que maître Salien me mit sous le nez quand je le quittai. J’achetai à la rue des Fripiers une veste ample, un pourpoint bien coupé, des bottes du meilleur cuir, puis j’ornai ma toque d’une plume blanche et jurai de ne la retirer pour personne. Mais voilà qu’elle se couvrait déjà de poussière. Je la mis à l’abri sous ma veste.
On fit étape à Beauraing, au pied des murailles du baron de Berlaymont, parmi les masures. Les tentes dressées, les chevaux abreuvés en bas au ruisseau, la plaine du Biran s’emplit des cris de sergents, du cliquetis des armes mises en faisceaux, des hennissements, des rires ou des disputes des soldats qui s’installaient autour des feux pour la nuit.
Deux jours plus tard nous étions devant Luxembourg, qui nous ouvrit ses portes au coucher du soleil. Tout entra dans les murs : cavaliers, piétons, chariots et chevaux. Ce fut une belle cohue dans les rues étroites, et il me fut impossible d’atteindre le palais du gouverneur où je devais livrer le contenu du chariot dont j’avais la garde : des coffres lourds de vaisselle d’argent, quelques petits meubles, ou des objets encombrants comme ces chandeliers d’église destinés à la résidence du comte de Mansfeld et à sa chapelle. Les chevaux furent conduits au fond de la gorge profonde, au pied des murailles où coule une rivière, pour y passer la nuit. Il me fallait attendre le matin, juché sur mon chariot, et me résigner à jeûner plutôt que de m’en éloigner pour aller aux cuisines — le couvre-feu n’a jamais empêché les soldats pillards de visiter les transports trop peu gardés —. Je cherchai le sommeil, l’épée de dame Amelia posée à côté de moi sur ma couche.
Le silence s’établit sur la ville et l’armée, après que les trompettes se furent tues. Quelles pensées meublaient mon insomnie, sinon l’attente des lendemains de gloire et le souvenir, déjà, de dame Amelia me souriant depuis sa cathèdre ? N’étais-je pas oublié ? La nuit inspire l’inquiétude, celle qui allait m’habiter pendant lontemps.
Un balancement du chariot me mit en éveil. Il faisait noir sous la bâche, l’ombre d’un homme escaladant mon chariot se profilait. Dressé, l’épée au fourreau tenue à deux mains. Sans sommation, je frappai vers cette ombre. « Holà valet ! fit une voix rauque. Tu m’as presque brisé l’épaule. » Mon visiteur avait prestement sauté à terre, agrippé des deux mains au plat-bord, tandis que je tenais encore l’épée levée au-dessus de sa tête. La lune éclaira son visage.
— Doucement, camarade, je ne cherche qu’à semer la patrouille qui est à mes trousses. Je quitte une bonne amie qui ne peut me loger plus longtemps. Fais-moi place, nous garderons ton chargement à deux.
Il me tendait sa dague tenue par la lame. Je m'en saisis. Il monta, eut tôt fait de s’installer à l’aise parmi les bagages. Il me souhaita bonne nuit et ronfla. Je ne m’endormis qu’à l’aube. Ce fut lui qui m’éveilla.
— Debout, Messire, cria-t-il. Vous avez le sommeil moins inquiet aux aurores qu’à la mi-nuit…
— Merci. J’ai mal dormi grâce à vous. J’aurais pu vous fendre le crâne.
— Je l’ai solide et vous n’avez pas frappé bien fort… Je m’appelle Fulrade, sergent des gardes wallonnes de Monsieur de Croy.
Je lui dis mon nom et expliquai qu’il me fallait livrer ce chariot à la résidence du gouverneur. Fulrade était un homme dans la trentaine, glabre, le visage ravagé par une ancienne vérole, le corps massif et pourtant leste. Il arborait cet air assuré qu’ont les vieux soldats, franc à ce qu’il me sembla, ce qui me poussa à lui demander un service en échange de mon hospitalité. Je pus juger de son efficacité car il ne tarda pas à m’amener un cheval, qu’il attela pour me conduire à la résidence du gouvernement. Je ne revis mon sergent de longtemps.
L’ancien palais des rois de Bohème et de Jean l’Aveugle n’était plus qu’une vieille bâtisse délabrée, entourée de vastes jardins, enclos de murs en partie effondrés. Un parti de chevau-légers y assurait une garde importante. J’attendis d’être introduit, voyant avec soulagement les gens de Monsieur de Mansfeld décharger mon chariot, emmener son contenu vers l’étage. Quant à la lettre, j’étais bien résolu à ne la remettre qu’en main propre. Après un temps — qui me parut interminable —, un valet vint me prier de le suivre. L’étage était moins délabré que le bas, occupé par le corps de garde dont les odeurs montaient par de profonds et sombres couloirs.
Le parquet de chêne résonna soudain de pas précipités et l’enfant Polyxène surgit devant moi. Une apparition blonde et bleue. Révérence. Elle me prit la main pour me conduire vers une salle, aussi vaste qu’empoussiérée, où elle me pria d’attendre, avant de se sauver aussi vite qu’elle était apparue. Elle revint, sage, aux côtés de sa mère.
J’ôtai ma toque devant Marguerite, fille de Renaud III de Brederode, autant frèle et délicate qu’était grand et vigoureux son frère Henri. Elle m’accorda à peine un regard, s’approcha d’une fenêtre, décacheta la lettre qui contenait un billet séparé, qu’elle lut, puis leva son regard vers moi, un bref instant, donna un ordre au valet qui se tenait près de la porte et, tandis qu’elle poursuivait sa lecture, un jeune gentilhomme se présenta, salua la dame, m’invita à le suivre.
Avec regret, Polyxène me regarda m’éloigner, tandis que sa mère la rendait à sa gouvernante. Le jeune homme m’invita courtoisement à prendre chez lui mes quartiers. Je compris son air narquois quand il m’emmena vers des annexes où j’eus droit à une couche de paille défraîchie, à la compagnie composite de militaires de tous poils, sous l’abri d’une vaste grange.
— De Nanfal, écuyer, lieutenant des gardes wallones, ainsi se présenta-t-il.
Il eut l’élégance de ne pas m’interroger, bien qu’il dût lui paraître étonnant que, citant mon nom, je ne faisais mention d’aucun titre, ni d'aucune appartenance à aucun régiment. Mais il veilla à mon bien-être avec tant de politesse que je m’obligeai à lui parler des circonstances qui me valaient sa compagnie. Il m’emmena vers le fond de la grange, où des soldats jouaient, autour d’un coffre en guise de table, à un jeu de dés et d’argent où je trouvai courtois de perdre quelques miettes de ma fortune. Après quoi, je fus autorisé à offrir le vin de l’accueil.
Henri de Brederode avait quitté notre convoi à l’étape de Marche. Se pouvait-il qu’il m’eût oublié pour la seconde fois ? Ce n’était plus de l’indifférence, mais un affront.
Je fus accueilli dans la compagnie de Nanfal. Qui de plus bavard que des militaires autour d’un feu ou d’une table de jeux ? J’appris que l’empereur — décidément infatigable — avait quitté Bruxelles pour Innsbrück, signe évident que la guerre que nous faisait la France le motivait peu. Au contraire de la menace turque en Hongrie. Le gros de l’armée française était en Italie. Nanfal ne faisait pas mystère que la stratégie de Mansfeld visait plus à réduire les points d’appui de la France, le long de sa frontière nord, plutôt que de chercher un affrontement important.
Le lendemain, j’accompagnai Nanfal et quelques autres aux alentours de la ville. Des centaines de travailleurs s’occupaient à démolir de vieilles murailles pour en reconstruire de plus solides. On creusait dans la roche, à même la paroi de la gorge, sous la ville, loin au-dessus de la rivière qui coule tout au fond ; des galeries et des grottes où même chevaux et chariots pouvaient circuler pour y entreposer des réserves de vivres, des armes et des munitions.
La vie de garnison me parut bientôt ennuyeuse. Je ne revis plus les dames de Mansfeld — sinon aux offices le dimanche —. Le soir, les hôtesses des bouges offraient leurs charmes avilis, le mal de Naples en prime. Le vin blanc, le jeu et les duels mouchetés distrayaient notre monachisme. Les relations entre Allemands et Wallons procuraient aux soldats inactifs de quoi entretenir leur agressivité. Nous sortions toujours armés. Un soldat me vendit un baudrier pris à quelque seigneur milanais dont les ors s’accordaient avec ceux du fourreau de dame Amelia. Chez les militaires, on ne parle ni de religion, ni de politique, on vit au jour le jour, dans l’attente du moindre événement propre à briser la routine.
La veille de Noël, Mansfeld partit de Gorze à quelques lieues de nous, en pleine nuit, avec seulement cinquante cavaliers. Au matin, la compagnie de Nanfal le rejoignit. J’allais enfin savoir ce que signifiait se trouver face à l’ennemi, et cela n’allait pas sans quelque excitation, que le gel ne put refroidir. Nos deux troupes se rencontrèrent au bord d’une jachère. Il y avait eu bataille la veille, et nos piétons furent chargés de rassembler les cadavres de quelques dizaines de Français et quelques-uns des nôtres, tous vilainement sabrés ou piqués. Les morts, déjà dépouillés, furent alignés côte-à-côte. Nos enseignes passèrent en revue les corps rangés en train de se figer dans l’herbe givrée. Des terrassiers creusaient des tombes dans la jachère. Mes premiers morts ! Certains avaient les yeux grands ouverts, comme s'ils nous regardaient œuvrer devant eux.
Apremont n’était pas loin, assis, massif sur son monticule, dépourvu de troupes et encombré de paysans et de bétail. Il fut investi avec beaucoup de célérité. Après les sommations d’usage, la place se rendit, la nuit tombante. Un donjon carré où brûlaient des feux nous accueillit, vaste quadrilatère à trois niveaux de murailles épaisses, de portes solides. Nanfal et son sergent enrageaient de n’avoir pu croiser le fer. Le vin blanc par contre coula en place du sang, comme pour consoler ces vainqueurs déçus d’Apremont. Les morts, eux, montaient une garde glacée devant mon sommeil.
La neige tomba en janvier. Il fallait tenir ce bastion isolé, entouré de forêts et de maigres prairies. L’ennui, éternel compagnon des soldats, investit notre logement. Autour de l’âtre se tenaient d’interminables conférences. Au-dehors, les sentinelles transies venaient se réchauffer aux feux des forgerons et des cuisines où flottaient, rassurantes, les effluves de soupe et de boulangerie. Aux étages, Mansfeld le magnifique et ses chefs de guerre régnaient sur ce petit monde. Le grand capitaine trompait lui aussi son ennui en dressant des cartes et des plans de batailles qui alternaient avec les dessins d’un nouveau palais qu’il projetait de construire sur les ruines de celui de Jean l’Aveugle. Nous vivions hors du monde. Cependant, Bruxelles n’était qu’à trois jours à peine de cheval et Luxembourg moins encore. On assurait que le roi Henri n’attendrait pas le printemps pour tenter de reprendre Apremont, que la gouvernante jugeait qu’on ne pourrait le défendre. Mansfeld, lui, entendait bien y rester, mais il finit par admettre l’avis des stratèges de Bruxelles et, à la fin de janvier, on chargea autant de chariots qu’il fallait, tandis que les artificiers brisaient les portes, boutaient le feu aux poutres, gâtaient les puits.
L’hiver nous frappa de ses tempêtes, nous enveloppa de ses brouillards et glaça nos nuits tandis que nous suivions Mansfeld vers Arlon, puis Luxembourg, Thionville, Montmedy. Partout il fallait relever les murs, réapprovisionner les garnisons. Nos trésoriers comptaient des sommes dérisoires aux mains des gouverneurs mécontents.
Et moi, Madame, je pensais à vous. La nuit, grelottant sous ma bâche, à vous, bien au chaud dans votre lit de plumes, qui dormiez sans les rêves auxquels je vous conviais si fortement.
Le printemps nous trouva au camp de Marche-en-Famenne, où était le duc d’Aerschot, avec ses enseignes. Lorsque je m’enquis du sieur Henri de Brederode, j’appris qu’il devait être à Aix-la-Chapelle avec le gros de l’armée. Il serait excessif de dire que je fus déçu, mais je n’avais aucun moyen de prendre des nouvelles de ma dame. Ainsi appelais-je dame Amelia avec une délectation amère, me disant que j’eusse été mieux inspiré de demeurer au chaud, non loin d’elle, plutôt que de tourner en rond dans cette guerre qui n’en n’était pas une.
Nanfal me prenait à partie et nous nous battions aux épées de frêne avec fureur. Il voulait que je lui livre le nom de la dame qui occupait mes pensées s’il gagnait le prochain assaut. Je me battais en champion, car lui livrer le prénom d’Amelia m’eût semblé une offense ou une trahison. Nanfal resta beau joueur, même lorsque je perdis. Il continua de me taquiner sans m’offenser.
Le temps effaçait son image et je me mis à penser que la mémoire que je gardais d’elle n’était plus qu’illusion.
Fin mai, Mansfeld reprit la route. Je le suivis dans la cavalerie. Il tint conseil à Arlon, déserté par ses habitants qui avaient emporté jusqu’à leurs cloches, et marcha vers Metz, dont la garnison française ne devait pas compter beaucoup plus de deux mille hommes. Nous traversâmes la plaine lorraine où les laboureurs traçaient leurs sillons, s’arrêtant pour regarder passer ceux qui, au retour, piétineraient leur blé. Des ordres nous parvinrent de rebrousser chemin et d’attaquer Stenay.





























