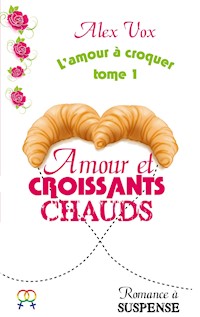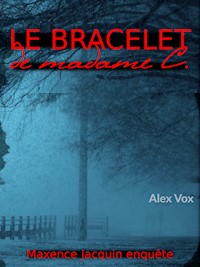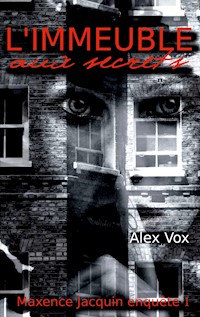Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Quand la vie sans histoire d'une prof de musique bascule... Un professeur de musique s'est défenestré. Carole Dalles sa remplaçante tombe sur des lettres de menaces. Elle commence une enquête parallèle. Quel peut bien être le lien entre Fred, serveuse dans un bar atypique et Bastien, le professeur de latin ? Plus la vérité est proche, plus les vies de Carole et de ses proches sont menacées. Comme le dit l'adage :"Il faut se méfier des apparences !"
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 250
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
À mes parents, grands-parents qui m’ont aidé à grandir,
À ma sœur, à mon frère qui ne cessent de me soutenir,
À mes amis qui m’écoutent et partagent sans (dé) faillir,
À mon amour qui m’a permis de réussir,
Et aux autres aussi… que la vie continue de nous réunir !
Alex.
Sommaire
Chapitre 1
Chapitre II
Chapitre III
Chapitre IV
Chapitre V
Chapitre VI
Chapitre VII
Chapitre VIII
Chapitre IX
Chapitre X
Chapitre XI
Chapitre XII
Épilogue
1
Je regardais le paysage défiler à toute allure. Aux endroits dévastés succédaient de fabuleux tableaux aux couleurs incroyables.
Je comprenais sans mal que les peintres, du plus modeste au plus réputé, y puisent leur inspiration sans vergogne. J’étais partie la veille au soir, mais je laissais encore mes yeux s’égarer, intégrant dans ma mémoire un million de clichés. Les voyages répétés ne m’avaient pas fait perdre cette habitude.
Dans huit minutes très exactement, je serais à destination, midi trente-neuf pour être précise. Mon estomac se chargeait sans cesse de me rappeler que je n’avais rien pu avaler depuis la soupe de légumes de maman à une heure du départ. Les deux sandwiches confectionnés par mes soins patientaient encore au fond de mon sac. Chaque fois que j’effectuais un long trajet, je demeurais le ventre vide, sans doute par précaution, ou qui sait, un brin de superstition. Comme l’heure approchait, je me mis debout, massant ma jambe droite, car je sentais naître un début de crampe. Je descendis mes deux sacs du compartiment à bagages. J’aidai la vieille dame, seule occupante de mon wagon, moi mis à part, bien entendu. Elle avait passé la quasi-totalité du trajet Besançon-Montbéliard à dormir. Elle me gratifia d’un immense sourire reconnaissant, et ses petites pommettes rougirent, rehaussant son teint porcelaine. Je m’approchai de la porte du train, gardant tout de même un œil attentif sur la petite mamie. Enfin, une voix doucereuse résonna dans les haut-parleurs : Montbéliard, deux minutes d’arrêt ! Mes bagages dans une main et la valise de la femme dans l’autre, je sautai sur le quai avant de presque la porter, tellement l’épreuve des marches semblait douloureuse pour elle. Une belle jeune femme, aux cheveux ambrés, accourue pour prendre le relais. Je continuai donc ma route tranquillement. Les autres passagers se pressaient à l’extérieur. Je suivis la foule en gardant toutefois mon allure. Je pénétrai dans la gare, moderne, bien agencée, mais assez petite. Je ne m’attardai pas davantage, pressée d’arriver chez moi, et me dirigeai vers la porte vitrée extérieure. J’admirai au passage son cadre bleu alu que personne n’avait encore pris la peine de dégrader. Dehors, je clignai des yeux, car le soleil venait d’apparaître depuis peu sans doute, car l’odeur de la pluie flottait encore dans l’air. Le brouhaha des voitures et des discussions des passants couvrait le chuchotement du vent dans les feuilles colorées d’automne. La bâtisse était très certainement d’époque, à en juger par ses pierres. Enfin ! N’étant pas une experte en bâtiment, je ne pouvais que regretter qu’il ait été repeint en rose pâle. Cette couleur me faisait dresser les poils depuis que j’en avais ! À quelques centimètres de moi, parallèlement à la façade, se dressait une file de cinq taxis. Les chauffeurs attendaient les clients potentiels en lisant le journal à l’intérieur. À ma droite, un imposant bâtiment, contenant la bibliothèque, à en croire les panneaux indicateurs. Je me jurai de revenir un de ces jours, mais ne m’attardai pas plus, parce que je désirais rejoindre mon nouvel appartement au plus vite. Je pris le premier taxi me pliant aux règles en vigueur. J’espérais tout bas que la ville me plairait : Montbéliard, Franche-Comté.
Le chauffeur était âgé d’une cinquantaine d’années, les cheveux poivre et sel, le front haut. Des petits yeux bleus malins étaient disposés de chaque côté d’un grand nez fin. Ses sourcils étaient presque inexistants, sa bouche minuscule, ses lèvres étroites. Par contre, il possédait une mâchoire forte et carrée. Sa petite taille, un mètre soixante environ, renforçait son aspect robuste. Il appréciait sûrement les salles de gym ! Avais-je devant mes yeux le portrait type d’un régional ? Avec la précipitation des événements, je n’avais même pas eu le temps de me renseigner sur cette ville inconnue. L’homme m’adressa la parole en premier.
— Bonjour mademoiselle ! entonna-t-il avec un accent traînant qui ressemblait à celui des Suisses.
— Bonjour monsieur. Je dois aller rue Quampenotte…, risquai-je d’une voix mal assurée en me dandinant d’un pied sur l’autre machinalement.
— Pas de problème ! me confia-t-il avec un large sourire encourageant. Il roula son journal avant de le poser sur le siège du passager. Il m’ouvrit la porte arrière droite, pour que je puisse m’installer dans la 605 grise. Auparavant, il avait porté mes sacs dans le coffre. Le poste de radio fonctionnait en sourdine. Il l’éteignit et nous partîmes.
— Je devine à votre accent que vous n’êtes pas d’ici, reprit-il après avoir manœuvré avec expertise parmi les voitures. Cette remarque me fit sourire.
— C’est exact. Je viens du sud, répliquai-je le plus gentiment possible, sans pour autant lui en dévoiler davantage. Sa radio professionnelle grésilla et, tandis qu’il prenait note d’une nouvelle course, j’en profitai pour admirer le paysage. Nous passâmes sur un pont d’où je pus distinguer un immense parc. Avec envie, je me tordis le cou jusqu’à ne plus l’avoir dans mon champ de vision, mais très rapidement nous arrivâmes dans une agglutination d’immeubles aussi hauts que laids. Je fermai les yeux, priant pour que ma destination se situe très loin de ce quartier. Malheureusement, le chauffeur me stoppa au pied d’une tour de dix étages, contre laquelle un berger allemand venait de se soulager.
— C’est sept euros mademoiselle.
Je lui tendis un billet de dix, il me remercia, me rendit la monnaie, me gratifia d’un dernier sourire et repartit en faisant crisser ses pneus sur le goudron bosselé.
Personne pour m’accueillir ! La rue était déserte. Je me retrouvais seule avec mes deux sacs de sport sur le trottoir, regardant la façade grisâtre et sale de mon immeuble. Ce n’était pas que je m’attendais à une grande fête de bienvenue avec des banderoles, mais j’aurais apprécié d’être saluée et guidée un minimum, d’autant plus que je n’avais pas les clés. N’ayant rien d’autre à faire, je mangeai un sandwich au thon sorti de mon sac rouge. Rassasiée, mes idées devenaient plus claires, allant même jusqu’à se disputer à l’intérieur de mon cerveau. Une cabine téléphonique me narguait au coin de la rue. J’allai appeler le collège avec le numéro apposé sur mon contrat de travail. Malheureusement, personne ne décrocha. J’attendais déjà depuis un bon quart d’heure — ayant eu tout de même le temps de reculer dans une crotte de chien, et croisant les doigts pour que ça me porte bonheur — quand un petit homme chauve, une serviette serrée sous le bras gauche, s’adressa à moi d’une voix mal assurée.
— Madame Dalles ?
J’avais envie de lui répliquer, Mademoiselle ! Mais je ravalai ma colère, trop heureuse que quelqu’un s’occupe enfin de moi. Il se tenait bien droit, sûrement pour tenter de paraître un peu plus grand : je le dépassais d’une bonne tête. Pourtant, je ne mesure qu’un mètre soixante-treize ! Il me tendit une main molle et humide. Je la lui serrai tout en continuant à le dévisager. Ses deux sourcils roux étaient si épais et fournis qu’ils se rejoignaient. Cela me faisait penser aux mutants que l’on trouve dans certaines séries télé. Ses yeux d’un noir de jais semblaient vides de toute émotion et renforçaient cette impression de méchanceté qui émanait de lui. Son nez n’existait pratiquement pas, tout comme ses lèvres d’ailleurs. Pour couronner le tout, il avait le teint blafard d’un mort.
— Je suis le directeur du collège, monsieur Radulac, continua-t-il précipitamment d’une toute petite voix qui montait bizarrement dans les aigus et qui ne cadrait absolument pas avec le personnage. Il soufflait bruyamment. Visiblement, je le troublais beaucoup, car il rougissait de plus en plus. Je lui répondis « enchantée » très sèchement. Je lui en voulais énormément de m’avoir laissée poireauter comme ça. Je venais sûrement de lui faire peur puisqu’il me posa brutalement les clés dans la main droite que j’avais encore à moitié tendue, et m’abandonna aussi vite, en se retournant tout de même pour déclarer : on se reverra au collège !
Je restai un moment inerte sur le trottoir, surprise par la fuite de mon supérieur hiérarchique. Les habitants de cette ville n’étaient guère accueillants au premier abord ! À moins que cet homme fût un spécimen à part. Je fis sauter le trousseau, hésitant à entrer. Un petit gamin, qui jouait au ballon, me regardait avec étonnement. Il devait se demander ce qu’une grande dinde comme moi faisait devant la porte de son immeuble depuis cinq bonnes minutes, sans y entrer. Il faut dire que de l’extérieur, le hall n’incitait guère à y mettre les pieds. Me servant du passe magnétique, je fis mes premiers pas dans ce corridor qui me menait jusqu’à mon domicile provisoire. Une feuille blanche à carreaux bleutés était scotchée sur la porte de l’ascenseur. Elle provenait apparemment d’un cahier d’écolier. On l’avait arrachée pour y inscrire à l’encre rouge en lettres capitales, ces deux mots qui vous coupent les jambes après un aussi long voyage : en panne ! Vu l’état des lieux, je n’en étais guère surprise. Un paquet de journaux de petites annonces piétiné et humide était éparpillé au pied des boîtes aux lettres. Deux ou trois mégots de cigarettes traînaient à même le sol qui paraissait ne pas avoir été nettoyé depuis six mois tellement il s’avérait difficile de donner une couleur au dallage. Le pire de tout, c’était cette odeur exécrable, mélange d’urine, de tabac froid et de sueur. Résignée, je me dirigeai vers l’escalier en retenant autant que possible mon souffle. Je grimpai les marches quatre à quatre, un sac dans chaque main. Les escaliers en colimaçon n’étaient guère plus propres et comme les ampoules étaient cassées, j’accélérai le pas dans l’obscurité. J’arrivai à peine essoufflée au quatrième étage devant la porte de mon logis. Mon nom était inscrit sur un post-it collé sur la porte bleue, Carole Dalles, mais la plaque indiquait encore Pascal Debussy. C’est ainsi que j’appris le nom de celui que je devais remplacer. Pas mal pour un professeur de musique ! Au moment où j’introduisis la clé dans la serrure, je crus percevoir un miaulement. J’ouvris. Aussitôt, une magnifique chatte tigrée et blanche aux yeux chocolat au lait se lova contre mes jambes. Enfin quelqu’un qui m’attendait ! Je la caressai délicatement. Elle n’était pas très sauvage. Visiblement, elle n’avait pas mangé depuis plusieurs jours.
Je posai mes valises et me mis en quête de la cuisine. L’appartement était dans un état pitoyable, sale et en désordre. La chatte, que je nommai Bastet, suivait chacun de mes pas. Elle m’avait déjà adoptée aussi incroyable que ça puisse paraître ! Dans la pièce, des relents de sardines s’échappaient de la poubelle. Mon prédécesseur n’était, sans nul doute, pas un as de la propreté. J’ouvris le réfrigérateur. Son contenu était à l’image de tout le reste : pas très appétissant : un vieux morceau de comté moisi, un bocal de cornichons presque vide et un bout de gâteau… peut-être un framboisier. Rien pour le chat ! Sous l’évier, je trouvai un litre de lait non périmé et encore fermé. Je lui en donnai un peu. Je savais bien que ce n’était pas conseillé : les chats adultes le digèrent mal, mais je n’avais que ça sous la main. Je lavai un bol, trouvé dans l’évier, au-dessus d’une pile de vaisselle sale. La chatte lapa immédiatement. Rassurée à propos de son état de santé, je repris ma visite des lieux.
Le salon était très grand avec des murs blancs. Il formait une seule et même pièce avec la chambre à coucher, beaucoup plus petite, aux murs bleutés. Le propriétaire, c’était du moins ce que je supposais, pour marquer la séparation entre les deux salles, avait placé une bibliothèque qui servait de mur et d’espace de rangement en même temps. La tapisserie était récente. La porte du salon donnait sur un petit couloir, menant lui-même à la salle de bain, à un débarras, et à la porte d’entrée. Pour aller à la cuisine, j’étais obligée de passer par le salon. Dans la salle de bain, des serviettes de toilette traînaient dans le bac à douche. Il y avait du calcaire partout. Je jugeai prudent de tout désinfecter à l’eau de Javel. Encore heureux que le samedi les magasins soient ouverts ! J’avais remarqué en venant ici, une petite supérette à quelques pas de l’immeuble, de l’autre côté de la rue, sur la gauche. J’y allai pour y acheter de la nourriture pour le chat et pour moi, ainsi que des produits ménagers. J’achevai mon nettoyage et empilai les affaires de Debussy dans le placard du couloir en attendant que quelqu’un vienne les chercher, car bizarrement il n’avait rien emporté en déménageant. Éreintée, je me couchai sur le lit et sombrai dans un profond sommeil.
Quand j’ouvris les yeux, je me sentis reposée, mais toujours aussi tendue. Je pris une grande inspiration, puis recrachai l’air brusquement, encore plus fort qu’il était entré. Un témoin, qui aurait assisté à la scène par hasard, aurait pu croire que je craignais que l’oxygène brûle mes poumons. Il n’en était rien. Je cherchais simplement à me relâcher. J’avais pris, avec ma meilleure amie, une bonne résolution pour cette année : commencer le yoga. Les jours étaient passés, je ne m’étais pas encore inscrite. Je me disais donc que quelques fortes respirations pourraient éventuellement calmer ma tension. Mais après avoir manqué plusieurs fois de m’exploser les poumons, je dus me rendre à l’évidence. Trop de pensées gambergeaient dans ma tête pour que je puisse faire le vide, comme on dit ! Sur le lit, les mains derrière la tête, je fixais le plafond. Soudain, j’eus une idée lumineuse : tenir une autre de mes promesses en écrivant à Sylvie, justement.
Elle et moi avions grandi ensemble, loin d’ici, dans un petit village de trois cents habitants de la région septentrionale de la vieille province du Rouergue : Conques. Nous avions eu les mêmes instituteurs, notamment mademoiselle Koupek. Celle-ci eut à nous supporter pendant toute notre maternelle. Nous étions de vrais paquets de nerfs ! Je me souviens que nous lui trouvions un drôle d’accent. Elle était russe, comme me l’avait expliqué papa. Il se prêtait alors de bonne grâce à mon caprice quotidien : il poussait très fort la balançoire pour que je puisse voler très haut. J’avais alors l’impression d’être assise dans les nuages.
— Russe, lui avais-je demandé, en ouvrant grand mes yeux bruns sous l’effet de la surprise ? Comme le vieux monsieur-soldat qui est toujours vers l’église ?
— Russe comme lui, m’avait affirmé Philippe Dalles, l’homme que je trouvais le plus beau de la terre : mon père. Il avait les cheveux noirs, rasés très courts, comme un militaire, des yeux bruns foncés et il était très grand par rapport à tous ses amis. Sa réponse m’avait laissée sceptique un petit moment : j’avais quatre ans et huit mois, septembre 1973. J’avais alors essayé d’imaginer un lien entre le vieux monsieur qui ne sentait pas bon, comme je l’avais déclaré haut et fort à mon père, un jour en passant devant le lieu de culte, et la jolie, mais sévère mademoiselle Koupek. Je dus faire une telle moue, que papa s’était mis à rire. Puis nous nous étions roulés dans l’herbe verte devant la maison, avec nos beaux habits blancs. Maman sur le perron, les mains sur les hanches nous regardait un éclat de bonheur au fond de ses yeux bleu clair. Elle était fine comme une sirène. Sa grande taille mettait ses courbes en valeur. Maman était la beauté incarnée, la Vénus de Conques. Au bout de quelques instants, une mèche blonde lui retombant dans les yeux, elle faisait mine de se fâcher : l’herbe verte avait jauni nos habits du dimanche. Elle jurait ses grands Dieux qu’elle n’arriverait jamais à les nettoyer. Mais elle les lavait. Elle avait toujours su rendre aux habits leur éclat avec, en plus, un délicat parfum de lavande. C’était le bonheur. Deux années plus tard, papa nous quittait, fauché par une voiture, alors qu’il revenait à pied de l’école où il était instituteur. Aujourd’hui, il était là-bas, au cimetière de Conques, sous quelques centimètres de marbre, que j’avais toujours trouvé trop froid, pour un papa qui était le plus formidable du monde. Après la maternelle, Sylvie et moi sommes entrées au primaire. Nous nous disputions alors les premières places. Au CP, j’ai commencé à jouer du clavier. Vint le collège puis j’entrai au conservatoire de musique à Paris. Sylvie continua un peu ses études, passa son bac puis se maria en 1988 avec Bernard, de dix ans son aîné. Le 3 mars 1990, Marie, ma filleule, est née de cette union. J’avais terminé mes études, et j’étais maintenant professeur de musique, mais pas encore titulaire. Sylvie et moi essayions de nous voir le plus souvent possible.
Sortant soudain de ma rêverie, je pris une grande feuille blanche dans un des tiroirs de ma commode. Certains y rangent des chaussettes, moi j’y avais mis feuilles, cahiers et stylos. De toute façon, je n’avais pas assez de chaussettes pour la remplir. Quant au stylo, j’en ai toujours un à côté de moi, en cas de brusque inspiration. La lettre achevée, je signai : Carole, avec de belles lettres rondes comme je savais si bien les faire. Je regardai ma montre : il était presque vingt et une heures. Je bâillai bruyamment et m’étirai. J’avais dû terminer à la lumière de l’ampoule. Elle était trop forte et j’avais les yeux qui me brûlaient. Je me les frottai. Je ne relus pas, le courage me manquait. Je pliai chacun des quatre feuillets en marquant avec précision les plis avec l’ongle de mon pouce. Je les réunis en les alignant soigneusement. Je les mis dans une enveloppe d’un blanc immaculé. D’une belle écriture, j’y inscrivis l’adresse de Sylvie. Je léchai le timbre que j’avais préparé et qui attendait au coin de la table. La colle était infecte ! J’avais toujours détesté faire subir à mes papilles gustatives un tel supplice, mais je n’avais plus de timbres autocollants. Cela m’arracha une grimace qui eut pour effet de faire fuir le chat. J’apposai ce petit rectangle tout mouillé sur l’enveloppe et appuyai bien fort du plat de la main. Je comptai jusqu’à dix, relâchai la pression. Ça tenait. Tout était prêt ! Le frigo était rempli. Bastet dormait dans le panier tout neuf que je lui avais choisi à la supérette. L’air dégageait l’odeur agréable des produits d’entretien nouvelle génération. J’allai dans le salon et m’assis sur le vieux clic-clac bleu. Il poussa un grognement plaintif qui réveilla la chatte. Elle vint se blottir sur mes genoux. Je la caressai. Mes yeux se posèrent sur la bibliothèque. Elle semblait devoir s’écrouler d’un instant à l’autre. Le contre-plaqué supportait mal d’être déménagé et visiblement ce meuble avait dû l’être plus d’une fois. Il était tout écaillé et ses angles n’étaient plus très droits. Cependant, par endroits, on pouvait encore distinguer sa couleur beige d’origine. Je me levai et fermai les volets. Ayant failli me déboîter une nouvelle fois la mâchoire à cause d’un bâillement puissant, je décidai prudemment d’aller me coucher. Je me dévêtis rapidement et me glissai dans les draps propres qui sentaient bon la lavande et me rappelaient maman. Bastet vint se coucher à côté de moi.
II
Je m’éveillai tôt, bien avant le réveil, qui m’indiquait en chiffres lumineux six heures trois, un peu déphasée ne reconnaissant ni mes odeurs, ni mes sons habituels. Je mis quelques instants à recouvrer mes esprits, bien aidée en cela par la chatte que j’avais complètement oubliée durant la nuit. Un petit frôlement imprévu et j’étais opérationnelle après avoir eu une peur bleue : d’ordinaire, je n’avais pas d’animal de compagnie. J’étais excitée à l’idée de rencontrer mes nouveaux collègues et élèves, mais une certaine appréhension me serrait le ventre, comme chaque fois que j’arrivais quelque part. J’allai à la salle de bain, suivie comme mon ombre par Bastet, fis un long pipi en bâillant, tirai la chasse deux fois : elle fonctionnait mal. Je pénétrai dans la cabine de douche et me savonnai vigoureusement sous l’eau chaude pour finir de me réveiller. Je m’essuyai le corps avec une serviette bleu clair, cadeau de Sylvie pour Noël 1995 et jetai un coup d’œil dans le miroir au-dessus du lavabo. Ce matin, pleine d’entrain, je me trouvais presque jolie : mes grands yeux sombres, brun-noir comme ceux de papa, brillaient et éclairaient ainsi mon visage encore trop blanc, bien que bronzé. Mes cheveux noirs retombaient sur mes épaules. Une goutte perlait au bout de mon nez, que je détestais plus que tout. Je l’avais cassé à l’âge de dix ans, lors de ma première et dernière visite à la patinoire. Mon visage plein de sang avait d’ailleurs fort effrayé Sylvie. La goutte tomba dans le lavabo de céramique aussi blanc que la douche, les toilettes et le carrelage (ce qui donnait à cette pièce des allures d’hôpital). Ma bouche large en sourit, tirant sur mes lèvres, trop grosses à mon goût. Je branchai le sèche-cheveux. Quand toute l’eau eut enfin disparu de ma tignasse, je me dirigeai vers l’armoire, beaucoup trop grande pour mes quelques vêtements ! Par contre, sa façade de miroirs me plaisait énormément. Essayant de discipliner une mèche rebelle, je me trouvais devant un choix cornélien : comment allais-je m’habiller ? Il fallait que ce soit simple, pour ne pas effrayer les élèves, mais suffisamment correct pour ne pas déplaire à mes collègues, à l’étrange Radulac, et pour marquer mon premier jour. J’optai pour un pantalon de cuir noir taille 38 et un petit débardeur blanc en stretch.
J’ouvris les stores vert d’eau. Je commençai par celui de la chambre, puis celui du salon. La chatte, qui visiblement avait une vie très agitée, avait repris ses bonnes habitudes et dormait déjà sur le clic-clac bleu nuit. J’ouvris le dernier volet et la fenêtre. Je fis du café. La cafetière avait besoin d’un détartrage. En attendant que je puisse prendre mon petit déjeuner, je préparai mes affaires. J’aimais bien mon sac. C’était un sac à dos en cuir qui m’avait été offert par Sylvie — et oui, encore elle… — pour mon anniversaire, le 15 janvier 1997. Elle en avait assez de me voir avec mon sac kaki de l’armée, à moitié déchiré, non étanche et d’une couleur douteuse. Elle savait, bien sûr, que j’aimais le cuir, sa texture, son odeur, son contact… Elle avait trouvé le cadeau idéal, comme à l’accoutumée ! J’y rangeai une trousse cylindrique noire, une règle graduée, un bloc-notes, des feuilles de papier musique, une flûte à bec en bois, une bouteille d’eau minérale d’un demi-litre (achetée à la supérette) et une pomme bien rouge. Tout était prêt ! Ah non ! J’avais failli oublier une boîte de craies blanches. Les fournitures devaient être données par le collège, mais j’avais déjà eu de mauvaises surprises par le passé. Inutile de songer à donner un cours sans utiliser le tableau noir. Mon erreur réparée, je sortis un bol du placard et me versai un bon café bien chaud. Qu’il était agréable ce premier café du matin ! J’en fermai les yeux et m’en versai un deuxième. Je regardai ma montre : il était presque sept heures. Je mettrais vingt minutes pour me rendre à pied au collège, d’après mes estimations. Les cours commençaient à huit heures. J’avais donc encore huit bonnes minutes devant moi. Je fis mon lit, lavai mon bol, l’essuyai, le rangeai, fermai la fenêtre, redonnai de l’eau au chat, me brossai les dents, enfilai mes chaussures et pour finir, mis mon sac au dos, pris la lettre pour Sylvie et les clés, sortis.
Vingt minutes plus tard, je me trouvais devant le collège : une grande bâtisse rectangulaire en préfabriqué. Il ressemblait à un supermarché, avec des petites fenêtres carrées et une façade saumon. Je pensai qu’une construction en Lego donnerait à peu près le même résultat. Surprise : monsieur Radulac m’attendait ! Il s’avança vers moi. Il était toujours aussi roux, aussi petit, mais beaucoup moins rouge. Il m’ordonna de le suivre d’une intonation qui ne donnait pas envie de le contredire. Après avoir parcouru des couloirs qui n’en finissaient pas, je me retrouvai dans la salle des professeurs. Une dizaine d’entre eux était déjà arrivée. Ils étaient assis soit sur des chaises, soit sur des tables. Ces dernières étaient de forme hexagonale et accolées les unes aux autres, de façon à former trois postes à l’intérieur de la pièce. Une grande fenêtre, en face la porte, se découpait dans les murs, jaunes comme les rideaux. À gauche, une cafetière, un four à micro-ondes et des gobelets en plastique blanc reposaient sur une petite table carrée. Mes collègues formaient deux groupes : un de quatre personnes, un autre de six. Certains parlaient très fort. La plupart fumaient, heureusement que la fenêtre était ouverte.
Derrière nous arriva un grand homme musclé aux yeux verts et aux cheveux blonds mi-longs. Je lui donnai une trentaine d’années. Il m’adressa un beau sourire. Deux petites fossettes apparurent. Il tenait un attaché-case d’une main, un sachet plastique de l’autre. Il lança plein d’énergie :
— Salut tout le monde ! J’ai apporté les croissants !
Il vint vers moi sans abandonner son sourire.
— Mademoiselle Dalles, je suppose ?
Radulac s’était discrètement effacé et en profitait pour se verser un café. Je passai une main dans mes cheveux pour écarter la mèche qui était tombée dans mes yeux.
— Oui, répondis-je bêtement, mais sans pourtant trouver d’autres répliques. J’étais intimidée. Heureusement, il ne semblait pas s’en être aperçu et continuait les présentations.
— Bastien Douareg. Je suis d’origine bretonne. J’enseigne le latin, débita-t-il d’une traite sans me quitter des yeux, mi-intrigué, mi-septique.
C’est drôle, je n’arrivais vraiment pas à l’imaginer conjuguant les rosa rosa rosam et parlant de Jules César.
— On se tutoie ? proposa-t-il immédiatement en envoyant le paquet de croissants à deux jumelles qui se tenaient bien droites à quelques centimètres de nous.
J’acceptai d’un hochement de tête ponctué par un sourire.
— Avec plaisir ! Appelle-moi Carole. J’avais enfin pu aligner deux phrases. Je faillis pousser un ouf de soulagement.
— Alors, pour toi ce sera Bastien.
Il me présenta ensuite tous les collègues présents, c’est ainsi que j’appris que les jumelles, que personne n’arrivait jamais à reconnaître, même pas lui, se nommaient Axelle et Alexandra Casevic, et qu’elles étaient toutes deux professeur de français. J’eus droit aux poignées de mains, puis, pour éviter que je me perde dans les couloirs, Bastien m’accompagna jusque devant la porte de ma salle de classe. Il était, d’après ma montre, huit heures moins deux. J’entrai.
De huit heures à midi, je donnai mes premiers cours à Montbéliard. D’après l’emploi du temps que Radulac m’avait glissé dans la main ce matin, juste avant de s’éclipser au milieu des présentations, je ne reprenais qu’à quinze heures. J’avais donc largement le temps de rentrer chez moi. Je me demandais en bouclant mon sac, comment j’allais bien pouvoir retrouver la sortie. La réponse se tenait debout devant mes yeux, avec ses deux petites fossettes : Bastien. Il était revenu me chercher.
— Alors, ils ne t’ont pas fait trop de misères ? s’enquit-il d’un air compatissant, en se dandinant d’un pied sur l’autre, visiblement pressé de quitter les lieux.
Je lui souris, heureuse de le retrouver.
— On dîne ensemble ? Il y a une cafet’ de l’autre côté de la rue, me proposa-t-il aimablement.
Nous allâmes chez Denis, puisque c’était le nom de cet endroit. Les chaises, attachées aux tables, reflétaient la lumière. Tout le mobilier, ainsi que le comptoir, était blanc crème. Les murs de crépi blanc étaient largement percés d’immenses portes-fenêtres. Comme le comptoir, en forme d’U, se trouvait au milieu, on avait l’étrange impression d’être dans un manège duquel on pouvait entrer et sortir de tous côtés. Un serveur au blazer rose vint prendre la commande : steak à point, frites, non, pas d’apéritif.
En mastiquant ma viande, j’appris à Bastien que j’étais fiancée à Laurent Brun, un professeur de mathématiques. J’appréhendais sa réaction. Il ne changea pourtant pas d’attitude. Il me dit simplement qu’il n’était pas seul non plus puis changea de sujet. Nous attaquions une crème renversée quand il me demanda si ça ne me dérangeait pas d’habiter dans l’ancien appartement de Debussy, sachant que celui-ci s’y était suicidé. Je lâchai ma cuillère et demeurai sans voix. Sous mon regard interrogateur, Bastien poursuivit :
— Il s’est défenestré il y a dix jours. Personne ne peut dire pourquoi. Il semblait pourtant heureux de vivre ces derniers temps.
J’expirai et ramassai ma cuillère, bien incapable de trouver une réplique adéquate. Nous finîmes notre repas et retournâmes à la salle des professeurs. Je plaçai quelques affaires dans mon casier de façon à ne pas avoir à les trimbaler en permanence de chez moi à l’école, d’autant plus que je n’avais pas de voiture.
Depuis le début de mon remplacement, je me sentais mal à l’aise, comme si l’on me cachait quelque chose. Je me rendais compte que Pascal Debussy était vraiment très aimé. À part Bastien, tout le monde était très froid avec moi. Bien sûr, je ne m’attendais pas à de grandes effusions le premier jour, mais au moins à quelques mots et de petits sourires. Je poursuivis ma journée de travail avec le moral dans les chaussettes.