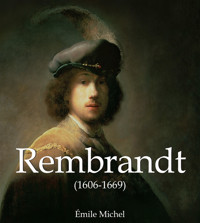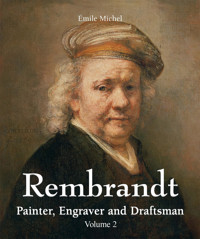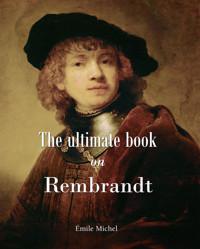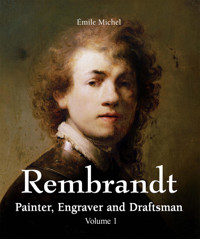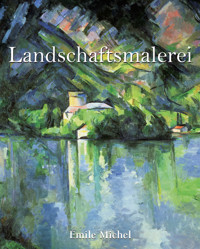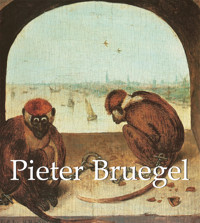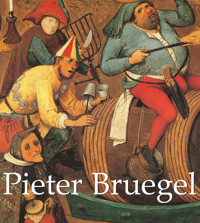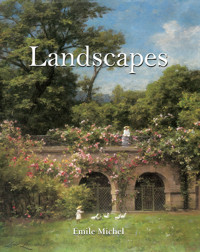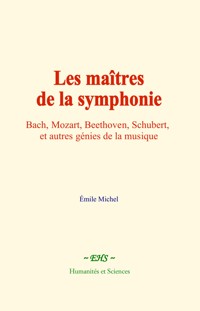
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: EHS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
« L’art a des clartés que la raison n’a pas… La symphonie tout entière avec ses moyens d’action, ses idées, son langage, émane du génie de l’homme, et entre les diverses formes de l’art, il n’en est pas qui soit une plus évidente démonstration de l’idéal ni qui l’affirme d’une manière plus communicative et plus saisissante. »
L’origine de la symphonie est très lointaine ; mais, comme la plupart des créations esthétiques de l’homme, elle a eu de bien humbles commencements, et ce n’est qu’après une suite prolongée de transformations qu’elle a pu atteindre son complet développement. Le terme même de symphonie a beaucoup varié dans sa signification. Chez les anciens comme au moyen-âge et jusqu’au siècle dernier il a été employé avec des acceptions très différentes pour exprimer tantôt le concert de plusieurs instruments, tantôt des mélodies reproduites à l’unisson ou à l’octave par des instruments ou par des voix. Vers la fin du XVIe siècle, on s’en servait pour désigner un morceau de musique quelconque, tandis qu’au XVIIIe siècle il s’appliquait soit à un accompagnement instrumental, soit à l’orchestre lui-même qui était chargé de cette exécution. Au sens où nous l’entendons aujourd’hui, la symphonie à orchestre est née du jour où, sans le secours de la voix humaine, plusieurs instruments furent joués simultanément. Mais ces instruments primitifs devaient eux-mêmes subir bien des modifications avant d’arriver à l’état où nous les voyons…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 136
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Les maîtres de la symphonie
Les maîtres de la symphonie
Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, et autres génies de la musique
Chapitre I
BACH. — HAYDN. — MOZART.
Il y a des satisfactions d’art qui, pour être goûtées, supposent un état de civilisation très avancé. Mais familiarisés avec elles par les habitudes de notre vie, nous nous contentons d’en jouir, sans songer à tout ce qu’il a fallu de temps et d’efforts pour nous les procurer. Une des délectations esthétiques les plus hautes et certainement une des mieux faites pour nous étonner, si nous y arrêtons notre pensée, est celle qu’on peut trouver à l’audition des grandes œuvres symphoniques des maîtres. Il n’y a guère de créations, en effet, qui émanent plus complètement du génie de l’homme. Le compositeur qui, de toutes pièces, a fait sortir cette œuvre de son cerveau, les exécutants qui l’interprètent, les instruments dont ils se servent, les impressions diverses qui traversent les foules réunies pour les entendre, ce sont là autant de sujets d’émerveillement. Cette forme de l’art musical exige une élaboration si complexe et des concours si différents que plus qu’aucune autre elle suggère à notre esprit une foule de questions délicates sur la nature de la musique elle-même, sur le but qu’elle se propose et sur les moyens qu’elle a d’y atteindre.
Afin de mieux fixer nos idées, supposons-nous en présence d’un de ces orchestres d’élite qui se consacrent à l’interprétation des chefs-d’œuvre classiques. L’instrument que tient en main chacun de ses artistes est le résultat de tâtonnements multipliés et d’une longue suite de combinaisons imaginées pour améliorer la qualité du son et le mécanisme de cet instrument. Avant qu’il ait reçu sa forme actuelle, de nombreuses générations se sont appliquées à le perfectionner. Les dispositions ingénieuses de sa structure, ces courbes si délicatement infléchies, ces épaisseurs renforcées ou amoindries afin d’assurer la pureté de son timbre, n’ont été fixées qu’après des tentatives réitérées. Toutes les matières, toutes les substances ont été essayées et façonnées par l’homme pour en tirer des sons musicaux, éclatants ou graves, très opposés ou très proches, mais susceptibles d’être associés et de se fondre dans un ensemble harmonieux. Il n’a pas fallu moins d’efforts pour arriver à une notation simple et rationnelle des sons, des mouvements, du rythme et des nuances infinies qu’ils peuvent comporter et que l’exécutant arrive à lire couramment, d’un regard, sur le cahier placé en face de lui. Pour se conformer exactement à ces indications, pour les réaliser en perfection, cet artiste a dû s’approprier lui-même tous les progrès accomplis par ses devanciers. Il a profité des méthodes imaginées par eux pour faciliter son apprentissage, et, quelles que fussent ses dispositions natives, cet apprentissage a été long et laborieux. Ce n’est qu’au prix d’exercices opiniâtres, commencés dès l’enfance, poursuivis régulièrement chaque jour, qu’il a pu acquérir et qu’il peut conserver une précision, une sûreté de mouvements, une subtilité de perception, une finesse d’oreille et une promptitude de vue qui tiennent vraiment du prodige. Toutes ces qualités que par un régime d’entraînement adapté à sa nature il a su développer en lui, il faut qu’il les mette au service de la pensée du compositeur, avec le goût que donne un long commerce des chefs-d’œuvre, avec la connaissance du style de chacun d’eux et de l’interprétation spéciale qui lui convient. Mais cet artiste n’est pas seul. A ses côtés d’autres ont pris place qui, par des études pareilles, sont parvenus à une habileté égale. Groupés dans des proportions et un ordre définis, ils se sont, comme lui, préparés à exprimer la pensée du maître, assouplis à leur tâche par de nombreuses répétitions qui ont permis d’arrêter le sens de chacune des parties et d’en nuancer les effets de manière à faire pénétrer la vie jusque dans les moindres détails, tout en respectant le caractère même de l’œuvre. Dociles et modestes, ils doivent, sans jamais faire montre de leur virtuosité, se subordonner à l’ensemble et accepter aveuglément la direction que leur imprime leur chef. Celui-ci, musicien consommé, au courant des traditions, les tient sous sa main avec l’autorité que lui assure une capacité reconnue et acceptée de tous. Se faisant comprendre et obéir, il peut à son gré les presser ou les maintenir, en les animant de son esprit. Tout en demeurant jusqu’au bout maître d’eux et de lui-même, il a pour mission de faire converger vers la perfection l’effort réuni de toutes ces intelligences et de tous ces talents.
Mais cette pensée que l’orchestre interprète avec tant de soins, d’où est-elle venue au compositeur ? Quelle inspiration la lui a fournie ? Ces idées, les formes qu’elles revêtent, la coupe de chacun de ces morceaux, la proportion de ces différentes parties, l’ordre dans lequel elles se produisent, comment tout cela lui a-t-il été révélé ? Sans doute, ses devanciers lui ont tracé la voie ; mais à quelles réalités répondent ces déterminations diverses ? qui a dicté ces règles et quelle est leur justification ? Comment chacun, suivant son génie propre et suivant l’idée qu’il se faisait de son art, a-t-il démêlé ce qu’il fallait emprunter au passé et ce qu’il pouvait y ajouter lui-même d’inspirations nouvelles, pour réveiller dans nos âmes d’intimes résonances et se faire comprendre de nous ? Et parmi tant d’étrangetés déjà accumulées, laquelle enfin est la plus étonnante sinon ce public lui-même qui, pour se procurer des jouissances aussi fugitives, consent à s’enfermer dans des salles où pressé, condamné à une immobilité absolue, il écoute, pendant des heures entières, avec une attention religieuse, ces successions de formes musicales qui ne répondent à aucun objet défini ; que bien des fois déjà il a entendues, mais qu’il ne se lasse pas d’accueillir par les témoignages répétés de son enthousiasme ou par ces émotions profondes et silencieuses, dont l’imperceptible frémissement demeure pour un orchestre la plus flatteuse des approbations. Par quel charme mystérieux se sent-il donc attiré et comment des impressions qui sont sur lui si puissantes restent-elles cependant si vagues que chacun est libre de les interpréter à son gré ? Tandis que dans les arts du dessin nous trouvons sinon une utilité formelle, du moins une intention nettement formulée et une part d’imitation dont les plus ignorants eux-mêmes sont juges en quelque manière ; tandis que dans la musique dramatique l’action, le jeu des acteurs, la beauté des voix et la richesse de la mise en scène offrent au spectateur des situations clairement définies et des éléments de nature si variée, ici tout est flottant, indéterminé, tout repose sur des conventions ou des conjectures et chacun, suivant son tempérament ou son éducation, donnerait une explication différente des sentiments qui l’agitent et de la jouissance qu’il éprouve. Tel, pour prendre intérêt à ces abstractions, a besoin de leur prêter une figuration pittoresque dans son esprit ; tel autre veut suivre une idée, se composer un drame, inventer des incidents et des épisodes qui répondent à toutes les phases de l’œuvre qu’il écoute ; d’autres encore se contentent de s’abandonner naïvement à un plaisir dont ils ne cherchent à analyser ni les effets ni les causes ; pour d’autres enfin, les beautés de cette œuvre sont indépendantes et ne relèvent que de la musique seule, de l’inspiration des motifs, les arabesques du dessin mélodique, de la richesse des développements, de l’enchaînement des pensées, du coloris plus ou moins brillant que leur donnent l’harmonie et l’orchestration. Entre tant de façons et si tranchées de sentir et de juger un même ouvrage, vous n’en rencontreriez pas deux qui fussent de tout point semblables.
Bien des questions, on le voit, peuvent être posées à propos de la symphonie, et critiques ou philosophes se trompent étrangement lorsque, frappés par le caractère de simplicité que les maîtres ont su lui donner, ils croient pouvoir mieux étudier et définir en elle ce qui est l’essence même de l’art musical. C’est bien là, en effet, le domaine propre de la musique pure, celui où, réduite à ses seules ressources, elle se suffit et atteint pourtant une irrésistible puissance. Mais l’idée de confier peu à peu à des instruments qu’il a fallu longtemps façonner un rôle prépondérant et de limiter graduellement jusqu’à l’exclure tout à fait celui qu’il était naturel d’attribuer à la voix humaine, c’est-à-dire à l’instrument le plus immédiat, cette idée ne pouvait être que très tardivement réalisée. En dépit de sa simplicité apparente, la symphonie est le terme extrême d’une longue série d’efforts. De toutes les formes musicales, elle est venue la dernière, et l’oratorio, comme l’opéra, qui cependant semblent des genres plus compliqués, avaient déjà produit des chefs-d’œuvre qu’elle n’était pas encore née. Pour apprécier les efforts qui l’ont faite ce qu’elle est, il convient donc de la suivre dans son développement historique et d’observer ainsi sur le vif les débuts et les progrès de son existence. Quand nous aurons vu les difficultés dont elle eut à triompher avant d’être constituée, nous comprendrons mieux quelques-uns des problèmes qu’elle soulève et que trop souvent on a essayé de résoudre d’emblée, a priori, en eux-mêmes, avec un appareil philosophique ou un parti pris systématique qui en ont augmenté les obscurités. Au lieu de dénaturer ces problèmes en les plaçant dans un cadre factice, nous les laisserons ici sous leur véritable jour et dans les conditions mêmes de la réalité. Peut-être saisirons-nous mieux alors l’opportunité de règles qui, autrefois adoptées et consacrées par les maîtres, sont aujourd’hui discutées ou niées parce qu’on méconnaît leur convenance et les raisons qui les avaient fait établir. Dans cette rapide revue où nous devons nous borner aux grands traits, nous prendrons souvent pour guide un ouvrage dont la publication vient d’être récemment terminée. Nous voulons parler de cette Histoire de la Musique d’Ambros, qui, après avoir joui en Allemagne d’un légitime succès, a été en ces derniers temps remaniée de manière à former en réalité un livre nouveau, grâce à l’importance des additions et des corrections par lesquelles M. Langhans l’a complétée. C’est là un de ces répertoires pleins de faits et de documents positifs, tels que nos voisins en possèdent sur tous les arts, supérieur même à ceux qu’ils ont publiés sur les arts du dessin, puisque la musique est en quelque sorte leur art national. Nous n’avons chez nous rien de comparable à ce travail d’ensemble où se trouvent consignés tous les résultats acquis par la critique et qu’il faudrait rechercher épars dans des études ou des monographies innombrables. Pour le sujet qui nous occupe spécialement, ceux de nos lecteurs qu’il intéresse trouveront également profit à consulter l’Histoire de la Symphonie à orchestre de M. Michel Brenet, un opuscule modeste, mais excellent, couronné en 1881 par la Société des compositeurs de musique. Au lieu des théories ambitieuses, ils y trouveront non seulement l’exposé historique qui leur est promis par le titre, mais, sous une forme discrète, une appréciation raisonnée des principales œuvres des maîtres, dictée toujours par un sentiment très délicat et très sûr de ce qui fait leur véritable beauté.
I.
L’origine de la symphonie est très lointaine ; mais, comme la plupart des créations esthétiques de l’homme, elle a eu de bien humbles commencements, et ce n’est qu’après une suite prolongée de transformations qu’elle a pu atteindre son complet développement. Le terme même de symphonie a beaucoup varié dans sa signification. Chez les anciens comme au moyen-âge et jusqu’au siècle dernier il a été employé avec des acceptions très différentes pour exprimer tantôt le concert de plusieurs instruments, tantôt des mélodies reproduites à l’unisson ou à l’octave par des instruments ou par des voix. Vers la fin du XVIe siècle, on s’en servait pour désigner un morceau de musique quelconque, tandis qu’au XVIIIe siècle il s’appliquait soit à un accompagnement instrumental, soit à l’orchestre lui-même qui était chargé de cette exécution. Au sens où nous l’entendons aujourd’hui, la symphonie à orchestre est née du jour où, sans le secours de la voix humaine, plusieurs instruments furent joués simultanément. Mais ces instruments primitifs devaient eux-mêmes subir bien des modifications avant d’arriver à l’état où nous les voyons.
Les instruments à vent semblent avoir précédé tous les autres. Plus faciles à inventer, puisqu’une branche d’arbre évidée ou un roseau percé de trous en fournissent naturellement à l’homme les matériaux, les sons qu’ils rendent y sont aussi plus directement produits par notre souffle, et ils se rapprochent par conséquent davantage des conditions de la voix. Dans les plus anciens monuments, nous voyons donc figurer des flûtes, des trompes, des trompettes et aussi les instruments à percussion les plus élémentaires, tels que les tambourins et les cymbales. Ce sont là, du reste, les instruments que de notre temps encore les voyageurs retrouvent chez les peuplades les plus arriérées et les plus sauvages. Vinrent ensuite les instruments à cordes, pincées directement ou vibrant sous la pression de l’archet. Bien que, — malgré les récentes découvertes de M. Homolle et les belles recherches de M. Gevaërt, — il soit difficile de nous éclairer d’une manière positive sur la musique des anciens, il ne semble pas que ceux-ci aient jamais songé à grouper ces instruments de manière à former un ensemble qui méritât vraiment le nom d’orchestre. D’après les bas-reliefs et les inscriptions relevées par l’épigraphie relativement aux prix décernés dans les concours musicaux, il est permis de croire qu’ils ne pratiquaient ces groupements que d’une manière fort restreinte, et que s’ils se préoccupaient du dessin mélodique, du rythme et de l’accentuation de leurs chants, l’harmonie, celle de la musique instrumentale surtout, demeura chez eux très élémentaire.
Avec le moyen-âge reparaissent non seulement tous les instruments usités dans l’antiquité, mais beaucoup d’autres encore que nous trouvons représentés dans les statues, les bas-reliefs ou les miniatures de cette époque, et M. Lavoix, dans une intéressante étude sur la Musique dans l’Imagerie du moyen âge, s’est appliqué à rechercher les différents types d’instruments dont on se servait alors. Les Tableaux de Paradis de l’Ecole de Cologne, les volets supérieurs de l’Adoration de l’Agneau de van Eyck, quelques compositions de Memling, les bas-reliefs de Ghiberti ou de Donatello, plusieurs des œuvres de Beato Angelico attestent le goût que de bonne heure les artistes du Nord aussi bien que ceux du Midi avaient pour la musique et la place qu’elle tenait déjà dans la vie de ce temps. Mais si, dès le XIIIe siècle, les instruments que nous voyons ainsi réunis dans ces ouvrages forment déjà des orchestres, on peut penser que bien des accouplements de sons hasardeux, ou même tout à fait discordants, devaient s’y produire. Parmi ces instruments, il en est plusieurs qui, après des tentatives plus ou moins nombreuses de perfectionnement, ont disparu, et qu’il a fallu rejeter de la composition de l’orchestre parce qu’ils ne pouvaient s’harmoniser avec les autres. Quant à ceux qui s’y sont maintenus, ils ont dû subir des modifications profondes avant d’arriver jusqu’à nous. Chacun d’eux a son histoire, et, afin de réaliser les améliorations désirables dans sa fabrication, on a recouru à toutes les matières, invoqué à la fois les leçons de l’expérience et de la science, essayé toutes les formes, épuisé les combinaisons de mécanisme les plus ingénieuses. C’est en examinant les différents modèles, exposés dans des collections spéciales, notamment au Conservatoire de musique et au musée de Nuremberg, qu’on peut se rendre compte de la multiplicité de ces tentatives. Dans cette dernière collection, en particulier, un tableau figuratif permet de suivre l’ordre chronologique des transformations opérées dans chacun des éléments de l’orchestre avant d’aboutir à la fixation des types adoptés aujourd’hui. On est moins étonné des innovations malencontreuses dont on peut à certains moments constater la trace, lorsqu’on songe à l’ensemble de conditions très délicates qu’il s’agit de réaliser et qui ne s’obtiennent parfois qu’au prix de longs tâtonnements pour assurer à chaque instrument un diapason et une forme nettement spécifiés, compatibles avec la facilité de son jeu, s’accommodant avec la sonorité des autres instruments de l’orchestre, soit par les contrastes, soit par les analogies qu’il offre avec eux.