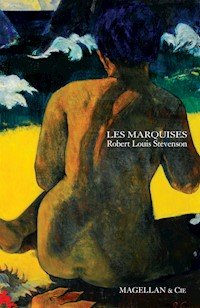
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Magellan & Cie Éditions
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
La liberté individuelle avant tout. Robert Louis Stevenson (1850-1894), à la courte vie bien remplie, est une star internationale des lettres quand il débarque dans les mers du Sud. L’Ile au trésor (1883) et L’Etrange Cas du docteur Jekyll et de M. Hyde (1886) ont fait de lui un écrivain réputé. Pourtant, aux yeux de beaucoup, c’est dans ses récits de voyage qu’il excelle véritablement, et, autre paradoxe, c’est sa santé fragile qui le pousse à parcourir le monde.
Ce long et beau texte sur les îles Marquises est paru en 1896 dans sa version française. En compagnie de sa femme, il tente d’oublier la tuberculose qui le mine et donne ici, avec humour, la vision d’un paradis menacé. Un merveilleux écrivain du voyage qui pousse toujours plus loin sa recherche de la liberté. Un témoignage unique sur les mers du Sud. Une analyse de la confrontation entre missionnaires et « sauvages ».
« Tusitala », le conteur d’histoires, tel est le surnom de celui qui a su gagner le respect des « indigènes » en vivant à leurs côtés.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Couverture
Page de titre
Ce climat, ces déplacements fréquents, ces atterrissages à l’aube, des îles nouvelles pointant hors de la brume matinale, de nouveaux ports ceints de forêts, les alarmes passagèreset répétées des grains et du ressac, l’intérêt pris à la vie indigène ‒ toute l’histoire de ma vie m’est plus chère que n’importe quel poème.
Robert Louis Stevenson
Robert Louis Stevenson, huile sur toile, 1892, portrait de Girolami Nerli (1860-1926)
PREMIÈRE PARTIE
I UN ATTERRISSAGE AUX ÎLES
Depuis près de dix ans, ma santé allait déclinant ; et vers l’époque où j’entrepris mon voyage, je me croyais arrivé à l’épilogue de ma vie, sans plus rien à attendre que la garde-malade et le croque-mort. On me suggéra de tenter les mers du Sud ; et je ne m’opposai pas à visiter comme un spectre et traverser comme un colis les paysages qui m’avaient attiré jeune et bien portant. J’affrétai donc le yacht-goélette du Dr Merritt, le Casco, jaugeant soixante-quatorze tonnes, partis de San Francisco vers la fin juin 1888, visitai les îles orientales de l’Océanie, et m’arrêtai, au début de l’année suivante, à Honolulu. Faute de courage pour retourner à mon ancienne vie et à ma chambre de malade, je repris la mer sur une goélette marchande, l’Equator, d’un peu plus de soixante-dix tonneaux, passai quatre mois parmi les atolls (ou îles de corail) de l’archipel Gilbert, et atteignis Samoa vers la fin de 1889. À cette époque, la reconnaissance et l’habitude commençaient de m’attacher aux îles ; j’avais recouvré la force de vivre, noué des amitiés, découvert de nouveaux intérêts ; le temps de mes voyages avait passé comme un rêve féerique : je décidai donc de rester. J’ai entrepris la rédaction de ces pages en mer, au cours d’une troisième croisière sur le vapeur marchand Janet-Nicholl. Les jours qui me seront accordés, je les passerai là où j’ai trouvé la vie plus agréable et l’homme plus intéressant ; les haches de mes domestiques noirs sont en train de déblayer le terrain de ma future maison ; et c’est du plus lointain des mers que désormais je m’adresse à mes lecteurs.
Que j’aie ainsi infirmé l’opinion du héros de Lord Tennyson, est moins extravagant qu’il ne le paraît. Bien peu des hommes venus aux îles les quittent : ils grisonnent où ils ont débarqué, et les palmes et l’alizé les éventent jusqu’à leur mort. Peut-être caressent-ils jusqu’au bout le désir d’une visite au pays ; mais celle-ci a lieu rarement, est plus rarement goûtée, et encore plus rarement réitérée. Aucune partie du monde n’exerce plus puissant attrait sur le visiteur, et la tâche que je m’assigne est de communiquer aux touristes en chambre quelque idée de cette séduction, de décrire la vie, en mer et à terre, de plusieurs centaines de mille individus, quelques-uns de notre sang et parlant notre langue, tous nos contemporains, et pourtant aussi lointains de pensée et d’usages que Rob Roy ou Barberousse, les Apôtres ou les Césars.
La première sensation ne se retrouve jamais. Le premier amour, le premier lever de soleil, la première île de la mer du Sud, sont des souvenirs à part, auxquels s’attache une virginité d’émotion. Le 28 juillet 1888, la lune était couchée depuis une heure. Il était quatre heures du matin. À l’est, une lueur irradiante annonçait le jour ; au-dessus de la ligne d’horizon, la brume matinale s’amassait déjà, noire comme de l’encre. Nous avons tous lu avec quelle soudaineté vient et disparaît le jour, sous les basses latitudes : c’est un point sur lequel concordent le touriste scientifique et le sentimental, et qui a inspiré de savoureuses poésies. Cette promptitude, évidemment, varie avec la saison ; mais voici un cas exactement noté. Bien que l’aube s’ébauchât ainsi dès quatre heures, le soleil ne fut pas levé avant six, et à cinq et demie seulement, on discerna l’île attendue, parmi les nuages de l’horizon. Huit degrés de latitude sud, et deux heures pour la venue du jour. L’intervalle se passa sur le pont, dans le silence de l’attente, l’émotion coutumière de l’atterrissage accentuée par l’étrangeté des rives dont nous approchions alors. Peu à peu, elles prenaient forme dans l’obscurité atténuée. Ua-huna, étagée sous un sommet tronqué, apparut la première à tribord ; presque par le travers s’élevait notre destination, Nuka-hiva, couverte de nuages, et plus au sud, les premiers rayons du soleil éclairaient les aiguilles de Ua-pu. Celles-ci pointaient sur la ligne d’horizon, et, telles les tours d’une église élégante et colossale, elles arboraient là, dans l’étincelante clarté du matin, l’enseigne appropriée à un monde de merveilles.
Personne à bord du Casco qui eût mis le pied sur les îles, ou connût, sauf par hasard, un mot d’aucune langue insulaire ; et ce fut avec quelque chose peut-être du même plaisir anxieux dont frémissait le cœur des découvreurs, que nous approchâmes de ces bords problématiques. Le rivage s’élançait en pics et en ravins ascendants ; il retombait en falaises et en éperons ; sa couleur passait par cinquante modulations d’une gamme perle, rose et olive ; et il était couronné de nuages opalescents. Les teintes vaguement répandues décevaient le regard : les ombres des nuages se confondaient avec les reliefs de la montagne, et l’île et son inconsistant baldaquin s’éclairaient devant nous comme une masse unique. Il n’y avait ni balise, ni fumée de ville à attendre, ni bateau-pilote. Quelque part, dans cette pâle fantasmagorie de falaises et de nuages, se cachait notre port, et quelque part, à l’est de ce point ‒ le seul repère signalé ‒, un certain promontoire, appelé indifféremment cap Adam et Ève, ou cap Jack et Jane, reconnaissable à deux figures colossales, grossières statues naturelles. C’est elles qu’il nous fallait découvrir, c’est elles qu’on cherchait de tous les yeux, de toutes les lunettes, en discutant les cartes. Le soleil était au zénith et la terre toute proche lorsque nous les aperçûmes. Pour un navire arrivant du nord, comme le Casco, elles présentaient en effet le détail le moins caractéristique d’une côte saisissante : le ressac jaillissant les enveloppait par la base ; des mornes étranges, sévères, empanachés, s’élevaient par derrière, et Jack et Jane ‒ ou Adam et Ève ‒ ne ressortaient guère parmi les brisants plus qu’une couple de verrues.
Nous laissâmes porter le long de la côte. Sur tribord retentissaient les explosions du ressac ; des oiseaux volaient en pêchant sous la proue ; nul autre bruit ou signe de vie, humaine ou animale, sur tout ce côté de l’île. Aidé par son élan et par la brise mourante, le Casco rasa des falaises, découvrit une crique où se montrait une plage avec quelques arbres verts, et la dépassa, piquant dans la houle. Les arbres, de notre distance, auraient pu être des noisetiers ; la plage, une plage d’Europe, dominée par des montagnes modelées en petit d’après les Alpes et revêtues de bois d’une taille guère plus élevée que notre bruyère d’Écosse. De nouveau, la falaise s’entrebâilla, mais cette fois avec une entrée plus profonde, et le Casco, serrant le vent, se glissa dans la baie d’Anaho. Le cocotier, cette girafe végétale, si gracieusement dégingandé, si exotique pour un œil européen, se pressait en foule sur la plage et grimpait en festons sur les pentes abruptes des montagnes. Des hauteurs âpres et nues enserraient des deux côtés la baie, que fermait vers l’intérieur un entassement de collines éboulées. Dans chaque crevasse de cette barrière, la forêt trouvait un asile, juchée et nichée comme des oiseaux dans une ruine, et, tout au haut, sa verdure émoussait les lames de rasoir des crêtes.
Sous les accores de l’est, notre goélette, ici privée de toute brise, avançait toujours, car, une fois lancée, la gracieuse créature semblait se mouvoir d’elle-même. À terre, tout proche, s’élevaient les bêlements de jeunes agneaux ; un oiseau chantait sur les pentes ; le parfum du sol et de cent fruits ou fleurs flottait à notre rencontre ; puis une ou deux maisons apparurent, haut situées sur la croupe des collines, l’une même entourée d’un semblant de jardin. Ces habitations très en vue, ce bout de culture étaient, nous devions l’apprendre, un indice du passage des Blancs, et nous aurions pu côtoyer cent autres îles sans y trouver l’équivalent. Ce fut ensuite que nous découvrîmes le village indigène, situé (selon la coutume générale) tout contre une courbe de la plage, tout contre un bois de palmiers, et, par devant, la mer grondait et blanchissait sur la concavité d’un arc de brisants. Car le cocotier et l’insulaire aiment tous deux et avoisinent le ressac. « Le corail croît, le palmier pousse, mais l’homme s’en va », dit le mélancolique proverbe tahitien ; mais tous trois, aussi longtemps qu’ils durent, sont les co-occupants de la plage. Le repère du mouillage était un évent dans les rochers, près de l’angle nord-est de la baie. Tout juste à notre intention, l’évent crachait. La goélette tourna sur sa quille ; l’ancre plongea. Cela fit un petit bruit, mais un grand événement : car mon âme est descendue avec cette amarre en des profondeurs d’où le cabestan ne pourra l’extraire ni le plongeur la repêcher ; et nous sommes, depuis cette heure, moi et plusieurs de mes compagnons de bord, les prisonniers des îles de Vivien.
Avant même que l’ancre eût plongé, une pirogue pagayait déjà, du village vers nous. Elle contenait deux hommes : un Blanc, un brun au visage tatoué de lignes bleues ; l’un et l’autre en d’immaculés costumes blancs d’Européens : l’agent du comptoir, M. Regler, et le chef indigène, Taïpi-kikino. « Capitaine, est-il permis de monter à bord ? », furent les premiers mots que nous entendîmes sur les Iles. Les pirogues se succédèrent, si bien que le navire regorgea d’hommes athlétiques hauts de six pieds, à tous les degrés de déshabillé : les uns en chemise, d’autres en pagne, l’un avec un mouchoir imparfaitement ajusté ; certains ‒ les plus considérables ‒ tatoués de la tête aux pieds en dessins terribles ; quelques-uns barbarement armés d’un couteau ; et un, qui m’est resté dans la mémoire pour son animalité, accroupi sur les cuisses dans une pirogue, suçant une orange et la recrachant à droite et à gauche avec une vivacité simiesque. Tous parlaient et nous ne comprenions pas un mot ; tous s’efforçaient de trafiquer avec nous qui n’avions aucune intention de trafic, ou nous offraient des curiosités de l’île, à des prix évidemment absurdes. Pas un mot de bienvenue, aucune démonstration de politesse, nulle autre main tendue que celles du chef et de M. Regler. Comme nous persistions à refuser les objets offerts, ils se plaignirent, hautement et grossièrement ; et l’un, le loustic de la bande, railla notre avarice au milieu de rires sarcastiques. Entre autres plaisanteries irritées : « Il est rudement joli, leur bateau, dit-il, mais ils n’ont pas d’argent à bord ! » J’éprouvais, je l’avoue, une vive répulsion et même de la crainte. Le navire était manifestement en leur pouvoir ; nous avions des femmes à bord ; je ne savais rien de mes hôtes, sinon qu’ils étaient cannibales ; l’Annuaire (ma seule autorité) était plein de recommandations inquiètes ; et quant à l’agent, dont la présence eût dû me rassurer, est-ce que, dans le Pacifique, les Blancs n’étaient pas les habituels instigateurs et complices des attentats indigènes ? En lisant cet aveu, notre excellent ami, M. Regler, ne pourra s’empêcher de sourire.
Dans le courant de la journée, tandis que j’écrivais mon journal, la cabine était de bout en bout pleine de Marquesans ; trois générations à peau brune, assis jambes croisées sur le parquet, me considéraient en silence avec des yeux embarrassants. Les yeux de tous les Polynésiens sont grands, lumineux et touchants, comme ceux des animaux et de certains Italiens. Une sorte de désespoir m’envahit, d’être ainsi sans remède bloqué dans un coin de ma cabine par cette foule muette ; une sorte de rage aussi, à songer qu’ils étaient hors de portée du langage articulé, comme des animaux à fourrure, ou des sourds de naissance, ou les habitants d’une autre planète.
Traverser la Manche, c’est, pour un garçon de douze ans, changer de cieux ; traverser l’Atlantique, pour un homme de vingt-quatre, c’est à peine modifier son régime. Mais je venais de m’échapper hors de l’ombre de l’Empire romain, dont les monuments dominent nos berceaux, dont les lois et les lettres mettent partout autour de nous contraintes et prohibitions. J’allais voir maintenant quels hommes peuvent être ceux-là dont les pères n’ont jamais étudié Virgile, jamais été conquis par Jules César, jamais été régis par la sagesse de Gaius et Papinien. Du même coup, j’avais dépassé cette zone confortable de langues apparentées, où il est si aisé de remédier à l’anathème de Babel. Mes nouveaux semblables restaient devant moi muets comme des peintures. Il me semblait que, dans mes voyages, toute relation humaine allait être supprimée et qu’une fois retourné chez moi (car à cette époque je projetais encore d’y retourner), mes souvenirs ne seraient qu’un livre d’images sans texte. Bien plus, je mettais en doute que mes voyages dussent beaucoup se prolonger. Peut-être une prompte fin leur était-elle destinée ; peut-être celui-là (mon ami futur, Kauauni), muettement assis parmi les autres, en qui je discernais un homme d’autorité, allait-il bondir sur ses cuisses, avec un strident appel ; et le navire serait emporté d’une ruée, et tous les gens du bord égorgés et mis en cuisine.
Rien ne pouvait être plus naturel que ces appréhensions, mais rien de moins fondé. Depuis, en parcourant les îles, je n’eus plus jamais réception si menaçante ; et d’en rencontrer une pareille aujourd’hui, m’alarmerait sans doute davantage et me surprendrait dix fois plus. La majorité des Polynésiens sont de relations faciles, francs, passionnés d’égards, avides de la moindre affection, tels des chiens aimables et caressants ; et même ces Marquesans, si récemment et imparfaitement rédimés de leur barbarie sanguinaire, devaient tous devenir nos intimes et, l’un d’eux au moins, pleurer notre départ avec sincérité.
II ON LIE CONNAISSANCE
L’obstacle des langues était un de ceux que je surévaluais le plus. Les dialectes polynésiens sont faciles à apprendre, quoique difficiles à parler avec élégance. Ils ont d’ailleurs beaucoup d’analogie entre eux, et quiconque a une teinture de l’un peut aborder les autres avec chance de succès.
Non seulement le polynésien est facile, mais les interprètes foisonnent. Missionnaires, agents commerciaux, Blancs qui vivent sur la générosité indigène, se rencontrent presque dans chaque île ou village. À leur défaut, bien des naturels ont glané quelques mots d’anglais ; et, dans la zone française (mais moins communément), beaucoup de Polynésiens sont familiarisés avec ce franco-anglais ou pidgin1 courant appelé dans l’ouest « Beach-la-Mar ». L’anglais encore s’apprend dans les écoles de Hawaii2, et grâce à la multiplicité des navires britanniques et à la proximité des États-Unis d’une part, et de nos colonies de l’autre, on peut d’ores et déjà le considérer comme la langue du Pacifique. Ainsi, par exemple, j’ai rencontré à Majuro un jeune garçon de l’île Marshall qui parlait un anglais excellent ; il l’avait appris au comptoir allemand de Jaluit, et ne savait cependant pas un mot d’allemand. Au dire d’un gendarme qui avait fait l’école à Rapa-iti, les enfants, qui ont beaucoup de difficulté ou de répugnance à apprendre le français, attrapent l’anglais au long des chemins et comme par hasard. Sur l’un des atolls les moins fréquentés des Carolines, mon ami, M. Benjamin Hird, eut la surprise de trouver des enfants qui parlaient anglais en jouant au cricket sur la plage. C’est en anglais que notre équipage de la Janet-Nicholl, assortiment de Noirs de diverses îles mélanésiennes, s’entretenait avec tous les insulaires rencontrés au cours du voyage ; c’est toujours en anglais qu’ils se transmettaient les ordres, et parfois même échangeaient des plaisanteries, sur le gaillard d’avant. Mais ce qui peut-être m’a frappé plus que tout, c’est un mot que je surpris sous la véranda du tribunal, à Nouméa. Les débats étaient clos ‒ il s’agissait d’une simiesque femme indigène inculpée d’infanticide ‒, et l’auditoire fumait des cigarettes en attendant le verdict. Une aimable dame française, anxieuse et presque en larmes, brûlait de voir acquitter la prisonnière, et se proclamait disposée à l’engager comme bonne d’enfants. Ses voisins se récriaient : la femme, disaient-ils, était une sauvagesse, et ne parlait pas la langue. « Mais vous savez, répliqua la belle sentimentale, “ils apprennent si vite l’anglais !” »3
Mais ce n’est pas le tout de pouvoir converser avec les gens. Au début de mes relations avec les indigènes, deux circonstances me vinrent en aide. D’abord, j’étais le montreur du Casco. Le navire lui-même, ses lignes élégantes, sa haute mâture, le pont immaculé, le mobilier rouge du salon, avec les ors, les blancs, et les miroirs multipliants de la petite cabine, nous amenaient cent visiteurs. Les hommes toisaient les dimensions avec leurs bras, comme leurs pères toisaient les navires de Cook ; les femmes déclaraient les cabines plus jolies qu’une église ; de bondissantes Junons ne se lassaient pas de s’asseoir dans les fauteuils et de contempler dans les miroirs leurs douces images ; enfin, j’ai vu une dame relever son vêtement, et, avec des exclamations émerveillées et ravies, frotter son séant à nu sur les coussins de velours. Les biscuits, la confiture et le sirop complétaient la réception, et, comme dans les salons d’Europe, l’album à photographies passait de mains en mains. Ce banal recueil des costumes et des physionomies de tous les jours s’était transformé, après trois semaines de navigation, en un musée prestigieux de splendeurs lointaines. Dans la cabine dépaysée, on contemplait, on montrait du doigt, avec une excitation et une surprise ingénues, ces visages étrangers et ces vêtements barbares. Beaucoup reconnaissaient Sa Majesté, et j’ai vu des sujets français baiser sa photographie. Le capitaine Speedy ‒ en costume de guerre abyssin, supposé être l’uniforme de l’armée britannique ‒ recueillit maintes approbations ; et les effigies de M. Andrew Lang4 furent admirées aux Marquises. Voilà une retraite pour lui, quand il sera las du Middlesex5 et d’Homère.
Il me fut peut-être encore plus important d’avoir, durant ma jeunesse, fréquenté nos Écossais des Highlands6 et des îles7. À peine s’est-il écoulé plus d’un siècle depuis que ce peuple subissait la même transition convulsive que les Marquesans d’aujourd’hui. Dans les deux cas, une autorité étrangère imposée de force, les clans désarmés, les chefs déposés, de nouveaux usages introduits, et surtout la mode de regarder l’argent comme moyen et objet de l’existence. L’ère commerciale, dans les deux cas, succédant d’un bond à un âge de guerres extérieures et de communisme patriarcal. Prohibition, chez les uns de la pratique favorite du tatouage, chez les autres d’un costume favori8. Des deux côtés, une haute friandise supprimée : le bœuf, qu’il ravissait sous le couvert de la nuit aux pâturages du Lowland, refusé au Highlander amateur de viande ; le « cochon-long »9, qu’il razziait sur le village voisin, refusé au Canaque mangeur d’hommes. Les murmures, la secrète fermentation, les craintes et les ressentiments, les alarmes et conseils soudains des chefs marquesans, me rappelaient continuellement les jours de Lovat et de Struan10. L’hospitalité, le tact, de bonnes manières naturelles, un point d’honneur chatouilleux sont des qualités communes aux deux races ; commune aux deux langues la manie de supprimer les consonnes médianes. Voici un tableau de deux mots polynésiens11 très répandus :
maison
amour12
tahitien
fare
aroha
néo-zélandais
whare
samoan
fale
talofa
manihiki
fale
aloha
hawaien
hale
aloha
marquesan
ha’e
kaoha
L’élision des consonnes médianes, si nette dans ces exemples marquesans, n’est pas moins habituelle au gaélique13 et chez les Écossais du Lowland14. Fait encore plus étrange, le son polynésien dominant, cette aspiration figurée par une apostrophe, qui est si souvent la pierre tombale d’une consonne morte, s’entend aujourd’hui même en Écosse. Quand un Écossais prononce water, better, ou bottle15 : « wa’er, be’er, bo’le », l’aspiration est la même exactement ; et je crois pouvoir aller plus loin, et dire que si une telle population était isolée, et que ce défaut de prononciation devînt la règle, il apparaîtrait sans doute comme le premier stade de la transmutation du t en k, qui est la maladie des langues polynésiennes. D’ailleurs, les Marquesans ont une tendance à mener une vraie guerre d’extermination contre les consonnes, ou au moins la lettre l, si commune. Un hiatus enchante les oreilles polynésiennes : l’oreille même d’un étranger s’accoutume bientôt à ces lacunes barbares ; mais c’est le marquesan seul qui possède des noms comme Haaii et Paaaeua, où chaque voyelle se prononce distinctement.
Cette sorte de ressemblance entre un peuple des mers du Sud et certaines gens de mon pays me trotta beaucoup par la tête, aux îles, et non seulement m’incita à voir favorablement mes nouvelles connaissances, mais ne cessa d’influencer mon jugement. Un Anglais policé d’aujourd’hui qui voyage aux Marquises s’étonne de voir des hommes tatoués ; il y a peu de temps, les Italiens policés qui voyageaient en Angleterre trouvaient nos pères bariolés au pastel16 ; en revanche, lorsque, petit garçon, je leur rendis la visite, je m’amusai beaucoup de trouver l’Italie si retardataire, tant est précaire et subordonnée au jour et à l’heure la prééminence d’une race. Ce fut ainsi que je découvris un moyen de communication que je recommande aux voyageurs. Pour amener un indigène à me dire un trait de mœurs sauvages ou une croyance superstitieuse, je recherchais dans l’histoire de nos pères quelque trait d’une égale barbarie, que je contais d’abord. Tous ces sujets de notre folklore : Michael Scott, la Tête-de-Lord-Derwentwater, la Seconde-Vue, l’Esprit-des-Eaux, autant d’appâts infaillibles. La Tête-du-Taureau-Noir-de-Stirling17 me procura la légende de Rahero ; et ce que je savais des Cluny Macphersons et des Appin Stewarts18, me permit de connaître et m’aida à comprendre les tevas19 de Tahiti. L’indigène n’avait plus honte de sa barbarie, le sentiment de notre parenté humaine s’éveillait en lui, et ses lèvres s’ouvraient. C’est ce sentiment de parenté que le voyageur doit susciter et partager ; sinon il fera mieux de ne voyager que du lit bleu au lit brun. Et la présence d’un cockney20 ricaneur sera cause que toute une chambrée se renfermera dans le vague le plus nébuleux.
Le village d’Anaho est situé sur une bande de terrain uni, entre l’ouest de la plage et le pied des mornes surplombants. Un bois de palmiers, froissant perpétuellement ses verts éventails, le jonche de rameaux tombés, comme pour un triomphe, et l’ombrage comme une tonnelle. Une route va d’un bout à l’autre du couvert, entre des parterres de fleurs ‒ le magasin de modes de la communauté ; et dans le délicieux demi-jour, dans un air chargé de multiples parfums, les cases indigènes, isolées çà et là, mais toujours à portée d’entendre briser le ressac, éparpillent leur voisinage. Le même mot, nous l’avons vu, désigne en plusieurs dialectes polynésiens, sauf une ombre de différence, la demeure de l’homme. Mais bien que le mot soit pareil, la structure elle-même varie beaucoup ; et le Marquesan, l’un des insulaires les plus retardataires et barbares, est néanmoins le plus commodément logé. Les huttes de gazon de Hawaii, les maisons-cages de Tahiti, ou l’abri couvert, aux absurdes jalousies, des Samoans policés ‒ rien de tout cela ne peut se comparer au paepae-hae, ou plateforme d’habitation des Marquesans. Le paepae est une terrasse oblongue, construite sans ciment, de pierre volcanique noire, qui a de vingt à cinquante pieds de long, quatre à huit d’élévation au-dessus du sol, et où l’on accède par un large escalier. Tout le long de la partie arrière, et venant à peu près jusqu’à mi-largeur, s’allonge en une espèce de galerie la façade ouverte de la case. L’intérieur en est parfois net et presque élégant dans sa nudité, avec son dortoir que limite une balustrade longitudinale, une étoffe de couleur vive pendue à un clou et ‒ seuls indices de civilisation ‒ une lampe ou une machine à coudre White. Dehors, à une extrémité de la terrasse, le foyer culinaire brûle sous un auvent ; à l’autre, il y a parfois une loge à porcs ; le reste est le promenoir du soir et la salle de banquet au frais. Dans certaines maisons, l’eau des montagnes, plus douce, est amenée par des tuyaux de bambou perforé. Préoccupé des rapprochements avec le Highland, je revis en imagination les mottes malpropres de gazon et de pierraille sur lesquelles, dans les Hébrides et les îles du Nord, je me suis souvent assis pour converser. L’explication d’un tel contraste est double. En Écosse, le bois est rare et, avec des matériaux aussi grossiers que du gazon et de la pierre, nulle propreté possible. Puis, en Écosse, il fait froid. Un toit et un foyer sont des nécessités si pressantes que l’homme ne regarde pas au-delà : il est dehors tout le jour à chercher sa pitance, et le soir, lorsqu’il a dit : « Aha ! il fait chaud ! », il n’en demande pas plus. Ou, s’il demande quelque chose d’autre, ses aspirations sont plus élevées : une belle école de poésie et de chant s’est développée sous ces toits grossiers, et un air comme Lochaber no more21 est une preuve de raffinement plus convaincante, et encore plus impérissable, qu’un palais.
Sur la plateforme d’habitation, une foule considérable de parents et de vassaux se rassemble. À l’heure du crépuscule, lorsque le feu flamboie, que le parfum du maioré22 en train de cuire emplit l’air, que déjà peut-être la lampe brille entre les piliers de la case, on les voit réunis en silence pour le repas, hommes, femmes et enfants ; et chiens et cochons gambadent pêle-mêle sur la terrasse et l’escalier, en agitant des queues rivales. Les étrangers du navire furent vite les bienvenus : bienvenus pour plonger leurs doigts dans le plat de bois, boire le lait des cocos, partager la pipe circulante, écouter et soutenir de grandes discussions sur les méfaits des Français, le canal de Panama, ou la position géographique de San Francisco et de New Yo’ko. Dans un hameau du Highland, tout à fait hors de portée des touristes, j’ai reçu la même hospitalité simple et digne.
J’ai mentionné deux faits, la conduite déplaisante de nos premiers visiteurs et le cas de la dame se frottant aux coussins, qui pourraient donner une très fausse opinion des manières marquesanes. La grande majorité des Polynésiens ont d’excellentes manières, mais le Marquesan est à part : ennuyeux et attrayant, sauvage, timide et raffiné. Si vous lui faites un cadeau, il affecte de l’oublier, et il faut le lui offrir encore à son départ : jolie formalité que je n’ai rencontrée nulle part ailleurs. Un simple mot vous débarrasse d’un seul, comme d’une foule, tant ils sont farouchement fiers et modestes, alors que dans d’autres îles, les habitants, plus aimables, mais plus frustes, se presseront autour de l’étranger, tenaces comme des mouches. Un manquement ou une insulte, le Marquesan ne les oublie jamais. J’étais un jour au bord du chemin à causer avec mon ami Hoka, lorsque je vis soudain son regard s’enflammer et sa taille se redresser. Un Blanc à cheval descendait de la montagne. Tout le temps qu’il fut à échanger des salutations avec moi, Hoka ne cessa de le dévorer des yeux et de s’ébouriffer comme un coq de combat. C’était un Corse qui, des années auparavant, l’avait appelé « cochon sauvage »23, « coçon chauvage », prononçait Hoka. Avec des gens si ingénus et susceptibles, on peut imaginer si nos patauds de l’équipage les offensaient par étourderie. Durant une de ses visites, Hoka tomba soudain en un silence pensif, puis quitta le navire avec une froide politesse. Une fois que je fus rétabli dans ses bonnes grâces, il m’expliqua fort adroitement et exactement la nature de l’affront que je lui avais fait : je lui avais demandé de me vendre des noix de coco, et dans l’idée de Hoka, les articles d’alimentation étaient choses qu’un gentleman doit donner, et non pas vendre, ou du moins pas à un ami. En une autre occasion, j’offrais à l’équipage de ma baleinière un goûter de chocolat et de biscuits. Je dus enfreindre, je n’ai jamais su comment, quelque règle de bienséance, car on me remercia sèchement, et ce que j’offrais resta sur la plage.
Mais notre pire bévue fut quand nous mortifiâmes Toma, père adoptif de Hoka, et à ses propres yeux chef légitime d’Anaho. Tout d’abord, nous ne lui avions pas rendu visite comme nous le devions, dans sa belle maison neuve à l’européenne, la seule du village. En outre, lorsque nous allâmes à terre pour visiter son rival, Taipi-kikino, c’est Toma que nous vîmes debout au bord de la plage, en sa prestance superbe, et magnifiquement tatoué, et c’est à lui que nous posâmes la question : « Où est le chef ? ‒ Quel chef ? » s’écria Toma, en tournant le dos aux blasphémateurs. Il ne nous le pardonna jamais. Hoka allait et venait quotidiennement avec nous ; mais seuls, je crois, de tout le pays, ni Toma ni sa femme ne mirent le pied à bord du Casco. Quelle tentation il surmontait, un Européen l’appréciera difficilement. La cité volante de Laputa24 qui jetterait l’ancre pour une quinzaine dans Saint James’ Park25, ne donne qu’une faible image du Casco mouillé devant Anaho, car le Londonien a des plaisirs multiples ; mais le Marquesan s’avance vers la tombe à travers une incessante monotonie de jours.
L’après-midi qui devait précéder notre appareillage, une délégation vint à bord nous faire les adieux : neuf de nos amis particuliers chargés de présents et parés comme pour une fête. Hoka, le meilleur danseur et chanteur, le dandy d’Anaho, était l’un des plus beaux jeunes gens du monde : grave, imposant, majestueux, léger comme une plume et fort comme un bœuf. Mais on l’eût à peine reconnu, dans cette occasion, lorsqu’il s’assit, affaissé et silencieux, le visage morne et fermé. Il était curieux de voir ce garçon tellement affecté ; plus curieux encore de reconnaître en cet ami, si bien vêtu, si visiblement ému de notre départ, l’un des sauvages à demi-nus qui nous avaient assaillis et insultés à notre arrivée. Mais le plus étrange, peut-être, c’était qu’il nous offrit ce manche d’éventail sculpté, car c’était la plus précieuse de ces curiosités qui nous avaient été exhibées le premier jour. Ces curiosités, aussi longtemps que nous restâmes des étrangers, ils avaient essayé de nous les vendre à des prix exorbitants ; mais à peine étions-nous devenus leurs amis qu’ils nous pressaient de les accepter pour rien.
La dernière visite ne se prolongea pas. L’un après l’autre, ils nous serrèrent les mains et redescendirent dans leurs pirogues. Hoka tourna le dos immédiatement, et nous ne vîmes plus son visage. Taipi, lui, resta debout, nous faisant face avec de gracieux gestes d’adieu ; et quand le capitaine Otis amena le pavillon, tous se découvrirent. Ce fut la séparation. L’épisode de notre séjour était considéré comme terminé, et bien que le Casco soit demeuré encore quarante heures sur ses amarres, personne ne revint à bord, et je crois même qu’ils évitèrent de se montrer sur la plage. Cette réserve et cette dignité sont le plus beau trait du Marquesan.
1 Sorte d’argot composite qui joue sur les côtes de la Chine et du Japon, et généralement en Extrême-Orient, le même rôle que la « langue franque » dans le bassin de la Méditerranée. (N.d. T.)
2 Alors indépendantes, les îles Sandwich ou Hawaii n’appartiennent aux États-Unis que depuis 1898. (N.d. T.)
3 En français dans le texte. (N.d. T.)
4 Littérateur anglais (1844-1912), connu par ses études de mythologie et de folkore. (N.d. T.)
5 Comté où se trouve située en partie la ville de Londres. (N.d. T.)
6 Hautes-Terres. La partie montagneuse, au nord de l’Écosse. Au sud, sont les Basses-Terres : Lowland. (N.d. T.)
7 Hébrides, Orcades, Shetland. (N.d. T.)





























