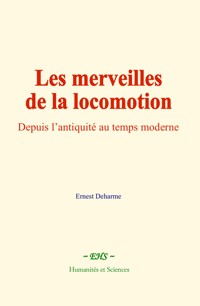Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Extrait : "Tout est mouvement dans la nature. Que nos yeux se dirigent sur la terre ou s'élèvent vers le ciel, ils ne voient que mouvement et progrès. Ici, des transformations géologiques, des îles qui s'abîment et des volcans qui jaillissent, une mer immense montant soir et matin ; des graines qui germent et des forêts qui s'élèvent ; et, pour régner sur ce monde, des animaux qui s'y agitent sans cesse ; tout emporté dans l'espace d'un mouvement régulier..."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 336
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335043075
©Ligaran 2015
Tout est mouvement dans la nature. Que nos yeux se dirigent sur la terre ou s’élèvent vers le ciel, ils ne voient que mouvement et progrès. Ici, des transformations géologiques, des îles qui s’abîment et des volcans qui jaillissent, une mer immense montant soir et matin ; des graines qui germent et des forêts qui s’élèvent ; et, pour régner sur ce monde, des animaux qui s’y agitent sans cesse ; le tout emporté dans l’espace d’un mouvement régulier, dont nous ne pouvons prévoir la fin. Là-haut, ce sont des mondes dont les révolutions s’exécutent avec la même régularité et dont les mouvements sont liés à celui de notre planète comme celui-ci l’est aux leurs, tous ces mouvements enchaînés par cette loi fatale que la chute d’une pomme a révélé au génie de Newton et qui s’appelle l’attraction universelle.
Mais tous ces mouvements ne sont pas de même nature. Des différences marquées existent entre eux et nous font apparaître la vie sous ces divers aspects.
Nous voyons les corps du règne minéral (ils sont 70 à peine) s’unir les uns aux autres, en obéissant à leurs affinités réciproques, – ces affections de la matière, – et constituer l’infinie variété de corps que la chimie et la minéralogie apprennent à connaître. Nous les voyons changer de forme et se mouvoir, passer d’un état d’équilibre à un autre, jaillir en gerbe au-dessus du sol, bondir en cascades ou s’écouler paisiblement vers l’Océan, en se soumettant aux lois physiques sur lesquelles repose l’harmonie de l’univers. Tous ces mouvements, les uns passagers, les autres permanents, ont lieu avec une passivité absolue de la part des corps qui les exécutent.
Ce caractère se modifie dans le règne végétal, et les mouvements de certaines plantes deviennent instinctifs. C’est ainsi que les feuilles se dirigent du côté d’où leur viennent l’air et le soleil, que les racines se cramponnent au morceau d’engrais qui leur apporte une nourriture plus riche ; qu’au moment de la floraison, les étamines embrassent le pistil et que certaines plantes quittent le fond des eaux pour venir éclore leur fleur à la surface.
L’intelligence enfin, s’élevant au-dessus de l’instinct aveugle, se révèle chez les animaux, et c’est, non seulement dans leurs rapports avec l’homme, mais encore dans leur vie privée qu’on en voit des preuves éclatantes. Leurs mouvements ne sont plus automatiques, ni instinctifs, ils sont raisonnés, conscients.
Au-dessus de ces êtres des trois règnes, dont les déplacements ne sont que des infiniment petits auprès des mouvements accomplis dans l’espace par les mondes qui les portent, s’élève l’homme, soumis comme eux aux forces naturelles et à l’instinct qui les guide, mais possédant à un degré supérieur l’intelligence qui règle chacun de ses pas.
Mais cette intelligence, qui étend son empire, rend en même temps ses membres impuissants à lui en faire parcourir les différentes parties. Ses seuls efforts ne peuvent le conduire bien loin. Il use de sa supériorité sur tous les êtres de la création pour les soumettre à ses volontés, et, si les animaux eux-mêmes ne le servent pas assez selon ses désirs, il asservit les forces naturelles, les dompte comme il a fait de ces animaux, s’en fait souvent un levier sur lequel il s’appuie pour courir sur la terre ou pénétrer dans son sein, pour franchir l’Océan ou s’enfoncer dans ses eaux, ou bien enfin pour s’élever dans l’air.
Être supérieur vis-à-vis de tous les autres êtres de la création, c’est, il est vrai, un pygmée vis-à-vis du Créateur lui-même, mais un pygmée grandissant sans cesse et pour qui le progrès est une loi aussi fatale que le mouvement est un besoin inné.
Nous nous proposons de faire connaître dans ce livre les moyens les plus remarquables employés par l’homme pour se mouvoir sur la terre ou dans la terre.
Tandis que la plupart des animaux ne peuvent vivre que dans un milieu spécial et peu étendu, l’homme est moins qu’aucun d’eux l’esclave de ses habitudes. S’il aime ses dieux lares et le ciel de sa patrie, il peut cependant changer de gîte et de climat pour son intérêt, pour ses plaisirs même.
Les insectes ont chacun leur loge secrète, ceux-ci dans la terre, ceux-là dans le tissu des végétaux ou des animaux ; les poissons ne peuvent vivre que dans l’eau : froide pour ceux-ci, tempérée pour ceux-là, douce pour les uns, salée pour les autres, calme au sein des lacs, agitée au cours des torrents, coulant en mince filet dans les petits ruisseaux, dormant en grande masse dans les bas-fonds de l’Océan. Le lion et la panthère se plaisent au désert, l’ours blanc au milieu des glaces des mers polaires, le serpent et la chauve-souris dans l’atmosphère lourde et viciée des cavernes, le condor dans l’air raréfié des plus hauts pics de la Cordillère des Andes ; c’est enfin pour vivre toujours dans une atmosphère plus douce que l’hirondelle regagne à l’approche de l’hiver les pays du soleil et revient, avec les feuilles, faire son nid sous le toit qui l’a abritée pendant ses premières années.
Les grandes agglomérations humaines se sont fixées dans les pays tempérés, mais les régions équatoriales et polaires sont aussi habitées, et si l’Abyssin et le Lapon ne quittent pas leur pays, ils sont visités souvent par les Européens. L’homme se lance sans crainte sur l’Océan, et s’il ne peut, comme les sirènes, vivre avec la même facilité dans l’eau que dans l’air, il sait plonger au sein de la masse liquide pour y cueillir le corail et les huîtres perlières aussi aisément qu’il s’enfonce dans la terre à la recherche du charbon et des métaux précieux. Grâce aux procédés ingénieux qu’il emploie pour varier ses vêtements et sa demeure, il vit dans l’air humide des mines comme dans l’air comprimé du scaphandre ou dans l’air raréfié des hautes régions de l’atmosphère.
Avec de l’air en provision, il peut tout braver : les miasmes délétères des exploitations souterraines, l’inconnu des vallées sous-océaniques, le feu même.
Pour des courses longues et souvent aventureuses, les jambes de l’homme sont trop fragiles et trop courtes, et celles des animaux doivent lui venir en aide. Le chameau sert de monture et de bête de somme, le bœuf est bête de trait, et le cheval sert à la fois aux deux usages.
À côté de ces animaux viennent s’en placer quelques autres, utilisés seulement en certains pays, ou consacrés à des usages spéciaux : l’âne et le mulet auxiliaires du cheval, mais moins forts et rendant de moindres services ; l’hémione remplaçant ce dernier dans l’Inde ; le yack et le bison, parents du bœuf et qui peuvent le suppléer dans certains cas ; l’éléphant servant de monture dans l’Inde, le chameau dans le désert et l’autruche dans quelques parties de l’Afrique ; le renne et le chien enfin, les bêtes de trait des pays glacés.
Tels sont, en résumé, les animaux dont l’homme a emprunté le secours. Les plus puissants d’entre eux ne portant encore que des charges bien faibles, il a fallu, pour le transport des lourds fardeaux, recourir à la voiture.
C’est à Cyrus que l’invention en est généralement attribuée ; mais il est très permis de croire que l’emploi des roues est de beaucoup antérieur à lui et l’on peut rechercher quels ont été les faits ou les idées qui ont dû conduire à cette simple découverte. Il est vraisemblable que, ne pouvant charger telle bête de somme de tout le fardeau qu’il avait à lui imposer, l’homme aura imaginé de le lui faire tirer. De là le traîneau, qui, selon toute probabilité, a été le point de départ de la voiture. Quelques pierres auront été placées sous le véhicule improvisé, peut-être même des pièces de bois de forme arrondie, des rouleaux enfin, différant peu de ceux qui servent dans nos chantiers de construction actuels pour le transport des lourds matériaux, pierre, bois ou fer ; et des rouleaux à la roue, la transition est simple. La roue n’est qu’une tranche du rouleau, rendue plus légère par des évidements intelligemment ménagés, et plus résistante par la ferrure destinée à la garantir de l’usure et des chocs produits par les inégalités du chemin.
Cette série d’hypothèses, d’ailleurs très naturelles, se trouve parfaitement justifiée par la forme des roues des premiers chars dans l’antiquité, forme rudimentaire que l’on retrouve encore aujourd’hui, dans toute sa simplicité, aux roues des chariots catalans. Ces roues sont de simples disques ferrés, ayant 4 ou 5 centimètres de largeur, assujettis d’une façon grossière au véhicule qu’ils supportent et produisant dans les chemins montueux des Pyrénées un bruit strident et criard que prolonge encore la lente allure des bœufs qui y sont attelés.
Le traîneau, cet état primitif du plus somptueux de nos carrosses ou de nos wagons d’aujourd’hui, est d’ailleurs utilisé avec avantage dans plusieurs pays, et notamment dans les contrées septentrionales et dans les pays de montagnes.
Dans les contrées septentrionales, deux raisons principales en ont maintenu et en maintiendront l’usage : la dureté de la terre glacée et l’absence ou la rareté des voies de communication. Quel que soit l’objet qu’on ait à faire mouvoir sur le sol, on favorisera son mouvement en réduisant le frottement qui se produit lorsqu’on cherche à le déplacer, frottement qui dépend tout d’abord de la nature des surfaces en contact. Le sol glacé des pays du Nord se prête merveilleusement à ce déplacement. Les surfaces du patin et du sol acquièrent par l’usage un poli essentiellement favorable au mouvement. Qu’arriverait-il si des roues étaient substituées aux longs patins de glissement ? Elles pénétreraient dans la neige au lieu de rester à la surface et deviendraient un obstacle à la marche. Le véhicule procéderait par ressauts et par saccades, se fatiguant lui-même, fatigant ceux qui y seraient placés et la bête qui le tirerait. Le traîneau, en abaissant le centre de gravité du véhicule presque au niveau du sol, et en lui fournissant une large base de sustentation, empêche ces accidents de se produire. Le traîneau passe partout, la roue sur les bons chemins seulement.
Tout le monde connaît le sabot qu’employaient nos anciennes diligences. À la montée d’une côte, tous les voyageurs descendaient et suivaient au pas le véhicule pesamment chargé. Au sommet, on remontait en voiture, le sabot était assujetti sous l’une des roues de derrière pour descendre le versant et les chevaux partaient. La voiture devenait momentanément un traîneau : trois des roues conservaient leur liberté et le frottement de roulement de la quatrième était transformé en frottement de glissement. C’est en traîneau qu’on faisait une partie de la traversée du Mont-Cenis, avant que le chemin de fer de Fell, qui a précédé l’ouverture du souterrain, fût établi.
Les forêts, dans les pays de montagnes, sont exploitées de la sorte. De jeunes arbres, ou même des branches à peine dégrossies, réunis par quelques liens tordus, servent à improviser un traîneau, qui est démembré à l’arrivée ou que le charbonnier remonte sur ses épaules. Le lit d’un ravin est le chemin suivi ; les pierres roulent sous le véhicule et descendent avec lui.
D’autres fois, ce sont des rondins de sapin couchés en travers de la percée ouverte au milieu du bois et fixés au sol par des piquets placés à leurs deux extrémités. Tels sont les chemins de schlitt qui servent à l’exploitation des forêts.
C’est en traîneau qu’on fait parcourir aux touristes certains passages rapides des Alpes ou des Pyrénées. Une de ces descentes renommées est celle de Brame-Farine, près d’Allevard, dans le département de l’Isère.
À Madère, la circulation s’effectue de la manière la plus pittoresque : toujours à cheval ou en traîneau. Quand il s’agit de monter, les traîneaux sont tirés par des bœufs ; pour descendre, les frêles véhicules sont lancés sur les pentes, conduits et à peine retenus à l’arrière à l’aide de cordes par un ou plusieurs guides dont les principaux efforts consistent à éviter les chocs aux tournants, parfois très brusques.
Avant de décrire la première de ces voitures à roues dont l’invention a été un progrès considérable demeuré, sans date dans l’histoire de la locomotion, arrêtons-nous pour esquisser rapidement les faits si intéressants qui expliquent l’avantage de la voiture sur le traîneau, puis du wagon de nos chemins de fer sur la voiture elle-même.
Tous les progrès de la locomotion reposent sur les améliorations apportées aux deux surfaces en contact durant le mouvement : patin et roue d’une part, chaussée ou rail d’une autre. Les améliorations introduites dans la construction du véhicule lui-même n’ont été que la conséquence des premières. L’emploi de la vapeur comme moteur a marqué une nouvelle étape que nous décrirons avec tous les développements qu’elle comporte.
Lorsqu’on examine à la loupe les objets les mieux polis, ou aperçoit à leur surface une innombrable quantité d’aspérités et de cavités, qui forment, entre deux objets rapprochés, comme autant de petites dents d’engrenage s’enchevêtrant les unes dans les autres. Chacun des deux objets agit sur celui qui lui est opposé comme un morceau de pierre ponce sur la main. Il y a entre eux :
1° Production d’une résistance au mouvement qu’on veut déterminer et qui est le frottement ;
2° Destruction des aspérités existantes, polissage des surfaces, d’où usure.
C’est l’effet qui se produit lorsqu’on pousse un dé d’ivoire sur le drap d’un billard. L’impulsion cessant, le dé s’arrête ; mais si au dé on substitue une bille, la moindre impulsion produit un mouvement qui se prolonge encore après que l’action a cessé d’être exercée. Le frottement n’est pas détruit, il est seulement réduit par le changement de forme de la surface. Dans le premier cas, il y avait frottement de glissement ; dans le second, il y a frottement de roulement.
Si, au lieu de placer cette bille d’ivoire sur une table recouverte de drap, nous la plaçons sur une table polie de bois ou de métal, une impulsion bien moindre que la première suffira à lui faire parcourir le même chemin.
Ces faits, tout simples et tout familiers, que nous venons d’observer sur une petite échelle, se produisent en grand.
Qu’un traîneau glisse sur le sol, qu’une voiture roule sur une chaussée, ou un wagon sur des rails, qu’un bateau se meuve sur l’eau ou un ballon dans l’air, il y a frottement. Une force se développe, au moment où le mouvement commence, de la part du sol, de l’eau ou de l’air avec lequel le véhicule est en contact. Elle est faible, presque insignifiante dans l’air, elle est plus grande dans l’eau ou à sa surface, et prend des valeurs très diverses et parfois considérables sur le sol. En somme, on peut dire, d’une manière générale, que toutes les fois que deux corps, en contact, viennent à être animés de vitesses variables, – ou l’un d’une certaine vitesse, l’autre restant à l’état de repos, – il se produit une force retardatrice du mouvement, et il y a frottement.
Quelles sont les lois du frottement ? Les géomètres et les ingénieurs ont cherché beaucoup et longtemps, et cherchent encore, car les opinions les plus opposées se sont produites. Nous n’avons pas l’intention de les relater toutes ici ; mais il convient d’indiquer les faits principaux, ceux sur lesquels on est généralement tombé d’accord et qui sont, par suite, hors de conteste.
Amontons est le premier qui s’occupa de la recherche des lois du frottement. Il se servait, pour ses expériences, d’un plan mobile autour d’une charnière et dont il faisait varier l’inclinaison. Mais les résultats auxquels il fut conduit paraissent contradictoires. Coulomb, en 1781, reprit ces recherches.
Sur deux madriers horizontaux juxtaposés il fixait un troisième madrier en chêne, long de 8 pieds, large de 16 pouces. Un traîneau, en forme de caisse, de 18 pouces de large, qu’il chargeait de poids, pouvait glisser sur ce dernier madrier, et le parcourir dans sa longueur. Une corde flexible, attachée au traîneau, venait, dans une direction horizontale, s’enrouler sur la gorge d’une poulie très mobile. Un plateau attaché à son extrémité recevait des poids et pouvait descendre dans un puits de 4 pieds de profondeur. Les poids, successivement placés dans le plateau, déterminaient le mouvement du traîneau. Un pendule, battant les demi-secondes, permettait d’étudier ainsi la loi du mouvement. La nature et l’étendue des surfaces frottantes, modifiées tour à tour, donnaient le moyen de varier à l’infini les conditions de ces expériences.
Le général Morin, en 1831, M. J. Poirée, en 1851, M. Bochet, en 1856 d’abord, puis en 1861, ont repris et étendu les études commencées par Coulomb.
On admettait, avant les travaux de ces deux derniers ingénieurs, que le frottement était proportionnel à la pression normale que les surfaces exercent l’une sur l’autre, qu’il variait selon la nature et l’état des surfaces en contact, et qu’il était indépendant de la vitesse et de l’étendue de ces surfaces.
M. Poirée a démontré que, pour des vitesses supérieures à 4 ou 5 mètres par seconde, le frottement diminuait à mesure que la vitesse augmentait.
Dans un mémoire fort intéressant, et à la suite de nombreuses expériences exécutées sur le chemin de fer de l’Ouest avec un wagon-traîneau du système Didier, M. Bochet a réfuté les premières lois admises et a conclu :
1° Que le frottement diminue à mesure que la vitesse augmente ;
2° Que le frottement n’est plus proportionnel à la pression et, par suite, n’est plus indépendant de l’étendue des surfaces frottantes, dès que la pression cesse d’être petite ;
3° Qu’il n’y a pas, en général, de frottement spécial au départ.
Ces nouvelles lois viennent renverser les opinions précédemment admises. Est-ce à dire, pour cela, qu’elles sont la dernière expression de la vérité et qu’elles ne souffriront pas de modifications ? Nous n’oserions pas l’affirmer.
On ne peut se faire une idée exacte des difficultés qui entourent l’exécution de ces expériences : les circonstances, qui semblent les plus insignifiantes, exercent souvent une influence considérable, qui échappe même aux yeux les plus perspicaces, à l’attention la plus vigilante. L’observation de ces phénomènes, où la constitution moléculaire des corps est immédiatement en jeu, présente bien autrement d’obstacles que celle des faits chimiques où les qualités et les affinités particulières de ces mêmes molécules se révèlent.
Nombre d’opérations, exécutées dans des conditions en apparence complètement identiques, donnent des résultats différents et déroutent l’expérimentateur ; nous disons : en apparence identiques, car nos yeux ou nos moyens de mesure ou de contrôle doivent nous égarer. Les deux morceaux de fer que nous faisons frotter l’un contre l’autre, bien qu’ils soient pris dans une masse que nous croyons homogène et qui a subi les mêmes opérations préparatoires, peuvent présenter, et présentent sans doute, des différences de contexture que nous ne pouvons saisir. Les fibres de tel morceau de bois ne sont pas dirigées comme celles de tel autre ; les parties tendres sont plus nombreuses dans celui-ci que dans celui-là ; l’état hygroscopique des deux échantillons est différent. En somme, l’homogénéité, l’identité, dans le sens le plus absolu et le plus général que l’on accorde à ces deux mots, n’existent pas. Les différences constatées n’offrent donc rien de surprenant.
Il en est absolument, de ce qui se passe entre ces deux morceaux de matière, comme de ce qui se produit entre deux individus de mœurs, de caractères et d’esprits bien définis et entraînés dans une action commune. Il n’est pas douteux que les circonstances les plus inappréciables peuvent agir sur l’un et l’autre ou sur l’un des deux seulement, et modifier d’une manière très sensible le résultat qu’ils poursuivent de concert ? Est-il déraisonnable de croire que des influences d’une autre nature, mais tout aussi bien modificatrices, aient pu agir sur la constitution moléculaire des deux échantillons mis en contact, et n’est-il pas permis de supposer à ces atomes matériels et inertes une impressionnabilité que nous constatons chez les êtres vivants et matériels aussi ?
Lorsque nous modifions, par l’interposition d’un nouveau corps ou par une altération quelconque des surfaces en contact, les conditions de ces expériences, nous obtenons les résultats les plus divers. Des aspérités, des stries, l’application sur l’une des surfaces de bandes de cuir ou de caoutchouc, en multipliant les points de connexion et d’enchevêtrement, créent un obstacle au mouvement, tandis que l’interposition d’un corps gras, de plombagine, de suif ou de telle ou telle huile, en unissant et en polissant les surfaces rapprochées, diminue le frottement. De là, l’avantage que l’on retire de l’emploi des matières lubrifiantes.
Le cri strident des chars catalans, dont nous avons parlé, celui de toutes les voitures dont les roues sont insuffisamment graissées, résultent d’une attaque plus ou moins profonde des surfaces en contact. Ce grincement est accompagné d’un échauffement de ces surfaces, qui, s’il n’y est porté remède, peut avoir les conséquences les plus graves.
Les faits que l’on constate dans l’étude du frottement de glissement s’observent dans celle du frottement de roulement, mais avec cette différence qu’ils sont moins accusés. Les aspérités de la surface roulante s’engagent dans les cavités de la surface fixe et réciproquement, et le mouvement s’opère sans déterminer ces arrachements et ces érosions particulaires qui constituent, en grande partie, le frottement et qui exigent sans cesse, de la part du moteur, une production de force additionnelle. Les deux surfaces s’épousent successivement l’une l’autre, les petites aspérités abandonnent leur mutuelle étreinte avec d’autant plus de facilité qu’elles se sont plus facilement réunies, et que la pénétration a eu lieu dans une direction plus normale à la surface fixe, ou que le diamètre de la surface roulante a été choisi de plus grande dimension.
L’accroissement du diamètre des roues des véhicules, est, en effet, le but vers lequel tendent les constructeurs, mais divers obstacles les arrêtent, entre autres l’instabilité de la machine de transport, accrue par l’élévation de son centre de gravité. Ils cherchent alors des artifices pour abaisser la charge, ils la placent parfois en dessous des essieux, ainsi que cela s’est fait pour certaines voitures et pour quelques fardiers, destinés au transport des matériaux de construction : ils réalisent ainsi des combinaisons plus ou moins ingénieuses, et qui répondent d’une manière plus ou moins satisfaisante à des besoins déterminés.
Des préoccupations de l’ingénieur, la principale est celle qui a pour objet la diminution des aspérités des deux surfaces en contact. Tel est le but que remplissent les cercles garnissant les roues des véhicules, les semelles métalliques fixées aux patins des traîneaux. Pour diminuer les aspérités de la surface de roulement, on emploie les pavés de granit ou de grès, ou les cailloux fichés dans une forme incompressible en sable et que les lourdes charges et les temps alternativement secs et pluvieux ne peuvent facilement déformer. On choisit les cailloux de la meilleure qualité pour les chaussées empierrées ou macadamisées, et avant de les livrer à la circulation des voitures, on a soin d’en comprimer la surface à l’aide de ces rouleaux tantôt en pierre, tantôt en métal, chargés de sable, de pavés ou d’eau et que remorquent péniblement de longs attelages de chevaux, ou, plus aisément, une machine à vapeur superposée. À cette chaussée imparfaite, aux ornières, aux aspérités ou aux dépressions plus ou moins profondes, on substitue des poutres ou longrines en bois, des morceaux de fonte ou des lames de fer et d’acier, et on a le merveilleux moyen de transport qui s’appelle un chemin de fer.
Adieu les durs cahots avec les vieilles pataches dans les mauvais chemins ! adieu la musique des grelots au collier des chevaux, interrompue de temps en temps par les coups de fouet du postillon ou par la trompette du conducteur ! adieu ces relations qui se nouaient au cours du voyage et se prolongeaient parfois après lui ! On ne met plus que dix heures au lieu de onze jours, pour aller de Paris à Strasbourg. Quelques coups de sifflet et, comme en un songe, durant une nuit, on passe du Nord au Sud ou du Levant au Couchant.
Voyez-vous ce tombereau qui ne contient qu’une tonne de cailloux ? Un cheval a peine à le tirer sur cette route bien entretenue. Voyez à côté : un même cheval fait avancer sur ces rails un wagon chargé de 8 à 10 tonnes.
Mais les rails de fer n’offrent pas de garanties de durée suffisantes lorsque la voie est très inclinée et doit résister à l’usage réitéré des freins ou au passage fréquent de lourdes charges. Dans ce cas, on les remplace par des rails d’acier.
Les progrès de la carrosserie et du charronnage, nous le verrons plus loin, sont contemporains des progrès apportés à la construction des chemins et des routes, et le degré de civilisation d’un peuple est en rapport intime avec l’état de ses voies de communication. Que l’on considère les pays excentriques de notre Europe : la Russie, la Turquie, et, sans aller chercher si loin, l’Espagne, dont nous connaissons les chemins par les récits de Théophile Gautier et les dessins de Gustave Doré. Ne trouve-t-on pas les mêmes ornières à l’esprit qu’à la chaussée ? Le chemin de fer a contribué à faire le dix-neuvième siècle. Sans lui, nous n’aurions pas accompli ces progrès rapides que tout le monde admire.
Qu’on ne se méprenne pas cependant sur l’importance du rôle que peut jouer un chemin de fer et qu’on ne le croie pas capable d’opérer des transformations dans un pays qui n’offre des ressources ni par l’esprit ou l’industrie de ses habitants, ni par la richesse ou la fertilité de son sol. C’est pour avoir cru à la possibilité de semblables transformations que de nombreux chemins de fer, construits en pays étranger, n’ont produit d’autre résultat que la ruine de ceux qui les avaient entrepris, sans changer d’une manière notable la face des pays déshérités qui en avaient été dotés. Nous ne nous arrêterons pas, d’ailleurs, à cette question économique qui nous ferait sortir de notre sujet et n’a d’ailleurs rien que de très facile à expliquer.
Les anciens avaient bien compris tout l’intérêt que peuvent offrir de bonnes voies de communication. Ils employaient à leur construction les peuples vaincus, et les établissaient avec une telle solidité qu’on en retrouve encore aujourd’hui quelques-unes en parfait état de conservation. Les Voies Romaines étaient remarquables par leur beauté et leur solidité. Elles étaient formées de blocs énormes de pierre de taille, parfois superposés, reposant sur une couche épaisse de béton, c’est-à-dire de pierres cassées réunies entre elles par un ciment très résistant. Si nos pères ne connaissaient pas les causes de l’hydraulicité des chaux et des ciments révélées par Vicat, ils connaissaient du moins les mélanges capables d’acquérir par le temps une dureté comparable à celle de la pierre la plus dure.
En première ligne, étaient les voies consulaires, prétoriennes ou militaires destinées au passage des armées ; puis les voies secondaires. Leur largeur, d’ailleurs variable, atteignait 60 pieds romains (17 mètres). Les voies secondaires étaient, à propre ment parler, les routes du commerce. Leur largeur excédait rarement 5 mètres. Venaient ensuite l’actus, dont la largeur moyenne était moindre de moitié, l’iter, per quod itur, à pied ou à cheval, enfin le semi iter, semita, simple sentier de piétons.
Les plus célèbres voies qui nous restent de l’antiquité sont celles qu’on connaît sous les noms de voies Appienne, Aurélienne, Flaminienne, etc. La voie Appienne doit son nom au censeur Appius Claudius (311 avant J.-C.), qui la prolongea jusqu’au-delà de Capoue, sur une longueur de 142 milles. La voie Aurélienne, la première qui ait été conduite d’Italie en Gaule, menait de Rome à Arles en longeant la Méditerranée. Elle desservait Nice par le col de l’Escarène, en empruntant la route actuelle du Col de Tende. La voie Flaminienne allait de Rome à Ariminum (aujourd’hui Rimini). Elle avait 360 milles de longueur. Commencée par le consul Flaminius, en 222 avant J.-C., elle fut prolongée ensuite jusqu’à Aquilée, au fond de l’Adriatique. Comme la voie Aurélienne, elle aboutissait à Arles, mais elle passait par Milan, Turin et Suse pour atteindre Briançon et Embrun par le mont Genèvre. De Gap, une bifurcation se dirigeait sur Lyon par Die, Valence et Vienne.
Quelques autres voies romaines existent encore au travers des Alpes. Deux documents d’une grande valeur donnent sur ces routes des renseignements pleins d’intérêt. « Ce sont l’Itinéraire des provinces, dressé au deuxième siècle par les ordres d’Antonin le Pieux et la Table de Théodore, datant de la fin du douzième siècle et plus communément appelée Table de Peutinger, du savant antiquaire qui en prépara la publication. »
Ces documents étaient l’Indicateur Chaix de cette époque !
Dans le nord de la France, en Belgique et en Bourgogne, on rencontre encore de belles chaussées, auxquelles on a donné le nom de Brunehaut, mais dont la construction remonte sans doute aux Romains. Il est peu probable que cette reine, au milieu des troubles qui ont agité son règne, ait pu donner ses soins à l’exécution des grands travaux qu’on lui attribue.
Ce qui est certain, c’est que les chaussées dont nous venons de parler, dues ou non à Brunehaut, remontent à une date très ancienne. Leur existence actuelle ne fait que mieux prouver l’excellence de leur construction.
Mais ce qu’ont pu faire les Romains, grâce aux armées dont ils disposaient et malgré des moyens d’exécution grossiers, est devenu après eux, et pour longtemps, tout à fait impossible.
À la fin du douzième siècle, Philippe Auguste a amélioré les rues et les routes de son royaume.
Plus tard, Colbert a créé de nouveaux moyens de communication. Il s’est occupé de la réparation des routes existantes et de la construction de voies nouvelles. C’est lui, rappelons-le en passant, qui a fait construire le célèbre canal du Languedoc et projeté celui de Bourgogne.
À cette époque, le corps des ponts et chaussées était déjà créé. Sa fondation remonte à Louis XIII, mais c’est seulement à dater de 1739, époque de son organisation par Trudaine et Perronnet, que les travaux de viabilité reçurent une impulsion considérable : les grands ponts de Neuilly, de Mantes et d’Orléans furent construits. Toutefois, le corps des ponts et chaussées ne reçut sa constitution définitive qu’à dater du décret impérial du 7 fructidor, an XII (25 août 1804), complété par les décrets des 15 octobre 1851 et 17 juin 1854.
Dès lors, on s’occupa de la construction de ces routes magnifiques, à chaussée entièrement pavée, mesurant, y compris les accotements destinés aux piétons, jusqu’à 14 mètres de largeur.
À côté des roules nationales, réparties en trois classes, selon qu’elles unissent Paris à un État voisin ou à un port militaire, – à une des principales villes de France, – ou qu’elles établissent une communication transversale entre plusieurs départements, – se placent les routes départementales construites et entretenues avec les fonds votés par les conseils généraux des départements, – puis, les chemins vicinaux, qui relient les routes aux villages ou les villages entre eux, et enfin les chemins ruraux destinés à faciliter les travaux de l’agriculture et entretenus, comme les précédents, par les communes intéressées. Nous comptons :
La circulation sur les routes nationales a été l’objet de comptages qui permettent d’en apprécier l’importance. Elle est de 3, 200 millions de colliers à 1 kilomètre ce qui signifie qu’elle est représentée par environ 1 800 000 tonnes transportées à la même distance.
Quant au nombre des inspecteurs généraux, ingénieurs en chef, ingénieurs ordinaires et élèves-ingénieurs chargés des travaux de construction et d’entretien des routes nationales, il est de 575. Indépendamment du service des routes nationales, ces ingénieurs ont encore celui des rivières, des canaux, des ports et des travaux maritimes, etc., et sont, d’ordinaire, chargés des travaux à exécuter pour les routes départementales.
On peut se faire une idée des sacrifices que fait l’État pour la construction et l’entretien des voies de communication, par les sommes énormes qu’il consacre à l’enseignement du personnel auquel il confie la direction des travaux. Un ingénieur des ponts et chaussées, à sa sortie de l’école, se trouve avoir coûté à l’État 20 000 francs ; un ingénieur des mines plus du triple : 61 000 francs.
Les voies de terre perdant de leur importance, depuis l’impulsion donnée à la construction des voies ferrées, les ingénieurs des ponts et chaussées passent au service des compagnies et contribuent avec les ingénieurs sortis de l’École Centrale et de quelques autres écoles à la construction et à l’exploitation de ces nouvelles voies.
Le personnel qui appartient aux compagnies de chemins de fer est considérable. Peu de personnes s’en font une idée exacte. Voici, à cet égard, les renseignements que nous extrayons de l’ouvrage de M. Jacqmin, Directeur de la Compagnie de l’Est.
Le seul personnel de l’exploitation de la Compagnie de l’Est se composait, au 21 décembre 1865, de :
Ce chiffre étant pris comme base, le nombre des agents attachés à l’exploitation des voies ferrées, en France, serait de 60 000 environ.
La sécurité de la locomotion sur le sol, sur cette terre, qui est notre élément, cesse au moment où nous l’abandonnons pour nous lancer sur l’eau. Nous n’avons plus cette base ferme et solide sur laquelle nos pieds, malgré leur faible étendue, trouvaient un appui suffisant, et, pour nous soutenir sur l’eau, nous devons nous développer de tout notre corps et fournir la plus grande surface possible.
Encore ne nous éloignons-nous jamais du rivage auquel nos forces épuisées nous rappellent bientôt. Pour tenter de longs voyages, nous devons emprunter un véhicule et nous demandons à nos bras, au flot lui-même, au vent, à la vapeur, enfin, un secours indispensable. Il est impossible de dire, avec Gessner, quel fut le « premier navigateur. » Le premier homme qui tenta l’aventure vit-il une feuille tombée dans l’eau, emportée par le vent, ou bien une branche, un roseau peut-être, ou un tronc d’arbre entraîné par un courant, et l’idée lui vint-elle de faire comme la fourmi sur la feuille ou l’oiseau sur la branche ? On ne sait : mais bientôt il creusa l’arbre pour le rendre plus léger, se fit une voile d’un morceau de toile, imagina la rame et le gouvernail.
Qui saurait dire ce que le sombre gouffre a englouti de victimes et de combien de vies a été payé chaque progrès accompli dans l’art de la navigation !
Les rivières, les fleuves et encore moins les canaux n’offrent, eu égard à leur faible largeur et à leur faible profondeur, aucun danger sérieux dont la navigation ne se soit rendue maîtresse depuis longtemps. Un cours plus ou moins rapide, un lit plus ou moins profond, pas plus de vent que sur la terre et un abordage presque toujours facile à tout moment du parcours, telles sont les conditions générales de la navigation fluviale, qui n’a d’autre inconvénient que sa lenteur ; telles sont aussi les conditions de la navigation sur les lacs, à cela près que, sur quelques-uns d’entre eux, le vent soulève parfois des bourrasques, devant lesquelles les légères embarcations doivent fuir et regagner la rive.
Mais, il en est tout autrement de cette grande étendue d’eau salée qui couvre les trois quarts de notre globe, de l’Océan et des mers secondaires.
Combien diffère du sol qui conserve la trace éternelle des travaux de l’homme, cette masse liquide incessamment mobile, incessamment agitée, plissée d’ondulations que le moindre zéphir gonfle, grossit, et que le vent grandissant fait éclater en tempêtes, vaste champ d’observations que l’homme ne connaît pas encore, vaste corps insondé dont les savants n’ont pu mesurer encore les capricieuses pulsations !
Le problème, que nous avons indiqué, de la recherche des lois du frottement entre deux corps solides, problème dont la solution dernière n’a pas encore été donnée, paraît bien simple à côté de celui du déplacement d’un corps solide à la surface des eaux. Les plus grands géomètres ont cherché à le résoudre : Newton, Lagrange, Laplace, Cauchy, Airy, Fronde, Macquorne Rankine, etc. ; et cette question, si elle a été quelque peu éclaircie, ne laisse pas que d’être encore enveloppée de ténèbres épaisses.
Une pierre jetée dans l’eau donne naissance à des courbes dessinant à sa surface des cercles concentriques d’un rayon croissant. L’eau paraît fuir le centre frappé, et pourtant elle ne se déplace pas. Ce phénomène n’est autre que celui qu’on produit avec une corde étendue sur le sol, puis relevée et abaissée brusquement. Les divers points de la corde montent et descendent et, l’action cessant, reprennent sensiblement leur position première. Les cercles concentriques, qui se sont produits sur l’eau, sont le résultat de l’incompressibilité du liquide, de son élasticité. Comprimées par la chute de la pierre, les molécules aqueuses, placées sous celle-ci, ont soulevé celles qui étaient à l’entour en un cercle saillant. Celles-ci, s’abaissant en vertu de leur poids, ont déterminé la formation d’un second cercle, celui-ci d’un troisième et ainsi de suite ; les saillies diminuant, les intervalles augmentant, les ondulations se sont éteintes et, après une série d’oscillations, le calme s’est rétabli.
Quelles sont les lois de ces ondulations dues à la chute d’un corps dans l’eau, dues aussi à la progression d’un corps solide à sa surface ?
Il n’y a que trouble dans l’esprit des savants sur la nature, la direction et l’amplitude du mouvement moléculaire dans l’ondulation.
Ils sont à peu près d’accord sur ce fait : que la direction du mouvement est verticale ou sensiblement verticale ; mais sur ce point seul ils s’entendent.
Indépendamment de ces mouvements que prend la masse liquide sous l’action du navire qui progresse à sa surface, il s’en produit encore d’autres qui sont dus aux attractions de la lune et du soleil combinées, au mouvement de rotation de la terre, aux différences de densité résultant des différences de température et de salure des eaux, enfin aux courants et aux vents.
Le soleil et la lune exercent sur les eaux une attraction d’autant plus sensible que l’étendue des mers est plus considérable. Telle est la cause du phénomène des marées.
La surface des mers se trouve, dans son immense étendue, soumise à des différences de température, – élévation dans les régions équatoriales, abaissement dans les régions tropicales, – à des différences de salure qui déterminent des différences de densité. L’équilibre cesse tous les jours d’exister dans la masse des eaux, les mêmes causes amenant les mêmes variations de densité. Les parties les plus denses gagnent l’équateur, sous l’influence du mouvement de rotation de la terre ; les parties les moins denses ou les plus légères se dirigent, au contraire, vers les pôles, où elles se refroidissent de nouveau.