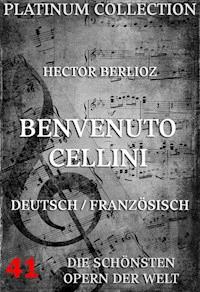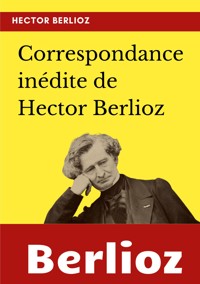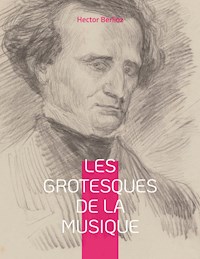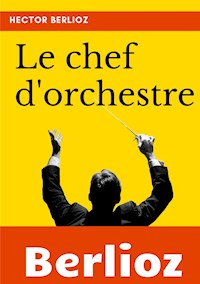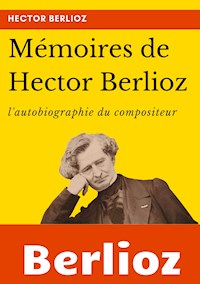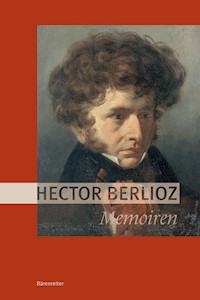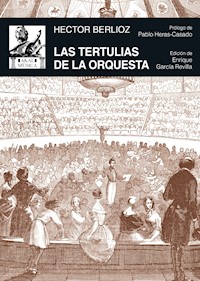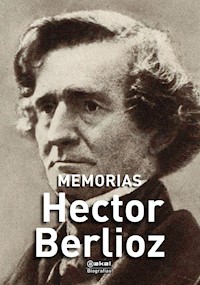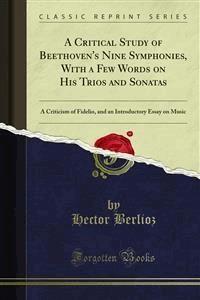Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: mémoires et écrits de compositeurs
- Sprache: Französisch
RÉSUMÉ : Dans "Les musiciens et la musique", Hector Berlioz nous invite à plonger dans une réflexion profonde sur la sociologie de la musique et la musicologie. Cet essai, empreint de l'intelligence et de la sensibilité de Berlioz, explore les interactions complexes entre les musiciens, leur art et la société qui les entoure. L'auteur, lui-même compositeur et critique musical de renom, offre une perspective unique sur la manière dont la musique influence et est influencée par le contexte social et culturel de son époque. Berlioz examine les rôles et les responsabilités des musiciens, tout en abordant les défis auxquels ils font face, qu'il s'agisse des attentes du public, des pressions économiques ou des évolutions stylistiques. Cet ouvrage se distingue par sa capacité à allier érudition et accessibilité, rendant ainsi ses réflexions pertinentes tant pour les spécialistes que pour les amateurs de musique. À travers une analyse fine et nuancée, Berlioz nous éclaire sur la place de la musique dans la société, la manière dont elle reflète les valeurs et les tensions de son temps, et comment elle peut, à son tour, influencer ces dynamiques. En lisant cet essai, le lecteur est amené à considérer la musique non seulement comme un art, mais aussi comme un phénomène social, ancré dans les réalités de son époque. "Les musiciens et la musique" est une invitation à redécouvrir la musique sous un angle nouveau, enrichissant notre compréhension de cet art universel. __________________________________________ BIOGRAPHIE DE L'AUTEUR : Hector Berlioz, né le 11 décembre 1803 à La Côte-Saint-André en France, est l'une des figures les plus emblématiques de la musique romantique. Compositeur, chef d'orchestre et critique musical, il a marqué son époque par son audace et son originalité. Berlioz est surtout connu pour ses compositions orchestrales, dont la "Symphonie fantastique" est sans doute la plus célèbre, une oeuvre qui illustre parfaitement son génie pour l'orchestration et son imagination débordante. En tant que critique, Berlioz a écrit pour divers journaux, partageant ses réflexions sur la musique et les musiciens de son temps. Sa plume, aussi acérée que passionnée, lui a valu une reconnaissance dans le monde littéraire. Berlioz a également été un fervent défenseur de la musique de Beethoven, qu'il admirait profondément.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 311
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sommaire
MOZART DON JUAN
LA FLÛTE ENCHANTÉE ET LES MYSTÈRES D'ISIS
CHERUBINI ESQUISSE BIOGRAPHIQUE
AUBER LES DIAMANTS DE LA COURONNE
LESUEUR RACHEL, NOÉMI, RUTH ET BOOZ
ESQUISSE BIOGRAPHIQUE
MEYERBEER LES HUGUENOTS
LE PROPHÈTE
HEROLD ZAMPA
DONIZETTI LA FILLE DU RÉGIMENT
HALÉVY LE VAL D'ANDORRE
BELLINI NOTES NÉCROLOGIQUES
ADAM LE TORÉADOR
MICHEL DE GLINKA LA VIE POUR LE CZAR RUSSLANE ET LUDMILA
FÉLICIEN DAVID LE DESERT
AMBROISE THOMAS LE CAÏD
GOUNOD SAPHO
FAUST
HENRY LITOLFF LA MUSIQUE SYMPHONIQUE A PARIS.
OFFENBACH BARKOUF
ERNEST REYER LA STATUE
BIZET LES PÊCHEURS DE PERLES
MOZART DON JUAN
15 novembre 1835.
On a donné hier soir Don Juan à l'Opéra. Je ne viens pas en faire l'analyse. Dieu m'en garde! Trop de savants critiques, musiciens, poètes, ou à la fois poètes et musiciens (comme Hoffmann par exemple) se sont exercés sur ce vaste sujet, de manière à ne rien laisser à glaner après eux. Je me bornerai à émettre quelques idées générales à propos de cette étonnante production toujours jeune, toujours forte, toujours à l'avant-garde de la civilisation musicale, lorsque tant d'autres, dont l'âge n'égale pas la moitié du sien, gisent déjà, cadavres oubliés dans les fossés du chemin, ou mendient des suffrages d'une voix cassée qu'on écoute à peine. Quand Mozart l'écrivit, il n'ignorait pas que le succès d'une œuvre pareille serait lent, et que peut-être même il ne serait pas donné à l'auteur de le voir. Il disait souvent, en parlant de Don Juan: «Je l'ai fait pour moi et quelques amis.» Mozart avait raison de n'espérer que l'admiration du petit nombre de musiciens avancés de son époque. La froideur de la masse du public devant le monument musical qu'il venait d'élever le prouva bien. Aujourd'hui même, si la supériorité de Mozart ne trouve pas en France de contradicteurs, c'est moins dans un sentiment réel du peuple dilettante qu'il en faut voir la cause, que dans l'influence exercée sur lui par l'opinion constamment la même des artistes distingués de toutes les nations; opinion qui a fini par passer dans l'esprit de la foule comme un dogme religieux sur lequel la controverse n'est point permise, et dont il serait criminel de douter. Pourtant le succès de Don Juan à l'Opéra, succès d'argent s'il en fut, peut être regardé comme la manifestation d'un progrès sensible dans notre éducation musicale. Il prouve avec évidence qu'une bonne partie du public peut déjà goûter sans ennui une musique fortement pensée, consciencieusement écrite, instrumentée avec goût et dignité, toujours expressive, dramatique, vraie; une musique libre et fière, qui ne se courbe pas servilement devant le parterre et préfère l'approbation de quelques esprits élevés (suivant l'expression de Shakespeare) aux applaudissements d'une salle pleine de spectateurs vulgaires. Oui, le nombre des initiés est devenu assez grand aujourd'hui pour qu'un homme de génie ne soit plus obligé de mutiler son œuvre en la rapetissant à la taille de ses auditeurs. La majorité des habitués de nos théâtres lyriques est encore, il est vrai, sous l'influence d'idées bien étroites, mais ces idées mêmes perdent peu à peu de leur empire, et, dans l'incertitude causée par la chute successive de leurs illusions, les traînards finissent par s'en rapporter aveuglément à la parole de ceux qui les ont devancés dans la voie du progrès, et s'applaudissent chaque jour de les avoir suivis, en faisant sur leurs pas de merveilleuses découvertes. Certaines parties des grandes compositions demeureront bien encore quelque temps voilées pour la multitude, mais au moins n'en est-elle plus à refuser à ces hiéroglyphes une signification, et ne désespère-t-elle pas d'en pénétrer le sens. On commence à comprendre qu'il y a un style en musique comme en poésie, qu'il y a par conséquent une musicalité de bas étage, comme une littérature d'antichambre, des opéras de grisettes et de soldats, comme des romans de cuisinières et de palefreniers. Par induction, on concevra peu à peu qu'il ne suffit pas qu'un morceau de musique soit d'un agréable effet sur l'organe de l'ouïe, mais qu'il doit remplir en outre d'autres conditions sans lesquelles l'art musical ne s'éleverait pas beaucoup au-dessus de l'art des Carêmes et des Vatels. On comprendra que, s'il est ridicule de vouloir exclure de l'orchestre le moindre de ses instruments, puisqu'ils peuvent tous produire des effets intéressants, employés à propos et avec sagacité, il l'est cent fois davantage de jouer de l'orchestre comme d'un piano dont on a levé les étouffoirs; d'entendre tous les sons confondus sans distinction de caractère, sans égard pour la mélodie qui disparaît, pour l'harmonie qui devient confuse, pour les convenances dramatiques blessées et pour les oreilles sensibles offensées. On verra bien qu'il est monstrueux d'accueillir l'entrée en scène de mademoiselle Taglioni avec les beuglements de l'ophicléïde et un feu roulant de coups de tampon, que cette instrumentation barbare, qui conviendrait à des évolutions de cyclopes, devient un stupide contresens appliquée à la danse de la plus gracieuse des sylphides; qu'il n'est pas moins singulier d'entendre la petite flûte doubler à la triple octave le chant d'une voix de basse, ou un accompagnement de violons, a punta d'arco, égayer un hymne de prêtres inclinés sur un tombeau. On apercevra enfin les déplorables conséquences de ce système de musique saltimbanque. En effet, comment voulez-vous ainsi produire des contrastes puissants? Où le compositeur consciencieux pourra-t-il trouver les moyens de faire ressortir certaines nuances sans lesquelles il n'y a pas de musique? Veut-il tirer de son orchestre une voix effrayante, grandiose, terrible? Les trombones, l'ophicléïde, les trompettes et les cors sont là, il les met en action... Ils ne produisent cependant pas sur l'auditoire l'impression qu'il espérait; le bruit de cette masse d'instruments de cuivre n'est ni effrayant, ni grandiose. Le public en entend tous les jours de semblables dans l'accompagnement d'un duo d'amour ou d'un chant d'hyménée; il y est accoutumé, et l'éclat sur lequel comptait le musicien n'ayant pour lui rien d'extraordinaire, ne le frappe en aucune façon. Si l'auteur a besoin, au contraire, d'une instrumentation douce et délicate, à moins que la situation dramatique ne soit saisissante au dernier point, soyez sûr qu'un auditoire, habitué à voir ses conversations couvertes par le fracas d'un orchestre possédé, ne prêtera pas le degré d'attention nécessaire pour l'apprécier. Voilà pourquoi je pense qu'avant l'apparition de Robert le Diable et celle du second acte de Guillaume Tell, c'eût été folie d'espérer un brillant succès pour la partition de Don Juan à l'Opéra. La sensibilité du public était engourdie; c'est grâce à l'heureuse influence exercée par ces deux modèles dans l'art de dispenser les trésors de l'instrumentation, que nous devons de l'avoir vue se réveiller. Enfin Mozart est venu à point.
Malheureusement, on a cru devoir introduire dans Don Juan des airs de danse formés de lambeaux arrachés çà et là aux autres œuvres de Mozart, étendus, tronqués, disloqués et instrumentés selon la méthode qui me paraît si contraire au sens musical et aux intérêts de l'art; sans cela, le style si constamment pur de la sublime partition, en rompant sans ménagements les habitudes que le public avait prises depuis huit ou dix ans, eût achevé cette révolution importante. Et notez bien que Mozart seul pouvait prendre la responsabilité d'une pareille tentative. On n'a pas encore osé dire que son orchestre fût pauvre, ni que son style mélodique eût vieilli; ce nom a conservé sur les savants comme sur les ignorants, sur les jeunes compositeurs comme sur les anciens maîtres, tout son prestige. On pouvait donc, sans crainte de s'attirer le reproche de ressusciter des vieilleries, remonter un opéra dont l'ensemble et les détails sont une critique sanglante des procédés adoptés par une école musicale moderne. Tentative qui eût été souverainement imprudente, au contraire, dans un nouvel ouvrage. «C'est une musique bien pâle, aurait-on dit de toutes parts, cet orchestre est bien pauvre, bien dépourvu d'éclat et de vigueur.» Tout cela, parce que la grosse caisse n'aurait pas tonné dans tous les morceaux, flanquée d'un tambour, d'une paire de timbales, des cimbales et du triangle, et accompagnée de toute la brillante cohorte des instruments de cuivre. Eh malheureux! vous ne savez donc pas que Weber n'a jamais permis à la grosse caisse de s'introduire dans son orchestre; que Beethoven, dont vous ne récuserez pas, j'espère, la puissance, ne l'a employée qu'une seule fois, et que dans le Barbier de Séville et quelques autres ouvrages de Rossini on n'en trouve pas une note! Si donc tout orchestre dépourvu de ce grossier auxiliaire vous paraît faible et maigre, n'en accusez que ceux qui vous ont ainsi blasés par l'abus des moyens violents, et prêtez plus d'attention au compositeur assez clairvoyant sur les causes réelles du pouvoir de son art, pour n'avoir recours au bruit qu'en des occasions rares et exceptionnelles.
C'est ce qu'on fait aujourd'hui pour Mozart, je n'en citerai pour preuve que le silence religieux avec lequel on écoute à l'Opéra la scène de la statue, dont l'entrée au Théâtre-Italien, est ordinairement le signal de l'évacuation de la salle. Il n'y a plus là de prima donna ou de ténor à la voix séduisante, pour donner une leçon de chant aux élégantes des premières loges; il ne s'agit point d'un duo à la mode, dans lequel les deux virtuoses font assaut de talent et d'inspiration, ce n'est qu'un chant mortuaire, une sorte de récitatif, mais sublime de vérité et de grandeur. Et comme l'instrumentation des actes précédents a été traitée avec discernement et modération, il s'ensuit qu'à l'apparition du spectre, le son des trombones, qu'on n'a pas entendus depuis longtemps, vous glace d'épouvante, et qu'un simple coup de timbale, frappé de temps en temps sous une harmonie sinistre, semble ébranler toute la salle. Cette scène est si extraordinaire, le musicien a réalisé là de tels prodiges, qu'elle écrase toujours l'acteur chargé du rôle du Commandeur; l'imagination devient d'une exigence excessive et dix voix de Lablache unies lui paraîtraient à peine suffisantes pour de tels accents. Il n'en est pas de même des cris forcenés de Don Juan, se débattant sous les étreintes glacées du colosse de marbre. Comme l'impie séducteur de donna Anna n'est rien de plus qu'une créature humaine, l'esprit ne lui demande que des accents humains, et c'est peut-être même de toutes les parties de ce rôle varié celle que l'acteur rend ordinairement le mieux. Au moins cela nous a-t-il semblé tel pour Garcia, Nourrit et Tamburini.
Le rôle d'Ottavio est devenu presque inabordable par la perfection désespérante avec laquelle Rubini chante l'air fameux: Il mio tesoro. Je cite cet air seulement parce qu'il est impossible de reconnaître la même supériorité dans la manière dont il exécute tout le reste du rôle. Dans les morceaux d'ensemble, dans le duo du premier acte, Rubini semble chercher à s'effacer complètement; le grand nombre de phrases écrites dans le bas, ou tout au moins dans le medium, doivent en effet présenter un obstacle réel au développement de cette voix admirable, destinée à planer toujours sur les autres au lieu de les accompagner. Il en résulte que le duo dont il est question produit ordinairement beaucoup plus d'effet à l'Opéra qu'au Théâtre Italien. Disons aussi que mademoiselle Falcon est pour beaucoup dans cette différence. Mademoiselle Grisi n'aime guère Mozart, et ne joue donna Anna qu'à contre cœur; ce n'est pas en Italie, où jamais Don Giovanni n'obtint droit de cité, qu'elle pouvait apprendre à goûter cette musique. Mademoiselle Falcon, au contraire, la chante avec amour, avec passion, on s'en aperçoit à l'émotion qui la tourmente, au tremblement de sa voix dans certains passages touchants, à l'énergie avec laquelle elle lance certaines notes, à l'habileté qu'elle met à faire ressortir plusieurs coins du tableau que la plupart de ses rivales laissent dans l'ombre. Je n'ai pas entendu mademoiselle Sontag dans donna Anna, mais de toutes les autres cantatrices que j'ai vues s'essayer dans ce rôle difficile, mademoiselle Falcon me paraît incontestablement la meilleure sous tous les rapports.
Je lui reprocherai seulement le mode de vocalisation qu'elle a adopté pour les phrases formées de gruppetti diatoniques où les notes se lient de deux en deux, comme celle qui se trouve dans son duo avec Ottavio au premier acte. En pareil cas, mademoiselle Falcon accentue tellement fort la première noie de chaque gruppetto, que la seconde en est presque effacée, et qu'à un certain éloignement il résulte de cette inégalité un effet tout autre que celui qu'en attend probablement la cantatrice, et assez analogue à la phraséologie des cors, lorsqu'ils emploient alternativement un son ouvert et un son bouché. Ainsi rendu, le trait que je viens de désigner dans le duo de Don Juan, perd beaucoup de sa force au lieu d'en acquérir. Si on ne le lui dit pas, il est impossible que mademoiselle Falcon s'en aperçoive, l'effet n'étant plus le même de près.
Je ne saurais passer sous silence l'exécution foudroyante du grand finale aux premières représentations. Le soin avec lequel les répétitions générales en avaient été faites, et l'assurance qu'une étude minutieuse et bien dirigée de sa partie avait donnée à chaque choriste, ne sont pas les seules causes de ce résultat. Tous les acteurs de l'Opéra, qui n'avaient pas de rôle dans la pièce, ayant demandé à figurer comme choristes dans le finale, cette augmentation inusitée du nombre des voix, l'exécution chaleureuse de ces chanteurs auxiliaires, l'enthousiasme réel éprouvé par quelques-uns et se communiquant à la masse, tout concourut à faire de ce morceau le prodige de l'exécution chorale à l'Opéra. Comme, d'ailleurs, l'orchestre de Mozart, malgré tout ce qu'il a de richesse et de force, n'écrase pas le chant, on a pu voir enfin de quoi était capable un pareil chœur ainsi exécuté. Voilà de la musique dramatique!!!
LA FLÛTE ENCHANTÉE
ET
LES MYSTÈRES D'ISIS
1er mai 1836.
La Flûte enchantée est celui peut-être de tous les ouvrages de Mozart dont les morceaux détachés sont les plus répandus et la partition complète la moins appréciée en France; elle n'obtint du moins qu'un fort médiocre succès à Paris, quand la troupe allemande voulut la représenter au théâtre Favart, il y a six ou sept ans. Pourtant il n'y a pas de concert où l'on ne puisse en entendre des fragments; l'ouverture est sans contredit l'une des plus admirées et des plus admirables qui existent; la marche religieuse est de toutes les cérémonies des temples protestants; à l'aide de quelques vers parodiés sur elle, cette mélodie instrumentale est devenue un hymne que chantent en Angleterre des milliers d'enfants; les petits airs, depuis longtemps populaires, ont servi de thèmes aux fabricants de variations, pour la plus grande joie des amateurs de guitare, de flûte, de clarinette et de flageolet, cette lèpre de la musique moderne; et avec quelques autres, bien que fort peu dansants, on a confectionné même des ballets. On ne devinerait guère cependant quelle somme Mozart a retirée de cette partition qui, avant d'arriver jusqu'à nous, a fait la fortune de trente théâtres en Allemagne et sauvé de sa ruine le directeur qui l'avait demandée... Six cents francs, ni plus ni moins. C'est précisément le prix que les éditeurs donnent à un de nos faiseurs à la mode pour une romance; et Rubini ou mademoiselle Grisi ne gagnent pas moins en dix minutes à chanter deux cavatines de Vaccaï. Pauvre Mozart! il ne lui manquait plus pour dernière misère que de voir son sublime ouvrage accommodé aux exigences de la scène française, et c'est ce qui lui arrivera.
L'Opéra, qui, peu d'années auparavant, avait si dédaigneusement refusé de lui ouvrir ses portes, l'Opéra, d'ordinaire si fier de ses prérogatives, si fier de son titre d'Académie royale de Musique, l'Opéra, qui jusque-là se serait cru déshonoré d'admettre un ouvrage déjà représenté sur un autre théâtre, en était venu à s'estimer heureux de monter une traduction de la Flûte enchantée. Quand je dis une traduction, c'est un pasticcio que je devrais dire, un informe et absurde pasticcio resté au répertoire sous le nom des Mystères d'Isis. Fi donc, une traduction! Est-ce que les exigences d'un public français permettaient une traduction pure et simple du livret qui avait inspiré de si belle musique? D'ailleurs, ne faut-il pas toujours corriger plus ou moins un auteur étranger, poète ou musicien, s'appela-t-il Shakespeare, Gœthe, Schiller, Beethoven ou Mozart, quand un directeur parisien daigne l'admettre à l'honneur de comparaître devant son parterre? Ne doit-on pas le civiliser un peu? On a tant de goût, d'esprit, de génie même dans la plupart de nos administrations théâtrales, que des barbares, comme ceux que je viens de nommer, doivent s'estimer heureux de passer par de si belles mains. Il y a dans Paris, sans qu'on s'en doute, une foule de gens aussi favorisés sous le rapport de la puissance créatrice que Mozart, Beethoven, Schiller, Gœthe ou Shakespeare; plus d'un souffleur eût été capable de créer Faust, Hamlet ou Don Carlos; bien des clarinettes et autant de bassons eussent pu écrire Fidelio ou Don Juan; et s'ils ne l'ont pas fait, c'est indolence, c'est paresse de leur part, mépris de la gloire, que sais-je? enfin c'est qu'ils n'ont pas voulu. On ne pouvait donc pas, sans de grandes modifications, non seulement dans le libretto, mais aussi dans la musique, introduire à l'Opéra une partition allemande de Mozart. En conséquence, on fit le beau drame que vous savez, ce poème des Mystères d'Isis, mystère lui-même, que personne n'a jamais pu dévoiler. Puis quand ce chef-d'œuvre fut bien et dûment charpenté, le directeur de l'Opéra, pensant faire un coup de maître, appela à son aide un musicien allemand pour charpenter aussi la musique de Mozart, et l'accommoder aux exigences de ces beaux vers. Un Français, un Italien ou un Anglais, qui eût consenti à se charger de cette tâche sacrilège, ne serait à nos yeux qu'un pauvre diable dépourvu de tout sentiment élevé de l'art, qu'un manœuvre dont l'intelligence ne va pas jusqu'à concevoir le respect dû au génie; mais un Allemand, un homme qui, par orgueil national au moins, devait vénérer Mozart à l'égal d'un dieu, un musicien (il est vrai que ce musicien a écrit d'incroyables platitudes sous le nom de symphonies) oser porter sa brutale main sur un tel chef-d'œuvre! Ne pas rougir de le mutiler, de le salir, de l'insulter de toutes façons!... Voilà qui bouleverse toutes les idées reçues. Et vous allez voir jusqu'où ce malheureux a porté l'outrage et l'insolence. Je ne cite qu'à coup sûr, ayant sous les yeux les deux partitions.
L'ouverture de la Flûte enchantée finit fort laconiquement; Mozart se contente de frapper trois fois la tonique, et c'est tout. Pour la rendre digne des Mystères d'Isis, l'arrangeur-charpentier a ajouté quatre mesures, répercutant ainsi treize fois de suite le même accord, suivant la méthode ingénieuse et économique des Italiens pour allonger les opéras. Le premier air de Zorastro (Ô déesse immortelle), rôle de basse, comme on sait, et de basse très grave, est fait avec la partie de soprano du chœur Per voi risplende il giorno, enrichie de quatre autres mesures dues au génie du charpentier-arrangeur. Le chœur reprend ensuite, mais avec diverses corrections également remarquables, et la suppression complète des flûtes, trompettes et timbales, si admirablement employées dans l'original. L'instrumentation de Mozart corrigée par un tel homme! n'est-ce pas l'impertinence la plus bouffonne qui se puisse concevoir?
Ailleurs, nous la verrons se manifester d'une autre manière. Ce ne sera plus sur l'orchestre que s'exercera le rabot de notre manouvrier mais bien sur la mélodie, l'harmonie et les dessins d'accompagnement. Nous en trouvons la trace d'abord dans cet air sublime, la plus belle page de Mozart peut-être, où le grand prêtre dépeint le calme profond dont jouissent les initiés dans le temple d'Isis; à la fin de la dernière phrase: N'est-ce pas imiter les dieux, le rabotteur a mis ut, ut, la, au lieu des deux notes graves sol, fa, sur lesquelles la voix du pontife descend avec une si paisible majesté. En outre, la partie d'alto est changée, et les accords que Mozart avait mis au nombre de deux seulement par mesure, entrecoupés de petits silences d'une admirable intention, se trouvent remplacés par six notes dans les violons, et enrichis d'une tenue de deux cors à laquelle n'avait pas songé l'auteur.
Plus loin, c'est le chœur des esclaves: O cara armonia, qu'il a impitoyablement estropié, et dont il s'est servi pour fabriquer l'air encore charmant, malgré tout: Soyez sensibles à nos peines; ailleurs, c'est le duetto: La dove prende amor ricetto, qu'il a converti en trio; et, comme si la partition de la Flûte enchantée ne suffisait pas à cette faim de harpie, c'est aux dépens de celles de Tito et de Don Giovanni qu'elle va s'assouvir. L'air: Quel charme à mes esprits rappelle est tiré de Tito, mais pour l'andante seulement, l'allegro si original qui le complète ne plaisant pas apparemment à notre uomo capace. Bien qu'il eût pu satisfaire aux exigences de la situation, il l'en a arraché pour en cheviller à la place un autre dans lequel il a fait entrer des lambeaux de l'allegro de Mozart.
Et savez-vous ce que ce monsieur a fait encore du fameux Fin ch'an dal vino, de cet éclat de verve libertine où se résume tout le caractère de Don Juan?... un trio pour une basse et deux soprani chantant entre autres gentillesses sentimentales les vers suivants:
Heureux délire!
Mon cœur soupire!
Que mon sort diffère du sien!
Quel plaisir est égal au mien!
Crois ton amie,
C'est pour la vie
Que ton sort va s'unir au mien (bis)...
O douce ivresse
De la tendresse!
Ma main te presse,
Dieu, quel grand bien!
C'est ainsi qu'habillé en singe, affublé de ridicules oripeaux, un œil crevé, un bras tordu, une jambe cassée, on osa présenter le plus grand musicien du monde à ce public français si délicat, si exigeant, en lui disant: voilà Mozart!— O misérables, vous fûtes bien heureux d'avoir à faire à de bonnes gens qui n'y entendaient pas malice et qui vous crurent sur parole; si vous aviez tardé quelque vingt-cinq ans pour commettre votre chef-d'œuvre, je connais quelqu'un qui vous aurait envoyé un furieux démenti.
Nous avons toujours cru, en France, beaucoup aimer la musique; il faut espérer que cette opinion est mieux fondée aujourd'hui qu'elle ne l'était à l'époque où l'on écartelait ainsi Mozart à l'Opéra. En tout cas, quand une nation en est encore à supporter de semblables profanations, c'est le signe le plus évident de son état de barbarie, et toutes ses prétentions au sentiment de l'art sont le comble du ridicule.
Je n'ai pas nommé le coupable qui s'est ainsi vautré avec ses guenilles sur le riche manteau du roi de l'harmonie; c'est à dessein; il est mort depuis longtemps; ainsi paix à ses os, il serait inutile de donner à ce nom aucun genre de célébrité; j'ai voulu seulement faire ressortir l'intelligence avec laquelle les intérêts de la musique ont été défendus chez nous pendant si longtemps, et montrer les conséquences du système qui tend à placer le sceptre des arts entre les mains de ceux qui, ne voulant s'en servir que pour battre monnaie, sont toujours prêts, au moindre espoir de lucre, à encourager le brocantage de la pensée, et pour quelques écus feraient, selon la belle expression de Victor Hugo, corriger Homère etgratter Phidias.
CHERUBINI
ESQUISSE BIOGRAPHIQUE
20 mars 1842.
La vie de ce grand compositeur peut être offerte aux jeunes artistes comme un modèle sous presque tous les rapports. Les études de Cherubini furent longues et patientes, ses travaux nombreux, ses ennemis puissants. A l'inflexibilité de son caractère, à la ténacité de ses convictions, se joignait une dignité réelle qui les rendit toujours respectables, et qu'on ne trouve pas souvent, il faut malheureusement le reconnaître, chez les artistes même les plus éminents.
Né à Florence, vers la fin de 1760, disciple dès l'âge de neuf ans, de Bartholomeo et d'Alexandro Felici, et plus tard de Bizarri, et de Castrucci, maîtres tous également inconnus aujourd'hui, il n'acheva son éducation musicale que vers sa vingtième année et sous la direction de Sarti. Le grand duc de Toscane, Léopold II, le prit alors sous sa protection spéciale, et Sarti, pour prix de ses leçons, se contenta de faire écrire à son élève une foule de morceaux qu'il intercalait dans ses propres ouvrages, et dont il gardait sans scrupule tout l'honneur pour lui seul. Le maître dut se décider pourtant à donner carrière à son élève; et Cherubini, libre enfin de voir ses compositions applaudies sous son nom, écrivit pour les théâtres d'Italie plusieurs partitions dont le succès le fit bientôt appeler à Londres. Ce fut en Angleterre qu'il composa la Finta principessa et Julio Sabino. Quelques années après, Ifigenia in Aulide parut avec un grand succès sur le théâtre de Turin. Après avoir donné Faniska à Vienne, Cherubini retourna en Angleterre pour diriger les concerts de la Société Philharmonique. A son retour en France, son ami Viotti, qui était fort à la mode, le mit en relations avec le monde élégant et lui ouvrit la plupart des salons de la capitale. Cherubini songea seulement alors à écrire pour la scène française, et Marmontel lui donna le poème de Démophon. Ce sujet, très dramatique et essentiellement musical cependant, avait déjà été fatal à une partition de Vogel, dont la pathétique ouverture est seule restée. Le succès du Démophon de Cherubini fut douteux; mais les beautés énergiques qu'on ne put y méconnaître firent prèssentir ce qu'on pouvait attendre de l'auteur dans ce genre grandiose et sévère.
Chargé bientôt après de la direction musicale de l'Opéra-Italien, il dut, dans l'intérêt des ouvrages qu'on y représentait et, peut-être aussi bien souvent, pour satisfaire les caprices des chanteurs, reprendre sa tâche de collaborateur anonyme, abandonnée avec les leçons de Sarti. Il introduisit ainsi dans diverses partitions un grand nombre de morceaux charmants, dont quelques-uns décidèrent le succès des opéras auxquels il les donnait si généreusement; tels furent le fameux quatuor des Viaggiatori felici et celui moins connu mais également admirable du Don Giovanni de Gazzaniga. Ce qui prouve sans réplique qu'il y eut un compositeur italien du nom de Gazzaniga, qui fit un opéra deDon Giovanni: Mozart aussi en a fait un.
Tout en écrivant ces mélodieux fragments pour les habiles virtuoses du Théâtre-Italien, Cherubini étudiait l'esprit de l'école française, et cherchait si, en demandant davantage à l'accent dramatique, aux modulations imprévues, aux effets d'orchestre, on ne pourrait suppléer à ce qui manquait d'habileté aux chanteurs français. La question fut résolue affirmativement par son opéra de Lodoïska, dont le succès eut été plus long et plus populaire si le petit ouvrage de Kreutzer, sur le même sujet et portant le même titre, ne se fut assuré la vogue par une plus grande facilité d'exécution et par l'exiguité gracieuse de ses formes mélodiques. On sait qu'en France surtout, des productions grandes et belles sont souvent éclipsées par d'autres qui ne sont que jolies. La Lodoïska de Cherubini produisit néanmoins une profonde sensation dans le monde musical, et le mouvement qu'elle imprima à l'art, secondé par les efforts à peu près parallèles de Méhul, de Berton et de Lesueur, amena pour l'école française une ère de gloire à laquelle il était permis de douter qu'elle pût jamais atteindre.
Lodoïska fut suivie, à des intervalles plus ou moins rapprochés, d'Élisa ou le Mont Saint-Bernard, de Médée, de l'Hôtellerie portugaise et enfin des Deux Journées, dont le succès devint rapidement populaire. C'est dans Élisa que se trouve ce chœur de moines cherchant les voyageurs ensevelis sous la neige, qu'on a trop rarement exécuté aux concerts du Conservatoire, et dont le caractère est empreint d'une telle vérité, qu'on disait en l'entendant: «Cette musique fait grelotter!» Dans le même opéra, on admire avec raison la scène de la cloche, dans laquelle, en tournant constamment autour de la note unique d'une cloche, dont le tintement se fait entendre sans interruption d'un bout à l'autre du morceau, le maître a montré tout ce qu'il possédait de ressources harmoniques et son adresse rare à enchaîner les modulations.
La Médée est une œuvre plus complète que la précédente; elle est restée au répertoire d'un grand nombre de théâtres allemands, et c'est une honte pour les nôtres qu'elle en soit bannie depuis si longtemps.
La même observation s'applique aussi aux Deux Journées, qu'on a eu dernièrement une velléité de remonter à l'Opéra-Comique, et qu'on a laissées en définitive dans les cartons, parce qu'il était impossible d'accorder à l'auteur, pour le rôle du porteur d'eau, l'acteur Henri qu'il exigeait. Voilà de ces impossibilités à faire mourir de rire, et dont on parle aussi sérieusement dans nos théâtres que s'il s'agissait de ressusciter Talma. L'Hôtellerie portugaise a été moins heureuse. Cette partition n'est pas même gravée; il n'en est resté qu'un trio bouffe fort intéressant (on le chante souvent dans les concerts) et l'ouverture, dont l'andante contient un canon sur l'air des Folies d'Espagne d'une couleur mystérieuse et de l'effet le plus original.
Un peu avant la représentation de son opéra des Deux Journées, Cherubini avait été nommé l'un des inspecteurs de l'enseignement du Conservatoire. Cette place fut pendant longtemps la seule qu'il eut à remplir; Napoléon ayant, comme on sait, une affectation bizarre, et en tout cas peu digne de lui, à faire sentir à Cherubini l'antipathie qu'il ressentait pour sa personne et pour ses ouvrages. On a donné pour motif à cet éloignement quelques réparties fort rudes de Cherubini à des observations assez mal fondées de Napoléon sur sa musique; on prétend que le compositeur aurait dit un jour au Premier Consul, avec une vivacité, fort concevable du reste en pareille occasion: «Citoyen consul, mêlez-vous de gagner des batailles, et laissez-moi faire mon métier auquel vous n'entendez rien!» Une autre fois, comme Napoléon lui avouait sa prédilection pour la musique monotone, c'est-à-dire pour celle qui le berçait doucement, Cherubini aurait répliqué, avec plus de finesse que d'humeur cependant: «J'entends, vous aimez la musique qui ne vous empêche pas de songer aux affaires d'État!» Ces réparties, on le verra plus loin, sont bien dans le caractère et la tournure d'esprit de Cherubini; toujours est-il certain que Napoléon chercha constamment à blesser son amour-propre en exaltant sans mesure en sa présence Paisiello et Zingarelli, toutes les fois qu'il en trouvait l'occasion, en le laissant à l'écart comme un homme médiocre, et en s'obstinant à prononcer son nom à la française, pour faire entendre par là qu'il ne le trouvait pas digne de porter un nom italien.
Ce fut en 1805 seulement que Napoléon, après la victoire d'Austerlitz, ayant su que Cherubini était à Vienne, occupé à écrire son opéra Faniska, le fit venir et lui témoigna assez de bienveillance pour ne plus prononcer son nom à la française. Il le chargea même d'organiser ses concerts particuliers, et ne manqua pas, lorsqu'ils eurent lieu, d'en critiquer l'ordonnance et d'exiger de Cherubini les choses les plus ridicules. Ainsi il voulut que l'air du père de la Nina de Paisiello (air de basse) fût chanté par le castrat Crescentini; Cherubini lui faisant observer que le povero ne pourrait le chanter qu'à l'octave supérieure: «Eh bien, qu'il le chante, dit Napoléon, je ne tiens pas à une octave!» Et ce fut vraiment bien heureux, car si le grand homme avait tenu à une octave, et s'il eût exigé que le chanteur prît une voix grave, malgré toute sa bonne volonté, il eût été impossible à celui-ci d'y parvenir.
Napoléon eut encore à Vienne avec Cherubini l'éternelle discussion, tant de fois commencée à Paris avec Paisiello et avec Lesueur, sur les nuances de l'orchestre. Le géant des batailles, le virtuose du canon, n'aimait pas que les instruments de musique se permissent d'élever la voix; les forte, les tutti éclatants l'impatientaient. Il prétendait alors que l'orchestre jouait trop haut, et quand il avait fait comprendre à ses malheureux maîtres de chapelle qu'il entendait par ces mots, jouer trop fort, ils devaient nécessairement ne plus tenir compte des intentions du compositeur, ni du sens de l'œuvre, et ordonner aux exécutants d'éteindre le son jusqu'au pianissimo. La musique alors berçait le grand homme, et il pouvait rêver aux affaires d'État. Napoléon aurait dû se contenter pour chœur et pour orchestre d'une harpe éolienne. Certes, rien ne ressemble moins aux soupirs harmonieux de cet instrument que l'orchestre de Cherubini; mais le goût exclusif de l'Empereur pour la musique douce, calme et rêveuse, a peut-être contribué, en dirigeant l'esprit du compositeur sur ce point de son art, à lui faire trouver cette forme curieuse de decrescendo dont il a laissé de si admirables modèles dans quelques-unes de ses compositions religieuses. Personne avant Cherubini et personne après lui n'a possédé à ce point la science du clair obscur, de la demi-teinte, de la dégradation progressive du son; appliquée à certaines parties essentiellement mélodieuses de ses messes, elle lui a fait produire de véritables merveilles d'expression religieuse et découvrir des finesses exquises d'instrumentation.
A son retour de Vienne, Cherubini fut atteint d'une maladie nerveuse qui donna les plus sérieuses inquiétudes à sa famille, et qui lui rendit tout travail musical impossible. La composition lui étant absolument interdite, il se prit, dans sa profonde mélancolie, d'un vif amour pour les fleurs; il étudia la botanique, ne songea plus qu'à herboriser, à former des herbiers, à étudier Linné, de Jussieu et Tournefort. Cette passion sembla même survivre à la maladie qui l'avait fait naître, et lorsque, entièrement rétabli, fixé chez le prince de Chimay, il aurait dû reprendre ses travaux trop longtemps interrompus, ce ne fut que pour céder aux vives instances de ses hôtes qu'il se décida à écrire une messe. Il produisit alors et presque à contre-cœur sa fameuse messe solennelle à trois voix, l'un des chefs-d'œuvre du genre.
Revenu à Paris, plein de santé et de confiance dans la force et la verdeur de son génie, il écrivit Pimmalione pour le Théâtre-Italien, le Crescendo pour l'Opéra-Comique, et les Abencérages pour l'Opéra. Je ne connais rien des deux premiers ouvrages, mais nous avons entendu au Conservatoire divers fragments du troisième qui donnent une grande idée de son mérite. L'air surtout, si souvent chanté par Ponchard: Suspendez à ces murs mes armes, ma bannière, est évidemment une des plus belles choses dont la musique dramatique ait eu à s'enorgueillir depuis Gluck. Rien de plus vrai, de plus profondément senti, de plus noble et de plus touchant à la fois. On ne sait ce qu'on doit admirer le plus du récitatif si plein d'accablement, de la mélodie si désolée et si tendre de l'andante ou de l'allegro final, où la douleur se ravivant arrache des cris d'angoisse au malheureux amant de Zoraïde.
Cherubini, en société avec trois autres compositeurs, improvisa, pour ainsi dire, deux opéras de circonstance, l'Oriflamme et Bayard à Mézières. Un seul morceau de l'Oriflamme nous est connu: c'est un chœur conçu dans son système de decrescendo dont nous avons parlé tout à-l'heure; on l'exécutait, il y a huit ou dix ans, assez souvent dans les concerts du Conservatoire, et il n'a jamais manqué d'y produire l'impression la plus vive par son exquise douceur et sa complète originalité. En présence des effets vraiment délicieux que Cherubini a su tirer des voix et de l'orchestre dans la nuance du pianissimo, de la distinction du style mélodique, de la finesse d'orchestration qui ne l'abandonnent jamais alors, de la grâce avec laquelle s'enchaînent ses harmonies et ses modulations, il est permis de regretter qu'il ait beaucoup plus écrit dans la nuance contraire. Ses morceaux énergiques ne brillent pas toujours par les qualités qui devraient leur être propres; l'orchestre y fait quelquefois, même dans ses messes, des mouvements brusques et durs qui conviennent peu au style religieux.
La Restauration amena pour Cherubini une tardive justice; les Bourbons prirent à cœur de lui faire oublier les rigueurs de Napoléon, et lui donnèrent la survivance de Martini à la surintendance de la musique du Roi. Au retour de l'île d'Elbe, l'Empereur cependant crut devoir le nommer chevalier de la Légion d'honneur. En outre, à la même époque, le nombre des membres de l'Académie des Beaux-Arts ayant été augmenté, Cherubini entra à l'Institut. A la mort de Martini, il lui succéda, en partageant avec Lesueur la place de surintendant de la musique du Roi. Dès lors, Cherubini se livra presque exclusivement aux compositions sacrées. Il écrivit pour la chapelle de Louis XVIII et pour celle de Charles X un nombre considérable de prières, psaumes, motets et messes, dont les deux principales sont connues et admirées de tous les musiciens de l'Europe; je veux parler de la messe du Sacre de Charles X et du premier Requiem à quatre voix. On rencontre, il est vrai, dans la messe du Sacre, plusieurs passages dont le style, empreint du défaut que je signalais tout à l'heure, a plus de violence que de vigueur, et partant peu d'accent religieux; mais tant d'autres sont irréprochables, et d'ailleurs, la Marche de la Communion qui s'y trouve, est une inspiration de telle nature, qu'elle doit faire oublier quelques taches et immortaliser l'œuvre à laquelle elle appartient.
Voilà l'expression mystique dans toute sa pureté, la contemplation, l'extase catholiques! Si Gluck, avec son chant instrumental aux contours arrêtés, empreint d'une sorte de passion triste, mais non rêveuse, a trouvé dans la marche d'Alceste