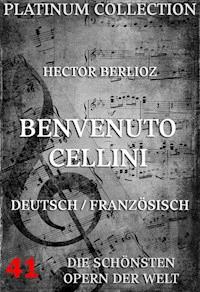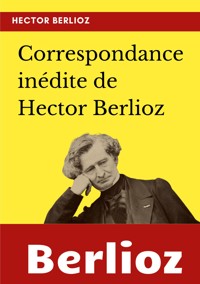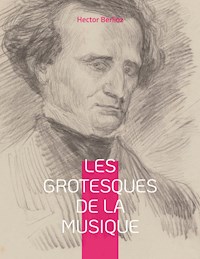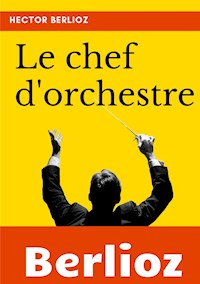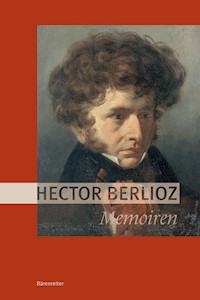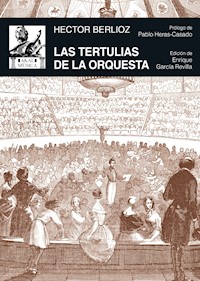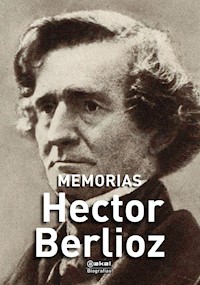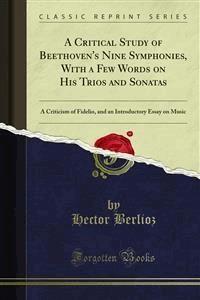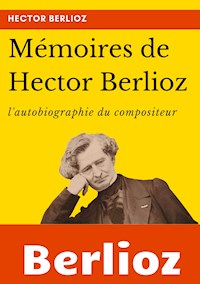
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: mémoires et écrits de compositeurs
- Sprache: Französisch
RÉSUMÉ : Les "Mémoires de Hector Berlioz" sont un voyage fascinant à travers la vie et l'esprit du compositeur français, dont l'oeuvre a marqué l'histoire de la musique romantique. Ce récit autobiographique, rédigé avec une plume vive et passionnée, nous plonge dans le monde artistique tumultueux du XIXe siècle. Berlioz, connu pour son audace et son originalité, partage ses expériences personnelles et professionnelles, allant de ses débuts modestes dans la petite ville de La Côte-Saint-André jusqu'à sa reconnaissance internationale. Le lecteur découvre les rencontres marquantes avec des figures emblématiques de son temps, telles que Franz Liszt et Niccolò Paganini, ainsi que les défis qu'il a dû surmonter pour faire accepter sa musique novatrice. Les mémoires dévoilent également la vie intérieure de Berlioz, ses amours tumultueuses, notamment avec l'actrice Harriet Smithson, et ses réflexions profondes sur l'art et la création. À travers ce témoignage authentique, Berlioz nous offre une perspective unique sur son processus créatif et les inspirations derrière ses oeuvres majeures, telles que la "Symphonie fantastique". Ce livre est non seulement une source précieuse pour les passionnés de musique classique, mais aussi une fenêtre ouverte sur l'âme d'un artiste visionnaire. L'AUTEUR : Hector Berlioz, né le 11 décembre 1803 à La Côte-Saint-André, est l'une des figures les plus emblématiques de la musique romantique française. Fils d'un médecin, il est destiné initialement à suivre les traces de son père, mais sa passion pour la musique le pousse à s'installer à Paris pour étudier au Conservatoire. Berlioz se distingue rapidement par son talent et son originalité, remportant le prestigieux Prix de Rome en 1830. Sa carrière est marquée par des oeuvres audacieuses et innovantes, telles que la "Symphonie fantastique", qui lui valent autant de critiques que d'admirateurs. En dehors de ses compositions, Berlioz est également un écrivain prolifique, contribuant régulièrement à des revues musicales et rédigeant plusieurs ouvrages, dont ses célèbres "Mémoires". Sa vie personnelle est tout aussi tumultueuse, marquée par des amours passionnées et des déceptions. Marié à l'actrice irlandaise Harriet Smithson, qui fut sa muse pour la "Symphonie fantastique", leur union connaît des hauts et des bas. Berlioz meurt le 8 mars 1869 à Paris, laissant derrière lui un héritage musical qui continue d'influencer les compositeurs du monde entier.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1041
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sommaire
MÉMOIRES DE HECTOR BERLIOZ
Chapitre I
Chapitre II
Chapitre III
Chapitre IV
Chapitre V
Chapitre VI
Chapitre VII
Chapitre VIII
Chapitre IX
Chapitre X
Chapitre XI
Chapitre XII
Chapitre XIII
Chapitre XIV
Chapitre XV
Chapitre XVI
Chapitre XVII
Chapitre XIX
Chapitre XX
Chapitre XXI
Chapitre XXII
Chapitre XXIII
Chapitre XXIV
Chapitre XXV
Chapitre XXVI
Chapitre XXVII
Chapitre XXVIII
Chapitre XXIX
Chapitre XXX
Chapitre XXXI
Chapitre XXXII
Chapitre XXXIII
Chapitre XXXIV
Chapitre XXXV
Chapitre XXXVI
Chapitre XXXVII
Chapitre XXXVIII
Chapitre XXXIX
Chapitre XL
Chapitre XLI
Chapitre XLII
Chapitre XLIII
CHANT DE LA COTE-SAINT-ANDRÉ
Chapitre XLIV
Chapitre XLV
Chapitre XLVI
Chapitre XLVII
Chapitre XLVIII
Chapitre XLIX
Chapitre L
Chapitre LI
MÉMOIRES DE HECTOR BERLIOZ II
PREMIER VOYAGE EN ALLEMAGNE
À MONSIEUR GIRARD : DEUXIÈME LETTRE
À LISZT : TROISIÈME LETTRE
À STÉPHEN HELLER, : QUATRIÈME LETTRE
À ERNST : CINQUIÈME LETTRE
À HENRI HEINE : SIXIÈME LETTRE
À MLLE LOUISE BERTIN : SEPTIÈME LETTRE
À M. HABENECK : HUITIÈME LETTRE
À M. DESMAREST : NEUVIÈME LETTRE
À M. G. OSBORNE : DIXIÈME LETTRE
Chapitre LII
Chapitre LIII
DEUXIÈME VOYAGE EN ALLEMAGNE L'AUTRICHE, LA BOHÊME ET LA HONGRIE
M. HUMBERT FERRAND : PREMIÈRE LETTRE
À M. HUMBERT FERRAND : DEUXIÈME LETTRE
À M. HUMBERT FERRAND : TROISIÈME LETTRE
À M. HUMBERT FERRAND : QUATRIÈME LETTRE
À M. HUMBERT FERRAND : CINQUIÈME LETTRE
À M. HUMBERT FERRAND : SIXIÈME LETTRE
Chapitre LIV
VOYAGE EN RUSSIE
SUITE DU VOYAGE EN RUSSIE
Chapitre LVII
DEUX JOURS PLUS TARD
Chapitre LVIII
Chapitre LIX
POST-SCRIPTUM
1re LETTRE
2e LETTRE
3e LETTRE
4e LETTRE
MÉMOIRES DE HECTOR BERLIOZ
I
La Côte Saint-André.—Ma première communion.—Première impression musicale.
Je suis né le 11 décembre 1803, à la Côte-Saint-André, très-petite ville de France, située dans le département de l'Isère, entre Vienne, Grenoble et Lyon. Pendant les mois qui précédèrent ma naissance, ma mère ne rêva point, comme celle de Virgile, qu'elle allait mettre au monde un rameau de laurier. Quelque douloureux que soit cet aveu pour mon amour-propre, je dois ajouter qu'elle ne crut pas non plus, comme Olympias, mère d'Alexandre, porter dans son sein un tison ardent. Cela est fort extraordinaire, j'en conviens, mais cela est vrai. Je vis le jour tout simplement, sans aucun des signes précurseurs en usage dans les temps poétiques, pour annoncer la venue des prédestinés de la gloire. Serait-ce que notre époque manque de poésie?...
La Côte Saint-André, son nom l'indique, est bâtie sur le versant d'une colline, et domine une assez vaste plaine, riche, dorée, verdoyante, dont le silence a je ne sais quelle majesté rêveuse, encore augmentée par la ceinture de montagnes qui la borne au sud et à l'est, et derrière laquelle se dressent au loin, chargés de glaciers, les pics gigantesques des Alpes.
Je n'ai pas besoin de dire que je fus élevé dans la foi catholique, apostolique et romaine. Cette religion charmante, depuis qu'elle ne brûle plus personne, a fait mon bonheur pendant sept années entières; et, bien que nous soyons brouillés ensemble depuis longtemps, j'en ai toujours conservé un souvenir fort tendre. Elle m'est si sympathique, d'ailleurs, que si j'avais eu le malheur de naître au sein d'un de ces schismes éclos sous la lourde incubation de Luther ou de Calvin, à coup sûr, au premier instant de sens poétique et de loisir, je me fusse hâté d'en faire abjuration solennelle pour embrasser la belle romaine de tout mon cœur. Je fis ma première communion le même jour que ma sœur aînée, et dans le couvent d'Ursulines où elle était pensionnaire. Cette circonstance singulière donna à ce premier acte religieux un caractère de douceur que je me rappelle avec attendrissement. L'aumônier du couvent me vint chercher à six heures du matin. C'était au printemps, le soleil souriait, la brise se jouait dans les peupliers murmurants; je ne sais quel arôme délicieux remplissait l'atmosphère. Je franchis tout ému le seuil de la sainte maison. Admis dans la chapelle, au milieu des jeunes amies de ma sœur, vêtues de blanc, j'attendis en priant avec elles l'instant de l'auguste cérémonie. Le prêtre s'avança, et, la messe commencée, j'étais tout à Dieu. Mais je fus désagréablement affecté quand, avec cette partialité discourtoise que certains hommes conservent pour leur sexe jusqu'au pied des autels, le prêtre m'invita à me présenter à la sainte table avant ces charmantes jeunes filles qui, je le sentais, auraient dû m'y précéder. Je m'approchai cependant, rougissant de cet honneur immérité. Alors, au moment où je recevais l'hostie consacrée, un chœur de voix virginales, entonnant un hymne à l'Eucharistie, me remplit d'un trouble à la fois mystique et passionné que je ne savais comment dérober à l'attention des assistants. Je crus voir le ciel s'ouvrir, le ciel de l'amour et des chastes délices, un ciel plus pur et plus beau mille fois que celui dont on m'avait tant parlé. Ô merveilleuse puissance de l'expression vraie, incomparable beauté de la mélodie du cœur! Cet air, si naïvement adapté à de saintes paroles et chanté dans une cérémonie religieuse, était celui de la romance de Nina: «Quand le bien-aimé reviendra.» Je l'ai reconnu dix ans après. Quelle extase de ma jeune âme! cher d'Aleyrac! Et le peuple oublieux des musiciens se souvient à peine de ton nom, à cette heure!
Ce fut ma première impression musicale.
Je devins ainsi saint tout d'un coup, mais saint au point d'entendre la messe tous les jours, de communier chaque dimanche, et d'aller au tribunal de la pénitence pour dire au directeur de ma conscience: «Mon père, je n'ai rien fait.»....—«Eh bien, mon enfant, répondait le digne homme, il faut continuer.» Je n'ai que trop bien suivi ce conseil pendant plusieurs années.
II
Mon père.—Mon éducation littéraire.—Ma passion pour les voyages.— Virgile.—Première secousse poétique.
Mon père (Louis Berlioz) était médecin. Il ne m'appartient pas d'apprécier son mérite. Je me bornerai à dire de lui: Il inspirait une très-grande confiance, nonseulement dans notre petite ville, mais encore dans les villes voisines. Il travaillait constamment, croyant la conscience d'un honnête homme engagée quand il s'agit de la pratique d'un art difficile et dangereux comme la médecine, et que, dans la limite de ses forces, il doit consacrer à l'étude tous ses instants, puisque de la perte d'un seul peut dépendre la vie de ses semblables. Il a toujours honoré ses fonctions en les remplissant de la façon la plus désintéressée, en bienfaiteur des pauvres et des paysans, plutôt qu'en homme obligé de vivre de son état. Un concours ayant été ouvert en 1810 par la société de médecine de Montpellier sur une question neuve et importante de l'art de guérir, mon père écrivit à ce sujet un mémoire qui obtint le prix. J'ajouterai que son livre fut imprimé à Paris et que plusieurs médecins célèbres lui ont emprunté des idées sans le citer jamais. Ce dont mon père, dans sa candeur, s'étonnait, en ajoutant seulement: «Qu'importe, si la vérité triomphe!» Il a cessé d'exercer depuis longtemps, ses forces ne le lui permettent plus. La lecture et la méditation occupent sa vie maintenant.
Il est doué d'un esprit libre. C'est dire qu'il n'a aucun préjugé social, politique ni religieux. Il avait néanmoins si formellement promis à ma mère de ne rien tenter pour me détourner des croyances regardées par elle comme indispensables à mon salut, qu'il lui est arrivé plusieurs fois, je m'en souviens, de me faire réciter mon catéchisme. Effort de probité, de sérieux, ou d'indifférence philosophique, dont, il faut l'avouer, je serais incapable à l'égard de mon fils. Mon père, depuis longtemps, souffre d'une incurable maladie de l'estomac, qui l'a cent fois mis aux portes du tombeau. Il ne mange presque pas. L'usage constant et de jour en jour plus considérable de l'opium, ranime seul aujourd'hui ses forces épuisées. Il y a quelques années, découragé par les douleurs atroces qu'il ressentait, il prit à la fois trente-deux grains d'opium. «Mais je t'avoue, me dit-il plus tard, en me racontant le fait, que ce n'était pas pour me guérir.» Cette effroyable dose de poison, au lieu de le tuer comme il l'espérait, dissipa presque immédiatement ses souffrances et le rendit momentanément à la santé.
J'avais dix ans quand il me mit au petit séminaire de la Côte pour y commencer l'étude du latin. Il m'en retira bientôt après, résolu à entreprendre lui-même mon éducation.
Pauvre père, avec quelle patience infatigable, avec quel soin minutieux et intelligent il a été ainsi mon maître de langues, de littérature, d'histoire, de géographie et même de musique! ainsi qu'on le verra tout à l'heure.
Combien une pareille tâche, accomplie de la sorte, prouve dans un homme de tendresse pour son fils! et qu'il y a peu de pères qui en soient capables! Je n'ose croire pourtant cette éducation de famille aussi avantageuse que l'éducation publique, sous certains rapports. Les enfants restent ainsi en relations exclusives avec leurs parents, leurs serviteurs, et de jeunes amis choisis, ne s'accoutument point de bonne heure au rude contact des aspérités sociales; le monde et la vie réelle demeurent pour eux des livres fermés; et je sais, à n'en pouvoir douter, que je suis resté à cet égard enfant ignorant et gauche jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans.
Mon père, tout en n'exigeant de moi qu'un travail très-modéré, ne put jamais m'inspirer un véritable goût pour les études classiques. L'obligation d'apprendre chaque jour par cœur quelques vers d'Horace et de Virgile m'était surtout odieuse. Je retenais cette belle poésie avec beaucoup de peine et une véritable torture de cerveau. Mes pensées s'échappaient d'ailleurs de droite et de gauche, impatientes de quitter la route qui leur était tracée. Ainsi je passais de longues heures devant des mappemondes, étudiant avec acharnement le tissu complexe que forment les îles, caps et détroits de la mer du Sud et de l'archipel Indien; réfléchissant sur la création de ces terres lointaines, sur leur végétation, leurs habitants, leur climat, et pris d'un désir ardent de les visiter. Ce fut l'éveil de ma passion pour les voyages et les aventures.
Mon père, à ce sujet, disait de moi avec raison: «Il sait le nom de chacune des îles Sandwich, des Moluques, des Philippines; il connaît le détroit de Torrès, Timor, Java et Bornéo, et ne pourrait dire seulement le nombre de départements de la France.» Cette curiosité de connaître les contrées éloignées, celles de l'autre hémisphère surtout, fut encore irritée par l'avide lecture de de tout ce que la bibliothèque de mon père contenait de voyages anciens et modernes; et nul doute que, si le lieu de ma naissance eût été un port de mer, je me fusse enfui quelque jour sur un navire, avec ou sans le consentement de mes parents, pour devenir marin. Mon fils a de très-bonne heure manifesté les mêmes instincts. Il est aujourd'hui sur un vaisseau de l'État, et j'espère qu'il parcourra avec honneur la carrière de la marine, qu'il a embrassée et qu'il avait choisie avant d'avoir seulement vu la mer.
Le sentiment des beautés élevées de la poésie vint faire diversion à ces rêves océaniques, quand j'eus quelque temps ruminé La Fontaine et Virgile. Le poëte latin, bien avant le fabuliste français, dont les enfants sont incapables en général, de sentir la profondeur cachée sous la naïveté, et la science du style voilée par un naturel si rare et si exquis, le poëte latin, dis-je, en me parlant de passions épiques que je pressentais, sut le premier trouver le chemin de mon cœur et enflammer mon imagination naissante. Combien de fois, expliquant devant mon père le quatrième livre de l'Énéide, n'ai-je pas senti ma poitrine se gonfler, ma voix s'altérer et se briser!... Un jour, déjà troublé dès le début de ma traduction orale par le vers:
«Atregina gravi jamdudum saucia cura,»
j'arrivais tant bien que mal à la péripétie du drame; mais lorsque j'en fus à la scène où Didon expire sur son bûcher, entourée des présents que lui fit Énée, des armes du perfide, et versant sur ce lit, hélas! bien connu, les flots de son sang courroucé; obligé que j'étais de répéter les expressions désespérées de la mourante, trois fois se levant appuyée sur son coude et trois fois retombant, de décrire sa blessure et son mortel amour frémissant au fond de sa poitrine, et les cris de sa sœur, de sa nourrice, de ses femmes éperdues, et cette agonie pénible dont les dieux mêmes émus envoient Iris abréger la durée, les lèvres me tremblèrent, les paroles en sortaient à peine et inintelligibles; enfin au vers:
«Quæsivit cœlo lucem ingemuitque reperta.»
à cette image sublime de Didon qui cherche aux cieux la lumière et gémit en la retrouvant, je fus pris d'un frissonnement nerveux, et, dans l'impossibilité de continuer, je m'arrêtai court.
Ce fut une des occasions où j'appréciai le mieux l'ineffable bonté de mon père. Voyant combien j'étais embarrassé et confus d'une telle émotion, il feignit de ne la point apercevoir, et, se levant tout à coup, il ferma le livre en disant: «Assez, mon enfant, je suis fatigué!» Et je courus, loin de tous les yeux, me livrer à mon chagrin virgilien.
III
Meylan.—Mon oncle.—Les brodequins roses.—L'hamadryade du Saint- Eynard.—L'amour dans un cœur de douze ans.
C'est que je connaissais déjà cette cruelle passion, si bien décrite par l'auteur de l'Énéide, passion rare, quoi qu'on en dise, si mal définie et si puissante sur certaines âmes. Elle m'avait été révélée avant la musique, à l'âge de douze ans. Voici comment:
Mon grand-père maternel, dont le nom est celui du fabuleux guerrier de Walter Scott, (Marmion) vivait à Meylan, campagne située à deux lieues de Grenoble, du côté de la frontière de Savoie. Ce village, et les hameaux qui l'entourent, la vallée de l'Isère qui se déroule à leurs pieds et les montagnes du Dauphiné qui viennent là se joindre aux Basses-Alpes, forment un des plus romantiques séjours que j'aie jamais admirés. Ma mère, mes sœurs et moi, nous allions ordinairement chaque année y passer trois semaines vers la fin de l'été. Mon oncle (Félix Marmion), qui suivait alors la trace lumineuse du grand Empereur, venait quelquefois nous y joindre, tout chaud encore de l'haleine du canon, orné tantôt d'un simple coup de lance, tantôt d'un coup de mitraille dans le pied ou d'un magnifique coup de sabre au travers de la figure. Il n'était encore qu'adjudantmajor de lanciers; jeune, épris de la gloire, prêt à donner sa vie pour un de ses regards, croyant le trône de Napoléon inébranlable comme le mont Blanc; et joyeux et galant, grand amateur de violon et chantant fort bien l'opéra-comique.
Dans la partie haute de Meylan, tout contre l'escarpement de la montagne, est une maisonnette blanche, entourée de vignes et de jardins, d'où la vue plonge sur la vallée de l'Isère; derrière sont quelques collines rocailleuses, une vieille tour en ruines, des bois, et l'imposante masse d'un rocher immense, le Saint-Eynard; une retraite enfin évidemment prédestinée à être le théâtre d'un roman. C'était la villa de madame Gautier, qui l'habitait pendant la belle saison avec ses deux nièces, dont la plus jeune s'appelait Estelle. Ce nom seul eût suffi pour attirer mon attention; il m'était cher déjà à cause de la pastorale de Florian (Estelle et Némorin) dérobée par moi dans la bibliothèque de mon père, et lue en cachette, cent et cent fois. Mais celle qui le portait avait dix-huit ans, une taille élégante et élevée, de grands yeux armés en guerre, bien que toujours souriants, une chevelure digne d'orner le casque d'Achille, des pieds, je ne dirai pas d'Andalouse, mais de Parisienne pur sang, et des... brodequins roses!... Je n'en avais jamais vu... Vous riez!!... Eh bien, j'ai oublié la couleur de ses cheveux (que je crois noirs pourtant) et je ne puis penser à elle sans voir scintiller, en même temps que les grands yeux, les petits brodequins roses.
En l'apercevant, je sentis une secousse électrique; je l'aimai, c'est tout dire. Le vertige me prit et ne me quitta plus. Je n'espérais rien... je ne savais rien... mais j'éprouvais au cœur une douleur profonde. Je passais des nuits entières à me désoler. Je me cachais le jour dans les champs de maïs, dans les réduits secrets du verger de mon grand-père, comme un oiseau blessé, muet et souffrant. La jalousie, cette pâle compagne des plus pures amours, me torturait au moindre mot adressé par un homme à mon idole. J'entends encore en frémissant le bruit des éperons de mon oncle quand il dansait avec elle! Tout le monde, à la maison et dans le voisinage, s'amusait de ce pauvre enfant de douze ans brisé par un amour au-dessus de ses forces. Elle-même qui, la première, avait tout deviné, s'en est fort divertie, j'en suis sûr. Un soir il y avait une réunion nombreuse chez sa tante; il fut question de jouer aux barres; il fallait, pour former les deux camps ennemis, se diviser en deux groupes égaux; les cavaliers choisissaient leurs dames; on fit exprès de me laisser avant tous désigner la mienne. Mais je n'osai, le cœur me battait trop fort; je baissai les yeux en silence. Chacun de me railler; quand mademoiselle Estelle, saisissant ma main: «Eh bien, non, c'est moi qui choisirai! Je prends M. Hector!» Ô douleur! elle riait aussi, la cruelle, en me regardant du haut de sa beauté...
Non, le temps n'y peut rien... d'autres amours n'effacent point la trace du premier... J'avais treize ans, quand je cessai de la voir... J'en avais trente quand, revenant d'Italie par les Alpes, mes yeux se voilèrent en apercevant de loin le Saint-Eynard, et la petite maison blanche, et la vieille tour... Je l'aimais encore... J'appris en arrivant qu'elle était devenue... mariée et... tout ce qui s'ensuit. Cela ne me guérit point. Ma mère, qui me taquinait quelquefois au sujet de ma première passion, eut peut-être tort de me jouer le tour qu'on va lire. «Tiens, me dit-elle, peu de jours après mon retour de Rome, voilà une lettre qu'on m'a chargée de faire tenir à une dame qui doit passer ici tout à l'heure dans la diligence de Vienne. Va au bureau du courrier, pendant qu'on changera de chevaux, tu demanderas madame F*** et tu lui remettras la lettre. Regarde bien cette dame, je parie que tu la reconnaîtras, bien que tu ne l'aies pas vue depuis dix-sept ans.» Je vais, sans me douter de ce que cela voulait dire, à la station de la diligence. À son arrivée, je m'approche la lettre à la main, demandant madame F***. «C'est moi, monsieur!» me dit une voix. C'est elle! me dit un coup sourd qui retentit dans ma poitrine. Estelle!... encore belle!... Estelle!... la nymphe, l'hamadryade du Saint-Eynard, des vertes collines de Meylan! C'est son port de tête, sa splendide chevelure, et son sourire éblouissant!... mais les petits brodequins roses, hélas! où étaient-ils?... On prit la lettre. Me reconnut-on? je ne sais. La voiture repartit; je rentrai tout vibrant de la commotion. «Allons, me dit ma mère en m'examinant, je vois que Némorin n'a point oublié son Estelle.» Son Estelle! méchante mère!...
IV
Premières leçons de musique, données par mon père.—Mes essais en composition.—Études ostéologiques.—Mon aversion pour la médecine.— Départ pour Paris.
Quand j'ai dit plus haut que la musique m'avait été révélée en même temps que l'amour, à l'âge de douze ans, c'est la composition que j'aurais dû dire; car je savais déjà, avant ce temps, chanter à première vue, et jouer de deux instruments. Mon père encore m'avait donné ce commencement d'instruction musicale.
Le hasard m'ayant fait trouver un flageolet au fond d'un tiroir où je furetais, je voulus aussitôt m'en servir cherchant inutilement à reproduire l'air populaire de Marlborough.
Mon père, que ces sifflements incommodaient fort, vint me prier de le laisser en repos, jusqu'à l'heure où il aurait le loisir de m'enseigner le doigté du mélodieux instrument, et l'exécution du chant héroïque dont j'avais fait choix. Il parvint en effet à me les apprendre sans trop de peine; et, au bout de deux jours, je fus maître de régaler de mon air de Marlborough toute la famille.
On voit déjà, n'est-ce pas, mon aptitude pour les grands effets d'instruments à vent?... (Un biographe pur sang ne manquerait pas de tirer cette ingénieuse induction...) Ceci inspira à mon père l'envie de m'apprendre à lire la musique; il m'expliqua les premiers principes de cet art, en me donnant une idée nette de la raison des signes musicaux et de l'office qu'ils remplissent. Bientôt après, il me mit entre les mains une flûte, avec la méthode de Devienne, et prit, comme pour le flageolet, la peine de m'en montrer le mécanisme. Je travaillai avec tant d'ardeur, qu'au bout de sept à huit mois j'avais acquis sur la flûte un talent plus que passable. Alors, désireux de développer les dispositions que je montrais, il persuada à quelques familles aisées de la Côte de se réunir à lui pour faire venir de Lyon un maître de musique. Ce plan réussit. Un second violon du Théâtre des Célestins, qui jouait en outre de la clarinette, consentit à venir se fixer dans notre petite ville barbare, et à tenter d'en musicaliser les habitants moyennant un certain nombre d'élèves assuré et des appointements fixes pour diriger la bande militaire de la garde nationale. Il se nommait Imbert. Il me donna deux leçons par jour; j'avais une jolie voix de soprano; bientôt je fus un lecteur intrépide, un assez agréable chanteur, et je jouai sur la flûte les concertos de Drouet les plus compliqués. Le fils de mon maître, un peu plus âgé que moi, et déjà habile corniste, m'avait pris en amitié. Un matin il vint me voir, j'allais partir pour Meylan: «Comment, me dit-il, vous partez sans me dire adieu! Embrassons-nous, peut-être ne vous reverrai-je plus...» Je restai surpris de l'air étrange de mon jeune camarade et de la façon solennelle avec laquelle il m'avait quitté. Mais l'incommensurable joie de revoir Meylan et la radieuse Stella montis me l'eurent bientôt fait oublier. Quelle triste nouvelle au retour! Le jour même de mon départ, le jeune Imbert, profitant de l'absence momentanée de ses parents, s'était pendu dans sa maison. On n'a jamais pénétré le motif de ce suicide.
J'avais découvert, parmi de vieux livres, le traité d'harmonie de Rameau, commenté et simplifié par d'Alembert. J'eus beau passer des nuits à lire ces théories obscures, je ne pus parvenir à leur trouver un sens. Il faut en effet être déjà maître de la science des accords, et avoir beaucoup étudié les questions de physique expérimentale sur lesquelles repose le système tout entier, pour comprendre ce que l'auteur a voulu dire. C'est donc un traité d'harmonie à l'usage seulement de ceux qui la savent. Et pourtant je voulais composer. Je faisais des arrangements de duos en trios et en quatuors, sans pouvoir parvenir à trouver des accords ni une basse qui eussent le sens commun. Mais à force d'écouter des quatuors de Pleyel exécutés le dimanche par nos amateurs, et grâce au traité d'harmonie de Catel, que j'étais parvenu à me procurer, je pénétrai enfin, et en quelque sorte subitement, le mystère de la formation et de l'enchaînement des accords. J'écrivis aussitôt une espèce de pot-pourri à six parties, sur des thèmes italiens dont je possédais un recueil. L'harmonie en parut supportable. Enhardi par ce premier pas, j'osai entreprendre de composer un quintette pour flûte, deux violons, alto et basse, que nous exécutâmes, trois amateurs, mon maître et moi.
Ce fut un triomphe. Mon père seul ne parut pas de l'avis des applaudisseurs. Deux mois après nouveau quintette. Mon père voulut en entendre la partie de flûte, avant de me laisser tenter la grande exécution; selon l'usage des amateurs de province, qui s'imaginent pouvoir juger un quatuor d'après le premier violon. Je la lui jouai, et à une certaine phrase: «À la bonne heure, me dit-il, ceci est de la musique.» Mais ce quintette, beaucoup plus ambitieux que le premier, était aussi bien plus difficile; nos amateurs ne purent parvenir à l'exécuter passablement. L'alto et le violoncelle surtout pateaugeaient à qui mieux mieux.
J'avais a cette époque douze ans et demi. Les biographes qui ont écrit dernièrement encore, qu'a vingt ans, je ne connaissais pas les notes, se sont, on le voit, étrangement trompés.
J'ai brûlé les deux quintettes, quelques années après les avoir faits, mais il est singulier qu'en écrivant beaucoup plus tard, à Paris, ma première composition d'orchestre, la phrase approuvée par mon père dans le second de ces essais, me soit revenue en tête, et se sont fait adopter. C'est le chant en la bémol exposé par les premiers violons, un peu après le début de l'allégro de l'ouverture des Francs-Juges.
Après la triste et inexplicable fin de son fils, le pauvre Imbert était retourné à Lyon, où je crois qu'il est mort. Il eut presque immédiatement à la Côte un successeur, beaucoup plus habile que lui, nommé Dorant. Celui-ci, Alsacien de Colmar, jouait à peu près de tous les instruments, et excellait sur la clarinette, la basse, le violon et la guitare. Il donna des leçons de guitare à ma sœur aînée qui avait de la voix, mais que la nature a entièrement privée de tout instinct musical. Elle aime la musique pourtant, sans avoir jamais pu parvenir à la lire et à déchiffrer seulement une romance. J'assistais à ses leçons; je voulus en prendre aussi moi-même; jusqu'à ce que Dorant en artiste honnête et original, vint dire brusquement à mon père: «Monsieur, il m'est impossible de continuer mes leçons de guitare à votre fils!—Pourquoi donc? vous aurait-il manqué de quelque manière, ou se montre-t-il paresseux au point de vous faire désespérer de lui?—Rien de tout cela, mais ce serait ridicule, il est aussi fort que moi.»
Me voilà donc passé maître sur ces trois majestueux et incomparables instruments, le flageolet, la flûte et la guitare! Qui oserait méconnaître, dans ce choix judicieux, l'impulsion de la nature me poussant vers les plus immenses effets d'orchestre et la musique à la Michel-Ange!... La flûte, la guitare et le flageolet!!!... Je n'ai jamais possédé d'autres talents d'exécution; mais ceux-ci me paraissent déjà fort respectables. Encore, non, je me fais tort, je jouais aussi du tambour.
Mon père n'avait pas voulu me laisser entreprendre l'étude du piano. Sans cela il est probable que je fusse devenu un pianiste redoutable, comme quarante mille autres. Fort éloigné de vouloir faire de moi un artiste, il craignait sans doute que le piano ne vînt à me passionner trop violemment et à m'entraîner dans la musique plus loin qu'il ne le voulait. La pratique de cet instrument m'a manqué souvent; elle me serait utile en maintes circonstances; mais, si je considère l'effrayante quantité de platitudes dont il facilite journellement l'émission, platitudes honteuses et que la plupart de leurs auteurs ne pourraient pourtant pas écrire si, privés de leur kaléidoscope musical, ils n'avaient pour cela que leur plume et leur papier, je ne puis m'empêcher de rendre grâces au hasard qui m'a mis dans la nécessité de parvenir à composer silencieusement et librement, en me garantissant ainsi de la tyrannie des habitudes des doigts, si dangereuses pour la pensée, et de la séduction qu'exerce toujours plus ou moins sur le compositeur la sonorité des choses vulgaires. Il est vrai que les innombrables amateurs de ces choses-là expriment à mon sujet le regret contraire; mais j'en suis peu touché.
Les essais de composition de mon adolescence portaient l'empreinte d'une mélancolie profonde. Presque toutes mes mélodies étaient dans le mode mineur. Je sentais le défaut sans pouvoir l'éviter. Un crêpe noir couvrait mes pensées; mon romanesque amour de Meylan les y avait enfermées. Dans cet état de mon âme, lisant sans cesse l'Estelle de Florian, il était probable que je finirais par mettre en musique quelques-unes des nombreuses romances contenues dans cette pastorale, dont la fadeur alors me paraissait douce. Je n'y manquai pas.
J'en écrivis une, entre autres, extrêmement triste sur des paroles qui exprimaient mon désespoir de quitter les bois et les lieux honorés par les pas,éclairés par les yeux et les petits brodequins roses de ma beauté cruelle. Cette pâle poésie me revient aujourd'hui, avec un rayon de soleil printanier, à Londres, où je suis en proie à de graves préoccupations, à une inquiétude mortelle, à une colère concentrée de trouver encore là comme ailleurs tant d'obstacles ridicules... En voici la première strophe: «Je vais donc quitter pour jamais Mon doux pays, ma douce amie, Loin d'eux je vais traîner ma vie Dans les pleurs et dans les regrets! Fleuve dont j'ai vu l'eau limpide, Pour réfléchir ses doux attraits, Suspendre sa course rapide, Je vais vous quitter pour jamais.» Quant à la mélodie de cette romance, brûlée comme le sextuor, comme les quintettes, avant mon départ pour Paris, elle se représenta humblement à ma pensée, lorsque j'entrepris en 1829 d'écrire ma symphonie fantastique. Elle me sembla convenir à l'expression de cette tristesse accablante d'un jeune cœur qu'un amour sans espoir commence à torturer, et je l'acueillis. C'est la mélodie que chantent les premiers violons au début du largo de la première partie de cet ouvrage, intitulé: RÊVERIES, PASSIONS; je n'y ai rien changé.
Mais pendant ces diverses tentatives, au milieu de mes lectures, de mes études géographiques, de mes aspirations religieuses et des alternatives de calme et de tempête dans mon premier amour, le moment approchait où je devais me préparer à suivre une carrière. Mon père me destinait à la sienne, n'en concevant pas de plus belle, et m'avait dès longtemps laissé entrevoir son dessein.
Mes sentiments à cet égard n'étaient rien moins que favorables à ses vues, et je les avais aussi dans l'occasion manifestés avec énergie. Sans me rendre compte précisément de ce que j'éprouvais, je pressentais une existence passée bien loin du chevet des malades, des hospices et des amphithéâtres. N'osant m'avouer celle que je rêvais, ma résolution me paraissait pourtant bien prise de résister à tout ce qu'on pourrait faire pour m'amener à la médecine. La vie de Gluck et celle de Haydn que je lus à cette époque, dans la Biographie universelle, me jetèrent dans la plus grande agitation. Quelle belle gloire! me disais-je, en pensant à celle de ces deux hommes illustres; quel bel art! quel bonheur de le cultiver en grand! En outre, un incident fort insignifiant en apparence vint m'impressionner encore dans le même sens et illuminer mon esprit d'une clarté soudaine qui me fit entrevoir au loin mille horizons musicaux étranges et grandioses.
Je n'avais jamais vu de grande partition. Les seuls morceaux de musique à moi connus consistaient en solfèges accompagnés d'une basse chiffrée, en solos de flûte, ou en fragments d'opéras avec accompagnement de piano. Or, un jour une feuille de papier réglé à vingt-quatre portées me tomba sous la main. En apercevant cette grande quantité de lignes, je compris aussitôt à quelle multitude de combinaisons instrumentales et vocales leur emploi ingénieux pouvait donner lieu, je et m'écriai: «Quel orchestre on doit pouvoir écrire là-dessus!» À partir de ce moment la fermentation musicale de ma tête ne fit que croître, et mon aversion pour la médecine redoubla. J'avais de mes parents une trop grande crainte, toutefois, pour rien oser avouer de mes audacieuses pensées, quand mon père, à la faveur même de la musique, en vint à un coup d'État pour détruire ce qu'il appelait mes puériles antipathies, et me faire commencer les études médicales.
Afin de me familiariser instantanément avec les objets que je devais bientôt avoir constamment sous les yeux, il avait étalé dans son cabinet l'énorme Traité d'ostéologie de Munro, ouvert, et contenant des gravures de grandeur naturelle, où les diverses parties de la charpente humaine sont reproduites très-fidèlement. «Voilà un ouvrage, me dit-il, que tu vas avoir à étudier. Je ne pense pas que tu persistes dans tes idées hostiles à la médecine; elles ne sont ni raisonnables ni fondées sur quoi que ce soit. Et si, au contraire, tu veux me promettre d'entreprendre sérieusement ton cours d'ostéologie, je ferai venir de Lyon, pour toi, une flûte magnifique garnie de toutes les nouvelles clefs.» Cet instrument était depuis longtemps l'objet de mon ambition. Que répondre?... La solennité de la proposition, le respect mêlé de crainte que m'inspirait mon père, malgré toute sa bonté, et la force de la tentation, me troublèrent au dernier point. Je laissai échapper un oui bien faible et rentrai dans ma chambre, où je me jetai sur mon lit accablé de chagrin.
Être médecin! étudier l'anatomie! disséquer! assister à d'horribles opérations! au lieu de me livrer corps et âme à la musique, cet art sublime dont je concevais déjà la grandeur! Quitter l'empirée pour les plus tristes séjours de la terre! les anges immortels de la poésie et de l'amour et leurs chants inspirés, pour de sales infirmiers, d'affreux garçons d'amphithéâtre, des cadavres hideux, les cris des patients, les plaintes et le râle précurseurs de la mort!...
Oh! non, tout cela me semblait le renversement absolu de l'ordre naturel de ma vie, et monstrueux et impossible. Cela fut pourtant.
Les études d'ostéologie furent commencées en compagnie d'un de mes cousins (A. Robert, aujourd'hui l'un des médecins distingués de Paris), que mon père avait pris pour élève en même temps que moi. Malheureusement Robert jouait fort bien du violon (il était de mes exécutants pour les quintettes) et nous nous occupions ensemble un peu plus de musique que d'anatomie pendant les heures de nos études. Ce qui ne l'empêchait pas, grâce au travail obstiné auquel il se livrait chez lui en particulier, de savoir toujours beaucoup mieux que moi ses démonstrations. De là, bien de sévères remontrances et même de terribles colères paternelles.
Néanmoins, moitié de gré, moitié de force, je finis par apprendre tant bien que mal de l'anatomie tout ce que mon père pouvait m'en enseigner, avec le secours des préparations sèches (des squelettes) seulement; et j'avais dix-neuf ans quand, encouragé par mon condisciple, je dus me décider à aborder les grandes études médicales et à partir avec lui, dans cette intention, pour Paris.
Ici, je m'arrête un instant avant d'entreprendre le récit de ma vie parisienne et des luttes acharnées que j'y engageai presque en arrivant et que je n'ai jamais cessé d'y soutenir contre les idées, les hommes et les choses. Le lecteur me permettra de prendre haleine.
D'ailleurs, c'est aujourd'hui (10 avril) que la manifestation des deux cent mille chartistes anglais doit avoir lieu. Dans quelques heures peut-être, l'Angleterre sera bouleversée comme le reste de l'Europe, et cet asile même ne me restera plus. Je vais voir se décider la question.
(8 heures du soir). Allons, les chartistes sont de bonnes pâtes de révolutionnaires. Tout s'est bien passé. Les canons, ces puissants orateurs, ces grands logiciens dont les arguments irrésistibles pénètrent si profondément dans les masses, étaient à la tribune. Ils n'ont pas même été obligés de prendre la parole, leur aspect a suffi pour porter dans toutes les âmes la conviction de l'inopportunité d'une révolution, et les chartistes se sont dispersés dans le plus grand ordre.
Braves gens! vous vous entendez à faire des émeutes comme les Italiens à écrire des symphonies. Il en est de même des Irlandais très-probablement, et O'Connell avait bien raison de leur dire toujours: Agitez! agitez! mais ne bougez pas!
(12 juillet). Il m'a été impossible pendant les trois mois qui viennent de s'écouler de poursuivre le travail de ces mémoires. Je repars maintenant pour le malheureux pays qu'on appelle encore la France, et qui est le mien après tout. Je vais voir de quelle façon un artiste peut y vivre, ou combien de temps il lui faut pour y mourir, au milieu des ruines sous lesquelles la fleur de l'art est écrasée et ensevelie. Farewell England!...
(France, 16 juillet 1848). Me voilà de retour! Paris achève d'enterrer ses morts. Les pavés des barricades ont repris leur place, d'où ils ressortiront peut-être demain. À peine arrivé, je cours au faubourg Saint-Antoine: quel spectacle! quels hideux débris! Le Génie de la Liberté qui plane au sommet de la colonne de la Bastille, a lui-même le corps traversé d'une balle. Les arbres abattus, mutilés, les maisons prêtes à crouler, les places, les rues, les quais semblent encore vibrants du fracas homicide!... Pensons donc à l'art par ce temps de folies furieuses et de sanglantes orgies!... Tous nos théâtres sont fermés, tous les artistes ruinés, tous les professeurs oisifs, tous les élèves en fuite; de pauvres pianistes jouent des sonates sur les places publiques, des peintres d'histoire balayent les rues, des architectes gâchent du mortier dans les ateliers nationaux... L'Assemblée vient de voter d'assez fortes sommes pour rendre possible la réouverture des théâtres et accorder en outre de légers secours aux artistes les plus malheureux. Secours insuffisants pour les musiciens surtout! Il y a des premiers violons à l'Opéra dont les appointements n'allaient pas à neuf cents francs par an. Ils avaient vécu à grand'peine jusqu'à ce jour, en donnant des leçons. On ne doit pas supposer qu'ils aient pu faire de brillantes économies. Leurs élèves partis, que vont-ils devenir, ces malheureux? On ne les déportera pas, quoique beaucoup d'entre eux n'aient plus de chances de gagner leur vie qu'en Amérique, aux Indes ou à Sydney; la déportation coûte trop cher au gouvernement: pour l'obtenir, il faut l'avoir méritée, et tous nos artistes ont combattu les insurgés et sont montés à l'assaut des barricades...
Au milieu de cette effroyable confusion du juste et de l'injuste, du bien et du mal, du vrai et du faux, en entendant parler cette langue dont la plupart des mots sont détournés de leur acception, n'y a-t-il pas de quoi devenir complètement fou!!!
Continuons mon auto biographie. Je n'ai rien de mieux à faire. L'examen du passé servira, d'ailleurs, à détourner mon attention du présent.
V
Une année d'études médicales.—Le professeur Amussat.—Une représentation à l'Opéra.—La bibliothèque du Conservatoire.— Entraînement irrésistible vers la musique.—Mon père se refuse à me laisser suivre cette carrière.—Discussions de famille.
En arrivant à Paris, en 1822, avec mon condisciple A. Robert, je me livrai tout entier aux études relatives à la carrière qui m'était imposée; je tins loyalement la promesse que j'avais faite à mon père en partant. J'eus pourtant à subir une épreuve assez difficile, quand Robert, m'ayant appris un matin qu'il avait acheté un sujet (un cadavre), me conduisit pour la première fois à l'amphithéâtre de dissection de l'hospice de la Pitié. L'aspect de cet horrible charnier humain, ces membres épars, ces têtes grimaçantes, ces crânes entr'ouverts, le sanglant cloaque dans lequel nous marchions, l'odeur révoltante qui s'en exhalait, les essaims de moineaux se disputant des lambeaux de poumons, les rats grignotant dans leur coin des vertèbres saignantes, me remplirent d'un tel effroi que, sautant par la fenêtre de l'amphithéâtre, je pris la fuite à toutes jambes et courus haletant jusque chez moi comme si la mort et son affreux cortège eussent été à mes trousses. Je passai vingt-quatre heures sous le coup de cette première impression, sans vouloir plus entendre parler d'anatomie, ni de dissection, ni de médecine, et méditant mille folies pour me soustraire à l'avenir dont j'étais menacé.
Robert perdait son éloquence à combattre mes répugnances et à me démontrer l'absurdité de mes projets. Il parvint pourtant à me faire tenter une seconde expérience. Je consentis à le suivre de nouveau à l'hospice, et nous entrâmes ensemble dans la funèbre salle. Chose étrange! en revoyant ces objets qui dès l'abord m'avaient inspiré une si profonde horreur, je demeurai parfaitement calme, je n'éprouvai absolument rien qu'un froid dégoût; j'étais déjà familiarisé avec ce spectacle comme un vieux carabin; c'était fini. Je m'amusai même, en arrivant, à fouiller la poitrine entr'ouverte d'un pauvre mort, pour donner leur pitance de poumons aux hôtes ailés de ce charmant séjour. À la bonne heure! me dit Robert en riant, tu t'humanises!
Aux petits des oiseaux tu donnes la pâture.
—Et ma bonté s'étend sur toute la nature.
répliquai-je en jetant une omoplate à un gros rat qui me regardait d'un air affamé.
Je suivis donc, sinon avec intérêt, au moins avec une stoïque résignation le cours d'anatomie. De secrètes sympathies m'attachaient même à mon professeur Amussat, qui montrait pour cette science une passion égale à celle que je ressentais pour la musique. C'était un artiste en anatomie. Hardi novateur en chirurgie, son nom est aujourd'hui européen; ses découvertes excitent dans le monde savant l'admiration et la haine. Le jour et la nuit suffisent à peine à ses travaux. Bien qu'exténué des fatigues d'une telle existence, il continue, rêveur, mélancolique, ses audacieuses recherches et persiste dans sa périlleuse voie. Ses allures sont celles d'un homme de génie. Je le vois souvent; je l'aime.
Bientôt les leçons de Thénard et de Gay-Lussac qui professaient, l'un la chimie, l'autre la physique au Jardin des Plantes, le cours de littérature, dans lequel Andrieux savait captiver son auditoire avec tant de malicieuse bonhomie, m'offrirent de puissantes compensations; je trouvai à les suivre un charme trèsvif et toujours croissant. J'allais devenir un étudiant comme tant d'autres, destiné à ajouter une obscure unité au nombre désastreux des mauvais médecins, quand, un soir, j'allai à l'Opéra. On y jouait les Danaides, de Salieri. La pompe, l'éclat du spectacle, la masse harmonieuse de l'orchestre et des chœurs, le talent pathétique de madame Branchu, sa voix extraordinaire, la rudesse grandiose de Dérivis; l'air d'Hypermnestre où je retrouvais, imités par Salieri, tous les traits de l'idéal que je m'étais fait du style de Gluck, d'après des fragments de son Orphée découverts dans la bibliothèque de mon père; enfin la foudroyante bacchanale et les airs de danse si mélancoliquement voluptueux, ajoutés par Spontini à la partition de son vieux compatriote, me mirent dans un état de trouble et d'exaltation que je n'essayerai pas de décrire. J'étais comme un jeune homme aux instincts navigateurs, qui, n'ayant jamais vu que les nacelles des lacs de ses montagnes, se trouverait brusquement transporté sur un vaisseau à trois ponts en pleine mer. Je ne dormis guère, on peut le croire, la nuit qui suivit cette représentation, et la leçon d'anatomie du lendemain se ressentit de mon insomnie. Je chantais l'air de Danaüs: «Jouissez du destin propice,» en sciant le crâne de mon sujet, et quand Robert, impatienté de m'entendre murmurer la mélodie «Descends dans le sein d'Amphitrite» au lieu de lire le chapitre de Bichat sur les aponévroses, s'écriait: «Soyons donc à notre affaire! nous ne travaillons pas! dans trois jours notre sujet sera gâté!... il coûte dix-huit francs!... il faut pourtant être raisonnable!» je répliquais par l'hymne à Némésis «Divinité de sang avide!» et le scalpel lui tombait des mains.
La semaine suivante, je retournai à l'Opéra où j'assistai, cette fois, à une représentation de la Stratonice de Méhul et du ballet de Nina dont la musique avait été composée et arrangée par Persuis. J'admirai beaucoup dans Stratonice l'ouverture d'abord, l'air de Séleucus «Versez tous vos chagrins» et le quatuor de la consultation; mais l'ensemble de la partition me parut un peu froid. Le ballet, au contraire, me plut beaucoup, et je fus profondément ému en entendant jouer sur le cor anglais par Vogt, pendant une navrante pantomime de mademoiselle Bigottini, l'air du cantique chanté par les compagnes de ma sœur au couvent des Ursulines, le jour de ma première communion. C'était la romance «Quand le bien-aimé reviendra.» Un de mes voisins qui en fredonnait les paroles, me dit le nom de l'opéra et celui de l'auteur auquel Persuis l'avait empruntée, et j'appris ainsi qu'elle appartenait à la Nina de d'Aleyrac. J'ai bien de la peine à croire, quel qu'ait pu être le talent de la cantatrice qui créa le rôle de Nina, que cette mélodie ait jamais eu dans sa bouche un accent aussi vrai, une expression aussi touchante qu'en sortant de l'instrument de Vogt, et dramatisée par la mime célèbre.
Malgré de pareilles distractions, et tout en passant bien des heures, le soir, à réfléchir sur la triste contradiction établie entre mes études et mes penchants, je continuai quelque temps encore cette vie de tiraillements, sans grand profit pour mon instruction médicale, et sans pouvoir étendre le champ si borné de mes connaissances en musique. J'avais promis, je tenais ma parole. Mais, ayant appris que la bibliothèque du Conservatoire, avec ses innombrables partitions, était ouverte au public, je ne pus résister au désir d'y aller étudier les œuvres de Gluck, pour lesquelles j'avais déjà une passion instinctive, et qu'on ne représentait pas en ce moment à l'Opéra. Une fois admis dans ce sanctuaire, je n'en sortis plus. Ce fut le coup de grâce donné à la médecine. L'amphithéâtre fut décidément abandonné.
L'absorption de ma pensée par la musique fut telle que je négligeai même, malgré toute mon admiration pour Gay-Lussac et l'intérêt puissant d'une pareille étude, le cours d'électricité expérimentale, que j'avais commencé avec lui. Je lus et relus les partitions de Gluck, je les copiai, je les appris par cœur; elles me firent perdre le sommeil, oublier le boire et le manger; j'en délirai. Et le jour où, après une anxieuse attente, il me fut enfin permis d'entendre Iphigénie en Tauride, je jurai, en sortant de l'Opéra, que, malgré père, mère, oncles, tantes, grands parents et amis, je serais musicien. J'osai même, sans plus tarder, écrire à mon père pour lui faire connaître tout ce que ma vocation avait d'impérieux et d'irrésistible, en le conjurant de ne pas la contrarier inutilement. Il répondit par des raisonnements affectueux, dont la conclusion était que je ne pouvais pas tarder à sentir la folie de ma détermination et à quitter la poursuite d'une chimère pour revenir à une carrière honorable et toute tracée. Mais mon père s'abusait. Bien loin de me rallier à sa manière de voir, je m'obstinai dans la mienne, et dès ce moment une correspondance régulière s'établit entre nous, de plus en plus sévère et menaçante du côté de mon père, toujours plus passionnée du mien et animée enfin d'un emportement qui allait jusques à la fureur.
VI
Mon admission parmi les élèves de Lesueur.—Sa bonté. La chapelle royale.
Je m'étais mis à composer pendant ces cruelles discussions. J'avais écrit, entre autres choses, une cantate à grand orchestre, sur un poëme de Millevoye (Le Cheval arabe.) Un élève de Lesueur, nommé Gerono, que je rencontrais souvent à la bibliothèque du Conservatoire, me fit entrevoir la possibilité d'être admis dans la classe de composition de ce maître, et m'offrit de me présenter à lui. J'acceptai sa proposition avec joie, et je vins un matin soumettre à Lesueur la partition de ma cantate, avec un canon à trois voix que j'avais cru devoir lui donner pour auxiliaire dans cette circonstance solennelle. Lesueur eut la bonté de lire attentivement la première de ces deux œuvres informes, et dit en me la rendant: «Il y a beaucoup de chaleur et de mouvement dramatique là-dedans, mais vous ne savez pas encore écrire, et votre harmonie est entachée de fautes si nombreuses qu'il serait inutile de vous les signaler. Gerono aura la complaisance de vous mettre au courant de nos principes d'harmonie, et, dès que vous serez parvenu à les connaître assez pour pouvoir me comprendre, je vous recevrai volontiers parmi mes élèves.» Gerono accepta respectueusement la tâche que lui confiait Lesueur; il m'expliqua clairement, en quelques semaines, tout le système sur lequel ce maître a basé sa théorie de la production et de la succession des accords; système emprunté à Rameau et à ses rêveries sur la résonnance de la corde sonore. Je vis tout de suite, à la manière dont Gerono m'exposait ces principes, qu'il ne fallait point en discuter la valeur, et que, dans l'école de Lesueur, ils constituaient une sorte de religion à laquelle chacun devait se soumettre aveuglément. Je finis même, telle est la force de l'exemple, par avoir en cette doctrine une foi sincère, et Lesueur, en m'admettant au nombre de ses disciples favoris, put me compter aussi parmi ses adeptes les plus fervents.
Je suis loin de manquer de reconnaissance pour cet excellent et digne homme, qui entoura mes premiers pas dans la carrière de tant de bienveillance, et m'a, jusqu'à la fin de sa vie, témoigné une véritable affection. Mais combien de temps j'ai perdu à étudier ses théories antédiluviennes, à les mettre en pratique et à les désapprendre ensuite, en recommençant de fond en comble mon éducation! Aussi m'arrive-t-il maintenant de détourner involontairement les yeux, quand j'aperçois une de ses partitions. J'obéis alors à un sentiment comparable à celui que nous éprouvons en voyant le portrait d'un ami qui n'est plus. J'ai tant admiré ces petits oratorios qui formaient le répertoire de Lesueur à la chapelle royale, et cette admiration, j'ai eu tant de regrets de la voir s'affaiblir! En comparant d'ailleurs à l'époque actuelle le temps où j'allais les entendre régulièrement tous les dimanches au palais des Tuileries, je me trouve si vieux, si fatigué, et pauvre d'illusions! Combien d'artistes célèbres que je rencontrais à ces solennités de l'art religieux n'existent plus! Combien d'autres sont tombés dans l'oubli pire que la mort! Que d'agitations! que d'efforts! que d'inquiétudes depuis lors! C'était le temps du grand enthousiasme, des grandes passions musicales, des longues rêveries, des joies infinies, inexprimables!... Quand j'arrivais à l'orchestre de la chapelle royale, Lesueur profitait ordinairement de quelques minutes avant le service, pour m'informer du sujet de l'œuvre qu'on allait exécuter, pour m'en exposer le plan et m'expliquer ses intentions principales. La connaissance du sujet traité par le compositeur n'était pas inutile, en effet, car il était rare que ce fût le texte de la messe. Lesueur, qui a écrit un grand nombre de messes, affectionnait particulièrement et produisait plus volontiers ces délicieux épisodes de l'Ancien Testament, tels que Noémi, Rachel, Ruth et Booz, Débora, etc., qu'il avait revêtus d'un coloris antique, parfois si vrai, qu'on oublie, en les écoutant, la pauvreté de sa trame musicale, son obstination à imiter dans les airs, duos et trios, l'ancien style dramatique italien, et la faiblesse enfantine de son instrumentation. De tous les poèmes (à l'exception peut-être de celui de Mac-Pherson, qu'il persistait à attribuer à Ossian), la Bible était sans contredit celui qui prêtait le plus au développement des facultés spéciales de Lesueur. Je partageais alors sa prédilection, et l'Orient, avec le calme de ses ardentes solitudes, la majesté de ses ruines immenses, ses souvenirs historiques, ses fables, était le point de l'horizon poétique vers lequel mon imagination aimait le mieux à prendre son vol.
Après la cérémonie, dès qu'à l'Ite missa est le roi Charles X s'était retiré, au bruit grotesque d'un énorme tambour et d'un fifre, sonnant traditionnellement une fanfare à cinq temps, digne de la barbarie du moyen âge qui la vit naître, mon maître m'emmenait quelquefois dans ses longues promenades. C'étaient ces jours-là de précieux conseils, suivis de curieuses confidences. Lesueur, pour me donner courage, me racontait une foule d'anecdotes sur sa jeunesse; ses premiers travaux à la maîtrise de Dijon, son admission à la sainte chapelle de Paris, son concours pour la direction de la maîtrise de Notre-Dame; la haine que lui porta Méhul; les avanies que lui firent subir les rapins du Conservatoire; les cabales ourdies contre son opéra de la Caverne, et la noble conduite de Cherubini à cette occasion, l'amitié de Paisiello qui le précéda à la chapelle impériale: les distinctions enivrantes prodiguées par Napoléon à l'auteur des Bardes; les mots historiques du grand homme sur cette partition. Mon maître me disait encore ses peines infinies pour faire jouer son premier opéra: ses craintes, son anxiété avant la première représentation; sa tristesse étrange, son désœuvrement après le succès; son besoin de tenter de nouveau les hasards du théâtre; son opéra de Télémaque écrit en trois mois; la fière beauté de madame Scio vêtue en Diane chasseresse, et son superbe emportement dans le rôle de Calypso. Puis venaient les discussions; car il me permettait de discuter avec lui quand nous étions seuls, et j'usais quelquefois de la permission un peu plus largement qu'il n'eût été convenable. Sa théorie de la basse fondamentale et ses idées sur les modulations en fournissaient aisément la matière. À défaut de questions musicales, il mettait volontiers en avant quelques thèses philosophiques et religieuses, sur lesquelles nous n'étions pas non plus très-souvent d'accord. Mais nous avions la certitude de nous rencontrer à divers points de ralliement, tels que Gluck, Virgile, Napoléon, vers lesquels nos sympathies convergeaient avec une ardeur égale. Après ces longues causeries sur les bords de la Seine, ou sous les ombrages des Tuileries, il me renvoyait ordinairement, pour se livrer pendant plusieurs heures à des méditations solitaires, qui étaient devenues pour lui un véritable besoin.
VII
Un premier opéra.—M. Andrieux.—Une première messe. M. de Chateaubriand.
Quelques mois après mon admission parmi les élèves particuliers de Lesueur, (je ne faisais point encore partie de ceux du Conservatoire) je me mis en tête d'écrire un opéra. Le cours de littérature de M. Andrieux, que je suivais assidûment, me fit penser à ce spirituel vieillard, et j'eus la singulière idée de m'adresser à lui pour le livret. Je ne sais ce que je lui écrivis à ce sujet, mais voici sa réponse.
«Monsieur,
»Votre lettre m'a vivement intéressé; l'ardeur que vous montrez pour le bel art que vous cultivez, vous y garantit des succès; je vous les souhaite de tout mon cœur, et je voudrais pouvoir contribuer à vous les faire obtenir. Mais l'occupation que vous me proposez n'est plus de mon âge; mes idées et mes études sont tournées ailleurs; je vous paraîtrais un barbare, si je vous disais combien il y a d'années que je n'ai mis le pied ni à l'Opéra, ni à Feydeau. J'ai soixante-quatre ans, il me conviendrait mal de vouloir faire des vers d'amour, et en fait de musique, je ne dois plus guère songer qu'à la messe de Requiem. Je regrette que vous ne soyez pas venu trente ou quarante ans plus tôt, ou moi plus tard. Nous aurions pu travailler ensemble. Agréez mes excuses qui ne sont que trop bonnes et mes sincères et affectueuses salutations.
»ANDRIEUX.»
17 juin 1823.
Ce fut M. Andrieux lui-même, qui eut la bonté de m'apporter sa lettre. Il causa longtemps avec moi, et me dit en me quittant: «Ah, moi aussi j'ai été dans ma jeunesse un fougueux amateur de musique. J'étais enragé Picciniste... et Gluckiste donc.»
Découragé par ce premier échec auprès d'une célébrité littéraire, j'eus recours modestement à Gerono qui se piquait un peu de poésie. Je lui demandai (admirez ma candeur) de me dramatiser l'Estelle de Florian. Il s'y décida et je mis son œuvre en musique. Personne heureusement n'entendit jamais rien de cette composition suggérée par mes souvenirs de Meylan. Souvenirs impuissants! car ma partition fut aussi ridicule, pour ne pas dire plus, que la pièce et les vers de Gerono. À cet œuvre d'un rose tendre succéda une scène fort sombre, au contraire, empruntée au drame de Saurin, Béverley ou le Joueur. Je me passionnai sérieusement pour ce fragment de musique violente écrit pour voix de basse avec orchestre, et que j'eusse voulu entendre chanter par Dérivis, au talent duquel il me paraissait convenir. Le difficile était de découvrir une occasion favorable pour le faire exécuter. Je crus l'avoir trouvée en voyant annoncer au Théâtre-Français une représentation au bénéfice de Talma, où figurait Athalie avec les chœurs de Gossec.—Puisqu'il y a des chœurs, me dis-je, il y aura aussi un orchestre pour les accompagner; ma scène est d'une exécution facile, et si Talma veut l'introduire dans son programme, certes Dérivis ne lui refusera pas de la chanter. Allons chez Talma! Mais l'idée seule de parler au grand tragédien, de voir Néron face à face, me troublait au dernier point. En approchant de sa maison, je sentais un battement de cœur de mauvais augure. J'arrive; à l'aspect de sa porte, je commence à trembler; je m'arrête sur le seuil dans une incroyable perplexité. Oserai-je aller plus avant?... Renoncerai-je à mon projet? Deux fois je lève le bras pour saisir le cordon de la sonnette, deux fois mon bras retombe... le rouge me monte au visage, les oreilles me tintent, j'ai de véritables éblouissements. Enfin la timidité l'emporte, et, sacrifiant toutes mes espérances, je m'éloigne, ou plutôt je m'enfuis à grands pas.
Qui comprendra cela?... un jeune enthousiaste à peine civilisé, tel que j'étais alors.
Un peu plus tard, M. Masson, maître de chapelle de l'église Saint-Roch, me proposa d'écrire une messe solennelle qu'il ferait exécuter, disait-il, dans cette église, le jour des Saints Innocents, fête patronale des enfants de chœur. Nous devions avoir cent musiciens de choix à l'orchestre, un chœur plus nombreux encore; on étudierait les parties de chant pendant un mois; la copie ne me coûterait rien, ce travail serait fait gratuitement et avec soin par les enfants de chœur de Saint-Roch, etc., etc. Je me mis donc plein d'ardeur à écrire cette messe, dont le style, avec sa coloration inégale et en quelque sorte accidentelle, ne fut qu'une imitation maladroite du style de Lesueur. Ainsi que la plupart des maîtres, celui-ci, dans l'examen qu'il fit de ma partition, approuva surtout les passages où sa manière était le plus fidèlement reproduite. À peine terminé, je mis le manuscrit entre les mains de M. Masson, qui en confia la copie et l'étude à ses jeunes élèves. Il me jurait toujours ses grands dieux que l'exécution serait pompeuse et excellente. Il nous manquait seulement un habile chef d'orchestre, ni lui, ni moi n'ayant l'habitude de diriger d'aussi grandes masses de voix et d'instruments. Valentino était alors à la tête de l'orchestre de l'Opéra, il aspirait à l'honneur d'avoir aussi sous ses ordres celui de la chapelle royale. Il n'aurait garde, sans doute, de ne rien refuser à mon maître qui était surintendant de cette chapelle. En effet, une lettre de Lesueur que je lui portai le décida, malgré sa défiance des moyens d'exécution dont je pourrais disposer, à me promettre son concours. Le jour de la répétition générale arriva, et nos grandes masses vocales et instrumentales réunies, il se trouva que nous avions pour tout bien vingt choristes, dont quinze ténors et cinq basses, douze enfants, neuf violons, un alto, un hautbois, un cor et un basson. On juge de mon désespoir et de ma honte, en offrant à Valentino, à ce chef renommé d'un des premiers orchestres du monde, une telle phalange musicale!... «Soyez tranquille, disait toujours maître Masson, il ne manquera personne demain à l'exécution. Répétons! répétons! Valentino résigné, donne le signal, on commence; mais après quelques instants, il faut s'arrêter à cause des innombrables fautes de copie que chacun signale dans les parties. Ici on a oublié d'écrire les bémols et les dièses à la clef; là il manque dix pauses; plus loin on a omis trente mesures. C'est un gâchis à ne pas se reconnaître, je souffre tous les tourments de l'enfer; et nous devons enfin renoncer absolument, pour cette fois, à mon rêve si longtemps caressé d'une exécution à grand orchestre.
Cette leçon au moins ne fut pas perdue. Le peu de ma composition malheureuse que j'avais entendu, m'ayant fait découvrir ses défauts les plus saillants, je pris aussitôt une résolution radicale dans laquelle Valentino me raffermit, en me promettant de ne pas m'abandonner, lorsqu'il s'agirait plus tard de prendre ma revanche. Je refis cette messe presque entièrement. Mais pendant que j'y travaillais, mes parents avertis de ce fiasco, ne manquèrent pas d'en tirer un vigoureux parti pour battre en brèche ma prétendue vocation et tourner en ridicule mes espérances. Ce fut la lie de mon calice d'amertume. Je l'avalai en silence et n'en persistai pas moins.