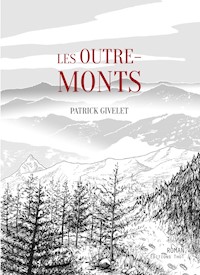
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ThoT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
En 1734, après douze années de travail dans une mine de cuivre de la Valsesia, dans le Piémont, Augustineo retourne dans son village, au cœur des montagnes du duché de Savoie. Un village habité par 180 feux, 400 vaches environ, un notaire, un curé, trois vicaires et un syndic nommé par l’intendant de Tarentaise pour administrer la commune. À partir de quelques indices, le jeune homme trouve dans la montagne un gisement de plomb argentifère. Rapidement, la mine devient usine, et Augustineo est dépossédé de sa découverte.
Commence alors pour ce village de paysans une ère de changement et d’innovation. Cette nouvelle activité minière est source de bien des bouleversements sociaux, culturels et économiques, avec notamment l’arrivée de plusieurs dizaines d’ouvriers venus du Piémont, d’Angleterre, du Tyrol du sud, de Franche-Comté. Autant de motifs d’affrontement avec les habitants de ce petit village, qui abrite une société agro-pastorale, patriarcale et religieuse. Mais cette immigration ouvrière recèle une multitude de destins particuliers, à l’image des personnages qui peuplent cette histoire sur trois générations.
Dans ce contexte social mouvant, dans cette Savoie du XVIIIe siècle que le pouvoir sarde, installé à Turin, situe « au-delà des monts », dans cette fin du petit âge glaciaire qui sème mauvaises récoltes et crises frumentaires, tous ne vivent pas les changements de la même façon…
À PROPOS DE L'AUTEUR
Né en 1939,
Patrick Givelet fait ses études à l’Institut d’études politiques de Grenoble. De retour en France en 1972, après une dizaine d’années passées en Afrique et en Amérique du Sud, il dirige un centre de formation professionnelle, puis prend la direction du service des affaires culturelles à Briançon, dans les Hautes-Alpes. En 1985, il s’installe dans la petite commune de Peisey-Nancroix en Tarentaise (Savoie), dont il devient maire pendant treize années. C’est là qu’il découvre les ruines d’un ancien site minier datant du XVIIIe siècle. Il entreprend alors des recherches et découvre une singulière histoire peuplée d’étonnants personnages. Membre de la Société d’histoire et d’archéologie d’Aime, il est l’auteur de plusieurs ouvrages :
L’École française des Mines en Savoie, Peisey, Moûtiers (1802-1814) et
Le plomb et l’argent, histoire d’un grand site minier européen, XVIIIe-XIXe siècles, publiés par la SHAA, et
L’or et la pierre, paru aux éditions La Fontaine de Siloé. Son premier roman,
Les outre-monts, s’inscrit dans cette continuité.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 487
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Présentation de l'auteur
Né en 1939, Patrick Givelet fait ses études à l’Institut d’études politiques de Grenoble. De retour en France en 1972, après une dizaine d’années passées en Afrique et en Amérique du Sud, il dirige un centre de formation professionnelle, puis prend la direction du service des affaires culturelles à Briançon, dans les Hautes-Alpes. En 1985, il s’installe dans la petite commune de Peisey-Nancroix en Tarentaise (Savoie), dont il devient maire pendant treize années. C’est là qu’il découvre les ruines d’un ancien site minier datant du xviiie siècle. Il entreprend alors des recherches et découvre une singulière histoire peuplée d’étonnants personnages. Membre de la Société d’histoire et d’archéologie d’Aime, il est l’auteur de plusieurs ouvrages : L’École française des Mines en Savoie, Peisey, Moûtiers (1802-1814) et Le plomb et l’argent, histoire d’un grand site minier européen, XVIIIe-XIXe siècles, publiés par la SHAA, et L’or et la pierre, paru aux éditions La Fontaine de Siloé. Son premier roman, Les outre-monts, s’inscrit dans cette continuité.
À Martine, qui m’a demandé de lui raconter une histoire de sa vallée.
Note de l’auteur
La coutume a été prise dans les registres de l’état civil au XVIIIe siècle de donner aux nouveau-nés le prénom du père ou celui de la mère et un deuxième prénom pour éviter les homonymes d’une génération à l’autre. À l’exception des prénoms composés (Jean-Baptiste, Jean-Marie, Maria-Magdalena…), les prénoms doubles des personnages de ce roman sont donc orthographiés sans trait d’union.
Premier épisode : 1734-1765
L’homme au shako en peau de chèvre
1. Pesey, juin 1734
Augustineo Merlo était bâti comme un jeune taureau ; trapu, massif, charpenté, tout en muscle. Sa tignasse noire, bouclée, lui donnait un air jeune malgré ses trente ans. Ses yeux avaient dû être rieurs il y a bien longtemps, mais aujourd’hui, ils étaient voilés d’amertume et de tristesse. Il était coiffé d’un chapeau de feutre noir à larges bords et portait sur le dos une balle en toile forte fixée sur une armature de bois de hêtre, contenant tout son ménage. Ce jour de juin 1734, il montait le chemin qui menait à Pesey, un village de la province de Tarentaise perché en altitude dans la Savoie montagneuse. Son pas était cependant celui d’un homme décidé à vivre, à réagir contre les vilains tours que la vie lui avait joués jusque-là.
Il avait quitté Pesey douze ans auparavant, croyant quitter l’ennui, le passé, il était jeune, croyait qu’ailleurs était mieux, qu’avant était nul, il entrait dans l’avenir. Il avait franchi le col du Petit-Saint-Bernard avec une troupe de marchands et s’était arrêté dans la vallée de la Sesia en Piémont. Il avait pu s’embaucher à la minière* de cuivre d’Alagna où il avait découvert le travail avec des compagnons, des machines, un salaire à lui, une bourgade qui se donnait des airs de ville, l’indépendance… Son père avait été charpentier, lui était devenu mineur, s’éloignant encore un peu plus de ses grands-parents paysans, un peu plus encore de cette terre, de ces saisons, de cette herbe, de ces bêtes… À la minière d’Alagna, il avait appris les longues journées du mineur, l’angoisse du fond, le plaisir de sortir au jour le minerai* bleuté de cuivre à pleines barelles* ; il avait observé les vieux caporaux renifler le filon, miner les parois dans la bonne direction ; il avait fait l’expérience des dangers de l’eau qui jaillissait soudain des fentes du rocher en jets tumultueux, des craquements sonores roulant de galerie en galerie annonçant les éboulements, du signal des lampes à huile qui s’éteignent les unes après les autres ; il avait appris à calmer l’angoisse des apprentis plongés brutalement dans le noir. Au bout de dix ans, Augustineo était devenu mineur. Puis, pendant les deux années qu’il avait passées aux fonderies de Scopello, un peu plus bas dans la vallée de la Sesia, il avait été brouetteur, puis faiseur de feu, faiseur de lit sur les fourneaux à manche, il avait vu le travail des fondeurs, des coupelleurs*, des affineurs de lingots d’argent.
Mais aujourd’hui, après douze années passées dans la vallée de la Sesia, son village lui manquait ; là-bas, il avait épousé Clara, une fille d’Alagna, morte en couches avec leur premier, leur seul enfant. Il avait juste eu le temps de lui donner un nom, Giacomo, le prénom de son père, juste le temps, à la demande de la famille de Clara, de présenter le corps du petit dans la chapelle San Marco, une chapelle de répit où le prêtre avait fait croire que le petit Giacomo était encore vivant le temps de le baptiser afin d’assurer à cette pauvre petite âme le chemin vers l’éternité des anges en lui évitant le séjour des limbes. Il avait couché Clara et l’enfant dans le petit cimetière d’Alagna, en pleine terre, les corps enveloppés d’un drap blanc cousu, laissant à sa famille l’entretien de la tombe, la neuvaine et les messes anniversaires des trépassés. Le curé avait eu beau lui dire qu’un cimetière était un champ du Seigneur où l’Église semait pour l’éternité, cette épreuve avait laissé Augustineo au bord du chemin de la foi, suspectant désormais en tout homme d’Église une complicité de tromperie sur la vie, sur la vie de sa femme, sur la vie de son enfant. Dans sa douleur, il s’était juré de tourner la page, de quitter cette vallée de la Sesia qui avait pourtant accueilli les espoirs de ses vingt ans, d’oublier cet amour de Clara la brune, ses yeux serpentine et son sourire lumineux qui l’avaient cloué sur place dès leur première rencontre. D’oublier cette nuit d’orage où les éclats se succédaient sans cesse, où les grondements du tonnerre roulaient d’un versant à l’autre de la vallée, couvrant les cris de douleur de Clara, d’oublier aussi la marque de ses ongles qui s’enfonçaient de plus en plus profondément dans son bras à mesure qu’elle quittait la vie. Et avec elle, toutes les femmes, tous leurs regards et leurs sourires qu’il n’était pas loin de soupçonner sources de malheur et de souffrance. Augustineo était devenu un homme seul, un homme solitaire.
Il retrouva facilement la maison de ses parents au fond du village ; le hameau du Villaret n’avait pas beaucoup changé, sauf cette nouvelle odeur écœurante, douçâtre, qui lui rappelait la tannerie d’Alagna. Des chamoiseurs qui travaillaient les peaux de vaches et de chèvres s’étaient installés sur les bords du Dard, déversant dans le ruisseau qui serpentait entre les maisons du Villaret les eaux putrides de leurs bains de chaux et d’écorces de sapin pilées où surnageaient des résidus d’huile de poisson. Il savait que dans la maison, seule sa mère serait là pour l’accueillir. Son père, le vieux charpentier Merlo, était mort deux ans auparavant. Il avait appris la nouvelle par un voiturier du Val de Tignes de passage aux fonderies de Scopello. Après un seul cri tremblant d’émotion, la vieille Baptista accueillit son fils dans une attitude très digne, sans effusion, les épanchements viendraient plus tard, mais Augustineo sentait bien dans le léger tremblement de sa voix que le cœur de sa mère était en éruption. Douze ans qu’elle ne l’avait pas revu ; un homme maintenant, fort, posé, décidé, qui rentrait dans la maison avec toute son histoire, ses peines, ses joies, ses malheurs, les yeux pleins de ses morceaux de vie qu’il avait laissés derrière lui. Elle devina dans son regard la morsure de la solitude qui l’empêcha de lui demander tout de suite des nouvelles de Clara et du petit Giacomo.
Augustineo s’installa dans la maison de ses parents, réapprenant à vivre dans son village. Sa première visite fut pour « oncle » Bartholomée Merlo, un cousin de son père, qui l’accueillit avec beaucoup d’affection. Bartholomée était veuf. Il avait hérité de plusieurs belles pièces de terre, dispersées un peu partout dans la paroisse, aux Roches, à Champadret, à la Croix du Brun et ailleurs encore, qu’il avait acensées à plusieurs paysans. Dans les premières années de leur mariage, Bartholomée et sa jeune femme avaient pris l’habitude d’accueillir dans leur grande maison aux Moulins les gens de passage. Colporteurs, muletiers, marchands de bestiaux, parfois même recors* et sergents de justice y trouvaient un bol de soupe et un garde-paille dans le premier village qu’ils abordaient en arrivant dans cette haute vallée. Après la mort de sa femme, en couches avec leur quatrième enfant, Bartholomée avait aménagé dans la grande maison plusieurs petites pièces pour mieux recevoir ses hôtes, et l’habitude avait été prise, dans le village, de lui adresser tous les visiteurs qui y trouvaient ainsi le gîte et le couvert pour un jour ou deux.
La famille de Bartholomée jouissait d’une grande réputation ; depuis quelques années, il assumait avec trois autres paroissiens la charge de procureur aux œuvres pies pour la construction de l’église de Notre-Dame de Pitié au Plan des Chailles. Augustineo s’en souvenait, avant son départ on parlait beaucoup de ce grand projet : édifier un sanctuaire sur le site d’une source miraculeuse qui avait déjà guéri plusieurs malades, pour accueillir les pèlerins qui n’hésitaient pas à traverser les montagnes pour déposer leurs maux et leurs souffrances entre les mains de la mère douloureuse du Christ. La construction du chœur, de la nef et du dôme était maintenant terminée ; l’entreprise avait nécessité beaucoup d’argent et de dons de la part des communiers*. Aujourd’hui, les procureurs devaient organiser le chantier des peintres pour décorer l’intérieur du dôme et les murs. Lucqua Valentino, un maître peintre de la paroisse d’Orta, pays de Milan, s’était engagé dans son contrat à prix-fait* à donner au lanternon du dôme un color di aria, à peindre les têtes des chérubins, des feuillages, des fleurages, des frises et même des rabecs* sur les pilastres et les corniches. À eux seuls les décors du dôme étaient un vaste chantier : des cartouches représentant des anges portant les instruments de la Passion et des fleurs répartis en huit quartiers sur trois rangs concentriques. Le peintre s’était même proposé de représenter à la base du dôme les quatre évangélistes et les quatre pères de l’Église. Ce programme de décor tout en feuillage et fleurage convenait fort bien aux procureurs de Pesey, mais voilà, le peintre exigeait que les maçons laissent en place les ponts qu’ils avaient échafaudés pour bâtir le dôme, confectionner les corniches au sommet des pilastres et plâtrer le tout à une trentaine de pieds du sol. Et les maçons, sous la direction de leur maître Pietro Jacchetto, étaient pressés de retourner dans leur paroisse de Riva dans la vallée de la Sesia. Finalement, Bartholomée avait réussi à mettre tout le monde d’accord : les maçons laisseraient les échafaudages en place, les communiers leur paieraient le prix des ais et le peintre démonterait les ponts à la fin de son travail. Un vrai négociateur, ce Bartholomée…
Il avait fini d’élever seul ses trois enfants, tout en s’occupant de sa maison qui n’avait ni nom ni enseigne, mais qu’on avait fini par appeler dans le village « l’auberge à Bartholomée ». Depuis quelques années, il y recevait des pèlerins de plus en plus nombreux attirés par le renom du sanctuaire de Notre-Dame de Pitié. L’aîné de Bartholomée, Laurent, un garçon taciturne et maussade, était devenu meunier dans un moulin que la communauté lui avait affermé après l’avoir racheté à la Confrérie du Saint-Esprit.
Sa sœur, Melchiotte, avait exprimé très tôt le désir de devenir en religion. Son père avait dû vendre quelques journaux* de terre pour payer les frais du noviciat chez les bernardines de Conflans. Et quand elle prononça ses vœux, en 1729, Bartholomée, fier et heureux de donner une fille à l’Église, dut cependant vendre le reste de ses terrains pour constituer une dot qui vînt accroître les biens de la communauté des Filles de la Divine Providence et de Saint-Bernard. Melchiotte Merlo devint sœur Scholastique, religieuse de chœur, revêtit la longue robe blanche, le scapulaire noir, la guimpe et le voile noir du costume des cisterciennes et entra pour toujours dans le silence de la clôture.
Catherine, la dernière fille de Bartholomée, était destinée, selon l’usage, à veiller sur les derniers jours de son père. Encore une enfant quand Augustineo était parti, elle était devenue une belle jeune femme. Elle l’accueillit avec étonnement, une pointe de malice dans son regard et un sourire moqueur.
* Les mots suivis d’un astérisque sont définis dans le glossaire en fin d’ouvrage.
2. L’homme au shako en peau de chèvre
Durant les quelques semaines qui suivirent son retour, Augustineo reprit peu à peu contact avec le village, retrouvant les visages, plus ridés, les sourires, moins rieurs, les silhouettes, plus tassées, mais encore familières, qu’il situait sans hésitation, chacun dans sa filiation familiale, s’informant des décès, des mariages, des naissances, tout en les observant avec une certaine distance. Mais son absence de plusieurs années ne l’avait pas fait oublier pour autant.
— Tineo ! Tineo !
Beaucoup l’accueillaient par le surnom de sa jeunesse et de son adolescence. Il s’étonnait de retrouver intactes les amitiés et les aversions qu’il avait laissées douze ans plus tôt, alors que lui avait suivi une route bien différente, mesurant la force de l’adhérence de ses anciens amis et voisins à leur petit coin de vie.
Il alla sur la tombe de son père dans le cimetière entourant l’église ; une simple croix en bois, Giacomo Merlo, 1652-1732 et quelques fleurs séchées. Il poussa même la porte, un peu par défi, comme pour s’assurer que, désormais, il ne se laisserait plus abuser par les décors, les statues grandeur nature et les ors qui recouvraient l’extraordinaire retable qu’un sculpteur de la vallée de la Sesia avait érigé dans l’église paroissiale, une trentaine d’années auparavant. Pendant plusieurs jours, dans cet automne lumineux, il parcourut la vallée en tous sens, mû par un besoin de retrouver les trajets d’autrefois, les sentiers, les sources, les alpages, la forêt, tous les lieux, les images, les odeurs de son enfance et de sa jeunesse. Curieusement, c’est avec plaisir qu’il retrouvait l’ambiance des montagnettes, des écuries*, des fermes, des granges, lui qui avait quitté sans regret ce monde paysan. Il avait ressenti le besoin, dans sa solitude construite sur plusieurs années d’absence, de retrouver des certitudes oubliées ; celle des heures du coucher du soleil, celle des dangers qui menaçaient les montagnettes en hiver, celle des senteurs poivrées des herbes d’alpage, celle des colères du Grand Nant* qui roulait ses eaux bruyantes au creux de la vallée…
Ce jour-là, fête de Saint-Jean-Baptiste, en arrivant au Pichu, une pente herbeuse au-dessus du hameau des Lanches, il se souvint de cet été chaud et humide, vingt ans auparavant, où une activité inhabituelle avait envahi pendant quelques semaines le haut du Pichu, à la lisière de la forêt. Il gardait les deux vaches de son grand-père sur une parcelle parsemée de petits rochers blancs par la dernière avalanche du printemps. Il avait alors une douzaine d’années, son père était parti cet été-là sur un chantier dans le duché voisin d’Aoste, et il se sentait déjà envahi par l’ennui de cette vie paysanne. Tout en ramassant les pierres et en les réunissant en murgers* le long des limites de la parcelle, il avait entendu de l’autre côté du bois de mélèzes des Chabottes, des voix, des bruits de ferraille, parfois même quelques explosions sourdes. En s’approchant, il avait vu une troupe d’une vingtaine d’hommes qui creusaient une tranchée peu profonde ; il avait reconnu plusieurs hommes de Pesey : Pierre Silvin-Cadere, Maurice à feu Justin Garçon, Claudio Roux, Claude Trésal et encore les deux frères Rey, Jacques et Jean-Baptiste ; il y avait aussi d’autres hommes qu’il ne connaissait pas. Ils creusaient le sol près de la grange des Adornet bâtie à la limite des communaux, sortant des barelles de cailloux qu’ils chargeaient sur des mulets. Tous travaillaient, semblait-il, sous les ordres d’un homme grand, noir de poil, habillé d’une veste en cuir et chaussé de grandes bottes. Il était coiffé d’une sorte de shako en peau de chèvre qu’il portait penché sur le côté pour tenter de masquer son œil gauche fermé, orbite vide, paupière cousue. Même de loin, il apparut alors à Augustineo brutal et rude, aboyant ses ordres, un homme habitué à commander d’une voix forte et d’une main ferme.
Le soir, à la tablée de son grand-père, on ne parlait que de ça ; « ils » auraient trouvé en haut du Pichu une minière de plomb portant quelques onces d’argent. Seuls les jeunes avaient été attirés par cette nouvelle, les anciens, paysans, n’avaient vu aucun intérêt dans ces cailloux qui mélangeaient, disait-on, du plomb et de l’argent. Mais comment les séparer ? Et pour faire quoi ? Ces cailloux, ils avaient eu beau les chauffer dans des marmites de gueuse chez Nicolas Baudin à la Chenery, un hameau proche, c’était resté des cailloux, et des cailloux on en a déjà assez comme ça ici, si ça se vendait, on serait riche depuis longtemps !
Puis, après quelques semaines de curiosité, l’intérêt était retombé, on avait arrêté les travaux à la Saint-Michel Archange, l’homme au shako était reparti, pour Turin disait-on, les mousses et les jeunes mélèzes avaient repoussé sur la modeste tranchée comblée peu à peu par l’éboulement de ses propres parois. Les vaches des Adornet avaient repris possession de leur parcours habituel, et on n’avait plus entendu parler de cette soi-disant minière pendant vingt ans.
Seulement, aujourd’hui, Augustineo savait. Il savait qui était l’homme au shako en peau de chèvre. Dès son arrivée à Alagna, il avait reconnu dans le directeur de la minière de cuivre l’homme autoritaire qui avait dirigé les travaux de prospection à Pesey : Giacomo Lorenzo Deriva. Il avait travaillé sous ses ordres pendant près de dix ans, mais lui, simple mineur dans un effectif de plusieurs dizaines d’ouvriers, n’avait jamais osé évoquer cette recherche menée autrefois à Pesey, d’autant que Deriva avait été alors envoyé officiellement par le bureau des Finances royales de Turin pour faire cette prospection. Son rang officiel, ajouté à son attitude autoritaire avec les hommes, en avait dissuadé plus d’un pour établir le contact…
Une minière à Pesey ? De plomb et d’argent… En tout cas des indices, suffisants pour que les autorités de l’époque déclenchent une recherche, mais pas assez abondants ou de trop mauvaise qualité pour engager une exploitation. Le soir, chez sa mère au Villaret, il se promit d’aller voir sur place ce qu’il restait de ces travaux vingt ans après.
Simplement pour voir…
3. Pesey, octobre 1734
Claudio Roux profitait du soleil qui éclairait encore les toits du village des Moulins. Dans quelques jours, il resterait caché derrière la montagne pour plusieurs semaines, plongeant le village dans un froid bleuté. Les toits se couvriraient d’abord d’une fine gelée qui resterait blanche jusqu’à la nuit, puis, jour après jour, d’une épaisse couche de neige. Les écuries deviendraient accueillantes, chaudes, où les hommes se rassembleraient volontiers quelques moments dans la journée. Pour l’heure, il était encore temps de regotoyer* le toit de sa maison, de replacer les écoupeaux* en les inversant, de changer ceux que l’humidité chaude de l’été avait corrompus. Il taillait chaque pièce à la hache, puis montait les installer une à une sur le toit. De loin, il vit arriver Augustineo qui s’engageait au sommet de la ruelle. Il savait qu’il était revenu après plusieurs années d’absence, mais les deux hommes ne s’étaient pas encore revus. Bien qu’ils aient le même âge, ils n’avaient pas grandi ensemble, chacun ne s’éloignant guère des parcelles de terre familiales, lui autour des Moulins, Augustineo autour du Villaret. Ils s’étaient croisés parfois à la fête de Saint-Loup ou à la Sainte-Catherine, patronne de la paroisse.
— Oh ! Tineo ! J’ai su que tu étais rentré. Ça faisait un temps…
— Oui, douze ans…
— Je me souviens que tu ne voulais pas rester.
— Oui, j’ai fait mineur à Alagna, puis sur les fours à Scopello, dans la vallée de la Sesia. Ouvrier, quoi ! Mais, dis-moi, toi aussi, tu as été un peu mineur à Pesey, il y a vingt ans.
Devant l’air interrogateur de Claudio, Augustineo reprit :
— Oui, en haut du Pichu, tu te souviens, avec Pierre Silvin, Maurice de Justin Garçon, les frères Rey…
— Oh ! ça n’a pas duré longtemps, on a gratté, mais ça n’a rien donné.
— Tu pourrais me montrer l’endroit où vous avez creusé, tu t’en souviendrais ?
— Pour ça, oui ! Pourquoi ? Tu veux prospecter ?
— Je sais pas encore. Faut voir. Alors, on peut y aller ? Demain ?
— D’accord, un peu avant midi, on se retrouve au pont romano…
Le lendemain, ils firent route ensemble en rive gauche du Grand Nant jusqu’à la passerelle qui enjambait le ruisseau de l’Arc. De là, ils montèrent à travers champs en suivant la rive du torrent qui dévalait la montagne depuis l’alpage de l’Arc. Le froid matinal avait déposé sur ce versant nord une pellicule de givre qui soulignait d’un liseré blanc chaque arbuste, chaque touffe d’herbe crissant sous leurs pas. On entendait une bande de grandes corneilles noires se chamailler dans les bois restés dans l’ombre.
— C’est là, dit Claudio en s’arrêtant au bout d’une vingtaine de minutes de marche.
Avec son pied, il brisait la fine couche de givre, dévoilant un tapis ocre d’aiguilles de mélèzes tombées sous le vent d’automne. Augustineo eut du mal à repérer la trace d’une tranchée ; seule l’ombre portée par le relief blanchi laissait deviner dans le jeune mélézin un vague sillon qui longeait le torrent en direction de la montagne, vers le sud.
— On a gratté sur trois pieds de profondeur, pas plus, sur une cinquantaine de toises*. Regarde, on peut en trouver encore, dit-il en ramassant quelques blocs.
Augustineo comprit tout de suite pourquoi Deriva avait abandonné les recherches : dans les blocs que lui montrait Claudio, les traces de mine* étaient vraiment très faibles, enchâssées dans la gangue. Il avait vu, à la fonderie de Scopello, les bocambres* broyer les blocs pour les réduire en sable : la mine était beaucoup plus apparente. Mais là, ce que lui montrait Claudio, c’étaient des cailloux dans lesquels ne brillaient que d’infimes traces argentées dans de maigres filets gris. Des masses de matières à bocarder* pour jeter beaucoup de stérile et garder bien peu de mine ! Une minière bien pauvre, trop peut-être pour justifier une exploitation…
Mais il y avait autre chose qui paraissait bizarre à Augustineo quand ils longèrent les restes de ces anciens travaux : la tranchée suivait le cours d’eau, comme si ruisseau et filon obéissaient à la même histoire. Son expérience de mineur à Alagna lui avait appris que la surface et le sous-sol n’étaient pas toujours liés, les vieux mineurs ne se fiaient pas à l’une pour trouver l’autre.
— Pourquoi les travaux se sont-ils arrêtés là ? demanda-t-il à Claudio.
— On ne trouvait plus rien, et le signore Deriva a décidé de tout arrêter, il disait qu’on perdait notre temps…
Augustineo regarda autour de lui ; la pente du terrain venait buter au pied d’une paroi de roche jaune, friable comme celle du Barmaÿ au-dessus de Beaupraz, une paroi qui marquait la limite des communaux. C’est là, pensa-t-il, qu’il fallait chercher ce filon, au contact de ces deux roches… Ça ne servait à rien de suivre le ruisseau… Une évidence qui soudain rendait possible ce vague projet qui lui trottait dans la tête depuis son retour à Pesey : prospecter à partir des indices de mine mis à jour, vingt ans auparavant, en 1714, en mettant à profit toute son expérience de mineur. Ne plus se fier au relief du terrain. Oublier la pente, le versant, le ruisseau, les arbres. Penser sous-sol et fouir comme la taupe aveugle qui s’oriente avec son museau sensible… Prospecter à partir d’une galerie d’où il pourrait comprendre les roches, leur direction, leur inclinaison. Repérer celles qui enserrent le filon minéral*. Renifler la mine comme les vieux mineurs le faisaient pour le cuivre d’Alagna. Avec un peu de chance, il pourrait devenir, lui, Augustineo, fils de feu Giacomo Merlo, habitant le Villaret, paroisse de Pesey, il pourrait devenir le vrai découvreur d’une minière de plomb et d’argent et jouir de tous les avantages que les Royales Constitutions réservaient aux sujets de Sa Majesté en pareil cas : une récompense proportionnée aux soins et aux peines qu’il se serait données et aux frais qu’il aurait faits pour découvrir la minière, et surtout un pourcentage sur les profits qu’on en tirerait annuellement.
Le soleil était déjà passé derrière la crête quand les deux hommes redescendirent vers le village des Moulins, inondant de lumière les alpages de l’adret et laissant le froid couler sur l’envers resté dans l’ombre. Un vent froid descendant des sommets entraînait les filets bleutés des quelques cheminées allumées dans le village de Nancruet. Ils se séparèrent, chacun gardant une image différente de cette petite virade. Pour l’un, on avait remué des souvenirs vieux de vingt ans, qui n’avaient mené à rien, il oublierait vite, retournant aux tâches les plus urgentes : les réparations du toit, le ménage du soir des deux vaches, finir de remplir le coffre à grains avec l’orge de l’automne et le seigle tardif… Pour l’autre, une promesse, un projet qui se formulait plus clairement, mais aussi qui soulevait beaucoup d’obstacles, de questions, d’incertitudes…
4. Pesey, novembre 1734
La maison de maître Costerg était située en dessous du Grand Chemin qui conduisait au village de Pesey d’amont. Elle ne comprenait pas moins d’une cuisine, une grande pièce faisant poële*, une cave, trois chambres et un galetas. Notaire royal et collégié, maître Costerg recevait dans la grande pièce, aidé de son fils qui, installé devant une fenêtre haute ouvrant sur la lumière du couchant, recopiait fidèlement tous les actes passés par son père : « contrats établis à tout ce qu’il appartiendra en présence des témoins à ce requis et bas nommés », ventes de terrains conclues « n’étant contraint, séduit ni suborné de personne », prêts que l’on promettait de rembourser « sur tous ses biens présents et advenir à peine de tous despens, dommages et intérests », « testaments nuncupatifs, inter liberos, olographes ou en faveur de la cause pie », successions « viri et uxoris », héritages « ab intestat », legs « tanquam corpus loco circumscriptum », inventaires, partages, transactions diverses que les parties font « touchant les Saintes Écritures et après avoir déclaré pour la seule vérité en cette part comme si elles étaient par devant leur juge compétent »… Le secrétaire-fils recopiait tous ces actes sur des papiers timbrés à l’effigie de l’Aigle de Savoie couronnée et entourée du collier de l’Annonciade, tarifés à quelques sols* ou à quelques deniers, pour les insinuer, selon les dispositions de Sa Majesté sarde, dans le tabellion* du bourg de Saint-Maurice. Des actes rédigés dans une langue alambiquée, d’apparence savante, parsemée de mots latins, que le notaire était obligé de traduire en mots simples à ses interlocuteurs pour s’en faire comprendre, mais qu’il s’empressait de compliquer dès lors qu’il les écrivait… Les compatriotes d’Augustineo, très portés sur les actes notariés, faisaient le bonheur et la bourse des notaires de villages…
Néanmoins, malgré sa répulsion devant ce galimatias, c’est auprès du notaire qu’Augustineo avait décidé de se renseigner sur les démarches qu’il aurait à faire. Qui était mieux placé en effet que maître Costerg – qui plus est domicilié à Pesey – pour connaître les lois, décrets, arrêtés, édits ? Pour savoir les droits de la couronne sur le sous-sol et les minières et les privilèges réservés à son vassal le seigneur marquis Chabod sur les terres du mandement de Saint-Maurice ? Le notaire Costerg lui dirait aussi à quelle instance il aurait affaire, de l’intendant de Tarentaise à Moustier, du Sénat de Savoie à Chambéry ou de la Cour des comptes de Turin… Augustineo savait que le roi de Piémont Sardaigne avait réglementé, par ses Royales Constitutions, la prospection et l’exploitation des minières dans son royaume. Bien sûr, avec les garçons de sa génération, il avait appris à lire et à écrire à l’école de Pesey qui fonctionnait l’hiver sous la houlette du régent, le révérend Trésal ; cela lui avait permis de signer son nom sur le registre des salaires quand d’autres n’y apposaient qu’une croix. Mais de là à lire les Royales Constitutions et les manifestes de Sa Majesté…
En tant qu’ouvrier mineur, il ne s’était jamais intéressé à ces questions. Propriétaire ? Exploitant ? Droit de seigneuriage ? Comment fait-on pour déclarer la découverte d’une minière ? Quels seraient ses droits, ses obligations ? Devrait-il payer des taxes ? Et à qui ? Et voilà qu’aujourd’hui il était obligé de se les poser. Et puis, ce n’était pas avec les petites économies qu’il avait rapportées du Piémont qu’il pourrait payer tous les frais : les mulets, les outils et ustensiles, les armements et bois d’étançonnage, les ferrements, la poudre et peut-être même les journées de deux ou trois compagnons pour commencer. Fallait-il s’associer avec d’autres pour réunir les premières sommes ? Avec qui ? Toutes ces questions lui laissaient entrevoir un monde qui lui donnait un peu le vertige, un monde abstrait, mais qu’il pressentait bien réel et qu’il lui fallait affronter. Et surtout un monde très éloigné du village…
Le « secrétaire-fils » du notaire vint lui ouvrir la porte et le fit entrer dans la grande pièce dont le mur du fond, sombre, était meublé de quatre armoires hautes en bois de noyer remplies de livres, extraits, grosses, rouleaux, règles, écritoires et semblables choses qui servent à rendre officiels et authentiques les actes passés par le notaire. Le long des murs étaient disposés des coffres garnis de recueils et de parchemins. Au plafond, de gros crochets de fer retenaient des sacs en toile de jute d’où dépassaient pour certains quelques feuillets. Le feu soutenu qui brûlait dans la cheminée peinait contre le froid ambiant. Maître Costerg était assis face à une grande table en noyer, vêtu d’une houppelande en drap de laine dont le col et les manches étaient bordés des restes d’une ancienne fourrure. Une lampe à huile qui charbonnait de temps à autre jetait des lueurs mouvantes sur une statuette de saint Yves revêtu de son lourd manteau ourlé d’hermine, veillant sur ce membre de la confrérie des notaires et magistrats. Maître Costerg prit le temps de finir ses écritures avant de lever les yeux sur Augustineo. Celui-ci se découvrit, plus par respect du lieu qui conférait aux écrits la légitimité des actes officiels que pour l’homme qui les rédigeait.
— Qui êtes-vous ? demanda maître Costerg.
— Hugues Augustineo fils de feu Giacomo Merlo, habitant du Villaret dans cette paroisse.
Et il ajouta, pensant que ce pouvait constituer une recommandation utile :
— Je suis parent avec honorable Bartholomée Merlo.
— Bien. Que puis-je pour vous ?
Augustineo raconta brièvement ses douze années d’ouvrier mineur en Piémont, son retour à Pesey, son souvenir des travaux de recherche menés il y avait vingt ans au Pichu, son projet de prospecter un peu plus haut…
Le notaire l’écouta sans l’interrompre. Chaque interrogation d’Augustineo l’éloignait un peu plus de son ordinaire limité aux affaires entre propriétaires, paysans, artisans, boutiquiers : des ventes de parcelles, des héritages, des prêts entre particuliers. Il n’avait jamais traité d’affaire concernant les minières, le sous-sol. Là, il était question des pouvoirs du prince et des privilèges du seigneur, de taxes et de droit de seigneuriage. Ces questions requéraient des réponses à un sujet de Sa Majesté, habitant sur les terres du seigneur marquis Chabod de Saint-Maurice et non pas simplement à un manant de la paroisse de Pesey. Mais un petit signal avait déjà retenti dans le cerveau de maître Costerg. Ce garçon semble décidé à prospecter une minière, pensa-t-il. Et pourquoi pas ? Il aura besoin de renseignements, d’argent, de recommandations…
— Mon ami, à ce que je vois, votre projet semble fort intéressant et il sort de l’ordinaire. Je dois cependant vous mettre en garde. Vous connaissez l’adage : en creusant le sein de la terre, on creuse souvent le tombeau de la fortune ! Toutefois, il me semble que c’est d’abord une affaire administrative et je crains de ne pas vous être fort utile. Vous devriez demander à monsieur l’intendant de Tarentaise, à Moustier, l’autorisation de prospecter les minières dans la province, il vous donnera la marche à suivre pour déclarer la découverte de votre minière. Mais il y a autre chose. Vous m’avez dit que cette minière pourrait se situer sur des terrains communaux…
— Oui, c’est ce que je crois, au-dessus des parcelles du Pichu…
— Il faudrait en être sûr. Car, voyez-vous, si vous excavez sur la parcelle d’un particulier, il vous faudra son accord, et si votre minière est ouverte sur les terrains communaux, ce sera au syndic et aux conseillers de Pesey d’en décider avec l’accord du châtelain du seigneur de Saint-Maurice.
— Les frères Adornet, ils connaîtront bien les limites de leurs parcelles.
— Pourquoi n’allez-vous pas demander au syndic de Pesey ? Il vous aiderait à situer votre minière sur la mappe qui vient juste d’être achevée.
La mappe ? Ah ! Oui, ce nouveau cadastre. En parcourant les sentiers de la commune, quelques jours auparavant, il avait rencontré du côté du mas des Mérieux un petit groupe de personnes en pleine discussion. Il y avait là Jean-Baptiste Richerme, ses deux fils et François Garçon ; ils étaient accompagnés par deux hommes qui portaient, suspendue à leur cou, une tablette en bois sur laquelle ils dessinaient et écrivaient. Jean-Baptiste expliqua à Augustineo qu’ils délimitaient leurs biens pour lever un nouveau cadastre. Les propriétaires mitoyens avaient été priés de venir sur place pour fixer d’un commun accord les confins de leurs parcelles respectives, aidés par un mesureur armé d’une grande chaîne en laiton, qui notait les distances en trabucs*, une mesure de longueur en usage dans le Piémont. Le trabucant était accompagné d’un estimateur qui appréciait la nature du produit des parcelles et leur degré de bonté.
— Vous faites ça sur toutes les parcelles de la commune ?
— Sur toutes, sans exception, lui répondit le trabucant. Et on les dessine sur un plan.
C’était donc ça, cette mappe : un cadastre pour lever un nouvel impôt, pensa Augustineo.
— Non pas un nouvel impôt, Tineo, lui dit le syndic tout en déroulant devant lui un grand rouleau d’un papier solide collé sur une forte toile de lin. Un impôt plus juste que la taille, pour que chacun paie selon ce que produit son terrain.
Ils s’étaient donné rendez-vous dans la maison commune, un beau bâtiment dont la porte encadrée de pierres de tuf taillées accueillait le visiteur montant vers le village de Pesey d’amont.
Augustineo découvrit le plan avec étonnement. Malgré les explications du syndic, il ne comprenait pas comment on pouvait dessiner à plat le relief accidenté qu’il connaissait bien : les sommets englacés, les pierriers et rochers, les alpages perchés en altitude, l’adret qui descendait en pentes fortes jusqu’au Grand Nant, les ravines du Nant Feissons et du Poncet, le village des Moulins niché au pied de la forêt de Grand Bois, le Villaret posé en balcon face à la Corbassière. Un pays où les replats étaient rares et dont les trajets se mesuraient en temps de marche et non pas en trabucs…
— Tu vois, pour qu’on s’y retrouve, ils ont dessiné les torrents en bleu, les places de culture en marron avec des rayures comme si elles étaient labourées et piochées, les prés à faucher et les pâtures en vert, et même pour les forêts, ils ont dessiné des petits sapins avec leur ombre. En gris et noir, les rochers et les pierrailles…
— Et ces petites taches rouges ? demanda Augustineo.
— Les bâtiments, les maisons, les granges, les chapelles…
Augustineo avait du mal à mettre derrière ces dessins les paysages qu’il connaissait. Pas facile de se repérer. Il demanda au syndic de lui montrer où était représenté le Pichu.
— Voilà. Le Grand Nant est là, il coule dans ce sens. Et le nant de l’Arc, c’est celui-là. Et le chemin qui vient du pont romano est là.
Cette fois, ayant repéré le sens de la pente, il put suivre du doigt sur le papier le chemin qu’ils avaient emprunté, Claudio et lui, la semaine précédente : la traversée du nant de l’Arc, la montée le long du ruisseau, les anciens travaux. Il était facile de voir que les parcelles venaient buter contre la pente et que la galerie qu’il voulait creuser se situerait au-dessus, là où, sur le plan, la mosaïque des parcelles laissait la place à un espace qui semblait vide, non occupé, où seules quelques ombres vertes et noires figuraient les rochers, où quelques silhouettes d’arbres ombrées suggéraient la forêt.
— Là, on est sur les terrains communaux, lui dit le syndic. Les communiers t’autoriseront à y travailler.
5. Pesey, juillet 1735
Ce jour-là, dans la maison du Villaret, Augustineo partageait une soupe de fèves avec la vieille Baptista. Il regarda sa mère avec attention. Elle lui sembla plus lasse qu’à l’accoutumée, ses gestes étaient incertains, son pas plus court, en remontant de l’écurie où elle avait été traire les deux chèvres, elle avait dû s’arrêter sur une marche au milieu de l’escalier en pierre pour reprendre son souffle.
— Tu devrais te reposer, M’ma, lui dit Augustineo, tu as gardé les chèvres, le mulet, les deux jardins où tu remontes la terre avant de la piocher, le pré à faner ! Tu devrais t’arrêter.
Baptista posa son assiette et répondit dans un souffle :
— Tu sais, si je m’arrête de travailler, je pense.
Un souffle qui explosa dans la tête d’Augustineo. Fallait-il vraiment payer ce prix pour vivre de la terre ? Travailler durant des journées interminables, courir sans cesse de la maison à l’alpage, redescendre pour les foins, remonter pour la traite ? Surtout ne pas s’arrêter, sous peine de penser !
Le temps était à l’orage et le tonnerre roulait déjà du côté de l’alpage de la Plagne où le ciel s’était rapidement encombré de nuages lourds, d’un gris de plomb. Bientôt ce fut un rideau de pluie qui couvrit toute la paroi des Dames du Midi. Quelques gouttes de pluie, larges et chaudes, commençaient à tomber au Villaret quand ils entendirent le son rauque et répété de la Sarrasine, la vieille cloche qui, depuis le haut clocher de l’église, sonnait les heures sombres, annonçait les dangers et convoquait tous les hommes valides. Incendie ? Attaque de brigands ? Invasion ? Éboulement ? Cette fois, ce devait être pour annoncer l’orage que le vieux Jean Maurice Trésal sonnait la Sarrasine. Augustineo se précipita sur le chemin qui conduisait à l’église, bientôt rejoint par une dizaine d’hommes du Villaret. Le syndic et quelques conseillers, déjà sur la place au pied de l’église et entourés par plusieurs habitants de Pesey, donnaient les premières informations et les premières consignes : le Grand Nant, le nant Tumelet, le nant Feissons avaient débordé, la Gurraz-en-Montagne avait été, disait-on, recouverte par un torrent de boue et de rochers, le pont de Beaupraz avait été emporté, le plus urgent était de protéger le village des Moulins. Chacun y allait de ses peurs et de ses craintes, le souvenir, vécu ou raconté, du débordement du nant Poncet, cinquante ans auparavant, était encore présent dans les esprits. La pluie et le tonnerre avaient été alors si terribles que tous se croyaient perdus, il était tombé près de six pouces de grêle, des grains gros comme des noisettes, tous les habitants de Nancruet avaient dû débagager et une bonne partie des maisons avaient été englouties par une énorme coulée de rochers et de boue. Aujourd’hui encore, en piochant les champs on trouvait des pierres de cheminées au ras du sol. On avait même dû reconstruire la chapelle de la Chenery, Sainte-Marguerite, à l’abri du torrent. Pourtant, pensa Augustineo, cette sainte Marguerite, avec son aventure dans le ventre d’un monstre marin, était censée protéger les habitants des inondations ! Ça n’avait pas marché, mais il n’osait pas le dire publiquement.
Avec précipitation, les hommes se munirent de pics à bois, de haches et de scies, de pelles et de pioches, de cordes et de chaînes. Il fallait construire des barrages de troncs d’arbres et de pierres en rive gauche du Grand Nant pour protéger les biefs qui alimentaient les moulins de la confrérie du Saint-Esprit et le battoir à chanvre. En arrivant sur la berge du Grand Nant en furie, roulant des eaux grises et visqueuses, ils constatèrent que le pont avait été emporté. Pas une seule des énormes billes de mélèze, qui avaient été jetées deux ans auparavant entre les deux rives, n’avait résisté. Quelques hommes du village étaient déjà remontés jusqu’au pont romano pour redescendre de l’autre côté de l’eau. Le vieux pont en pierre avec sa grande et haute arche avait tenu bon. Très vite on abattit plusieurs troncs et l’on construisit des barrages qui forcèrent le courant à rejoindre le lit du Grand Nant. La nuit tombante rendait le spectacle encore plus sinistre, et dans le crépuscule on entendait sans les voir les rochers roulés par le courant, qui se heurtaient les uns contre les autres et parfois ébranlaient le sol sous les pieds des villageois qui s’étaient prudemment retirés sur les berges hautes.
Le lendemain matin, le ciel était limpide. Le froid avait semé une fine couche de neige sur les sommets, mais la forêt restait encore très verte. Seuls les alpages commençaient à prendre une teinte dorée, annonçant les premières gelées en altitude. L’orage de la veille semblait avoir tout lavé et redonné ses couleurs vives au paysage. Avant même le lever du soleil, on était nombreux aux Lanches, à Pré Envers, aux Bettières, à Pierre Blanche pour constater les dégâts. Des chemins obstrués par les monceaux de rochers et de laves boueuses qui commençaient à sécher, tout au long du lit du Grand Nant, des dizaines de parcelles de prairies recouvertes de graviers et de boues craquelées, des troncs d’arbres jonchaient les prés, le lit du Grand Nant lui-même avait été déplacé, dévoyé par ses propres déjections. L’accès au hameau de la Gurraz était rendu difficile par une haute coulée de boue et de rochers. On était inquiet pour le vieux Pantaléon Anxionnaz, un homme notoirement pauvre pour ne pas avoir une vache, qui ne quittait sa maison de la Gurraz que pour vivre à Pesey les mois les plus froids de l’hiver. Plusieurs hommes avaient atteint le hameau et s’activaient pour déblayer les maisons. Aux Bettières, à Vigerand, l’eau avait envahi plusieurs chalets, noyant les bêtes dans les écuries.
Durant les jours qui suivirent, la commune connut une agitation inhabituelle. Le vieil Anxionnaz fut extrait des décombres de son chalet et rapatrié dans sa maison de Pesey d’aval. Blessé à une jambe, il en garderait pour toujours une forte claudication. Très vite, le syndic et les conseillers contraignirent tous les habitants à concourir avec leurs bêtes de charge aux réparations des ponts de Beaupraz et des Moulins et des chemins ruinés par les débordements. Le châtelain du seigneur de Saint-Maurice autorisa à prélever les bois nécessaires dans la forêt sous la surveillance du garde-bois. Instruit par cet événement néfaste, on dut surélever les culées des ponts pour échapper aux prochaines furies du Grand Nant. Les chemins furent tracés dans ces nouveaux reliefs. Tout fut remis dans l’ordre avant les grands froids.
Dans la semaine, plusieurs comparsonniers propriétaires vinrent à la maison commune pour réclamer une révision de la valeur de leurs parcelles retenue par l’estimateur du nouveau cadastre. Les quelques chalets détruits n’étaient pas une grande perte, d’autant que les maisons n’étaient pas soumises à l’impôt ; au printemps prochain, moyennant quelques journées de travail collectif, elles seraient reconstruites et accueilleraient à nouveau la tramée* des hommes et des bêtes dans les montagnettes. Mais la destruction des parcelles était autrement plus grave. Monsieur l’intendant de Tarentaise dépêcha le sieur Secundo Antonine Rascha, le géomètre en charge de la mappe de Pesey, qui, flanqué du trabucant et de l’estimateur, parcourut en deux journées toutes les terres ruinées pour affecter une nouvelle valeur au produit des parcelles. Au total, ce furent plus de cinquante journaux qui n’étaient plus d’aucun produit. Puis on entra dans le détail, communier par communier. C’était le montant de l’impôt futur qui était en jeu, les discussions furent âpres. Pour l’un, c’étaient ses prés à faucher aux Lanches, sur la rive gauche :
— Vous avez classé mes parcelles en foin de bœuf à quinze sols le quintal*, aujourd’hui, elles ne valent même plus pour produire de la blache* !
On les lui reclasse en foin de marais à douze sols.
Pour l’autre, l’estimateur avait classé ses places de culture en dessous des Moulins dans la catégorie « bled seigle » à seize sols le bichet :
— Elles ont été toutes engravelées, je ne pourrai rien y cultiver !
On les porte au registre en landes et broussailles, il pourra en tirer au mieux deux deniers par fascine.
Augustineo se renseigna discrètement auprès du trabucant : non, le haut du Pichu n’avait pas été touché, le nant de l’Arc avait bien grossi, mais il n’avait causé aucun dégât.
En revenant au Villaret, Augustineo perçut tout de suite que ce jour ne serait pas comme les autres. Par la porte de l’écurie restée ouverte, il entendit bêler les chèvres, des voisines étaient attroupées devant l’entrée de la maison, la mine grave.
— On l’a trouvée dans l’écurie, près des bêtes, elle n’a pas eu le temps de finir la traite… On l’a portée jusque dans la chambre.
Sa mère était allongée sur le lit, déjà dans une posture de gisante. Augustineo s’effraya de ne pas ressentir de chagrin comme cela aurait dû être le cas en pareille circonstance, le plus urgent étant de faire taire ces chèvres qui bêlaient en bas comme des pleureuses. Et puis il fallait prévenir Bartholomée, il s’occuperait du curé, des funérailles. En fin d’après-midi, le glas commença sa longue plainte du pardon lancée depuis le clocher de l’église, relayant la petite cloche de la chapelle Saint-Pierre qui avait averti plus tôt voisins et amis habitants du Villaret.
Le lendemain, le pas lourd et lent du cortège funèbre montant vers l’église ne s’interrompit que le temps d’une halte sur la pierre des morts. La funèbre procession ne cessait de lui rappeler cet autre rythme qui avait accompagné à Alagna les funérailles de Clara et de leur petit Giacomo. Entouré de Bartholomée et de Catherine, Augustineo revoyait sa propre enfance, les moments de tendresse avec sa mère, qui restaient enfouis dans son plus jeune âge, dans les premiers apprentissages de sa vie, il en gardait des impressions de douceur et de chaleur, et c’est là que se nichait la douleur du décès de sa mère, c’est là qu’il devrait construire son deuil. En grandissant, son père l’avait initié à son métier de charpentier, lui avait appris les gestes et les outils, mais il travaillait sur des chantiers, chez les autres, il n’avait pas d’atelier. Sa mère, restée dans le sillage de ses propres parents, lui avait fait partager toutes les tâches paysannes au fil des mois et des saisons, mais Augustineo était resté sans enthousiasme, sans passion pour les champs, sans amour des bêtes, sans intérêt pour les récoltes. Il était sorti de l’enfance sans projet, sans futur, quand ses amis écrivaient déjà leur avenir. Pierre deviendrait maréchal-ferrant, Jean-Baptiste, Claudio et Ambroise continueraient à travailler les parcelles de leur père, Antoine les avait quittés pour le Petit puis le Grand Séminaire et deviendrait curé d’une paroisse alentour, Martin irait rejoindre son oncle François parti dans les Allemagne faire le commerce des draps. Mais lui, Augustineo, fils d’un artisan charpentier et d’une mère cultivatrice, n’avait pu se décider. Il comprenait maintenant que son départ pour le Piémont était moins dû à son rejet de la vie paysanne qu’à son incapacité à trancher alors parmi les choix qui s’offraient à lui. La vie avait décidé pour lui, il était devenu mineur. Le décès de sa mère était le dernier acte de son enfance. Aujourd’hui, c’était décidé, il ouvrirait une mine à Pesey.
Le lendemain de l’enterrement, à la tombée du soir, alors qu’il rentrait pour apprendre à vivre seul dans le silence de la maison devenue trop grande, Augustineo passa devant l’échoppe de Joseph Dupraz, le sabotier. Sa sœur, Jeanne Marie, était sur le seuil de la porte.
— Si tu as besoin, on peut t’aider, lui dit-elle dans un sourire affectueux.
Elle avait cherché son regard, clairement, pour lui dire qu’elle partageait sa peine.
Augustineo vendit les chèvres et les deux lopins de terre à potager. Désormais, quand il aurait épuisé les réserves de grains, de fromage, de pain d’orge et d’avoine cuit par sa mère pour l’année et de viande séchée, qui restaient dans la maison, il devrait acheter de quoi vivre. C’était peut-être ça, pensa-t-il, être paysan, c’est manger ce qu’on cultive, et être ouvrier, c’est acheter ce qu’on mange… Ce n’était pas un mode de subsistance nouveau pour lui. À la Sesia, c’était comme ça qu’il vivait : il touchait le salaire de son travail.
Il garda le mulet, la maison et les deux journaux de pâture et de prés à faucher.
6. Pesey, septembre 1735
Alors qu’Augustineo déambulait entre les étals du petit marché qui se tenait habituellement le dimanche au pied de la montée de l’église, sous de modestes halles soutenues par deux grosses colonnes maçonnées, le fils-secrétaire aborda Augustineo ; maître Costerg le priait de venir à son étude dès que possible.
— Mon ami, monsieur l’intendant a bien voulu me renvoyer, par le pedon* arrivé hier de Moustier, la supplique que nous lui avions adressée, accompagnée de sa réponse. Je vous la lis (Augustineo se demanda pourquoi le notaire lui donnait du « Mon ami »…). « Vu la requête cy-jointe, nous disons que le suppliant est autorisé à prospecter les minières dans la province de Tarentaise.
Disons également que le suppliant devra, en cas de découverte, en informer le présent bureau pour qu’il puisse en alléguer devant le magistrat dans les termes portés par les Royales Constitutions.
Moustier, le 16 septembre 1735
Signé pour l’intendant de Tarentaise empêché, Sylvestre, secrétaire. »
— Ça veut dire que je peux commencer à excaver ? demanda Augustineo.
— Oui, et il vous faut garder précieusement cette lettre, elle est la preuve que les fonctionnaires de Sa Majesté vous autorisent à prospecter et, en cas de découverte d’une minière, que vous en êtes l’auteur. Mais ce que monsieur l’intendant ne dit pas et qui va de soi, c’est que vous devez tenir informé le seigneur de Saint-Maurice de vos projets.
— L’accord du syndic et des conseillers de la commune ne suffit-il donc point pour travailler sur des communaux ?
— Voyez-vous, mon ami, la culture d’une minière donne lieu à un droit de seigneuriage à payer aux royales Finances ou au seigneur si celui-ci est investi du droit des minières. Allez donc voir le châtelain du seigneur Chabod, il vous renseignera.
Et comme pour signifier la fin de cet entretien, le notaire ajouta :
— Vous devez me payer huit sols pour le pedon.
Je n’en ai donc pas fini de ces formalités, pensa Augustineo en posant les huit sols sur la table du notaire.
Le châtelain du seigneur Chabod était installé dans le bourg de Saint-Maurice, dans une maison de la grand’rue montant vers l’église. Augustineo était descendu le matin à l’aube avec un voisin qui menait un mulet chargé de fromages. Il se faisait dans cette rue un grand commerce en miel, fromages, cuirs, pelleteries, mulets, poulains, génisses, chèvres et moutons. Le sieur Pillet, un chevalier de bonne maison, tenait son officine à l’étage ; la pièce était pleine de gens qui attendaient d’être reçus, venant des paroisses alentour, profitant de ce jour de marché pour régler leurs affaires avec le châtelain : différends entre voisins, vols de bétail, injures, coups. Le sieur Pillet ne pouvait pas juger ces affaires, mais il pouvait tenter de les régler en entendant les parties. Par contre, il avait la réputation d’être intraitable pour faire rentrer gabelle, taille, banalités et autres subsides extraordinaires dans l’escarcelle du seigneur Chabod, marquis de Saint-Maurice.
— Ah ! Non, vous ne pourrez pas vous entretenir avec Son Excellence. Il est à la cour de Turin, mais il m’a fait l’honneur de gérer les affaires de Sa Seigneurie sur place. Je vous écoute.
Augustineo comprit que sa recherche n’intéresserait pas beaucoup le marquis. Oui, il avait des tâches beaucoup plus importantes, il était lieutenant général de l’infanterie de Sa Majesté. Oui, il détenait le droit des minières, mais il ne croyait pas à l’avenir de cette industrie. Oui, vous pouvez gratter sur les terres de la communauté de Pesey, il n’est point nécessaire de vous le signifier par écrit.
Voilà un discours qui me laisse le champ libre, pensa Augustineo.
Il consacra les jours suivants à organiser son chantier. Il pourrait commencer en octobre et se donnait tout l’hiver pour prospecter. D’après ce qu’il avait vu des anciens travaux, le gîte prenait une orientation du levant vers le couchant, une galerie d’une quinzaine de toises de longueur orientée du nord vers le midi devrait être suffisante pour recouper le filon et le localiser. Il attaquerait à la jonction entre le socle dur et ce rocher jaune et friable, une zone fracturée où l’excavation ne devrait pas être trop difficile. S’il avait décidé de mener seul ces travaux, ce n’était pas seulement pour garder l’entière paternité de sa découverte éventuelle. Cette prospection dans la montagne, c’était aussi la recherche d’une nouvelle vie, un tête-à-tête avec lui-même, et il ne souhaitait pas que d’autres interfèrent dans cette intimité. Une galerie de quinze toises ne lui faisait pas peur, il lui faudrait deux ou trois masses, une pointerole, une bonne dizaine de fleurets*, un ou deux pics. Pas de poudre, trop chère, pas d’étançonnage, inutile pour une galerie étroite. Pour évacuer les débris, une hotte suffirait. Il avait repéré qu’en stockant les matières à la sortie de la galerie, il pourrait former un replat qui en faciliterait l’accès.
Son premier coup de pic résonna dans la froidure immobile de ce début novembre. Il s’arrêta pour écouter, effrayé par ce bruit qui lui parut obscène dans la quiétude matinale. Seuls quelques oiseaux s’envolèrent silencieusement. Augustineo avait l’impression de briser un univers antique, de bouleverser un équilibre de début du monde, de déranger le ciel et la terre. Coup après coup, il imposa sa présence bruyante aux arbres, aux rochers, au torrent tout proche, manière de leur signifier que désormais, chaque jour et pour longtemps, il serait là, qu’on entendrait ses coups de masse, ses ahanements d’effort, ses cris et ses jurons, mais qu’on se rassure, on s’habituerait, ce tintamarre étrange s’étoufferait au fur et à mesure de sa progression au cœur du rocher.
Augustineo travailla durant tous les mois de grand froid. Chaque jour, il rejoignait son chantier solitaire, traçant son chemin dans la neige fraîche. Dans la forêt, le froid était si intense qu’il formait une vapeur de petits cristaux en suspens qui enveloppait les arbres. Chaque matin, il découvrait de nouvelles traces d’animaux entre les troncs de mélèzes et d’épicéas, de nouvelles scènes des crimes perpétrés pendant la nuit parmi le petit peuple de la forêt : quelques bouquets de plumes, quelques touffes de poils. Il retrouvait avec plaisir le front de taille de la veille, mesurant la progression de sa galerie. Il se mettait alors à l’ouvrage avec une sorte de rage, non pas une colère, mais une obsession, une certitude de découvrir cette minière, plus même, un devoir de prouver à ses amis et voisins qu’on pouvait accéder aux trésors du sous-sol. Même si on disait au village que ces cailloux ne serviraient à rien, qu’on ne saurait jamais les travailler comme la pierre à bâtir, la chaux, le bois, le cuir des vaches et des chèvres, la laine des moutons que tout un chacun savait utiliser. Depuis qu’il était revenu du Piémont, il s’était senti en décalage par rapport à ses anciens amis ; ce n’était pas tant les années d’absence qui l’avaient éloigné d’eux, mais bien plutôt cette vie d’ouvrier des minières si différente de la leur. Au marché le dimanche, à la veillée ou même dans les ruelles quand il les croisait, ce n’étaient que des histoires de potagers brûlés par le gel, de poulaillers massacrés par le renard, de vaches échappées du troupeau ou de la levée de l’herbe en montagne. Augustineo ne savait que leur répondre, il se sentait inculte devant eux, ignorant de leur vie, de leur travail, de leurs plaisanteries qu’il ne comprenait pas. Bien sûr, on parlait parfois de sujets plus généraux : les réparations du pont de Bellentre pour lesquelles l’intendant demandait une participation aux communiers de Pesey, le dernier procès avec la communauté de Landry à propos des communaux indivis ou encore la récente nomination de l’archevêque de Tarentaise. Même là il se sentait incompétent, il n’avait plus rien à dire.
S’il ne trouvait pas ce filon, il devrait repartir et cette fois quitter définitivement le village.
Un petit compagnon prit l’habitude de venir chaque matin, une hermine dans sa livrée blanche de l’hiver, qui attendait son arrivée, assise à l’écart, toujours sur le même rocher, immobile. Elle guettait chaque sortie d’Augustineo courbé sous sa hotte de gravats et disparaissait en milieu de journée pour réapparaître le lendemain matin.





























