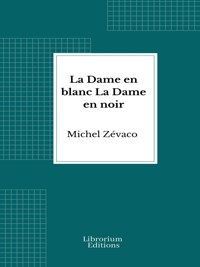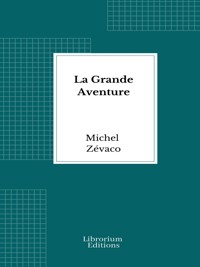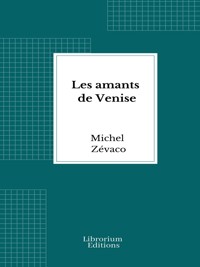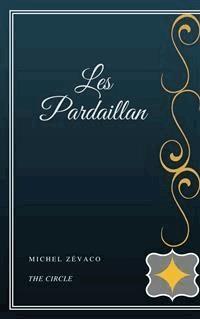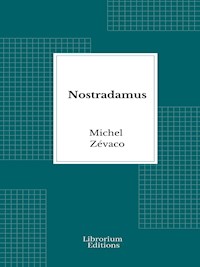3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
1590. À Rome, Fausta, après avoir mis au monde le fils de Pardaillan, bénéficie de la grâce du pape Sixte Quint, qui se prépare à intervenir auprès du roi d'Espagne Philippe II dans le conflit qui l'oppose à Henri IV roi de France. Fausta est investie d'une mission auprès de Philippe II : lui faire part d'un document secret par lequel le roi de France Henri III reconnaissait formellement Philippe II comme son successeur légitime sur le trône de France. En France, le chevalier de Pardaillan est investi par Henri IV, absorbé par le siège de Paris, d'une double mission : déjouer les manoeuvres de Fausta et obtenir de Philippe II la reconnaissance de la légitimité d'Henri de Navarre comme roi de France. Pardaillan et Fausta s'affrontent à Séville. Pardaillan est aidé dans sa lutte par Cervantès, qui reconnaît en lui le vrai Don Quichotte. Sortira-il vivant des traquenard tendus par le Grand Inquisiteur Don Espinoza et Fausta?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 634
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Les Pardaillan, tome 5 : Pardaillan et Fausta
Pages de titreLes Pardaillan VIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIXXXXXIXXIIXXIIIXXIVXXVXXVIPage de copyrightMichel Zévaco
Pardaillan et Fausta
Michel Zévaco
Les Pardaillan V
La série des Pardaillan comprend :
1. Les Pardaillan.
2. L’épopée d’amour.
3. La Fausta.
4. Fausta vaincue.
5. Pardaillan et Fausta.
6. Les amours du Chico.
7. Le fils de Pardaillan.
8. Le fils de Pardaillan(suite).
9. La fin de Pardaillan.
10. La fin de Fausta.
Pardaillan et Fausta
Édition de référence :
Robert Laffont, coll. Bouquins.
Édition intégrale.
I
La mort de Fausta
À l’aube du 21 février 1590, le glas funèbre tinta sur la Rome des papes – la Rome de Sixte Quint. En même temps, la rumeur sourde qui déferlait dans les rues encore obscures indiqua que des foules marchaient vers quelque rendez-vous mystérieux. Ce rendez-vous était sur la place del Popolo. Là se dressait un échafaud. Là, tout à l’heure, la hache qui luit aux mains du bourreau va se lever sur une tête. Cette tête roulera. Cette tête, le bourreau la saisira par les cheveux, la montrera au peuple de Rome, ainsi qu’il est dit dans la sentence... Et ce sera la tête d’une femme jeune et belle, dont le nom prestigieux, évocateur de la plus étrange aventure de ces siècles lointains, est murmuré avec une sorte d’admiration par le peuple qui s’assemble autour de l’échafaud :
– Fausta ! Fausta ! C’est Fausta qui va mourir !...
*
La princesse Fausta était enfermée au château Saint-Ange depuis dix mois qu’elle avait été faite prisonnière dans cette Rome même où elle avait attiré le chevalier de Pardaillan... le seul homme qu’elle eût aimé... celui à qui elle s’était donnée... celui qu’elle avait voulu tuer enfin, et que sans doute elle croyait mort. C’est ce que la formidable aventurière, qui avait rêvé de renouer avec la tradition de la papesse Jeanne, attendait, le jour où serait exécutée la sentence de mort prononcée contre elle. Chose terrible, il avait été sursis à l’exécution de la sentence parce que, au moment de livrer Fausta au bourreau, on avait su qu’elle allait être mère. Mais maintenant que l’enfant était venu au monde, rien ne pouvait la sauver.
Et bientôt l’heure allait sonner pour Fausta d’expier son audace et sa grande lutte contre Sixte Quint.
Ce matin-là, Fausta devait mourir !
*
Ce matin-là, dans une de ces salles d’une somptueuse élégance comme il y en avait au Vatican, deux hommes, debout, face à face, se disaient de tout près et dans la figure des paroles de haine mortelle rendues plus effrayantes par les attitudes immobiles, comme pétrifiées. Ils étaient tous deux dans la force de l’âge et beaux tous deux. Et tous deux aussi, bien qu’appartenant à l’Église, portaient avec une grâce hautaine l’harmonieux costume des cavaliers de l’époque : grands seigneurs, à n’en pas douter. Et c’était bien la même haine qui grondait dans ces deux cœurs, puisque c’était le même amour qui les avait faits ennemis.
L’un d’eux s’appelait Alexandre Peretti. Peretti ! le nom de famille de Sa Sainteté Sixte Quint. Cet homme, en effet, c’était le neveu du pape. Il venait d’être créé cardinal de Montalte. Il était ouvertement désigné pour succéder à Sixte Quint, dont il était le confident et le conseiller. L’autre s’appelait Hercule Sfondrato ; il appartenait à l’une des plus opulentes familles des Romagnes, et il exerçait les fonctions de grand juge avec une sévérité qui faisait de lui l’un des plus terribles exécuteurs de la pensée de Sixte Quint.
Et voici ce que ces deux hommes se disaient :
– Écoute, Montalte, écoute ! Voici le glas qui sonne... rien ne peut la sauver maintenant, ni personne !
– J’irai me jeter aux pieds du pape, râlait le neveu de Sixte Quint, et j’obtiendrai sa grâce...
– Le pape ! Mais le pape, s’il en avait la force, la tuerait de ses mains plutôt que de la sauver. Tu le sais, Montalte, tu le sais, moi seul je puis sauver Fausta. Hier la sentence lui a été lue. Maintenant l’échafaud est dressé. Dans une heure, Fausta aura cessé de vivre si tu ne me jures sur le Christ, sur la couronne d’épines et sur les plaies que tu renonces à elle...
– Je jure... bégaya Montalte.
Et il s’arrêta, ivre de douleur, de rage et d’horreur.
– Eh bien, gronda Sfondrato, que jures-tu ?
Ils étaient maintenant si près l’un de l’autre qu’ils se touchaient. Leurs yeux hagards se jetèrent une dernière menace et leurs mains tourmentèrent les poignées des dagues.
– Jure, mais jure donc ! répéta Sfondrato.
– Je jure, gronda Montalte, de m’arracher le cœur plutôt que de renoncer à aimer Fausta, dût-elle me haïr d’une haine aussi impérissable que mon amour. Je jure que, moi vivant, nul ne portera la main sur Fausta, ni bourreau, ni grand juge, ni pape même. Je jure de la défendre à moi seul contre Rome entière s’il le faut. Et en attendant, grand juge, meurs le premier, puisque c’est toi qui as prononcé sa sentence.
En même temps, d’un geste de foudre, le cardinal Montalte, neveu du pape Sixte Quint, leva sa dague et l’abattit sur l’épaule d’Hercule Sfondrato.
Puis, avec une sorte de râle, qui était peut-être une imprécation, peut-être une prière, Montalte s’élança au dehors.
Sous le coup, Hercule Sfondrato était tombé sur les genoux. Mais presque aussitôt il se releva, défit rapidement son pourpoint et constata que le poignard de Montalte n’avait pu traverser la cotte de mailles qui ouvrait sa poitrine. Hercule eut un sourire terrible et murmura :
– Ces chemises d’acier que l’on fabrique à Milan sont vraiment de bonne trempe. Je tiens le coup pour reçu, Montalte ! et je te jure que ma dague à moi saura trouver le chemin de ton cœur !
Montalte s’était élancé dans le dédale des couloirs, des salles immenses, des cours et des escaliers. Il pénétra dans le passage couvert qui reliait le Vatican au château Saint-Ange. Il parvint au cachot où Fausta vaincue attendait l’heure de mourir.
Montalte s’approcha en tremblant de la porte que gardaient deux hallebardiers. Les deux soldats eurent un geste comme pour croiser les hallebardes. Mais sans doute puissante était, dans le Vatican, l’autorité du neveu de Sixte-Quint, ou peut-être sa physionomie, à ce moment, était-elle terrible, car les deux gardes reculèrent.
Montalte ouvrit le guichet qui permettait de surveiller l’intérieur du cachot.
Et voici ce que, à travers ce guichet, vit alors le cardinal Montalte... Fugitive, rapide et effrayante vision de rêve funèbre.
Sur un lit étroit était étendue une jeune femme... La jeune mère... elle... Fausta... un être éblouissant de beauté. Dans ses deux mains elle a saisi l’enfant et elle l’élève d’un geste de force et de douceur, et elle le contemple de ses yeux larges et profonds qui ont l’éclat des diamants noirs.
Au pied du lit se tient une suivante.
Et Fausta, d’une voix étrangement calme, prononce :
– Myrthis, tu le prendras, tu l’emporteras loin de Rome, loin de l’Italie. N’aie crainte, nul ne s’opposera à ta sortie du château Saint-Ange : j’ai obtenu cela que, moi morte, meure aussi la vengeance de Sixte-Quint.
– Je n’aurai nulle crainte, répond Myrthis avec une sorte de ferveur exaltée. Puisque, vous morte, je dois vivre encore, je vivrai pour lui.
Fausta esquisse un signe de tête comme pour prendre acte de cette promesse. Une minute elle garde le silence ; puis, les yeux fixés sur l’enfant, elle prononce encore :
– Fils de Fausta !... Fils de Pardaillan !... que seras-tu ?... Ta mère, en mourant, te donne le baiser d’orgueil et de force par quoi elle espère que son âme passera dans ton être !... Fils de Pardaillan et de Fausta, que seras-tu ?...
C’est fini. Myrthis a pris dans ses bras l’enfant qu’elle doit emporter loin de Rome, loin de l’Italie, le fils de Fausta, le fils de Pardaillan. Et elle se recule, et elle se détourne, comme pour cacher à l’innocent petit être, à peine entré dans la vie, la vue de sa mère entrant dans la mort.
Fausta, d’un geste funèbrement tranquille, a ouvert un médaillon d’or qu’elle porte suspendu à son cou et a versé dans une coupe préparée d’avance les grains de poison que contient ce médaillon.
C’est fini, Fausta a vidé d’un trait la coupe et elle retombe sur l’oreiller... Morte.
II
Le grand inquisiteur d’Espagne
De l’autre côté de la porte retentit un effroyable cri d’angoisse et d’horreur. C’est Montalte qui clame sa stupeur, Montalte que ce dénouement imprévu vient de foudroyer et qui râle :
– Morte ?... Comment ! elle est morte !... Insensé ! Comment n’ai-je pas prévu que Fausta, pour se soustraire au contact du bourreau, se donnerait la mort !...
Et presque aussitôt, une ruée tout impulsive contre cette porte qu’il martèle d’un poing furieux en bégayant :
– Vite ! vite ! Du secours !... On peut la sauver peut-être !
Et devant le néant de cette tentative, s’adressant aux hallebardiers qui assistent, impassibles, à cette crise de désespoir :
– Ouvrez ! mais ouvrez donc, je vous dis qu’elle se meurt... qu’il faut la sauver !
L’un des deux gardes répond :
– Cette porte ne peut être ouverte que par monseigneur le grand juge.
– Hercule Sfondrato !... Malédiction sur moi !...
Et Montalte s’abat sur ses genoux, la tête dans ses mains, secoué de sanglots.
À ce moment une voix calme prononça ces mots :
– Moi aussi, j’ai le droit d’ouvrir cette porte... Et je l’ouvre !...
Montalte se redressa d’un bond, considéra une seconde l’homme qui venait de parler ainsi, et d’un accent de sourde terreur, mêlé de respect, murmura :
– Le grand inquisiteur d’Espagne !
Inigo de Espinosa, cardinal-archevêque de Tolède, grand inquisiteur d’Espagne, proche parent et successeur de Diego de Espinosa, était un homme de cinquante ans, grand, fort et de physionomie presque douce ou, pour mieux dire, il était bien rare que cette physionomie exprima ouvertement un sentiment quelconque. L’inquisiteur était à Rome depuis un mois. Il était venu y accomplir une mission que nul ne connaissait. Il avait eu avec Sixte Quint de nombreux entretiens auxquels nul n’avait assisté. Seulement on avait remarqué que le vieux pape, naguère encore si robuste et si redoutable athlète dans ses entrevues diplomatiques, était sorti de ses entretiens avec Espinosa de plus en plus brisé, de plus en plus vieilli. On savait aussi que l’inquisiteur devait, le lendemain, reprendre le chemin de l’Espagne.
Sur un geste impérieux d’Espinosa, les deux gardes s’inclinent en tremblant et vont se placer à l’extrémité de l’étroit couloir où ils reprennent, de loin, leur garde monotone.
Sans ajouter une parole, Espinosa, comme il l’a dit, ouvre la porte et pénètre dans le cachot.
Montalte se précipite à sa suite, le cœur débordant d’une joie délirante, l’esprit soulevé par un espoir aussi puissant qu’irraisonné. Sans savoir pourquoi avec la certitude absolue qu’un miracle va se produire là, devant lui et pour lui, il se rue vers le lit étroit sur lequel repose le corps de Fausta.
Et soudain il reste cloué sur place... Ses yeux hagards se fixent avec douleur, avec rage... avec haine, sur un tout petit être, là, dans les bras de la suivante.
La vue de cet enfant a suffi, seule, à déchaîner dans l’esprit de cet homme robuste un monde de pensées tumultueuses dont le souffle empesté emporte et détruit tout sentiment humain, ne laisse rien... rien qu’une pensée de haine mortelle... car, ce tout petit, c’est le fils de Pardaillan !
Et l’innocente créature, avertie sans doute par quelque instinct mystérieux et sûr, laisse entendre un vagissement plaintif et se blottit dans les bras de celle qui, désormais, sera sa mère.
Et Myrthis, debout, les yeux rivés sur le visage convulsé de cet inconnu, resserre sur l’enfant son étreinte presque maternelle, en un geste de protection.
Pas un détail de cette scène rapide, d’une éloquence terrible dans son mutisme même, n’a échappé à l’œil observateur du grand inquisiteur.
Cependant, d’une voix calme, presque douce, il dit en montrant la porte ouverte :
– Vous êtes libre, femme. Accomplissez la mission maternelle qui vous a été confiée... Allez, et que Dieu vous garde !
Puis impérieusement, aux deux gardes toujours immobiles au fond du couloir :
– Laissez passer la clémence de Sixte !
Et Myrthis, serrant sur son sein le fils de Pardaillan, sans un mot, sans un geste, franchit le seuil de la porte, s’éloigne d’un pas rapide.
Espinosa referme la porte et vient tranquillement se placer au chevet de Fausta, morte.
Quand l’enfant a disparu, le cardinal Montalte se tourne vers Fausta dont la tête, déjà pâle, auréolée de la splendeur de ses longs cheveux, se détache sur la blancheur de l’oreiller. Il la contemple un moment, puis il s’écroule, saisit la main de Fausta qui pend hors du lit, imprime un long baiser sur cette main déjà froide et sanglote :
– Fausta ! Fausta !... Est-il vrai que tu sois morte ?...
Et soudain le voilà debout, l’œil injecté, la dague au poing, et cette fois, il hurle :
– Malheur à ceux qui me l’ont tuée !...
Mais alors il se trouve face à face avec l’inquisiteur, et comme unéclair la notion de la réalité lui revient. Alors, c’est à Espinosa qu’il s’adresse d’une voix tour à tour ardente ou suppliante :
– Monseigneur ! monseigneur ! pourquoi m’avez-vous conduit ici ? Pourquoi ?... Ah ! tenez, monseigneur, je ne sais si mon esprit chavire mais il me semble... oui, je devine... je sens... je vois que vous êtes ici pour y faire un miracle... Vous allez me la ressusciter, n’est-ce pas ?... De grâce, parlez, monseigneur !... mais parlez donc ou, par le Dieu vivant, je vais la rejoindre !...
D’un geste furieux il lève la dague sur sa propre poitrine, prêt à se frapper.
Alors Espinosa, de sa voix toujours calme, prononce :
– Monsieur, le poison que la princesse Fausta a pris sous vos yeux lui a été vendu par Magni1, le marchand d’herbes que vous connaissez... Ce Magni est un homme à moi... Il existe un contrepoison unique... Ce contrepoison, je l’ai sur moi... Le voici !
En disant ces mots, Espinosa fouille dans sa bourse et en sort un minuscule flacon.
Une clameur de joie délirante jaillit des lèvres de Montalte. Il saisit les mains de l’inquisiteur, et d’une voix vibrante :
– Ah ! monseigneur, sauvez-la !... Sauvez-la et puis prenez ma vie... je vous la livre.
– Monsieur le cardinal, votre vie nous est trop précieuse... Ce que j’ai à vous demander, Dieu merci, est de moindre importance.
Ceci fut dit très simplement, avec douceur même.
Montalte eut la sensation très nette que l’inquisiteur allait lui proposer quelque effroyable marché duquel dépendrait la mort de Fausta. Mais il regarda Espinosa bien en face et dit :
– Tout, monseigneur ! Demandez !
Espinosa s’approcha jusqu’à le toucher presque, et le dominant du regard :
– Prenez garde, cardinal !... Prenez bien garde !... Je sauve cette femme, puisque sa vie vous est précieuse au-dessus de tout... Mais en échange, vous, vous m’appartenez... n’oubliez pas cela...
Montalte secoue furieusement la tête pour manifester que sa résolution est irrévocablement prise, et d’une voix rauque, il gronde :
– Je n’oublierai pas, monseigneur. Sauvez-la et je vous appartiens... Mais, pour Dieu, hâtez-vous, ajoute-t-il en essuyant son front où perle la sueur de l’angoisse.
– Je retiens votre engagement, dit Espinosa gravement.
Et désignant Fausta rigide :
– Aidez-moi.
Avec des gestes doux comme des caresses, Montalte prit la tête de Fausta dans ses mains tremblantes, et frissonnant d’espoir, la souleva doucement pendant qu’Espinosa versait dans la bouche le contenu de son flacon.
– Attendons maintenant, dit l’inquisiteur.
Au bout de quelques instants, une légère rougeur vint colorer les joues de Fausta.
Montalte, penché sur elle, suivait avec une angoisse inexprimable les effets du contrepoison, qui lui paraissaient d’une lenteur mortelle.
Enfin un souffle à peine perceptible s’échappe doucement des lèvres entrouvertes et Montalte, qui sent sur son visage ce souffle léger, pousse lui-même un profond soupir, comme s’il voulait aider au travail lent qui se fait dans cet organisme.
Il pose sa main sur le sein et se redresse les yeux étincelants : le cœur bat... très faiblement, il est vrai, mais enfin il bat.
– Elle vit ! elle vit ! crie-t-il, éperdu de joie.
Au même instant Fausta ouvre les yeux et les pose sur Montalte qui se penche sur elle. Presque aussitôt elle les referme.
Un souffle régulier soulève son sein. Elle semble dormir.
Alors Espinosa qui, impassible, a considéré toute cette scène, dit :
– Avant deux heures la princesse Fausta aura retrouvé toute sa conscience.
Certain désormais que le miracle est enfin accompli, Montalte esquisse un signe de tête pour indiquer qu’il prend acte de cette affirmation, et s’inclinant devant Espinosa prononce :
– Vos ordres, monseigneur ?
– Monsieur le cardinal, répond l’inquisiteur, je suis venu d’Espagne à Rome tout exprès pour chercher un document portant la signature d’Henri III de France, ainsi que son cachet. Ce document est enfermé dans le petit meuble placé dans la chambre de Sa Sainteté. En l’absence du pape, nul ne peut pénétrer dans sa chambre... Nul... hormis vous, Montalte !... Ce document, reprend-il après une légère pause, ce document, il nous le faut.
Ce disant, Espinosa fixe Montalte droit dans les yeux.
Le cardinal répond froidement :
– C’est bien... Je vais le chercher.
Et il sort aussitôt d’un pas rude et violent.
Demeuré seul, Espinosa paraît plongé un moment dans une profonde méditation. Puis il s’approche de Fausta, la touche légèrement à l’épaule pour la réveiller, et dit :
– Êtes-vous assez forte, madame, pour m’entendre et me comprendre ?
Fausta ouvre les yeux et les pose graves et lucides sur le visage de l’inquisiteur qui se contente de cette réponse muette et reprend :
– Avant mon départ, je veux, madame, vous rassurer sur le sort de votre enfant... Il vit... Et votre servante Myrthis doit, à l’heure qu’il est, avoir quitté Rome, emportant ce dépôt sacré que vous lui avez confié... Toutefois, ne croyez pas que Sixte Quint a laissé vivre cet enfant uniquement pour tenir le serment qu’il vous a fait... Si l’enfant vit, madame, c’est que Sixte sait que vous avez caché quelque part une somme de dix millions2 et que ces millions, vous les avez légués à votre fils... Si Myrthis a pu quitter Rome sans encombre, c’est que Sixte sait que votre suivante connaît l’endroit où sont enfouis ces millions.
Espinosa s’arrête un moment pour juger de l’effet produit par sa révélation.
Fausta le fixe toujours de ses grands yeux noirs. Mais sur ce visage impassible, l’œil exercé de l’inquisiteur ne découvre pas la moindre trace d’émotion, et comme il veut savoir, il insiste :
– Vous m’avez entendu ?... Vous m’avez bien compris ?...
D’un signe, Fausta fait entendre qu’elle a compris.
Espinosa se contente encore une fois de cette réponse muette.
– C’est tout ce que je voulais vous dire, madame.
Il s’incline gravement, avec une sorte de déférence, et se dirige lentement vers la porte qu’il ouvre. Mais, avant de franchir le seuil, il se retourne et ajoute :
– Encore un mot, madame : le sire de Pardaillan a pu échapper à l’incendie du palais Riant... Pardaillan est vivant, madame !... Vous m’entendez ?... Pardaillan... vivant !
Et cette fois, Espinosa sort tranquillement.
Herboriste connu à Rome, véhémentement soupçonné d’avoir empoisonné Sixte Quint, sur l’ordre de l’inquisition d’Espagne. (Note de M. Zévaco).
Somme qui, à notre époque (vers 1910), représenterait environ vingt-cinq millions de francs. (Note de M. Zévaco).
III
La vieillesse de Sixte Quint
Une grande table de travail, deux fauteuils, un petit meuble, çà et là quelques escabeaux ; une étroite couchette, un prie-dieu, au-dessus du prie-dieu un magnifique christ en or massif, merveille de ciselure signée Benvenuto Cellini, seul luxe de ce retrait ; une vaste cheminée où pétille un feu clair ; un épais tapis, de lourds rideaux hermétiquement clos : c’était la chambre de Sa Sainteté Sixte Quint.
Usé par le temps et le long effort, ce n’est plus le formidable athlète d’autrefois. Mais à l’éclair qui parfois luit sous les sourcils, on devine encore l’infatigable lutteur.
Sixte Quint était assis à sa table de travail, le dos tourné à la cheminée. Et le Pape songeait :
« À cette heure, Fausta a pris le poison. Bourreau, peuple romain, la fête est finie : Fausta est morte !... La suivante Myrthis a quitté le château Saint-Ange, emportant l’enfant de Fausta... le fils de Pardaillan !... »
Le pape se leva, fit quelques pas, les mains au dos, puis revint s’asseoir dans son fauteuil, qu’il tourna vers le feu, et présenta ses mains amaigries à la flamme. Et il reprit sa rêverie :
« Oui, les quelques jours que j’ai à vivre seront paisibles, car l’aventurière n’est plus !... Il me reste, avant de mourir, il me reste à frapper Philippe d’Espagne... Le frapper ! Lui ! Le roi catholique !... Oui, par le ciel, puisqu’il a voulu me frapper, et que nul n’a impunément bravé Sixte Quint !... Mais comment le frapper ?... Comment ?... »
Le pape allongea la main vers le petit meuble et y prit un parchemin qu’il parcourut des yeux, lentement. Et il murmura :
– Funeste inspiration que j’ai eue d’arracher cette déclaration à la pusillanimité d’Henri III... inspiration plus funeste encore que j’aie eue de la garder si longtemps... Maintenant, Philippe connaît son existence, et le grand inquisiteur est venu ici me menacer de mort !... Moi !...
Sixte Quint haussa les épaules :
– Mourir !... ce n’est rien... Mais mourir sans avoir réalisé son rêve : Philippe chassé d’Italie !... L’Italie unifiée du nord au midi, l’Italie entière soumise et asservie et la papauté maîtresse du monde... Que faire ?... Envoyer ce parchemin à Philippe ? – Par quelqu’un qui n’arriverait jamais ?... Peut-être... L’anéantir ?... Ce serait un coup terrible pour Philippe... Aussi bien j’ai juré à Espinosa qu’il a été détruit... Oui... un geste, et il devient la proie de cette flamme !...
Le pape se pencha et tendit vers le foyer le parchemin ouvert sur lequel s’étale un large sceau... le sceau d’Henri III de France.
Déjà la flamme mordait les bords du parchemin.
Un instant encore, et c’en était fait des rêves de Philippe d’Espagne.
Brusquement Sixte Quint mit le parchemin hors d’atteinte, et hochant la tête répéta :
– Que faire ?...
À ce moment une main, d’un geste rude, saisit le parchemin.
Sixte Quint se retourna furieusement et se trouva en présence de son neveu, le cardinal Montalte. À l’instant, les deux hommes furent face à face.
– Toi !... toi !... Comment oses-tu !... Je vais...
Et le pape allongea la main vers le marteau d’ébène posé sur la table pour appeler, jeter un ordre.
D’un bond, Montalte se plaça entre la table et lui, et froidement :
– Sur votre vie, Saint-Père, ne bougez pas, n’appelez pas !
– Holà ! dit le vieux pape, en se redressant de toute sa hauteur, oserais-tu porter la main sur le souverain pontife ?
– J’oserai tout... si je n’obtiens de vous ce que je suis venu demander.
– Et que veux-tu ?
– Je veux...
– Allons, ose ! puisque tu es en veine d’audace insensée !
– Je veux... eh bien, je veux la grâce de Fausta.
Le pape eut un mouvement de surprise, puis, songeant qu’elle était morte, un sourire :
– La grâce de Fausta ?
– Oui, Saint-Père, dit Montalte courbé.
– La grâce de Fausta ?... Soit !
Le pape choisit un parchemin parmi les nombreux papiers rangés sur sa table, et, très posément, le remplit et le signa d’une main ferme.
Pendant que le pape écrivait, Montalte, d’un coup d’œil rapide, parcourait le parchemin qu’il venait de lui arracher.
– Voici la grâce, dit Sixte Quint, grâce pleine et entière. Et maintenant que tu as obtenu ce que tu voulais, rends-moi ce parchemin, et va-t’en... va-t’en... À toi aussi, fils de ma sœur bien-aimée, je fais grâce !
– Saint-Père, avant de vous rendre ce parchemin, un mot : si vous avez signé cette grâce, c’est que vous croyez Fausta morte... Eh bien, vous vous trompez, mon oncle, Fausta n’est pas morte !
– Fausta vivante ?
– Oui ! car je l’ai sauvée en lui faisant prendre moi-même le contrepoison qui l’a rappelée à la vie.
Sixte Quint resta un moment rêveur, puis :
– Eh bien, soit ! Après tout, que m’importe Fausta vivante ?... Elle ne peut plus rien contre moi. Sa puissance religieuse est morte en même temps que naissait son enfant... Mais toi, qu’espères-tu donc d’elle ?... As-tu fait ce rêve insensé que tu pourrais être aimé de Fausta ?... Triple fou !... Sache donc, malheureux, que tu attendriras le marbre le plus dur avant que d’attendrir le cœur de Fausta.
Et gravement :
– Il n’y a pas deux Pardaillan au monde !
Montalte ferma les yeux et pâlit.
Plus d’une fois, en effet, il avait songé en grinçant à ce Pardaillan inconnu qui avait été aimé de Fausta. Et alors il avait senti une haine mortelle et tenace l’envahir. Alors des imprécations furieuses étaient montées à ses lèvres. Alors des pensées de meurtre et de vengeance étaient venues le hanter. Et d’une voix morne, il répondit :
– Je n’espère rien. Je ne veux rien... si ce n’est sauver Fausta... quant à ce parchemin, ajouta-t-il rudement, je vais le remettre à Fausta qui ira le porter, elle, à Philippe d’Espagne à qui il appartient... Et pour plus de sûreté j’accompagnerai la princesse.
Sixte Quint eut un geste de rage. La pensée de paraître céder à des menaces à peine déguisées lui était insupportable. Bravant le poignard de Montalte, il allait appeler, lorsqu’il se souvint que ce parchemin, somme toute, il l’avait lui-même retiré de la flamme où il hésitait à le jeter. L’instant d’avant il était irrésolu, cherchant une solution. Cette solution, sans le vouloir, Montalte la lui indiquait peut-être... Pourquoi pas ?... Après tout, qu’importait le messager : Fausta ou comparse, pourvu qu’il n’arrivât pas à destination ? Sa résolution fut prise. Il répondit :
– Peut-être as-tu raison. Et puisque j’ai fait grâce à toi et à elle, va !...
Un quart d’heure plus tard, Montalte rejoignait Espinosa et lui disait :
– Monseigneur, j’ai le parchemin.
L’œil froid de l’inquisiteur eut comme une lueur aussitôt éteinte, et toujours calme :
– Donnez, monsieur.
– Monseigneur, avec votre agrément, la princesse Fausta ira le porter à S. M. Philippe d’Espagne... C’est là, je crois, ce qui vous importe le plus.
Espinosa fronça légèrement le sourcil, et :
– Pourquoi la princesse Fausta ?
– Parce que je vois là un moyen de la préserver de tout nouveau danger, dit fermement Montalte en le regardant en face.
Espinosa réfléchit une seconde, puis :
– Soit, monsieur le cardinal. L’essentiel, en effet, est, comme vous le dites, que ce document parvienne à mon souverain le plus tôt possible.
– La princesse partira dès que ses forces lui permettront d’entreprendre le voyage... Je puis vous assurer que le parchemin parviendra à destination, car j’aurai l’honneur de l’accompagner moi-même.
– En effet, dit sérieusement Espinosa, la princesse sera bien gardée.
– Je le crois aussi, monseigneur, répondit froidement Montalte.
IV
Le réveil de Fausta
Lorsque Fausta revint à elle, ce fut d’abord, dans son esprit, un prodigieux étonnement. Sa première pensée fut que Sixte Quint n’avait pas permis qu’elle échappât à la hache du bourreau. Le cri de Montalte, clamant sa joie de la voir vivante, était si vibrant de passion qu’elle voulut savoir quel était l’homme qui l’aimait à ce point. Elle ouvrit les yeux et reconnut le neveu du pape. Elle les referma aussitôt et pensa :
« Celui-là, a obtenu de Sixte qu’il me fît grâce de la vie... Que m’est la vie à présent que morte est mon œuvre et que Pardaillan n’est plus ! Que suis-je, à présent ? Néant. Je dois retourner au néant. Avant ce soir ce sera fait ! »
Cette résolution prise, elle écouta et alors elle comprit qu’elle s’était trompée. Non ! Sixte Quint n’avait pas fait grâce. Montalte, seul, au prix de quelque infamie héroïquement consentie, avait accompli ce miracle de l’arracher à Sixte et à la mort. Aussitôt, elle entrevit tout le parti qu’elle pourrait tirer d’un pareil dévouement. Mais à quoi bon !... Elle voulait, elle devait mourir !
Malgré tout, elle ne put se désintéresser de ce qui se disait près d’elle. Qu’était-ce que ce document ?... Quel rapport entre elle et ce parchemin ?...
Elle sentit qu’on la touchait à l’épaule... on lui parlait... Elle ouvrit les yeux et fixa Espinosa. Et, au fur et à mesure, son esprit réfutait ses arguments.
Son fils ?... Oui ! Sa pensée s’est déjà portée vers l’innocente créature. Il vit... Il est libre... C’est là le point capital... quant au reste : mieux vaut sa mère morte qu’ensevelie vivante dans un cachot.
Et soudain, comme un coup de tonnerre, ces mots répétés dans son esprit éperdu :
– Pardaillan vivant !
Deux mots évocateurs d’un passé d’enivrante passion... et de luttes mortelles ! Ce passé qui lui semblait si éloigné !... et qui, cependant, était si proche, puisque quelques mois à peine la séparaient du moment où elle avait voulu faire périr Pardaillan, dans l’incendie du palais Riant !... Ce Pardaillan si haï... et tant adoré !...
Quel passé !...
Elle : riche, souveraine, puissante et adulée, vaincue, brisée, meurtrie dans toutes ses entreprises. Lui : pauvre, gentilhomme sans feu ni lieu, vainqueur par la force de son génie d’intrigue et de son cœur généreux. Et, suprême humiliation, son amour à elle, la vierge d’orgueil, son amour dédaigné !...
Pardaillan vivant !... Mais alors la mort, pour Fausta, ce serait la fuite devant l’ennemi ! Et Fausta n’a jamais fui !... Non, elle ne veut plus mourir... Elle vivra pour reprendre le tragique duel interrompu et sortir enfin triomphante de ce suprême combat.
C’est à ce moment que Montalte s’approcha d’elle.
Pendant qu’il se courbait, elle l’étudiait d’un coup d’œil prompt et sûr, et tout de suite, comme si elle eût toujours été la souveraine redoutée – ou peut-être pour bien marquer, dès le début, la distance infranchissable qu’elle entendait établir entre eux – cette femme étrange qui semblait échapper à toutes les faiblesses, à toutes les fatigues, se redressa en une majestueuse attitude, et d’une voix qui ne tremblait pas !
– Vous avez à me parler, cardinal ? Je vous écoute.
En même temps ses yeux noirs se posaient sur ceux de Montalte, étrangement dominateurs et pourtant graves et doux.
Et Montalte, qui peut-être avait rêvé de la conquérir, vaincu dès le premier contact, se courbait davantage, presque prosterné, dans une muette adoration. Et Fausta comprit qu’il se donnait corps et âme et sans réserve, et elle lui sourit et elle répéta avec une douceur inexprimable :
– Parlez, cardinal.
Alors Montalte, d’une voix basse et tremblante, lui annonça qu’elle était libre.
Sans manifester ni surprise, ni émotion, Fausta dit :
– Sixte Quint me fait donc grâce ?
Montalte secoua la tête :
– Le pape n’a pas fait grâce, madame. Le pape a cédé devant une volonté plus forte que la sienne.
– La vôtre... n’est-ce pas ?
Montalte s’inclina.
– Alors Sixte Quint révoquera la grâce qu’il a signée par contrainte.
– Non, madame, car en même temps j’ai... obtenu de Sa Sainteté un document qui sera votre égide.
– Qu’est-ce que ce document ?
– Le voici, madame.
Fausta prit le parchemin et lut :
« Nous, Henri, par la grâce de Dieu roi de France, inspiré de notre Seigneur Dieu, par la voix de son Vicaire, notre Très Saint Père le Pape ; en vue de maintenir et conserver en notre royaume la religion catholique, apostolique et romaine ; attendu qu’il a plu au Seigneur, en expiation de nos péchés, de nous priver d’un héritier direct ; considérant Henri de Navarre incapable de régner sur le royaume de France, comme hérétique et fauteur d’hérésie ; à tous nos bons et loyaux sujets : Sa Majesté Philippe II, roi d’Espagne, est Seule apte à nous succéder au trône de France, comme époux d’Élisabeth de France, notre sœur bien-aimée, décédée ; mandons à tous nos sujets demeurés fils soumis de notre Sainte Mère l’Église, le reconnaître comme notre successeur et unique héritier. »
– Madame, dit Montalte, lorsqu’il vit que Fausta avait terminé sa lecture, la parole du roi ayant en France force de loi, cette proclamation jette dans le parti de Philippe les deux tiers de la France. De ce fait, Henri de Béarn, abandonné par tous les catholiques, voit ses espérances à jamais détruites. Son armée réduite à une poignée de huguenots, il n’a d’autre ressource que de regagner promptement son royaume de Navarre, trop heureux encore si Philippe consent à le lui laisser. Celui qui apportera ce parchemin à Philippe lui apportera donc en même temps la couronne de France... Celui-là, madame, si c’est un esprit supérieur comme le vôtre, peut traiter avec le roi d’Espagne et se réserver sa large part... Votre puissance est ruinée en Italie, votre existence y est en péril. Avec l’appui de Philippe, vous pouvez vous créer une souveraineté qui, pour n’être pas celle que vous avez rêvée, n’en sera pas moins de nature à satisfaire une vaste ambition... Ce parchemin, je vous le livre et je vous demande de consentir à le porter à Philippe...
Aussitôt la résolution de Fausta fut prise :
Son fils ?... Il était sous la garde de Myrthis et maintenant hors de l’atteinte de Sixte Quint. Plus tard, elle saurait bien le retrouver.
Pardaillan ?... Plus tard aussi, elle le retrouverait.
Montalte ?... Pour celui-là, c’est à l’instant qu’il fallait décider. Et elle décida :
– Celui-là ?... Celui-là sera mon esclave !
Et tout haut :
– Quand on s’appelle Peretti, on doit avoir assez d’ambition pour agir pour son propre compte... Pourquoi avez-vous imposé ma grâce à Sixte ?... Pourquoi m’avez-vous empêchée de mourir ?... Pourquoi me faites-vous entrevoir ce nouvel avenir de splendeur ?
– Madame... balbutia Montalte.
– Je vais vous le dire : parce que vous m’aimez, cardinal.
Montalte tomba sur les genoux, tendit les mains dans un geste d’imploration.
Impérieuse, elle arrêta avant qu’elle se produisit l’explosion passionnée qu’elle-même avait provoquée :
– Taisez-vous, cardinal. Ne prononcez pas d’irréparables paroles... Vous m’aimez, soit, je le sais. Mais moi, cardinal, moi, je ne vous aimerai jamais.
– Pourquoi ? pourquoi ? bégaya Montalte.
– Parce que, dit-elle gravement, parce que j’aime, cardinal Montalte, et que Fausta ne peut concevoir deux amours.
Montalte se redressa, écumant :
– Vous aimez ?... Vous aimez ?... et vous me le dites... à moi ?...
– Oui, dit simplement Fausta en le fixant droit dans les yeux.
– Vous aimez !... Qui ?... Pardaillan, n’est-ce pas ?...
Et Montalte d’un geste de folie, tira sa dague.
Fausta, immobile dans son lit, le regardait d’un œil très calme, et d’une voix qui glaça Montalte, elle dit :
– Vous l’avez dit : j’aime Pardaillan... Mais croyez-moi, cardinal Montalte, laissez votre dague... Si quelqu’un doit tuer Pardaillan, ce n’est pas vous.
– Qui ?... Qui ?... râla Montalte dont les cheveux se hérissèrent.
– Moi !...
– Pourquoi ? hurla Montalte.
– Parce que je l’aime, répondit froidement Fausta.
V
La dernière pensée de Sixte Quint
Après le départ de son neveu, Sixte Quint, assis devant sa table de travail, demeura longtemps songeur.
Il fut tiré de sa rêverie par l’entrée d’un secrétaire qui vint, à voix basse, lui dire que le comte Hercule Sfondrato sollicitait avec instance la faveur d’une audience particulière, ajoutant que le comte paraissait violemment ému.
Le nom d’Hercule Sfondrato, brusquement jeté dans sa méditation, fut comme un trait de lumière pour le pape qui murmura :
– Voilà l’homme que je cherchais !
Et à voix haute :
– Faites entrer le comte Sfondrato.
Un instant après, le grand juge, les traits bouleversés, entrait d’un pas rude, se campait devant le pape, de l’autre côté de la table, et attendait dans une attitude de violence.
– Eh bien, comte, dit Sixte Quint en le fixant, qu’avez-vous à nous dire ?
Pour toute réponse, Sfondrato, furieusement, dégrafait son pourpoint, écartait la cotte de mailles et montrait sur sa poitrine la marque du coup de dague de Montalte.
Le pape examina la plaie en connaisseur, et froidement :
– Beau coup, par ma foi ! et sans la chemise d’acier...
– En effet, Saint-Père, dit Sfondrato avec un sourire livide.
Puis, réparant hâtivement le désordre de sa tenue, avec un haussement d’épaules dédaigneux, les dents serrées, d’un ton tranchant :
– Le coup n’est rien... J’eusse peut-être pardonné à celui qui l’a porté. Ce que je ne lui pardonnerai jamais, ce qui rend ma haine mortelle, ce qui fait que je le poursuivrai partout et toujours jusqu’à ce qu’enfin ma dague lui fouille le cœur, c’est que... tous deux, nous aimons la même femme.
– Fort bien, dix Sixte paisiblement. Mais pourquoi me dire cela à moi ?
– Parce que, Saint-Père, celui-là touche de près à Votre Sainteté, parce que la femme que j’aime s’appelle Fausta et l’homme que je hais s’appelle Montalte !
Sixte Quint le considéra un instant, puis, froidement :
– J’apprécie la valeur de l’avertissement que vous me donnez.
Le pape prit un parchemin sur sa table et, d’une main calme, se mit à le remplir.
Sfondrato, immobile, songeait :
« Il va me faire jeter dans quelque cachot, mais, par l’enfer ! celui qui osera toucher au grand juge... »
Sixte Quint achevait de remplir le parchemin.
– Voici pour panser votre coup de poignard, dit-il. Vous m’avez demandé le duché de Ponte-Maggiore et Morciano. En voici le brevet...
Stupéfait, Sfondrato, d’un geste machinal, prit le parchemin et gronda :
– Votre Sainteté n’a donc pas entendu ?... Celui que je veux tuer c’est Montalte... Montalte ! votre neveu ! celui-là même que vous avez désigné au conclave pour vous remplacer ?
Le pape se leva, redressa sa taille voûtée. Son visage prit une expression d’indicible amertume. Et il prononça :
– Que vous frappiez Montalte, c’est affaire entre lui et vous. Frappez-le donc !... Mais frappez-le dans ses entreprises, mais frappez-le dans son amour en lui enlevant cette femme... cela vaudra mieux, croyez-moi, qu’un stupide coup de dague !
– Oh ! haleta Sfondrato, quel crime a donc commis Montalte pour que vous, son oncle, vous parliez ainsi ?
– Montalte, dit le pape avec un calme effrayant, Montalte n’est plus mon neveu. Montalte est mon ennemi. Montalte est l’ennemi de notre Église ! Montalte a conspiré ! Montalte a arraché de mes mains l’arme qui peut anéantir la puissance de la papauté et, cette arme, Fausta, graciée par le pape, oui, graciée par moi !... Fausta libre et vivante ira la porter à l’Espagnol maudit.
– Fausta graciée ! gronda Sfondrato anéanti.
– Oui, dit Sixte, Fausta libre !... Fausta qui, dans quelques heures peut-être, quittera Rome et s’en ira, escortée de Montalte, porter à l’Escurial1 le document qui donne à Philippe le trône de France. Voilà l’œuvre de Montalte, instrument docile aux mains du grand inquisiteur !...
– Fausta libre ! grinça Sfondrato, Fausta accompagnée de Montalte ! Par l’enfer ! moi vivant, cela ne sera pas !...
Et avec une résolution sauvage, posant rudement sur la table le brevet de duc que le pape venait de lui conférer :
– Tenez, Saint-Père, reprenez ce brevet, ôtez-moi les fonctions de grand juge, et en échange, nommez-moi chef de votre police. Avant une heure, je vous rapporte ce document, cette arme redoutable... L’échafaud est prêt, le bourreau attend. Eh bien, j’en mourrai de douleur peut-être, mais cette femme appartient au bourreau et sa tête tombera !... Montalte, je le saisis, je le condamne comme rebelle et sacrilège ; quant au grand inquisiteur, un coup de dague vous en délivre... Un mot, Saint-Père, un ordre !
– Oui ! dit le pape d’une voix sombre. Et avant trois jours, j’aurai, moi, cessé de vivre !
Et comme Sfondrato reculait en le considérant avec stupeur :
– Croyez-vous donc que Montalte, Fausta, le grand inquisiteur lui-même pèsent d’un grand poids dans la main de Sixte Quint ?... Par le sang du Christ, je n’aurais qu’à la fermer, cette main, pour les broyer ! Mais au-dessus du grand inquisiteur, il y a l’Inquisition !... Et l’Inquisition me tient !... Si je les frappe... si j’essaye de reprendre ce document, l’Inquisition m’assassine... Et je ne veux pas mourir encore... J’ai besoin de deux ou trois années d’existence pour assurer le triomphe définitif de la papauté !... Comprenez-vous pourquoi Montalte, Fausta et Espinosa doivent sortir libres de mes États ?
Le nouveau duc de Ponte-Maggiore avait écouté avec une attention passionnée. Quand le pape eut terminé :
– Eh bien, soit, Saint-Père, qu’ils partent... Mais quand ils seront hors de vos États, moi, je les rejoins, et je vous jure que de ce moment leur voyage est terminé.
– Oui ! Mais on sait que vous m’appartenez... et alors... Et puis, duc, êtes-vous sûr de vous ?
– Dix Montalte ! Cent Montalte ! Je ne les crains pas, gronda le duc.
– Et le grand inquisiteur ?
– Un ordre... il meurt !
– Et Fausta ?
– Fausta ! bégaya Ponte-Maggiore livide.
– Oui ! Fausta, malheureux ! Fausta vous tuera ! Fausta vous brisera comme je brise cette plume !
Et, d’un coup sec, Sixte Quint cassait une plume qu’il maniait machinalement en parlant.
Et sur un geste du duc :
– Non, non, reprit Sixte avec autorité, après moi, je ne connais qu’un seul homme au monde capable de tenir tête à Fausta... et de la vaincre... Et cet homme, c’est le chevalier de Pardaillan !
Le duc tressaillit, rougit et pâlit tour à tour. Mais surmontant son émotion, il demanda d’une voix rauque :
– Vous croyez, Saint-Père, que celui-là réussira là où je serais brisé, moi ?
– Je l’ai vu mener à bien des entreprises autrement redoutables. Oui, si Pardaillan voulait... si quelqu’un avait assez d’intelligence à la tête, assez de haine au cœur pour aller trouver cet homme, et le décider... oui, ce serait le seul moyen d’arrêter Fausta et Montalte en leur voyage !
– Eh bien, j’aurai cette intelligence et cette haine, moi ! Je consens à m’effacer. Et puisqu’il y a au monde un dogue de taille à les broyer d’un coup de mâchoire, je vais le chercher, je vous l’amène, et vous le lâchez sur eux, tonna Ponte-Maggiore.
Et en lui-même :
– Quitte à lui briser les crocs après, s’il est nécessaire...
– Lâchez ! lâchez !... C’est bientôt dit !... Sachez, duc, que Pardaillan n’est pas un homme qu’on peut lâcher sur qui on veut et comme on veut... Non, par le Christ, Pardaillan ne marche à l’ennemi que quand il lui convient, à lui... et alors, malheur à ceux contre qui il fonce... Lâcher Pardaillan ! répéta le pape avec un rire terrible.
Puis, sérieusement, l’index levé :
– Dieu seul, duc, peut lâcher la foudre !
– Saint-Père, est-ce d’un homme que vous parlez ainsi ?
– Duc, dit gravement le pape, Pardaillan est peut-être le seul homme qui ait forcé l’admiration de Sixte Quint... Puisque vous le voulez, allez, duc. Essayez de décider Pardaillan.
– Où le trouverai-je ?
– Au camp du Béarnais. Vous allez monter à cheval et vous rendre auprès d’Henri de Navarre. Vous lui ferez connaître la teneur exacte du document que Fausta porte à Philippe – document que nous n’avons livré que par la violence. Votre mission officielle se borne à cela seul. Le reste vous regarde... c’est à vous de trouver Pardaillan. Et quand vous l’aurez trouvé, vous lui direz simplement ceci : Fausta est vivante ! Fausta porte à Philippe un document qui lui livre la couronne de France.
– Est-ce là tout ce que j’aurai à lui dire, Saint-Père ?
– C’est tout oui... et cela suffira !
– Quand faut-il partir ?
– À l’instant.
L’Escurial : palais royal bâti par Philippe II d’Espagne à environ 10 kilomètres de Madrid.
VI
Le chevalier de Pardaillan
Hercule Sfondrato, duc de Ponte-Maggiore, sortit de Rome et se lança au galop sur la route de France. Les passions grondaient dans son cœur. La colère, la haine et l’amour s’y déchaînaient. À une demi-lieue de la Ville Éternelle, il s’arrêta court et, longtemps, sombre, muet, le visage convulsé, il contempla la lointaine silhouette du château Saint-Ange. Son poing se tendit et il murmura :
– Montalte, Montalte, prends garde, car à partir de ce moment je suis pour toi l’ennemi que rien ne désarmera...
Et plus bas, plus doucement :
– Fausta !...
Alors il reprit sa course, et pendant des jours, par les monts, par les plaines, il passa, cavalier rapide que poussait la vengeance.
*
Ponte-Maggiore traversa la France, ayant crevé plusieurs chevaux, et ne s’arrêtant, parfois, que lorsque la fatigue le terrassait.
À quelques lieues de Paris il rejoignit un gentilhomme qui s’en allait, lui aussi, vers la capitale, et Ponte-Maggiore aborda cet inconnu en lui demandant si on avait des nouvelles du roi Henri et si on savait vers quel point de l’Île-de-France le Béarnais se trouvait alors.
– Monsieur, répondit le cavalier inconnu, S. M. le roi a pris ses logements dans le village de Montmartre, à l’abbaye des Bénédictines de Mme Claudine de Beauvilliers, qui, dit-on, passe ses jours à prier et ses nuits à essayer de convertir à la messe le royal hérétique.
Ponte-Maggiore considéra plus attentivement l’étranger qui parlait avec cette sorte d’irrévérence moqueuse et il vit un homme d’une quarantaine d’années, au visage fin, au profil de médaille, vêtu sans aucune recherche, mais avec cette élégance qui tenait à sa manière de porter le pourpoint et le manteau, dont les plis retombaient avec grâce sur la croupe du cheval.
– Si vous le désirez, monsieur, reprit l’inconnu, je vous conduirai jusqu’au roi, qui m’a donné rendez-vous pour ce soir.
Ponte-Maggiore, étonné, jeta un regard presque dédaigneux sur le costume simple et sans aucun ornement.
– Oh ! continua l’inconnu en souriant, vous serez bien plus étonné quand vous verrez le roi qui porte un costume si râpé que vraiment vous lui ferez honte, vous avec toutes vos broderies reluisantes, avec votre superbe manteau en velours de Gênes, avec la plume mirifique de votre chapeau, avec vos éperons d’or, avec...
– Assez, monsieur, interrompit Ponte-Maggiore, ne m’accablez pas, ou, par le Dieu vivant, je vous montrerai que si je porte de l’argent à mon pourpoint et de l’or aux talons de mes bottes, je porte aussi de l’acier dans ce fourreau.
– Vraiment, monsieur ? Eh bien ! je ne vous accablerai donc pas et me bornerai à vous tirer mon chapeau, car il serait malséant qu’un illustre cavalier, venu en droite ligne du fond de l’Italie...
– Comment savez-vous cela ? interrompit furieusement Ponte-Maggiore.
– Eh ! monsieur, si vous ne vouliez pas qu’on le sache, vous auriez bien dû laisser votre accent de l’autre côté des monts.
En disant ces mots, le gentilhomme salua d’un geste de grâce et d’aisance merveilleuse et reprit paisiblement son chemin.
Ponte-Maggiore porta la main à la poignée de sa dague. Mais considérant la silhouette vigoureuse de l’inconnu, il se calma.
– Accomplissons d’abord la mission que je suis venu remplir ici. Et quand j’aurai vu le roi, quand j’aurai retrouvé ce Pardaillan de malheur, alors il sera temps d’infliger une leçon à cet insolent, si je le trouve encore en travers de ma route. Eh ! monsieur, continua-t-il à haute voix, ne vous fâchez pas, je vous prie, et permettez-moi d’accepter l’offre bienveillante que vous m’avez faite tout à l’heure.
L’inconnu salua de nouveau et dit du bout des lèvres :
– En ce cas, monsieur, suivez-moi.
Les deux cavaliers allongèrent le trot, et vers le soir, au moment où le soleil allait se coucher, ils se trouvèrent sur les hauteurs de Chaillot.
Le gentilhomme français s’arrêta, étendit le bras et prononça :
– Paris !...
De la ville, sur laquelle planait un morne silence, on n’apercevait quele fouillis des toitures, d’où émergeaient les flèches de ses innombrables églises et la massive ceinture de pierre, chargée de la protéger, entourée elle-même d’un cercle de toile : les tentes des troupes royalistes, dont le cordon se resserrait de plus en plus.
Tandis que Ponte-Maggiore considérait ce spectacle de la grande ville assiégée, son compagnon semblait rêver à des choses lointaines. Sans doute des souvenirs s’évoquaient dans son esprit, sans doute le lieu même où il se trouvait lui rappelait quelque épisode héroïque ou charmant de sa vie, qui avait dû être aventureuse, car un sourire mélancolique errait sur ses lèvres : ce souvenir de poésie qui vient fleurir les lèvres de l’homme quand, se tournant vers le passé, il y trouve, par hasard, une heure de joie ou de charme sans amertume.
– Eh bien, monsieur, dit Ponte-Maggiore, je suis à vous.
L’inconnu tressaillit, parut revenir du pays des songes, et murmura :
– Allons...
Ils descendirent donc vers Paris en obliquant du côté de Montmartre.
Sous les murs, c’était le même fourmillement de troupes assiégeantes.
Sur les remparts, quelques lansquenets indifférents. Quantité de prêtres et de moines, la robe retroussée, le capuchon renversé ; quelques-uns avaient la salade en tête, quelques autres portaient des cuirasses ; tous étaient armés de piques, de hallebardes, de colichemardes ou dagues, de vieux mousquets, ou tout uniment de solides gourdins. Tous avaient le crucifix à la main ou pendu à la ceinture. Et ces étranges soldats allaient, venaient, se démenaient, prêchaient d’un côté, anathémisaient1 de l’autre, et somme toute faisaient bonne garde.
Autour des religieux, une foule de misérables, déguenillés, se traînaient péniblement, pourchassés sans cesse par les moines-soldats et revenant sans cesse, avec l’obstination du désespoir, occuper les créneaux, d’où ils criaient avec des voix lamentables :
– Du pain !... du pain !...
– Il paraît, dit Ponte-Maggiore en ricanant, que les Parisiens accepteraient volontiers une invitation à dîner.
– C’est vrai, murmura l’inconnu, ils ont faim. Pauvres diables !...
– Vous les plaignez ? dit Ponte-Maggiore, avec le même ricanement.
– Monsieur, dit l’inconnu, j’ai toujours plaint les gens qui ont faim et soif, car moi-même souvent, dans mes longues courses à travers le monde, j’ai eu faim et j’ai eu soif.
– C’est ce qui ne m’est jamais arrivé, fit dédaigneusement Ponte-Maggiore.
L’inconnu le parcourut de haut en bas d’un étrange regard, et, avec un sourire plus étrange encore, répondit :
– Cela se voit.
Si simple que fut cette réponse, elle sonna comme une insulte, et Ponte-Maggiore pâlit.
Sans doute il allait cette fois répondre par une provocation directe, lorsqu’au loin s’éleva une clameur qui, se gonflant de proche en proche, de troupe en troupe, s’en vint déferler jusqu’à eux :
– Le roi !... le roi !... Vive le roi !...
Comme par enchantement, une foule hurlante et délirante envahit les remparts, bouscula les moines-soldats, s’empara des parapets en criant :
– Sire ! Sire !... Du pain !...
– Me voici, mes amis ! criait Henri IV. Eh ! Ventre-saint-gris ! pourquoi diable ne m’ouvrez-vous pas vos portes ?
Alors l’inconnu et Ponte-Maggiore virent une de ces choses émouvantes que l’histoire enregistre avec un sourire attendri :
Henri IV venait de mettre pied à terre. Les deux ou trois cents cavaliers qui l’entouraient l’imitèrent, et alors on vit s’avancer toute une théorie de mulets chargés de pain. Henri IV, le premier, prit un de ces pains, le fixa au bout d’une immense perche et le tendit aux affamés des remparts. En un clin d’œil, le pain fut partagé et englouti.
– Que fait-il ? s’écria Ponte-Maggiore stupéfait.
– Eh ! monsieur, vous voyez bien que Sa Majesté invite les Parisiens à dîner !
En même temps les cavaliers de l’escorte suivaient l’exemple du roi. De tous les côtés, par des moyens divers, on faisait passer aux assiégés quantité de pains accueillis avec transport, et les cris de joie, les bénédictions éclataient sur les remparts, bientôt suivis d’une longue acclamation :
– Vive le roi !
Et quand tout fut distribué :
– Mangez, mes amis, mangez, dit le roi. Demain je vous en apporterai encore.
– Bravo, Sire ! cria l’inconnu.
– Intrigant ! murmura Ponte-Maggiore.
Henri IV se tourna vers celui qui manifestait si hautement son approbation, et, avec un bon sourire :
– Ah ! enfin !... Voici donc M. de Pardaillan !
– Pardaillan ! gronda Ponte-Maggiore...
– Monsieur de Pardaillan, continuait Henri IV, je suis bien heureux de vous voir. Et la célérité avec laquelle vous avez répondu à mon invitation me fait présager que, cette fois, vous serez des nôtres.
– Votre Majesté sait bien que je lui suis tout acquis.
Henri IV posa un moment son œil rusé sur la physionomie souriante du chevalier et dit :
– À cheval, messieurs, nous rentrons au village de Montmartre. Monsieur de Pardaillan, veuillez vous placer près de moi.
Au moment de partir :
– Monsieur, dit Pardaillan à Ponte-Maggiore, s’il vous plaît de me dire votre nom, j’aurai l’honneur, en arrivant à Montmartre, de vous présenter à Sa Majesté, selon ma promesse...
– Vous voudrez donc bien présenter Hercule Sfondrato, duc de Ponte-Maggiore et Marciano, ambassadeur de S. S. Sixte Quint auprès de S. M. le roi Henri et auprès de M. le chevalier de Pardaillan !
Un léger tressaillement agita Pardaillan. Mais son naturel insoucieux et narquois reprenant le dessus :
– Peste ! je ne m’attendais pas à un tel honneur !
Lorsque le roi s’éloigna, à la tête de son escorte, une immense acclamation partit du haut des remparts.
– Au revoir, mes amis, au revoir ! cria Henri IV.
Et, se tournant vers Pardaillan qui chevauchait à son côté, avec un soupir :
– Quel dommage que de si braves gens s’entêtent à ne pas m’ouvrir leurs portes !
– Eh ! Sire, dit le chevalier en haussant les épaules, ces portes tomberont d’elles-mêmes quand vous le voudrez.
– Comment cela, monsieur ?
– J’ai déjà eu l’honneur de le dire à Votre Majesté : Paris vaut bien une messe !
– Nous verrons... plus tard, dit Henri IV avec un fin sourire.
– Il faudra toujours bien en venir là, murmura le chevalier.
Cette fois Henri IV ne répondit pas.
Bientôt l’escorte s’arrêtait devant l’abbaye où le roi pénétra, suivi de Pardaillan, de Ponte-Maggiore et de quelques gentilshommes.
Le roi avant mis à terre, Pardaillan qui, sans doute, l’avait avisé de la venue d’un envoyé du pape, présenta le duc :
– Sire, j’ai l’honneur de présenter à Votre Majesté le seigneur Hercule Sfondrato, duc de Ponte-Maggiore et Marciano, ambassadeur de S. S. Sixte Quint auprès de S. M. le roi Henri et auprès de M. le chevalier de Pardaillan.
– Monsieur, dit le roi, veuillez nous suivre. Monsieur de Pardaillan, quand vous aurez reçu la communication que M. le duc est chargé de vous faire, n’oubliez pas que nous vous attendons.
Et, tandis que le chevalier s’inclinait, Henri IV se tourna vers des hommes occupés à transporter des sacs. Le heurt d’un de ces sacs avait produit un son argentin et ce bruit avait fait dresser l’oreille au Béarnais, toujours à court d’argent. Avisant un personnage qui surveillait le transport des précieux colis, le roi lui cria gaiement :
– Hé ! Sancy, avez-vous enfin trouvé un acquéreur pour votre merveilleux diamant2 et nous apportez-vous quelque argent pour garnir nos coffres vides ?
– Sire, j’ai en effet trouvé, non pas un acquéreur, mais un prêteur qui, sur la garantie de ce diamant, a consenti à m’avancer quelques milliers de pistoles que j’apporte à mon roi.
– Merci, mon brave Sancy.
Et, avec une pointe d’émotion :
– Je ne sais quand, ni si jamais je pourrai vous les rendre, mais, ventre-saint-gris ! argent n’est pas pâture pour des gentilshommes comme vous et moi3 !
Et, à Ponte-Maggiore stupéfait :
– Venez, monsieur.
Quand il fut dans la salle qui lui servait de cabinet et où travaillaient encore ses deux secrétaires : Rusé de Beaulieu et Forget de Fresnes :
– Parlez, monsieur.
– Sire, dit Ponte-Maggiore en s’inclinant, je suis chargé par Sa Sainteté de remettre à Votre Majesté cette copie d’un document qui l’intéresse au plus haut point.
Henri IV lut avec la plus extrême attention la copie de la proclamation d’Henri III que l’on connaît. Quand il eût terminé, impassible :
– Et l’original, monsieur ?
– Je suis chargé de dire à Votre Majesté que l’original se trouve entre les mains de Mme la princesse Fausta, laquelle, accompagnée de S. E. le cardinal Montalte, doit être, à l’heure présente, en route vers l’Espagne pour le remettre aux mains de Sa Majesté Catholique.
– Ensuite, monsieur ?
– C’est tout, Sire. Le souverain pontife a cru devoir donner à Votre Majesté ce témoignage de son amitié en l’avertissant. Quant au reste, le Saint-Père connaît trop bien la vaste intelligence de Votre Majesté pour n’être pas assuré que vous saurez prendre telles mesures que vous jugerez utiles.
Henri IV inclina la tête en signe d’adhésion. Puis, après un léger silence, en fixant Ponte-Maggiore :
– Le cardinal Montalte n’est-il pas parent de Sa Sainteté ?
Le duc s’inclina.
– Alors ?
– Le cardinal Montalte est en état de rébellion ouverte contre le Saint Père ! dit rudement Ponte-Maggiore.
– Bien !...
Et s’adressant à un des deux secrétaires :
– Rusé, conduisez M. le duc auprès de M. le chevalier de Pardaillan, et faites en sorte qu’ils se puissent entretenir librement. Puis, quand ils auront terminé, vous m’amènerez M. de Pardaillan.
Et, avec un gracieux sourire :
– Allez, monsieur l’ambassadeur, et n’oubliez pas qu’il me sera agréable de vous revoir avant votre départ.
Quelques instants après, Ponte-Maggiore se trouvait en tête-à-tête avec le chevalier de Pardaillan, assez intrigué au fond, mais dissimulant sa curiosité sous un masque d’ironie et d’insouciance.
– Monsieur, dit le chevalier d’un ton très naturel, vous plairait-il de me dire ce qui me vaut l’insigne honneur que veut bien me faire le Saint-Père en m’adressant, à moi, pauvre gentilhomme sans feu ni lieu, un personnage illustre tel que M. le duc de Ponte-Maggiore et Marciano ?
– Monsieur, Sa Sainteté m’a chargé de vous faire savoir que la princesse Fausta est vivante... vivante et libre.
Le chevalier eut un imperceptible tressaillement et, tout aussitôt :
– Tiens ! tiens ! Mme Fausta est vivante !... Eh bien, mais... en quoi cette nouvelle peut-elle m’intéresser ?
– Vous dites, monsieur ? dit Ponte-Maggiore abasourdi.
– Je dis : qu’est-ce que cela peut me faire à moi, que Mme Fausta soit vivante ? répéta le chevalier d’un air si ingénument étonné que Ponte-Maggiore murmura :
– Oh ! mais... il ne l’aime donc pas ?... Mais alors ceci change bien les choses !
Pardaillan reprit :
– Où se trouve la princesse Fausta, en ce moment ?
– La princesse est en route pour l’Espagne.
– L’Espagne ! songea Pardaillan, le pays de l’Inquisition !... Le génie ténébreux de Fausta devait fatalement se tourner vers cette sombre institution de despotisme... oui, c’était fatal !
– La princesse porte à Sa Majesté Catholique un document qui doit assurer le trône de France à Philippe d’Espagne.
– Le trône de France ?... Peste ! monsieur. Et qu’est-ce donc, je vous prie, que ce document qui livre ainsi tout un pays ?
– Une déclaration du feu roi Henri troisième, reconnaissant Philippe II pour unique héritier.
Un instant, Pardaillan resta plongé dans une profonde méditation, puis relevant sa tête fine et narquoise :
– Est-ce tout ce que vous aviez à me dire de la part de Sa Sainteté ?
– C’est tout, monsieur.
– En ce cas, veuillez m’excuser, monsieur, mais S. M. le roi Henri m’attend, comme vous savez... Veuillez donc transmettre à Sa Sainteté l’expression de ma reconnaissance pour le précieux avis qu’elle a bien voulu me faire passer et agréer pour vous-même les remerciements de votre très humble serviteur.
*
Henri IV avait accueilli la communication de Ponte-Maggiore avec une impassibilité toute royale, mais en réalité, le coup était terrible et à l’instant il avait entrevu les conséquences funestes qu’il pouvait avoir pour lui.
Il avait aussitôt convoqué en conseil secret ceux de ses fidèles qu’il avait sous la main, et lorsque le chevalier fut introduit, il trouva auprès du roi, Rosny, du Bartas, Sancy et Agrippa d’Aubigné, accourus en hâte.
Dès que le chevalier eut pris place, le roi, qui n’attendait que lui, fit un résumé de son entretien avec Ponte-Maggiore et donna lecture de la copie que Sixte Quint lui avait fait remettre.
Pardaillan, qui savait à quoi s’en tenir, n’avait pas bronché. Mais chez les quatre conseillers ce fut un moment de stupeur indicible aussitôt suivi de cette explosion :
– Il faut le détruire !...
Seul, Pardaillan ne dit rien. Alors le roi, qui ne le quittait pas des yeux :
– Et vous, monsieur de Pardaillan, que dites-vous ?
– Je dis comme ces messieurs, sire : Il faut reprendre ce parchemin ou c’en est fait de vos espérances, dit froidement le chevalier.
Le roi approuva d’un signe de tête, et fixant le chevalier comme s’il eût voulu lui suggérer la réponse qu’il souhaitait, il murmura :
– Quel sera l’homme assez fort, assez audacieux, assez subtil pour mener à bien une telle entreprise ?
D’un commun accord, comme s’ils se fussent donné le mot, Rosny, Sancy, du Bartas, d’Aubigné se tournèrent vers Pardaillan. Et cet hommage muet, venu d’hommes illustres ayant donné des preuves éclatantes de leur mérite à la guerre ou dans l’intrigue, cet hommage fut si spontané, si sincère que le chevalier se sentit doucement ému. Mais se raidissant, il répondit avec cette simplicité si remarquable chez lui :
– Je serai donc celui-là.
– Vous consentez donc ? Ah ! chevalier, s’écria le Béarnais, si jamais je suis roi... roi de France... je vous devrai ma couronne !
– Eh ! sire, vous ne me devrez rien...
Et avec un sourire étrange :
– Mme Fausta, voyez-vous, est une ancienne connaissance à moi à qui je ne serai pas fâché de dire deux mots... Je tâcherai donc de faire en sorte que ce document n’arrive jamais aux mains de Sa Majesté Catholique... Quant aux moyens à employer...
– Monsieur, interrompit vivement le roi, ceci vous regarde seul... Vous avez pleins pouvoirs.
Pardaillan eut un sourire de satisfaction.
Le roi réfléchit un instant, et :
– Pour faciliter autant que possible l’exécution de cette mission forcément occulte, mais qui doit aboutir coûte que coûte, il est nécessaire que vous soyez couvert par une autre mission, officielle, celle-là. En conséquence, vous irez trouver le roi Philippe d’Espagne et vous le mettrez en demeure de retirer les troupes qu’il entretient dans Paris.
Et se tournant vers son secrétaire :
– Rusé, préparez des lettres accréditant M. le chevalier de Pardaillan comme notre ambassadeur extraordinaire auprès de S. M. Philippe d’Espagne. Préparez, en outre, des pleins pouvoirs pour M. l’ambassadeur.
Pardaillan, mélancolique et résigné, songeait :
– Allons ! il était écrit que je finirais dans la peau d’un diplomate !... Mais que dirait monsieur mon père si, sortant du tombeau, il voyait son fils promu à la dignité d’ambassadeur extraordinaire ?
Et à cette pensée, un sourire ironique arquait le coin de sa lèvre moqueuse.
– Combien d’hommes désirez-vous que je mette à votre disposition ? reprenait le roi.
– Des hommes ?... Pour quoi faire, sire ?... fit Pardaillan avec son air naïvement étonné.
– Comment, pourquoi faire ?... s’écria le roi stupéfait. Vous ne prétendez pourtant pas entreprendre cette affaire-là seul ? Vous ne prétendez pas lutter seul contre le roi d’Espagne et son inquisition ?... Vous ne prétendez pas enfin, et toujours seul, disputer la couronne de France à Philippe pour me la donner à moi ?...
– Ma foi, sire, répondit le chevalier avec un flegme imperturbable, je ne prétends rien !... Mais il est de fait que si je dois réussir dans cette affaire, c’est seul que je réussirai... C’est donc seul que je l’entreprendrai, ajouta-t-il froidement, en fixant sur le roi un œil étincelant.
– Ventre-saint-gris ! cria le roi suffoqué.
Pardaillan s’inclina pour manifester que sa résolution était inébranlable.
Le Béarnais le considéra un moment avec une admiration qu’il ne chercha pas à cacher. Puis ses yeux se portèrent sur ses conseillers, muets de stupeur, et enfin il leva les bras en l’air dans un geste qui signifiait :
– Après tout, avec ce diable d’homme, il faut s’attendre à tout, même à l’impossible.
Et à Pardaillan, qui attendait très calme, presque indifférent :
– Quand comptez-vous partir ?
– À l’instant, sire.
– Ouf !... Voilà un homme, au moins !... Touchez-là, monsieur.
Pardaillan serra la main du roi et sortit aussitôt, suivi de près par de Sancy, à qui le roi venait de donner un ordre à voix basse.
Au moment où le chevalier se disposait à monter à cheval, Sancy lui remit ses lettres de créance et son pouvoir, et :
– Monsieur de Pardaillan, dit-il, Sa Majesté m’a chargé de vous remettre ces mille pistoles pour vos frais de route.
Pardaillan prit le sac rebondi avec une satisfaction visible, et toujours gouailleur :
– Vous avez bien dit mille pistoles, monsieur de Sancy ?
Et sur une réponse affirmative :
– Peste, monsieur, le roi a-t-il donc fait fortune enfin ?... Ou bien cette réputation de ladrerie qu’on lui fait ne serait-elle qu’une légende comme... toutes les légendes ? Mille pistoles !... c’est trop ! beaucoup trop !