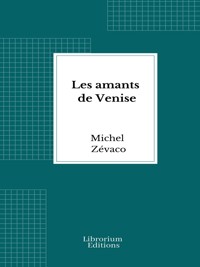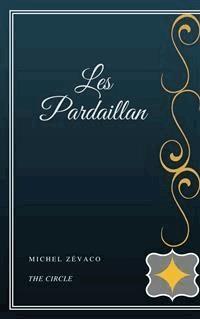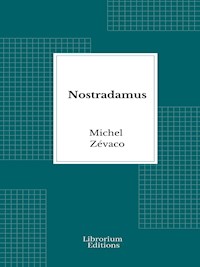3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Nous sommes à Paris en 1609. Henri IV règne, sous la menace permanente des attentats. Le chevalier de Pardaillan, qui n'a pas retrouvé son fils, rencontre un jeune truand, Jehan-le-Brave, en qui il ne tarde pas à reconnaître l'enfant de Fausta. Or, Jehan-le-Brave, qui ignore tout de ses origines, est amoureux de Bertille de Saugis, fille naturelle d'Henri IV. Pour protéger sa bien-aimée et le père de celle-ci, c'est-à-dire le roi, il entre en conflit avec tous ceux qui complotent sa mort: Concini et son épouse, Léonora Galigaï, Aquaviva, le supérieur des jésuites qui a recruté un agent pour ses intentions criminelles, le pauvre Ravaillac. Le chevalier de Pardaillan s'engage dans la lutte aux côtés de son fils, aussi bien pour l'observer que pour protéger le roi. Or, Fausta jadis avait caché à Montmartre un fabuleux trésor que tout le monde convoite, les jésuites, les Concini, et même le ministre du roi Sully. Seule Bertille connaît par hasard le secret de cette cachette, ainsi que le chevalier de Pardaillan...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 594
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Les Pardaillan, tome 7 : Le Fils de Pardaillan
Pages de titreLes Pardaillan VIII 1IIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIXXXXXIXXIIXXIIIXXIVXXVXXVIXXVIIXXVIIIXXIXXXXXXXIXXXIIXXXIIIPage de copyrightMichel Zévaco
Le fils de Pardaillan I
Michel Zévaco
Les Pardaillan VII
La série des Pardaillan comprend :
1. Les Pardaillan.
2. L’épopée d’amour.
3. La Fausta.
4. Fausta vaincue.
5. Pardaillan et Fausta.
6. Les amours du Chico.
7. Le fils de Pardaillan.
8. Le fils de Pardaillan(suite).
9. La fin de Pardaillan.
10. La fin de Fausta.
Le fils de Pardaillan I
Édition de référence :
Robert Laffont, coll. Bouquins.
Édition intégrale.
I 1
Nous sommes à Paris, Henri IV régnant sur la France pacifiée, par un matin de mai, clair, ensoleillé.
La fenêtre d’une petite maison bourgeoise de la rue de l’Arbre-Sec s’ouvre. Une jeune fille paraît au balcon. Les chauds rayons du soleil viennent poser comme une impalpable poussière d’or sur le nuage d’or de son opulente chevelure. Ses yeux plus bleus et plus purs que l’azur éclatant du ciel, sa taille élancée, ses formes d’une harmonie incomparable, une dignité ingénue dans ses attitudes, une franchise de regard admirable, un voile de mélancolie répandu sur ce front de neige, tout en elle force l’attention et la garde, tout en elle charme et captive.
Comme attirée par quelque force invincible, sa tête charmante se lève timidement, furtivement, vers la maison d’en face.
Là-haut, à la lucarne du grenier, apparaît un jeune cavalier. Et ce cavalier, les mains jointes, l’air extasié, fixe sur elle un regard profond, chargé d’une muette adoration.
La jeune fille rougit, pâlit... son chaste sein se soulève d’émoi... Elle demeure un instant les yeux posés sur ceux de l’inconnu, puis lentement, comme à regret, elle rentre chez elle et pousse le battant de la fenêtre.
*
En bas, dans la rue, un pauvre hère, dans l’ombre protectrice d’un renfoncement, dresse vers la radieuse apparition une face d’ascète morne, ravagée, où luisent, au-dessous de sourcils broussailleux, deux yeux vitreux de visionnaire. Et à la vue de la gracieuse jeune fille, voici que ces yeux de fou s’animent, s’humanisent, prennent une expression de douceur et de tendresse mystique. Voici que cette sombre physionomie s’illumine d’une joie céleste. Et le pauvre hère, lui aussi, joint les deux mains dans un geste d’imploration et murmure :
– Qu’elle est belle !...
Comme il prononce ces mots, quelque chose d’informe, un tas, une énorme boule de graisse, déboule on ne sait d’où, roule avec une agilité surprenante et vient s’arrêter devant l’homme en adoration. Cela est couvert d’un froc cavalièrement relevé sur la hanche, surmonté d’une autre petite boule joviale outrageusement enluminée. Deux pattes de basset, courtes et cagneuses, servent de colonnes et deux pieds plats, immenses, sont les assises solides de ce monument de graisse. Et cela parle d’une voix de basse taille qui semble sourdre de profondeurs inconnues ; cela se prononce sans raillerie :
– Je vous y prends encore, frère Ravaillac !... Toujours plongé dans vos sombres visions, donc !
Brutalement arraché à son rêve, Ravaillac, Jean-François Ravaillac tressaille violemment. Ses traits reprennent leur expression absente, l’étincelle de vie allumée dans son œil s’éteint brusquement, et ramenant son regard à terre, sans contrariété apparente, sans surprise, sans plaisir, avec une morne indifférence, il dit doucement, poliment :
– Bonjour, frère Parfait Goulard.
À ce moment, la jeune fille ferme sa fenêtre sans avoir eu la curiosité de jeter un coup d’œil en bas. Ravaillac pousse un soupir et, sans affectation, s’éloigne dans la direction de la rue Saint-Honoré, proche, entraînant avec lui le frère Parfait Goulard, enchanté de la rencontre, et qui se prête complaisamment à la manœuvre.
Le moine cependant a guigné du coin de l’œil la jeune fille. Il a noté le soupir de celui qu’il a appelé frère Ravaillac. Mais il ne laisse rien paraître et sa bonne grosse face demeure parfaitement hilare.
En s’éloignant, ils croisent un personnage qui doit être quelque puissant seigneur, à en juger par sa mine hautaine et par la richesse du costume. Ce seigneur discute âprement avec une digne matrone qui a toute l’apparence d’une petite bourgeoise.
En passant près du moine, le brillant seigneur ébauche un geste furtif auquel le moine répond par un clignement d’yeux.
Ni la vénérable matrone ni Ravaillac ne remarquent cet échange de signaux mystérieux.
Le grand seigneur et la bourgeoise continuent leur chemin et viennent s’arrêter devant le perron de la petite maison de la jeune fille. Ils continuent à discuter avec animation et ni l’un ni l’autre ne font attention à une ombre blottie dans une encoignure, laquelle, bien qu’ils parlent à voix basse, ne perd pas un mot de leur entretien.
Le jeune cavalier était resté accoudé à sa lucarne.
Peut-être ressassait-il son bonheur. Peut-être attendait-il patiemment qu’une heureuse fortune lui permît d’apercevoir encore une fois un bout de ruban ou l’ombre de la bien-aimée se profiler sur les vitraux... Les amoureux, on le sait, sont insatiables. Celui-ci, tout à ses rêves, ne voyait rien en dehors du balcon où elle lui était apparue.
Sous ce balcon, cependant, leur discussion sans doute terminée, la matrone avait franchi les trois marches et mettait la clé dans la serrure.
Par hasard, les yeux de l’amoureux quittèrent un instant le bienheureux balcon et se portèrent dans la rue. Alors, un cri de colère lui échappa, à la vue du seigneur qui n’avait pas bougé :
– Encore ce ruffian maudit de Fouquet !...
Il se pencha à faire croire qu’il allait se précipiter tête première. Et il grinçait :
– Que fait-il là, devant sa porte ?... Qui appelle-t-il ainsi ?...
En effet, à ce moment, celui que notre amoureux venait de nommer Fouquet appelait la matrone qui se disposait à entrer dans la maison. Elle redescendit une marche et tendit la main. Geste d’adieu ?... Marché conclu ?... Arrhes données ?... C’est ce que l’amoureux n’aurait pu dire. Il lui sembla bien entrevoir une bourse... Mais le geste avait été si rapide, si subtil l’escamotage !... En tout cas, il connaissait la matrone, car en se retirant précipitamment de la fenêtre, il était blême et il bredouillait :
– Dame Colline Colle !... Ah ! par tous les démons de l’enfer, je veux savoir !... Malheur au damné Fouquet !...
Et il se rua en trombe dans l’escalier.
À cet instant précis, trois braves s’arrêtaient devant sa porte. Ils avaient des allures de tranche-montagne, avec des rapières formidables qui leur battaient les talons. À les voir, on devinait des diables à quatre, ne redoutant rien ni personne. Et cependant ils restaient indécis devant la porte, n’osant soulever le marteau.
– Eh vé ! dit l’un avec un accent provençal, vas-y toi, Gringaille... Tu es Parisien, tu parles bien...
– Voire ! répondit l’interpellé. Tu n’as pas non plus ta langue dans ta poche, toi, Escargasse... M’est avis cependant que Carcagne me paraît être celui de nous trois qui a le plus de chance de s’en tirer avec honneur... Il a des manières si avenantes, si polies !...
L’homme aux manières polies dit à son tour :
– Vous êtes encore de singuliers bélîtres de me vouloir exposer seul à la colère du chef... Savez-vous pas, mauvais garçons que vous êtes, qu’il nous a formellement interdit de nous présenter chez lui sans son assentiment ?... Pensez-vous que je me soucie de me faire jeter par la fenêtre uniquement pour préserver vos chiennes de carcasses ?...
– Il faut cependant lui faire savoir que le signor Concini désire le voir aujourd’hui même.
– Que la peste l’étrangle, celui-là ! Il avait bien besoin de nous charger d’une commission pareille !
– Vé ! allons-y ensemble.
– Au moins nous serons trois à recevoir l’averse.
– Ce sera moins dur.
Ayant ainsi tourné la difficulté, ils se prirent par le bras et allongèrent la main vers le marteau.
La porte s’ouvrit brusquement, quelque chose comme un ouragan fondit sur eux, les sépara brutalement, les envoya rouler à droite et à gauche. C’était l’amoureux, qui se mit à remonter la rue en courant.
– C’est le chef ! s’écria Escargasse. J’ai reconnu sa manière de nous dire bonjour.
Et il se tenait la mâchoire ébranlée par un maître coup de poing.
– Malheur ! gémit Gringaille en se relevant péniblement, je crois qu’il m’a défoncé une côte.
– Où court-il ainsi ? dit Carcagne qui n’avait reçu qu’une bourrade sans conséquence.
Chose curieuse, ils ne paraissaient ni étonnés ni mortifiés. Ils étaient dressés sans doute.
Sans s’attarder plus longtemps, tous trois, ensemble :
– Suivons-le !...
Et ils se lancèrent à la poursuite de celui qu’ils appelaient « le chef » et qu’ils paraissaient tant redouter.
Celui-ci, trompé par une vague similitude de costume et de démarche, s’était lancé dans la direction de la Croix-du-Trahoir située au bout de la rue. Il allait droit devant lui, comme un furieux, bousculant et renversant tout ce qui lui faisait obstacle, sans se soucier des protestations et des malédictions soulevées sur son passage.
Il avait ainsi parcouru une cinquantaine de toises lorsqu’il heurta violemment un gentilhomme qui cheminait devant lui. Il continua d’avancer sans se retourner, sans un mot d’excuse. Mais, cette fois-ci, il était tombé sur quelqu’un qui n’était pas d’humeur à se laisser malmener :
– Holà !... Hé !... monsieur l’homme pressé ! s’écria le gentilhomme.
L’amoureux ne tourna pas la tête. Peut-être n’avait-il pas entendu.
Tout à coup, une poigne s’abattit sur son épaule. Sans se retourner, confiant en sa force, il se secoua comme un jeune sanglier, pensant faire lâcher prise au gêneur. Mais le gêneur ne céda pas. Au contraire, son étreinte se resserra, se fit plus puissante. Sous la poigne de fer qui le maîtrisait, l’amoureux fut contraint de s’arrêter. Il se retourna en grinçant.
Il se vit en présence d’un gentilhomme de haute mine qui pouvait avoir une soixantaine d’années, mais n’en paraissait pas cinquante. En tout cas, ce gentilhomme était doué d’une force prodigieuse, puisqu’il avait pu, d’une seule main, paralyser, sans effort apparent, la résistance de notre amoureux.
Face à face, les deux hommes se regardèrent dans les yeux un inappréciable instant.
La stupeur, la honte, l’admiration, la fureur, le désespoir, tous ces sentiments passèrent sur le visage expressif du jeune homme.
Le gentilhomme, très calme, sans colère, le regardait d’un air froid. Il faut croire que ce gentilhomme n’était pas le premier venu. Comme si cette jeune physionomie qu’il considérait avait été un livre ouvert dans lequel il lisait couramment, une expression de pitié adoucit son œil fixe jusque-là et, lâchant le bouillant amoureux, il lui dit avec une douceur qui n’excluait pas une certaine hauteur :
– Je vois, monsieur, que si je vous laisse aller, ma susceptibilité va être cause de quelque irréparable malheur.
« Il me convient d’oublier la brusquerie de vos manières. Allez, jeune homme, pour cette fois-ci le chevalier de Pardaillan oubliera votre incivilité. »
L’amoureux eut un sursaut violent, ses yeux s’injectèrent, sa main se crispa sur la poignée de sa rapière comme s’il eût voulu dégainer à l’instant même. Mais il n’acheva pas le geste et, secouant la tête, pour lui-même, il expliqua :
– Non !... Je n’ai pas un instant à perdre !...
Et se rapprochant du chevalier de Pardaillan jusqu’à le toucher, les yeux dans les yeux, il gronda :
– Vous voulez bien me pardonner !... Et moi qui ne suis pas chevalier, moi Jehan qu’on appelle le Brave, je ne vous pardonnerai jamais l’humiliation que vous venez de m’infliger... Je vous tuerai, monsieur !... Allez, profitez des quelques heures qui vous restent à vivre. Demain matin, à neuf heures, je vous attendrai derrière le mur des Chartreux... Et s’il vous convenait d’oublier le rendez-vous qu’il vous donne, sachez que Jehan le Brave saura vous retrouver, fussiez-vous au plus profond des enfers !
Et il repartit comme un fauve déchaîné.
Le chevalier de Pardaillan fit un mouvement en avant comme pour le saisir à nouveau. Puis il s’arrêta, haussa les épaules avec insouciance et s’éloigna paisiblement en sifflotant un air du temps de Charles IX.
II
Pendant que Jehan le Brave – à défaut de nom, laissons-lui ce fier prénom – pendant que l’impétueux amoureux, disons-nous, le cherchait du côté de la Croix-du-Trahoir, Fouquet était redescendu vers la rue Saint-Honoré.
Il passa sans s’arrêter auprès du moine Parfait Goulard, à qui il fit un signe imperceptible, et continua son chemin dans la direction du Louvre.
À peine était-il passé que le moine, poussant du coude son compagnon, lui glissa :
– Voyez-vous ce seigneur... là, devant nous... C’est Fouquet, marquis de La Varenne, entremetteur, Premier ministre des plaisirs de Sa Majesté !
Et le moine éclata d’un gros rire égrillard, tandis qu’une lueur fugitive s’allumait dans l’œil de Ravaillac. Tout à coup, le moine se frappa le front :
– Mais nous l’avons déjà croisé tout à l’heure !... Il était avec... attendez donc !... j’y suis !... avec dame Colline Colle, la propriétaire de cette petite maison devant laquelle je vous ai rencontré, précisément... Par saint Parfait, mon vénéré patron, je devine la manigance !... Dame Colline Colle a pour unique locataire une jeune fille... un ange de beauté, de candeur et de pureté... Je gage que le marquis a soudoyé l’honnête matrone... Eh ! eh !... ce soir peut-être, notre bon sire le roi passera par là... et demain peut-être aurons-nous une nouvelle favorite !...
L’ombre qui avait écouté la conversation de Fouquet de La Varenne avec dame Colline Colle sortit de son trou lorsque le marquis se fut éloigné.
C’était un homme dans la force de l’âge. Les tempes grisonnantes, plutôt grand, sec, merveilleusement musclé, avec ces mouvements souples, aisés, que donne la pratique régulière de tous les exercices violents. Physionomie rude que n’adoucissait pas l’éclat de deux yeux de braise.
L’homme resta un moment méditatif, les yeux fixés sur la lucarne de Jehan le Brave, et lorsque le jeune homme passa comme une rafale, il le suivit longtemps d’un regard étrange, terrible, un sourire énigmatique aux lèvres, puis il se dirigea d’un pas assuré vers la rue Saint-Honoré et pénétra dans une maison de fort belle apparence...
Cette maison c’était le logis de Concini...
L’homme resta là une demi-heure environ puis ressortit et se dirigea à nouveau, en flâneur, vers la rue de l’Arbre-Sec. Il allait le nez au vent, sans but précis, en apparence du moins. Tout à coup, son œil se posa, avec cette même expression étrange que nous avons signalée, sur Jehan le Brave qui paraissait chercher quelqu’un, à en juger par l’attention avec laquelle il dévisageait les passants. L’homme s’approcha doucement et posa la main sur l’épaule du jeune homme qui se retourna tout d’une pièce. En reconnaissant à qui il avait affaire, il eut un geste de déception. Néanmoins sa physionomie s’adoucit d’un vague sourire, et il dit :
– Ah ! c’est toi, Saêtta !... J’avais espéré...
Saêtta, puisque tel était son nom, demanda :
– Que cherches-tu donc, et qu’avais-tu espéré, mon fils ?
À ces mots, prononcés avec une intonation bizarre, les traits mobiles et fins de Jehan le Brave se contractèrent. Il releva vivement, rudement :
– Pourquoi m’appelles-tu ton fils ?... Tu sais bien que je ne le veux pas !... Au surplus, tu n’es pas mon père !...
– C’est vrai, dit lentement Saêtta en l’étudiant avec une attention farouche, c’est vrai, je ne suis pas ton père...
« Cependant, quand je te ramassai – voici tantôt dix-huit ans – mourant de froid et de faim, sur le bord de la route où tu étais abandonné, tu avais deux ans à peine... Si je ne t’avais pris, emporté, soigné, veillé nuit et jour, car tu fus malade d’une mauvaise fièvre qui faillit t’emporter... si je n’avais fait cela, tu serais mort... Et depuis ce moment jusqu’au jour où je t’ai senti assez fort pour voler de tes propres ailes, qui donc a eu soin de toi, t’a nourri, élevé, qui donc a fait de toi l’homme sain, robuste, vigoureux que tu es devenu ? Moi, Saêtta !... Qui t’a mis au poing la rapière que voici et t’a appris le fin du fin de l’escrime, qui a fait de toi une des plus fines – si ce n’est la plus fine – lames du monde ? Moi !... Aujourd’hui tu es un brave sans pareil, fort comme Hercule lui-même, audacieux, entreprenant ; tu commandes à des hommes qui ne craignent ni Dieu ni diable et qui tremblent devant toi ; tu es le roi du pavé, la terreur et le désespoir du guet, l’admiration de la truanderie qui n’attend qu’un signe de toi pour te proclamer roi d’Argot... Qui a fait tout cela ?... Moi !... Mais je ne suis pas ton père... Tu ne me dois rien. »
Tout ceci avait été débité d’une voix âpre, mordante. Jehan avait laissé dire, sans chercher à interrompre, et pendant que Saêtta parlait, il tenait ses yeux fixés obstinément sur lui. On eût dit qu’il attendait anxieusement une parole qui ne tombait pas. Quand il vit que l’autre avait fini, il se secoua furieusement, comme pour jeter bas le fardeau de pensées obsédantes, et il gronda :
– C’est vrai !... Tout ce que tu dis là est vrai !... Mais il paraît que je suis un monstre... ou peut-être m’as-tu trop bien élevé, puisque...
– Achève, dit Saêtta, avec un sourire sinistre.
– Eh bien, oui, par l’enfer ! j’achèverai. Quand tu me regardes, comme tu le fais en ce moment, avec ce sourire satanique, quand tu me parles, de cet air narquois qui m’enrage, quand tu m’appelles ton fils, avec cette équivoque intonation, je sens, je devine que tu es mon plus mortel ennemi... que tout ce que tu as fait pour moi, tu l’as fait dans je ne sais quelle intention tortueuse... terrible, peut-être... et alors, je sens la haine me soulever, et j’ai des envies furieuses de te tuer !...
Avec un calme glacial, Saêtta dit :
– Qui t’arrête ?... Tu as ton épée, j’ai la mienne... Je fus ton maître, mais depuis longtemps tu m’as surpassé... Je ne pèserai pas lourd contre toi.
– Enfer ! rugit Jehan le Brave, c’est cela précisément qui m’arrête !... Je ne suis pas un assassin, moi !... C’est la seule chose que tu n’as pas réussi à faire de moi !...
Le sourire de Saêtta se fit plus aigu, plus équivoque, si possible. Et brusquement, changeant de physionomie, avec une bonhomie qui conservait malgré lui on ne sait quoi de louche :
– Tu es d’une nature trop impressionnable, dit-il, ce n’est pas ta faute... Tu es ainsi... Moi, je suis rude, violent, affligé d’un physique qui n’inspire pas la sympathie... Ce n’est pas ma faute... Je suis ainsi... Bravo, j’ai fait de toi un bravo... Pouvais-je prévoir que tu aurais un jour des délicatesses de gentilhomme ?... Je ne puis te parler un langage qui n’est pas le mien...
Et soudain, fixant sur lui un regard étrange, avec une émotion que trahissait le tremblement de la voix :
– Cependant, je me suis attaché à toi... Tu es... oui, tu es le seul lien qui me rattache à la vie... Je n’ai plus que toi... Et comme je ne veux pas te perdre, je m’efforcerai d’adoucir mes manières pour toi... Je ne peux pas mieux te dire.
L’effort qu’il venait de faire était évident, et cependant, celui à qui il parlait, celui pour qui cet effort était accompli, parut ressentir une sensation d’angoisse. Sur ce visage étincelant, où toutes les sensations se lisaient comme en un livre ouvert, une expression de malaise se répandit soudain. On voyait qu’il était touché et qu’il cherchait une bonne parole... Cette parole, il ne la trouvait pas. Pourquoi ?
Comme s’il eût compris, Saêtta ébaucha son énigmatique sourire et, changeant brusquement la conversation :
– Tu ne m’as pas dit ce que tu cherchais, ce que tu espérais ?
Jehan se frappa le front :
– Qui je cherchais ? fit-il d’une voix ardente. Un insolent qui... Mais d’abord, tu connais ma force musculaire, n’est-ce pas ? Tu as cru, et moi-même je le croyais, que personne n’était de taille à me résister !... Eh bien, ici, dans cette rue, je me suis heurté à quelqu’un qui m’a saisi... et je n’ai pu me dégager de cette étreinte...
– Oh ! s’exclama Saêtta avec une véritable émotion, que dis-tu là ?... Je ne connais qu’une personne au monde qui soit de force...
– Tu connais quelqu’un qui est plus fort que moi ?
– Oui.
– Son nom ?...
– Le chevalier de Pardaillan.
– Tripes de Satan !... C’est lui !... C’est mon insolent.
– Oh oh ! fit Saêtta, et rien ne saurait traduire tout ce que contenaient de sous-entendus ces deux simples onomatopées. Tu connais Pardaillan ?... Tu l’as vu ?... C’est lui que tu cherches ?... pour te battre, pour le tuer, hein ?... Parle donc !
Et cette fois, son émotion était si violente, que Jehan en fut bouleversé.
– Je l’ai rencontré tout à l’heure, je te l’ai dit.
– Porco dio !... Cela devait arriver... Et tu vas te battre, nécessairement ?
– Oui.
– Quand ?
– Demain matin.
– Dieu soit loué !... Je t’ai rencontré à temps !
– Enfer !... M’expliqueras-tu ?...
– Rien que ceci : Pardaillan t’a saisi et tu n’as pu te dégager... Si tu croises le fer avec lui, il te tuera...
– Me tuer, moi ! Allons donc !
– Je te dis que Pardaillan est le seul homme au monde qui soit plus fort que toi... Mais je ne veux pas qu’il te tue, moi !... Non, per la Madona !... Demain matin, m’as-tu dit ?... Répète... C’est demain matin que tu dois te battre avec lui ?...
– Oui, fit Jehan, stupéfait.
– Bon !... Alors je suis tranquille, fit Saêtta, qui paraissait se calmer.
– Tu es tranquille ?... pourquoi ?... Que veux-tu dire ?...
– Simplement ceci : demain matin, Pardaillan ne pourra plus rien contre toi !
– Étrange ! murmura le jeune homme. Quelle émotion !... Jamais je n’ai vu Saêtta aussi ému... Mais alors ?... Il m’aime donc ?... Oui, sans doute... Sans quoi il ne tremblerait pas ainsi pour moi !... Je m’y perds... Serais-je décidément mauvais ?...
Et tout haut, d’un ton brusque, mais singulièrement radouci :
– As-tu besoin d’argent ?...
– Non !... c’est-à-dire... donne toujours, fit Saêtta, en empochant la bourse rebondie que le jeune homme glissait dans sa main.
Jehan s’éloignait, l’air rêveur.
Saêtta dardait sur son dos un regard terrible et grinçait :
– Demain matin !... Il sera trop tard !... Pardaillan ne pourra rien contre toi... parce que tu appartiendras au bourreau...
Il parut s’abîmer dans des réflexions profondes et il grommelait :
– Le laisser tuer par Pardaillan ?... Oui... à la rigueur... Mais j’ai mieux que cela... Va, fils de Fausta, fils de Pardaillan, va, cours à l’abîme que j’ai creusé sous tes pas !... L’heure de la vengeance a enfin sonné pour moi !
Et s’enveloppant dans son manteau, de son pas souple et cadencé, il se dirigea vers le Louvre.
III
La cour est dans le marasme. Le roi ne dort plus... Le roi ne mange plus... Le roi, si débordant de vie, ne traite plus les affaires de l’État avec ses ministres. Il fuit la société de ses intimes, il s’enferme des heures durant dans sa petite chambre à coucher du premier...
Le roi est malade : de qui est-il donc amoureux ?
Voilà ce que disent les courtisans ordinaires.
Voici maintenant ce que savent et gardent pour eux cinq ou six intimes de Sa Majesté :
Le roi a vu une jeune fille de seize ans à peine. Et il a éprouvé le coup de foudre.
Comme toujours, chez lui, ce nouvel amour a altéré son humeur et sa santé. D’autant plus profondément que, chose inouïe, et qui prouve combien cette fois-ci il est bien assassiné d’amour, lui, si entreprenant et si expéditif en pareille occurrence, devenu plus timide que le plus timide des jouvenceaux, il n’a pas osé « déclarer sa flamme ».
Et tous les soirs, sous des déguisements divers, le roi s’en va rue de l’Arbre-Sec soupirer sous le balcon de sa belle...
Les confidents du roi se sont empressés d’aller rôder autour du logis de celle qui peut devenir la grande favorite...
Tout ce qu’ils ont appris, c’est que la jeune fille est couramment désignée sous le nom de « demoiselle Bertille ». Demoiselle Bertille ne sort jamais, si ce n’est le dimanche, pour aller assister à la messe à la chapelle des Cinq-Plaies. Alors elle est accompagnée par sa propriétaire, respectable matrone qui répond au nom de dame Colline Colle. Quelques-uns cependant ont pu apercevoir demoiselle Bertille. Ceux-là sont revenus enthousiasmés de son idéale beauté.
L’après-midi de ce jour où se sont déroulés les différents incidents que nous venons de narrer, le roi était dans sa petite chambre. Il était assis sur sa chaise basse, et du bout des doigts il tambourinait machinalement sur l’étui de ces lunettes. De temps en temps, il poussait un soupir lamentable et gémissait :
– Que fait donc La Varenne ?
Et il reprenait le cours de ses pensées :
– Jamais femme ne m’a produit l’effet que me produit cette jeune fille !... Bertille !... Le joli nom, si clair, si frétillant !... Bertille !... Jarnidieu ! d’où vient donc que je suis troublé à ce point ? Est-ce la candeur, l’innocence de cette jeune fille ?... Je ne me reconnais plus !... Ce cuistre de La Varenne ne viendra donc pas !...
Brusquement Henri IV frappa ses deux cuisses et se leva en murmurant :
– J’ai beau chercher, je ne trouve pas... qui donc ce doux visage me rappelle-t-il ? Qui donc ?... Voyons, parmi les belles que j’ai eues autrefois, cherchons...
Il fit plusieurs fois le tour de la chambre, de ce pas accéléré qui faisait le désespoir du vieux Sully, obligé de le suivre quand il expédiait les affaires avec lui, et tout à coup :
– Ventre-saint-gris ! J’ai trouvé !... Saugis !...
L’air rêveur, il revint s’asseoir sur sa chaise et poursuivit :
– C’est à la demoiselle de Saugis que ressemble mon doux cœur de Bertille... Saugis !... Heu ! c’est bien loin cela !... Ma conduite ne fut peut-être pas très nette vis-à-vis de cette demoiselle... Dieu me pardonne, je crois que je l’ai quelque peu violentée... J’avais sans doute trop bien soupé ce jour-là !... Hé ! mais, j’y songe... C’est curieux comme les souvenirs se lèvent nombreux et précis quand on fouille sérieusement le passé. Cette pauvre Saugis, je crois bien qu’elle est morte en donnant le jour à un enfant qui aurait bien, oui, ma foi, seize ans... l’âge de Bertille !...
Pour la première fois, un soupçon vint l’effleurer, car il répéta :
– L’âge de Bertille !...
Il rejeta la pensée qui se faisait obscurément jour dans son cerveau :
– Était-ce un garçon ou une fille ?... Du diable si je le sais... Je n’aurais jamais pensé à cela sans cette vague ressemblance... Est-elle si vague ?... Heu !...
Et pour se remonter soi-même :
– Par Dieu ! je suis content d’être sorti de ce souci... Me voilà plus tranquille... Je veux, pour les beaux yeux de Bertille, faire rechercher cet enfant de la pauvre Saugis et, garçon ou fille, je lui ferai un sort raisonnable. C’est dit, et je ne m’en dédirai pas... Après tout, c’est un enfant à moi... Mais que fait donc ce bélître de La Varenne ?...
Comme il se posait cette question pour la centième fois, La Varenne fut introduit. Le confident paraissait radieux et, tout de suite, avec cette familiarité qu’Henri IV encourageait dans son entourage et savait d’ailleurs royalement réprimer lorsqu’elle allait trop loin, il s’écria :
– Victoire ! Sire, victoire !
Le roi devint très pâle, porta la main à son cœur et chancela en murmurant :
– La Varenne, mon ami, ne me donne pas de fausse joie... je me sens défaillir.
Et, en effet, il paraissait sur le point de s’évanouir.
– Victoire, vous dis-je !... Ce soir, vous entrez dans la place ! Du coup, le roi fut debout et, radieux :
– Dis-tu vrai ?... Ah ! mon ami, tu me sauves !... Je me mourais... Ce rôle d’amoureux transi commençait à peser. Ce soir, dis-tu, qu’as-tu fait ?... Tu l’as vue ?... Tu lui as parlé ?... M’aime-t-elle un peu, au moins ?... Ne me cache rien, La Varenne... Ce soir, je la verrai, je lui parlerai, enfin !... Jarnidieu ! qu’il fait bon vivre et quel radieux jour que ce jour !... Parle. Raconte-moi tout... Mais parle donc !... Il faut t’arracher les paroles du ventre !
– Eh, mordieu ! Vous ne me laissez pas placer un mot !... S’il faut vous dire les choses tout à trac : j’ai acheté la propriétaire, qui nous ouvrira la porte ce soir.
– Cette matrone qui paraissait incorruptible ?
La Varenne haussa les épaules :
– Le tout était d’y mettre le prix, dit-il. Il m’en a coûté vingt mille livres, pas moins.
Et en même temps, il étudiait du coin de l’œil l’effet produit par l’énoncé de la somme.
Henri IV savait se montrer généreux en amour. Il n’en était plus de même quand il s’agissait de lâcher la forte somme à ceux qui servaient ses amours :
– Tu m’as demandé la place de contrôleur général des postes, dit-il. Tu l’as.
La Varenne se cassa en deux et, avec une grimace de jubilation, il supputait à part lui :
– Allons, j’ai fait un bon placement ! La place me remboursera au centuple les dix mille livres que j’ai dû donner à cette sorcière de Colline Colle, que le diable l’étrangle !
– Raconte-moi tout par le menu, fit joyeusement le roi, qui avait retrouvé toute sa vivacité.
Pendant que l’homme à tout faire du roi, l’ancien cuisinier créé marquis de La Varenne, expliquait à son maître comment il pourrait s’introduire subrepticement chez une innocente enfant qu’il s’agissait de déshonorer, il se passait dans une autre partie du Louvre une scène qui a sa place ici.
Une jeune femme était nonchalamment étendue sur une sorte de chaise longue appelée lit d’été. Une carnation de ce blanc laiteux particulier à certaines brunes, des cheveux naturellement ondulés et d’un beau noir, des traits réguliers, des lèvres pourpres, sensuelles, des yeux noirs mais froids, des formes imposantes, la splendeur d’une Junon en son plein épanouissement.
C’est Marie de Médicis, reine de France.
Sur un pliant de velours cramoisi, une autre jeune femme dont le corps est maigre et contrefait, le teint plombé, la bouche trop grande, une épaule plus haute que l’autre, une femme dont la laideur semble avoir été choisie pour servir de repoussoir à l’imposante beauté de l’autre. La seule supériorité de cette disgraciée de la nature résidait dans ses yeux : des yeux noirs, immenses, brillant d’un feu sombre, reflet d’une âme forte que consume une flamme dévorante.
C’était Léonora Doré, plus connue sous le nom de la Galigaï. Elle est dame d’atours de la reine... Elle est aussi la femme légitime du signor Concino Concini, qui n’est pas encore marquis, pas encore maréchal, pas encore Premier ministre, mais qu’elle « veut » voir devenir tout cela... et même plus, si possible... car il est dès maintenant – elle le sait – l’amant de la reine... Et c’est sur cet amour insensé qu’elle compte et qu’elle échafaude l’avenir.
Cette énigmatique créature n’a jamais eu qu’un sentiment réellement profond : son amour pour Concini ; qu’une seule et unique ambition : la grandeur de Concini. Peut-être espère-t-elle qu’en le hissant, par la seule puissance de son mâle génie, jusqu’à ces sommets accessibles à ceux-là seuls qui sont nés sur les marches d’un trône, peut-être espère-t-elle ainsi l’éblouir et faire jaillir en lui l’étincelle qui embrasera ce cœur jusque-là fermé pour elle – car il ne l’aime pas, il ne l’a jamais aimée – peut-être !...
Quoi qu’il en soit, elle a résolu de pousser Concini jusqu’à la toute-puissance, et c’est dans ce but qu’elle a jeté l’homme qu’elle adore dans les bras de la reine... la reine, qui peut le faire grand. C’est dans ce but qu’elle a écarté ou supprimé tous les obstacles. De ces obstacles, il n’en reste plus qu’un : le plus terrible, le plus puissant... le roi ! Et cet obstacle, Léonora a résolu de le supprimer comme tous les autres. Et ce qu’elle veut, de sa volonté implacablement tenace, c’est amener Marie de Médicis, caractère faible et indécis qu’elle pétrit lentement à sa guise, à accepter la complicité du meurtre de son royal époux. Ce qu’elle veut, c’est amener la reine qui ne « veut » pas se séparer de Concini, qui ne « peut » pas se passer de lui, à couvrir le régicide.
Ses yeux sombres, chargés d’effluves, se fixaient sur les yeux de la reine, qui clignotaient comme éblouis par l’insoutenable éclat de ce regard de feu, et, penchée sur le visage de sa maîtresse, pareille à quelque sombre génie du mal, elle parlait d’une voix basse, insinuante. Et ses paroles prudentes, mesurées, distillaient la mort !
– Pourquoi ces hésitations, ces scrupules ? (Elle hausse les épaules.) Laissez les scrupules à la masse du vulgaire, pour qui ils ont été inventés. N’attendez pas pour vous décider que votre perte soit consommée.
Et comme Marie de Médicis demeurait muette et songeuse, la tentatrice reprit, d’une voix qui se fit plus âpre, où perçait une ironie menaçante :
– Quand vous serez répudiée, honteusement chassée et que votre fils sera déclaré bâtard, pour la grande gloire du fils de Mme d’Entraigues1, alors, madame, vous verserez des larmes de sang, alors vous regretterez votre indigne faiblesse et de pas m’avoir laissé faire... Trop tard, madame, il sera trop tard !
La reine répondit par une question :
– Léonora, es-tu bien certaine qu’il ira ce soir rue de l’Arbre-Sec ?
– Tout à fait certaine, madame...
Un silence. Marie de Médicis semble méditer profondément. La Galigaï l’observe avec une imperceptible moue de dédain.
– Et... ce jeune homme dont tu m’as parlé, reprit enfin la reine, qui paraissait chercher ses mots, es-tu bien sûre de lui ?
Elle baissa davantage la voix, jeta un coup d’œil inquiet autour d’elle et acheva :
– Ne s’avisera-t-il pas de parler... après ?
– Sur la tête de Concini, madame, je réponds de lui, je réponds de tout. Ce jeune homme frappera sans trembler... Il ne parlera pas après, parce que c’est pour son propre compte qu’il agira.
– Il hait donc bien le roi ?
Léonora eut un insaisissable sourire : la reine paraissait accepter la complicité. Sans rien laisser paraître de ses sentiments, elle dit :
– Non !... Mais il est amoureux... et jaloux comme tous les amoureux. Or, la jalousie, madame, engendre facilement la haine.
– Pas pourtant jusqu’au point de se faire assassin.
– Si, madame, lorsqu’il s’agit d’une nature violente et passionnée comme celle de ce jeune homme. Ce matin même, pour l’avoir vu de sa fenêtre au moment où il soudoyait la propriétaire de la jeune fille en question, ce jeune homme s’est rué comme un fou à la recherche de M. de La Varenne. S’il avait pu le joindre, la carrière du marquis était terminée du coup... Mais vous vous trompez étrangement quand vous parlez d’assassinat... Ce jeune homme est un bravo, c’est vrai. Mais un bravo extraordinaire... comme on n’en vit jamais de pareil... Ne croyez pas qu’il ira traîtreusement poignarder... celui dont nous parlons. C’est en face qu’il l’attaquera. C’est en un combat loyal qu’il le tuera.
– Enfin, comment t’y prendras-tu pour l’amener à accomplir... ce geste ?...
– Je m’intéresse à lui, moi... C’est mon droit... D’ailleurs il est le fils d’adoption d’un de mes compatriotes... Pour lui témoigner cet intérêt, je glisse dans son oreille un renseignement... Est-ce ma faute, à moi, si ce renseignement déchaîne la haine en lui ? Et si la haine, chez lui, se traduit par des gestes qui tuent, en suis-je responsable ?...
Elle était effroyable de cynisme tranquille, et c’est ainsi qu’elle dut apparaître à Marie de Médicis, car elle murmura, vaguement épouvantée :
– Tu es terrible, sais-tu ?
Léonora sourit dédaigneusement et ne répondit pas. Poussée par la curiosité, peut-être avec le secret espoir de faire dévier cette conversation qui l’épouvantait, la reine s’informa :
– Qui est ce malheureux ?... Comment s’appelle-t-il ?
– On le connaît sous le nom de Jehan le Brave. Où est-il né ? Le nom de son père et de sa mère ?... Mystère. Saêtta, qui l’a élevé et l’aime comme son fils, pourrait peut-être répondre à ces questions. Mais il est muet sur ces points... Ce que je sais, pour l’avoir vu à l’œuvre, c’est que c’est une force... Malheureusement pour lui, il a des idées à lui... des idées qui ne sont pas celles de tout le monde... C’est un fou.
À ce moment, la porte du cabinet s’ouvrit silencieusement et Caterina Salvagia, la femme de chambre de confiance de la reine, parut dans l’entrebâillement. Sans entrer plus avant, elle fit un signe à Léonora et se retira discrètement aussitôt.
Marie de Médicis, sans doute au courant, se redressa sur son lit d’été et s’écria joyeusement, une flamme subite aux yeux :
– C’est Concini !... Fais-le entrer, cara mia !...
Elle pensait que, du coup, la terrible conversation était terminée. Mais la Galigaï ne bougea pas. Et, avec une froideur effrayante, elle posa nettement la question :
– Madame, dois-je exciter la jalousie de Jehan le Brave ?
Et la reine répéta le mot qu’elle avait eu déjà :
– Tu es terrible !...
La Galigaï attend, muette, impassible comme la fatalité.
La reine Marie de Médicis s’est redressée. Son regard s’emplit d’une lointaine épouvante. Ses lèvres tremblantes retiennent le mot terrible qui veut s’échapper et tomber... tomber comme une condamnation, car ce mot, c’est la mort du roi de France !
Enfin, elle gémit :
– Que veux-tu que je te dise ?... C’est terrible !... terrible !... Laisse-moi le temps de réfléchir... plus tard... attends... Tu peux bien attendre un peu, voyons !
Alors Léonora se leva et se courba dans une longue et savante révérence de cour. Elle exagéra la correction des attitudes imposées par l’étiquette et d’une voix tranchante qui contrastait avec cette humilité voulue :
– J’ai l’honneur de solliciter de Votre Majesté mon congé... et celui de Concino Concini, mon époux.
La reine pâlit affreusement. Elle bégaya :
– Tu veux me quitter ?
– S’il plaît à Votre Majesté, oui, dit Léonora glaciale. Demain matin nous quitterons la France.
Affolée par la pensée de perdre Concini, Marie cria :
– Mais je ne le veux pas !
– Votre Majesté daignera excuser mon insistance... Notre décision est irrévocable... Nos préparatifs de départ sont faits. Nous voulons nous retirer.
À ces mots, prononcés à dessein, la souveraine chez Marie de Médicis se réveille enfin et se révolte. Elle se redresse de toute sa hauteur, et laissant tomber un regard courroucé sur la confidente toujours courbée :
– Vous voulez ! répéta-t-elle en martelant chaque syllabe. Et moi, je ne veux pas !
– Madame...
– Assez !... Il ne me plaît pas d’accorder le congé que vous sollicitez... Allez !
Et comme la dame d’atours ébauchait un geste, elle reprit violemment :
– Allez-vous-en, dis-je, ou par la santa Maria, j’appelle et vous fais arrêter.
Léonora, comme écrasée, obéit, se retire à reculons. Et la reine, que cette feinte soumission apaise, se reproche déjà sa violence, soupire à la pensée qu’elle va être privée d’une visite de Concini.
Arrivée à la porte, la Galigaï se redressa et, respectueusement, sans bravade, mais d’une voix ferme :
– Votre Majesté, je pense, ne trouvera pas mauvais que j’aille de ce pas chez le roi.
Ces paroles jettent le trouble et l’effroi dans l’esprit de la reine, qui balbutie :
– Le roi !... Pour quoi faire ?...
– Le supplier de nous accorder ce congé que Votre Majesté nous fait l’insigne honneur de nous refuser.
À demi rassurée, Marie gronda :
– Tu... vous oseriez !... Malgré ma volonté !
– Pour mon Concini, oui, madame, j’oserai tout... même encourir la colère et la disgrâce de ma reine...
– Ingrate !... Tu n’es qu’une ingrate !...
C’était le prélude de la capitulation. L’effort que Marie de Médicis avait fait pour résister était aux trois quarts brisé. C’est que la pensée de perdre Concini l’affolait. C’est que l’amour de Concini était devenu toute sa vie.
Et Léonora, qui ne comptait que sur ce sentiment, le comprit bien, car elle dit plus doucement :
– Le roi accordera avec joie ce congé qui le débarrassera de nous... Vous le savez, madame.
Eh oui ! elle le savait. C’est pourquoi elle gémit :
– Mais enfin, pourquoi veux-tu t’en aller ?
– Eh ! madame, je vous vois disposée à tout pardonner au roi... à tout lui sacrifier... peut-être pousserez-vous l’abnégation jusqu’à vous effacer devant Mme de Verneuil... ou devant l’astre nouveau qui brillera demain sur la cour.
– Tu as peur que je t’abandonne ?
– Oui, dit nettement la Galigaï. Si j’étais seule, je vous dirais : disposez de ma vie, elle vous appartient. Mais il y a Concini, madame... C’est lui qu’on frappera... et je ne veux pas qu’on me le tue, moi !
– Moi vivante, on ne touchera pas à un cheveu de Concini !
– Le roi est le maître, madame.
– Ainsi... si tu te sentais en sûreté...
– Pas moi, madame... Concini.
– C’est ce que j’ai voulu dire... Tu ne parlerais plus de me quitter ?
– Eh, madame, vous savez bien que c’est la mort dans l’âme que nous vous quitterions... Concini surtout... Il vous est si dévoué, poveretto !
– Eh bien ?...
Une dernière hésitation suspendit la phrase.
– Eh bien ? interrogea Léonora, qui palpitait d’espoir.
La résolution de Marie de Médicis est prise : tout plutôt que perdre Concini.
– Eh bien, dit-elle d’une voix blanche, je crois, Léonora, que tu as raison... Il est temps de déchaîner la jalousie de ton protégé.
La reine venait de prononcer la condamnation de son époux, le roi Henri IV.
Léonora se courba pour dissimuler la joie puissante qui l’étreignait. En se relevant, elle dit simplement :
– Je vais vous envoyer Concini, madame.
Et elle sortit, froide, inexorable, emportant la mort dans les plis rigides de sa robe.
Cependant Marie de Médicis souriait à l’image évoquée de Concini. Et ses lèvres pourpres, entrouvertes, appelaient le baiser de l’amant qui allait venir, le baiser qui lui était dû... Car il était sa part à elle, sa part tacitement convenue dans le meurtre qui se préparait.
Madame d’Entraigues : Henriette de Balzac d’Entraigues, marquise de Verneuil, maîtresse de Henri IV (1579-1633).
IV
Henri IV avait décidé de se rendre à onze heures du soir rue de l’Arbre-Sec. Mais le Béarnais était un vif-argent. Dès neuf heures, bouillant d’impatience, ne tenant plus en place, il était parti, quittant le Louvre par une porte dérobée. Il avait, pour cette expédition, revêtu un de ces habits très simples et fort râpés, comme il les affectionnait, qui lui donnait l’apparence d’un pauvre gentilhomme et dont sa garde-robe était mieux fournie que d’habits neufs et luxueux. La Varenne l’accompagnait seul et devait le quitter à la porte de sa belle.
La maison de dame Colline Colle avait sa façade sur la rue de l’Arbre-Sec. Le derrière donnait sur une impasse appelée le cul-de-sac Courbâton. Il y avait là une porte basse renforcée de tentures épaisses. Sur le devant, la porte principale s’ornait d’un perron de trois marches. Les marches franchies, on se trouvait sur un palier d’où émergeaient deux piliers massifs qui supportaient le balcon en haut duquel nous avons entrevu, le matin même, la jeune fille chez laquelle le Vert Galant cherche à se glisser comme un larron. Les deux piliers, de chaque côté, et le balcon surplombant la porte formaient comme une voûte d’ombre opaque.
Devant la porte, La Varenne frappa dans ses mains deux coups rapprochés. Signal convenu avec la propriétaire. Et se penchant à l’oreille du roi, avec une familiarité obséquieuse et un rire cynique :
– Allez-y, Sire !... Enlevez la place... d’assaut.
Henri mit le pied sur la première marche et murmura :
– Jamais je ne fus aussi ému !
À ce moment une ombre surgit de derrière un des piliers, se campa au milieu, devant la porte, dominant ainsi le roi. En même temps une voix jeune et vibrante lança dans le silence de la nuit cet ordre bref :
– Holà !... Tirez au large.
La Varenne, qui déjà s’éloignait, revint précipitamment sur ses pas...
À cet instant précis, un cavalier s’avançait d’un pas insouciant. Entendant la voix impérieuse, apercevant ces deux ombres au bas d’un escalier, le cavalier s’arrêta à quelques pas du perron, s’immobilisa au milieu de la chaussée, curieux sans doute de ce qui allait se produire, et sans qu’aucun des acteurs de cette scène parût prêter attention à lui.
Cependant le roi avait reculé d’un pas. La Varenne, sur un signe qui recommandait la prudence, se campa au bas du perron, et d’un ton plein de morgue, il railla :
– Vous dites ?...
– Je dis, reprit la voix froide et tranchante, je dis que vous allez vous faire étriller selon vos mérites si vous ne déguerpissez à l’instant.
Il devenait difficile de parlementer avec un inconnu qui, du premier coup, le prenait sur ce ton. La Varenne l’essaya cependant et, d’une voix où commençait à percer l’impatience :
– Holà ! êtes-vous enragé ou fou ? monsieur... Comment, un paisible passant ne pourra pénétrer chez lui parce qu’il...
– Tu mens ! interrompit la voix qui se faisait plus âpre, plus mordante, tu ne demeures pas dans cette maison.
– Ah ! prenez garde, mon maître !... Vous insultez deux gentilshommes !...
– Tu mens encore !... Tu n’es pas gentilhomme ! tu es un marmiton... Retourne à tes marmites, mauvais gâte-sauce... Tu vas laisser brûler le rôti !
On ne pouvait faire une plus sanglante injure à La Varenne – dont la noblesse et le marquisat étaient de création récente encore – que de lui rappeler aussi brutalement la bassesse de son extraction. Livide de fureur, il hoqueta :
– Misérable !...
– Quant à ton compagnon, continua la voix dans un rire strident, il doit être gentilhomme, lui... puisqu’il cherche à s’introduire traîtreusement, la nuit, dans le logis d’une jeune fille sans défense pour y jeter la honte et le déshonneur !... Ah ! pardieu oui ! ce doit être un gentilhomme de haute et puissante gentilhommerie... puisqu’il ne recule pas devant une besogne vile... dont rougirait le dernier des truands !...
La Varenne ne manquait pas de cette bravoure à qui il faut le stimulant d’une galerie attentive pour la faire épanouir. Seul il eût déjà tiré au large comme l’avait ordonné Jehan le Brave – car on a deviné que c’était lui. Mais il y avait le roi. Impossible de se dérober. Puis le ton, écrasant d’impertinence, dont cet inconnu l’avait renvoyé à ses marmites, l’avait exaspéré jusqu’au délire, avait déchaîné en lui une haine implacable. Enfin sa bravoure était en tous points conforme à sa nature vile et tortueuse.
C’est ce qui fait que sournoisement il dégaina, et traîtreusement, à l’improviste, il porta un coup terrible de bas en haut en grinçant :
– Drôle !... Tu payeras cher ton insolence !
Jehan devina le coup plutôt qu’il ne le vit. Il ne fit pas un mouvement pour l’éviter. Seulement, d’un geste prompt comme l’éclair, il leva très haut le pied et le projeta violemment en avant.
Atteint en plein visage, La Varenne alla rouler sur la chaussée, où il demeura évanoui.
– Voilà ! « Drôle » est payé, dit froidement Jehan.
Le cavalier, qui avait assisté impassible à cette scène rapide, murmura :
– Le superbe lion !... Vrai Dieu ! voilà qui me change un peu de ce répugnant troupeau de loups et de chacals qu’on appelle des hommes. Je devine toute l’algarade. Mais à qui donc en a-t-il ?
À ce moment Jehan descendait les deux marches et s’approchait du roi.
– Monsieur, fit-il d’un ton rude, donnez-moi votre parole de ne jamais renouveler l’odieuse tentative de ce soir et je vous laisse aller... je vous fais grâce !
Effaré, stupide d’étonnement, troublé par l’imprévu, de l’aventure, le roi secoua la tête.
– Non !... Dégainez en ce cas, dégainez !
Et en disant ces mots, Jehan, d’un geste large, sans hâte inutile, tira son épée, fouetta l’air d’un coup sec, fit un pas vers le roi et avec un calme terrible :
– Je vais vous tuer, monsieur, dit-il. Au fait, ce sera plus sûr qu’une parole de gentilhomme, en quoi je n’ai aucune confiance.
Henri se ressaisissait. L’idée qu’il pouvait être en danger de mort ne lui venait pas encore. L’aventure n’était encore à ses yeux qu’un contretemps fâcheux. Certainement ce n’était qu’un malentendu, une méprise qui se dissiperait dès qu’il aurait fait entendre à ce forcené qu’il se trompait et s’attaquait à qui était assez puissant pour le briser. Il se redressa de toute sa hauteur et d’un ton dédaigneux où il entrait plus d’impatience que de colère :
– Prenez garde, jeune homme !... Savez-vous à qui vous parlez ?... Savez-vous que je puis d’un geste faire tomber votre tête ?...
Le cavalier aux écoutes sursauta :
– Cette voix !... On dirait !... Oh ! diable !...
Jehan le Brave fit un pas de plus dans la direction du roi, le toisa de haut en bas, car il le dominait de toute sa tête, et :
– Je sais, dit-il glacial. Mais avant que vous n’ayez ébauché ce geste, moi je vous plonge le fer que voici dans la gorge !
Cette fois, Henri commença de soupçonner que ce n’était pas une méprise, que c’était à lui personnellement que ce furieux en voulait. Néanmoins, il ne se rendit pas, et plus dédaigneux, plus hautain :
– Assez ! fit-il. J’ai affaire dans cette maison. Va-t-en !... Il en est temps encore.
– Dégainez, monsieur !... Il en est temps encore.
– Pour la dernière fois, va-t-en !... Tu auras la vie sauve !
– Pour la dernière fois, dégainez !... ou, par le Dieu vivant, je vous charge !...
Henri jeta un coup d’œil sur l’homme qui osait lui parler ainsi. Il vit un visage flamboyant. Il lut dans ces yeux étincelants une implacable résolution.
La peur, ce sentiment sournois et déprimant, Henri IV y était accoutumé. Il l’éprouvait chaque fois qu’il lui fallait faire face à un péril personnel. Mais toujours, par un effort de volonté admirable, il parvenait à maîtriser cette révolte de la chair et alors il n’y avait pas de brave plus follement brave que ce peureux. Cette fois, il s’aperçut, la sueur de l’angoisse sur les tempes, que l’esprit ne parvenait pas à dompter la matière. Pourquoi ?
C’est qu’il avait en lui une terreur – que les événements devaient justifier – et qu’il ne put jamais parvenir à refouler : la terreur de l’assassinat.
Or, Henri venait de lire dans les yeux de cet inconnu qu’il se savait en présence du roi. C’est pourquoi il ne se nomma pas. Or, si cet inconnu, sachant qu’il parlait au roi, osait menacer ainsi, c’est qu’il était résolu à tuer. C’était clair. Dès lors, il n’y avait plus qu’une alternative : se laisser égorger bénévolement ou se défendre de son mieux. Ce fut à ce dernier parti qu’Henri, faisant appel à tout son sang-froid, se résigna.
Lentement il dégaina et tomba en garde. Les fers s’engagèrent.
Dès les premières passes, Henri reconnut l’incontestable supériorité de son adversaire. Il sentit le frisson de la mort le frôler à la nuque, et dans son esprit éperdu il clama :
« Oh ! on m’a dépêché un redoutable coupe-jarret !... C’est un assassinat prémédité... Je suis perdu ! »
Il eut autour de lui ce regard angoissé du noyé qui cherche à quoi il pourra se raccrocher et il aperçut alors le cavalier qui s’était insensiblement rapproché.
– Holà ! monsieur, cria le roi, êtes-vous complice ?
Ceci pouvait sous-entendre : si vous n’êtes pas complice, ne me laissez pas égorger.
C’est ce que traduisit sans doute l’inconnu, car il s’approcha vivement et juste à point pour détourner le bras de Jehan, au moment où il se fendait à fond dans un coup droit foudroyant qui eût infailliblement tué le roi.
– Malédiction ! gronda furieusement le jeune homme, tu vas payer !...
Et il se rua l’épée haute sur le malencontreux inconnu.
À ce moment, la porte du logis si vaillamment défendu s’ouvrit d’elle-même et sur le seuil apparut la demoiselle Bertille.
Et le bras levé de Jehan retomba mollement. Le geste de mort s’acheva par un geste d’imploration à l’adresse de la pure enfant et cette physionomie l’instant d’avant si terrible prit une expression de douceur extraordinaire, ces yeux noirs si étincelants se voilèrent, semblèrent demander grâce. De quoi ?... Peut-être de l’avoir défendue sans son assentiment.
Le roi passa la main sur son front où perlait la sueur et murmura :
– Ouf !... J’ai vu la mort !...
Quant à l’inconnu, il regardait tour à tour la jeune fille et le jeune homme et un mince sourire errait sur ses lèvres narquoises pendant qu’il songeait :
– Voilà donc le joli tendron pour qui ce maître fou a osé tenir tête au plus puissant monarque de la terre, l’obliger, lui pauvre hère, à mettre flamberge au vent, le réduire à implorer l’assistance d’un passant !... Morbleu ! il me plaît, ce jeune lion ! Et elle !... Ma foi, elle est assez belle pour justifier aussi insigne folie !... Mais, décidément, c’est une belle chose que l’amour !
En son déshabillé de laine blanche, le léger manteau d’or fin et duveteux de son opulente chevelure retombant en plis harmonieusement ondulés sur la frange de sa robe, adorable dans sa grâce virginale, Bertille s’avança lentement jusqu’au bord du perron doucement éclairé par les sept cires du flambeau d’argent que, sur le seuil, dame Colline Colle élevait au bout de son bras tremblant d’émotion.
Pendant le temps très court qu’elle mit à franchir les quelques pas qui la séparaient du bord du perron, la jeune fille tint constamment son regard lumineux, brillant d’une naïve admiration, fixé sur les yeux de Jehan. De ces trois hommes immobiles qu’elle dominait du haut des marches, il semblait qu’elle ne vît que lui. Et il faut croire que ce regard si candide, si pur, parlait un langage muet d’une éloquence singulièrement expressive, car le jeune homme qui n’avait pas tremblé en menaçant le roi, se sentit frissonner de la nuque aux talons, il sentit le sang affluer à son cœur qu’il comprima de sa main crispée, et il se courba dans une attitude de vénération qui était presque un agenouillement.
Il faut croire que le langage de ces yeux était singulièrement clair, car le roi pâlit lui aussi, et lui qui, peut-être, avait oublié son audacieux agresseur, il ramena sur lui un œil froid qui était une condamnation.
Quant à l’inconnu dont le geste opportun venait de sauver la vie au roi, il contemplait le couple si jeune, si gracieux, si idéalement assorti, dont toutes les attitudes trahissaient l’amour le plus chaste, le plus pur, avec une visible sympathie, et ses yeux se reportant sur le visage convulsé par la jalousie de Henri, une lueur de pitié brilla dans son œil railleur et il murmura :
– Pauvres enfants !...
Quand elle eut suffisamment remercié le jeune homme, car toute son attitude était à la fois un cantique d’amour et d’actions de grâces, Bertille se tourna vers le roi, s’inclina dans une révérence gracieuse que plus d’une grande dame eût admirée, et d’une voix harmonieuse, admirablement timbrée, douce comme un chant d’oiseau, elle dit, avec un ton de dignité déconcertant chez une aussi jeune et aussi ignorante enfant :
– Daigne Votre Majesté honorer de sa présence l’humble logis de noble demoiselle Bertille de Saugis.
La foudre tombant à grand fracas n’eût pas produit sur les deux principaux acteurs de cette scène l’effet que produisirent ces paroles.
D’un bond, le roi franchit les trois marches et fut sur la jeune fille qu’il dévorait d’un regard ardent. Il était livide et tout secoué d’un frisson qui n’échappa pas à l’œil perçant de l’inconnu qui contemplait cette scène d’un air intéressé.
Henri bégaya :
– Vous avez dit Saugis ?... Saugis ?...
– C’est mon nom, sire.
Henri passa la main sur son front ruisselant.
– J’ai connu, dit-il lentement, péniblement, dans le pays chartrain, une dame de Saugis... Blanche de Saugis.
– C’était ma mère.
« Miséricorde ! cria en lui-même Henri, bouleversé, c’est ma fille !... Et j’ai failli !... »
Instinctivement ses yeux se portèrent sur Jehan le Brave qui paraissait pétrifié et il ajouta :
« Dieu soit loué qui l’a placé sur ma route pour m’épargner le remords de cet épouvantable crime ! »
Voyant que le roi se taisait, Bertille, ignorante sans doute des règles de l’étiquette, demanda :
– Votre Majesté ne le savait-elle pas en venant ici ?
Il y avait une candeur si manifeste dans le ton dont fut posée cette question que le roi, rougissant malgré lui, se hâta de dire :
– Si fait, jarnidieu !... Mais je tenais à m’assurer... je voulais vous entendre confirmer...
Gravement, avec un accent touchant de mélancolie, la jeune fille dit :
– Il y a bien longtemps que je n’espérais plus l’honneur insigne que le roi veut bien me faire ce soir... N’importe, Votre Majesté est la bienvenue chez moi. Entrez, Sire.
Elle avait l’air d’une souveraine accordant une faveur à un de ses sujets, et le roi, lui, paraissait singulièrement gêné. Il fit un mouvement pour pénétrer dans la maison. Au moment d’entrer, il se rappela tout à coup cet inconnu qui venait de lui sauver la vie, et il se retourna dans l’intention de lui adresser quelques paroles de remerciement. Il n’en eut pas le temps. Un incident imprévu éclata brusquement comme un nouveau coup de tonnerre.
Lorsque Bertille parut sur le perron, nous avons vu que Jehan était tombé en extase. Cette extase se changea en stupeur douloureuse lorsqu’il entendit la jeune fille se nommer en invitant le roi à pénétrer chez elle. Peu à peu la stupeur tomba et fit place à la colère, laquelle s’exaspéra à son tour pour s’élever jusqu’à la fureur. La fureur froide, aveugle, qui ne raisonne pas, qui se hausse du premier coup aux pires actes de folie.
Un moment l’inconnu qui le surveillait du coin de l’œil put croire qu’il allait escalader le perron, sauter sur le roi, l’étrangler et, qui sait ? poignarder après la jeune fille.
Mais il changea d’idée sans doute. Ou plutôt il est probable qu’il ne raisonnait plus et agissait sous l’empire d’un accès de folie. D’un geste rageur, il rengaina violemment son épée qu’il avait toujours à la main, comme s’il eût voulu s’interdire à soi-même tout acte de violence, et croisant ses bras sur sa large poitrine, livide, les yeux exorbités, il éclata soudain d’un rire strident, terrible et en même temps il tonna :
– Entrez, sire !... Soyez le bienvenu chez noble demoiselle Bertille de Saugis qui n’espérait plus l’insigne honneur que vous voulez bien lui faire ce soir !... Entrez ! la chambre virginale s’ouvrira pour vous !... entrez, les courtines sont tirées ! entrez, la noble demoiselle est prête au sacrifice d’amour !...
Dès les premiers mots, Henri s’était retourné stupéfait, en songeant :
« Voyons jusqu’où il osera aller ! »
Bertille, pâle comme une morte, attachait sur l’exalté un regard chargé d’un douloureux reproche qui prit bientôt une expression de tendre pitié.
Le fou – car il était fou en ce moment, fou de rage jalouse – continua de sa voix de tonnerre :
– Ah ! par l’enfer, la farce est plaisante, et j’en ris de bon cœur !... Riez donc avec moi, noble demoiselle, et vous aussi, Majesté !... Riez de ce triste hère, de ce truand, de ce fou qui s’était imaginé défendre une pure, une innocente jeune fille et qui n’avait pas hésité, lui misérable inconnu, sans fortune et sans nom, à se dresser devant un roi, à l’arrêter, à le tenir à sa merci !... Riez, vous dis-je, riez de ce triple fou qui ne soupçonnait pas que la pure, l’innocente jeune fille n’attendait qu’un signe pour se laisser choir dans les bras du galant barbon... mais couronné !
Comme s’il n’avait rien entendu de ces sarcasmes violents, débités sur un ton de violence inouï. Henri se tourna vers l’inconnu, et avec ce sourire accueillant qu’il avait pour ses amis :
– Serviteur, Pardaillan, serviteur1,dit-il. Et tout aussitôt, très cordial :
– Puisqu’il est dit qu’à toutes nos rencontres – et il ne tient pas à moi qu’elles ne soient plus fréquentes...
– Votre Majesté sait que de loin comme de près...
– Je sais, Pardaillan, fit doucement Henri. Il n’empêche que vous me négligez trop, mon ami.
Pardaillan, puisque c’était lui, s’inclina sans répondre. Henri étouffa un soupir et poursuivit :
– Je disais donc : puisque à chacune de nos rencontres vous rendez service à moi ou à ma couronne sans qu’il me soit possible de vous prouver ma gratitude, puisqu’il vous plaît qu’il en soit ainsi, rendez-moi encore un service...
– Je suis à vos ordres, sire.
Henri se redressa, et très froid, en le désignant d’un coup d’œil dédaigneux :
– Gardez-moi ce jeune homme... Je l’avais, ma foi, oublié, mais il paraît qu’il tient à ce que je m’occupe de lui... Gardez-le moi donc... précieusement.
En entendant cet ordre, Jehan se redressa et fixa un œil étincelant sur l’homme que le roi paraissait honorer d’une estime particulière. Bertille, au contraire, lui jeta un regard implorant.
Sans paraître rien remarquer, le chevalier de Pardaillan répondit avec un flegme admirable :
– Vous le garder, sire ! C’est facile... Jehan eut un sourire de dédain.
Bertille crispa ses mains diaphanes avec une expression de désespoir qui eût touché tout autre qu’un amoureux jaloux.
– Mais, continua imperturbablement Pardaillan, je ne puis pourtant pas vous le garder jusqu’à l’heure du jugement dernier. Le roi me permettra-t-il de lui demander ce qu’il faudra en faire ?
– Tout simplement le conduire jusqu’au Louvre et le remettre aux mains de mon capitaine des gardes...
– Très simple, en effet... Et alors, qu’adviendra-t-il ?
– Ne vous occupez pas du reste, fit Henri avec autorité. C’est l’affaire du bourreau.
Jehan se raidit dans une attitude de défi. Bertille chancela et dut s’appuyer à un des piliers.
– Le bourreau ! peste ! oh diable ! reprit Pardaillan avec un air parfaitement indifférent. Pauvre jeune homme !
Henri IV connaissait sans doute de longue date ce singulier personnage, qui lui parlait avec une sorte de respect narquois, qui avait des allures désinvoltes, des attitudes telles qu’on pouvait se demander si ce n’était pas plutôt lui qui était le roi. Il connaissait sans doute ses manières, il avait appris sans doute à lire sur cette physionomie indéchiffrable, car il s’écria, avec plus d’inquiétude que de colère :
– Enfin, Pardaillan, obéissez-vous ?...
– J’obéis, Sire, j’obéis ! Diantre ! résister aux ordres du roi ! Je saisis ce jeune homme, je le traîne au Louvre, au Châtelet, à la potence, à la rue, je l’écartèle moi-même.
Et tout à coup se frappant le front, comme quelqu’un qui se souvient brusquement :
– Jour de Dieu ! et moi qui oubliais !... Ah ! cuistre, bélître, faquin ! Je vieillis, Sire, voilà-t-il pas que je perds la mémoire ! Sire, vous me voyez affligé, désolé, navré, désespéré. Je ne puis faire ce que Votre Majesté me demande.
Bertille se sentit renaître, le rose reparut sur le lis de ses joues, ses doux yeux bleus se posèrent sur cet inconnu et se levèrent ensuite au ciel en une muette action de grâces.
Jehan, qui n’avait pas bronché, le considéra avec un étonnement manifeste.
– Pourquoi ? demanda sèchement le roi.
– Eh ! Sire, je viens de me souvenir, à l’instant, que monsieur m’a – précisément donné, pour demain matin, certain rendez-vous auquel un gentilhomme ne saurait se dérober à peine de se déshonorer.
– Eh bien ?...
– Comment, Sire, ne comprenez-vous pas que, devant me battre demain matin avec un monsieur, je ne puis l’arrêter ce soir ?... Voyons, Sire, ce jeune homme aurait le droit de croire que j’ai eu peur.
Et en disant ces mots avec un air de naïveté ingénue, ses yeux pétillants de malice se posaient tour à tour sur Jehan, chez qui l’étonnement commençait à faire place à de l’admiration, et sur Bertille qui, après avoir respiré un moment, retombait dans les transes.
– Monsieur de Pardaillan, fit le roi d’un air sévère, ne savez-vous pas que nous avons édicté des lois2 très rigoureuses à seule fin de réprimer cette criminelle fureur de duels qui décime la fleur de notre gentilhommerie ?
De cet air figue et raisin qui paraissait inquiéter Henri, Pardaillan s’écria :
– Corbleu ! C’est vrai !... J’oubliais les édits contre le duel... Ah ! décidément la mémoire s’en va chez moi !... Les édits !... Peste ! je n’aurai garde de les oublier maintenant !