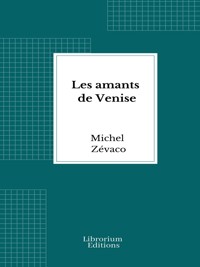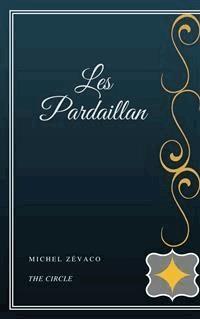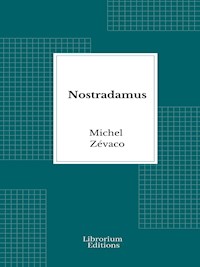3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Saêtta s'arrêta devant la table du ministre et s'inclina profondément, mais sans servilité, avec une sorte de fierté narquoise. Sully fixa sur lui son oeil scrutateur. Ce coup d'oeil lui suffit pour juger le personnage. Sans aménité, brusquement, sèchement, il dit : - C'est vous qui prétendez apporter au Trésor une somme de dix millions ? Nullement intimidé, Saêtta rectifia froidement : - J'apporte en effet dix millions au Trésor, monseigneur. Sully le fixa le quart d'une seconde et, avec la même brusquerie : - Soit. Où sont ces millions ? Parlez. Et surtout soyez bref : je n'ai pas de temps à perdre. L'accueil eût démonté un solliciteur ordinaire. Il eût écrasé un courtisan.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 592
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Les Pardaillan, tome 8 : Le trésor de Fausta
Pages de titreLes Pardaillan VIIIXXXIVXXXVXXXVIXXXVIIXXXVIIIXXXIXXLXLIXLIIXLIIIXLIVXLVXLVIXLVIIXLVIIIXLIXLLILIILIIILIVLVLVILVIILVIIILIXLXLXILXIILXIIILXIVLXVLXVILXVIILXVIIILXIXLXXLXXILXXIILXXIIILXXIVLXXVLXXVILXXVIIPage de copyrightMichel Zévaco
Le fils de Pardaillan II
Michel Zévaco
Les Pardaillan VIII
La série des Pardaillan comprend :
1. Les Pardaillan.
2. L’épopée d’amour.
3. La Fausta.
4. Fausta vaincue.
5. Pardaillan et Fausta.
6. Les amours du Chico.
7. Le fils de Pardaillan.
8. Le fils de Pardaillan(suite).
9. La fin de Pardaillan.
10. La fin de Fausta.
Le fils de Pardaillan II
Édition de référence :
Robert Laffont, coll. Bouquins.
Édition intégrale.
XXXIV
Saêtta s’arrêta devant la table du ministre et s’inclina profondément, mais sans servilité, avec une sorte de fierté narquoise.
Sully fixa sur lui son œil scrutateur. Ce coup d’œil lui suffit pour juger le personnage. Sans aménité, brusquement, sèchement, il dit :
– C’est vous qui prétendez apporter au Trésor une somme de dix millions ?
Nullement intimidé, Saêtta rectifia froidement :
– J’apporte en effet dix millions au Trésor, monseigneur.
Sully le fixa le quart d’une seconde et, avec la même brusquerie :
– Soit. Où sont ces millions ? Parlez. Et surtout soyez bref : je n’ai pas de temps à perdre.
L’accueil eût démonté un solliciteur ordinaire. Il eût écrasé un courtisan. Mais Saêtta ne se considérait pas comme un solliciteur, et il n’était pas courtisan. Il ne fut pas démonté : il fut piqué. Et se redressant, du tac au tac, il répliqua :
– Je sais que votre temps est précieux, monseigneur. Je ne vous demande que dix minutes en échange de quoi je vous donne dix millions... Un million par minute... C’est assez bien payé, même pour un ministre.
La réponse était plutôt impertinente. Sully fronça le sourcil et allongea la main vers le marteau pour appeler et faire jeter dehors l’insolent.
Mais cet homme remarquable, qui rendit d’éminents services à son roi, avait un faible, comme tous les hommes, qu’ils soient illustres ou obscurs. Le faible de Sully était l’intérêt. L’intérêt frisant de près la rapacité.
Il réfléchit que s’il faisait jeter dehors l’homme avant qu’il eût parlé, il courait le risque de perdre dix millions. La somme méritait d’être prise en considération, sinon l’homme qui lui paraissait négligeable.
Il n’acheva pas le geste. Et, avec un air de souverain mépris :
– Je vous engage à peser vos paroles... J’imagine que vous ne manquerez pas de réclamer une part de ces millions. En sorte qu’au bout du compte, c’est encore moi qui payerai et non vous.
Sully pensait bien avoir maté le singulier visiteur. Mais Saêtta avait conscience de l’importance de la divulgation qu’il allait faire et de la force qu’elle lui donnait. Peut-être éprouvait-il une sourde rancune contre tout ce qui était grand et haut placé, et n’était-il pas fâché d’humilier à son tour un de ces grands personnages qui l’écrasaient de leur dédain.
Quoi qu’il en soit, il ne lâcha pas pied et rétorqua flegmatiquement :
– Vous imaginez mal, monseigneur. Je ne réclame rien, je ne demande rien. Au contraire, j’entends vous rendre, en sus des millions, un service en vous donnant un avis dont vous reconnaîtrez la valeur. Vous voyez que c’est bien moi qui paye... et de toutes les manières.
Cette fois, Sully fut étonné. L’homme n’était pas le premier venu, décidément. Évidemment, il manquait d’éducation. Il l’avait jugé tout de suite sur ce point. Mais s’il disait vrai, il faisait preuve d’un désintéressement peu commun. En outre, pour lui parler sur ce ton, il fallait qu’il fût vraiment brave. Allait-il, par une sotte susceptibilité, risquer de faire perdre à l’État une somme énorme ? Non, ma foi. Il fallait savoir d’abord. Il serait temps de châtier l’homme après, s’il s’était vanté. Il refoula donc sa mauvaise humeur et adoucissant ses manières :
– S’il en est ainsi, parlez. Je vous écoute.
– Monseigneur, dit Saêtta à brûle-pourpoint, vous n’êtes pas sans avoir entendu parler du trésor de la princesse Fausta ?
Sully dressa l’oreille et devint très attentif sous son apparente impassibilité. Mais, se tenant sur la réserve :
– Je sais, dit-il. Je sais aussi que nul ne sait où est caché ce trésor... Si toutefois il existe réellement.
– Il existe, monseigneur, affirma péremptoirement Saêtta. Il existe, je sais où il est caché, moi, et c’est ce que je viens vous apprendre.
Une lueur s’alluma sous les sourcils broussailleux du ministre. Mais toujours sur la réserve :
– Comment savez-vous cela, vous ?
– Peu importe, monseigneur. Je le sais, c’est l’essentiel pour vous. Il fouilla dans son pourpoint, en tira un papier plié en quatre, qu’il tendit au ministre, en disant :
– Ce papier, monseigneur, contient des indications complètes et exactes sur l’emplacement où sont enfouis les millions. Vous n’aurez que la peine de les faire prendre là.
Le papier que Saêtta tendait au ministre était celui qu’il avait trouvé dans le cachot de Jehan, rue des Rats. Dans sa chute, la cassette avait échappé et s’était ouverte. Les papiers s’étaient éparpillés. Il les avait ramassés à tâtons, mais dans l’obscurité, celui-là lui avait échappé. De même qu’il avait échappé à Pardaillan et à Gringaille, qui n’avaient fait qu’entrer et sortir.
Sully prit le papier et jeta un coup d’œil dessus. Il eut un geste de désappointement. Saêtta vit ce geste et l’expression qui l’accompagnait.
– Si vous le désirez, monseigneur, dit-il, je vais vous traduire ce papier écrit en italien. Comme mon nom l’indique, je suis Italien moi-même. Vous pourrez faire vérifier, pour plus de sûreté, ma traduction. Mais je vous réponds qu’elle sera exacte.
Sans mot dire, Sully lui tendit le papier. Saêtta traduisit à haute voix. Et ce qu’il dit était la répétition exacte de ce que le père Joseph avait traduit du latin, Pardaillan de l’espagnol.
Sa lecture achevée, Saêtta rendit le papier à Sully, qui dit :
– C’est on ne peut plus précis.
Et il parut réfléchir.
Nous avons dit qu’il était très intéressé. Ce papier, il n’eût pas hésité à le payer un million, davantage même – il faut savoir faire la part du feu. Saêtta avait dit qu’il le donnait sans rien exiger en échange. Précisément parce qu’il était intéressé, ceci paraissait trop beau à Sully. Il redoutait que l’homme ne se ravisât.
Cependant, s’il était intéressé, il était aussi loyal. La loyauté l’obligeait à reconnaître que ce Lupini lui rendait un grand service. Il fallait le dire. Il fallait même remercier. Et il craignait que l’autre n’en profitât pour réclamer sa part. Il se résigna toutefois, et :
– C’est un réel service que vous rendez à l’État, monsieur (il disait monsieur cette fois), en donnant ce papier sans demander aucune récompense. Car vous l’avez dit, monsieur. Ce dont je ne saurais trop vous louer.
Notez maintenant que Saêtta était pauvre et qu’il savait très bien que, s’il le voulait, il pouvait se faire payer le prix qu’il voudrait. Cependant, Saêtta mettait une sorte d’orgueil, qui n’était pas sans grandeur, à ne rien demander. Il devina la crainte inavouée du ministre, et, avec un sourire railleur, il le rassura :
– Je l’ai dit et je le répète, monseigneur, je ne demande rien.
– Désintéressement qui vous honore grandement, monsieur, fit Sully rassuré.
– Maintenant, monseigneur, voici l’avis que je vous ai promis. Ce trésor vous sera âprement disputé. Vous ne le tenez pas encore et il pourrait fort bien vous passer sous le nez, dit Saêtta avec une assurance impressionnante.
– Oh ! oh ! fit Sully en se redressant, qui donc serait assez osé pour disputer au roi de France son bien... chez lui ?... Est-ce le pape ?... Est-ce Philippe d’Espagne ?... Les temps sont passés où les souverains étrangers pouvaient impunément se mêler des affaires du royaume.
– Il s’agit de quelqu’un autrement redoutable que le pape ou le roi d’Espagne.
– Çà, monsieur, vous êtes fou ?... De qui s’agit-il, voyons ?
Saêtta s’inclina d’un air narquois et, paisiblement :
– Il s’agit d’un truand, monseigneur. D’un simple petit truand.
Sully sourit dédaigneusement :
– Ceci regarde M. le chevalier du guet, dit-il. N’en parlons plus !
– Monseigneur, vous ne me connaissez pas. Sous ce costume, qui ferait envie à plus d’un riche seigneur, je n’ai pas trop mauvaise mine. Je le sais. Cependant, du premier coup d’œil, vous avez reconnu que je ne suis qu’un pauvre diable, sans naissance, et vous m’avez traité en conséquence, et vous vous êtes demandé un moment si vous ne deviez pas me faire bâtonner. J’ai admiré la promptitude et la sûreté de votre coup d’œil. Mais vous m’avez froissé... et je vous l’ai fait sentir à ma manière.
Saêtta s’était redressé dans une attitude de force et d’audace. Ses yeux étincelants plongeaient dans les yeux du ministre. Le ton de ses paroles, dans sa rudesse même, était empreint d’une dignité sauvage.
Sully était quelque peu effaré. Mais maintenant cet énigmatique personnage l’intriguait et l’intéressait, malgré qu’il en eût. Il voulut savoir à quoi il tendait, et sans se fâcher il demanda :
– Où voulez-vous en venir ?
– À ceci, dit froidement Saêtta : vous prouver que je ne suis pas un imbécile et que je ne me laisse pas intimider facilement.
Sully le regarda un instant et, malgré lui, il hocha la tête d’un air approbateur.
– Je vois que vous me rendez justice, reprit Saêtta. Eh bien, monseigneur, moi qui ne suis pas un sot, moi que rien n’effraye, je vous dis ceci : « Prenez garde, monseigneur ! Si vous le laissez faire, ce truand que vous dédaignez se jouera de vous, diplomate consommé, et tout ministre puissant que vous êtes, vous ne pèserez pas lourd dans sa main. Il rossera votre chevalier du guet et ses sergents ; il rossera le grand prévôt et ses archers ; il battra vos soldats, si vous les envoyez contre lui... Et finalement, à votre nez et à votre barbe, il vous soufflera ce fameux trésor et vous n’y verrez que du feu. »
– C’est donc un diable à quatre ? fit Sully impressionné. Quelque redoutable chef de bande ?
– C’est un homme qui ne recule devant rien, dit Saêtta en haussant les épaules. Et si vous ne prenez pas vos précautions, quand vous allongerez la main pour saisir le trésor, vous trouverez le coffre peut-être, mais les millions seront envolés.
Sully allongea la main et prit une feuille de papier.
– Bon, bon, dit-il tranquillement, je retiens l’avertissement. Il a sa valeur, s’il en est comme vous dites. Comment s’appelle ce brave extraordinaire ?
– Jehan le Brave, dit froidement Saêtta.
Sully inscrivit le nom sur la feuille et :
– Où peut-on le trouver ? fit-il encore.
– Il loge rue de l’Arbre-Sec, presque en face le cul-de-sac Courbâton.
Sully inscrivit l’adresse à côté du nom et, d’une voix rude, il dit :
– Dès cet instant, ces millions appartiennent au roi. Celui qui s’aviserait d’y porter la main serait impitoyablement livré au bourreau, ce Jehan le Brave plus que quiconque. Qu’il aille rôder du côté de l’abbaye de Montmartre, et je vous réponds que ses exploits seront à jamais terminés. Ce soir, il sera arrêté et je l’interrogerai moi-même.
Saêtta s’inclina pour dissimuler sa joie et, en lui-même, il rugit : « Cette fois, je crois que c’en est fait du fils de Fausta !... Quant à la signora Léonora, qu’elle se débrouille avec M. de Sully. Tant pis pour elle... Je ne veux pas, moi, que le Concini me ravisse une vengeance que j’attends depuis vingt ans !... Ce qu’il a déjà failli faire. » Et tout haut, d’un air indifférent :
– Ceci, c’est votre affaire, monseigneur.
Sully le regarda fixement un instant et, froidement :
– Est-ce tout ce que vous aviez à me communiquer ? dit-il en allongeant la main vers le marteau.
– C’est tout, monseigneur, dit Saêtta qui s’inclina une dernière fois et sortit de ce pas souple et dégagé qui était le sien.
Sully, le marteau à la main, le regarda s’éloigner d’un air rêveur et il murmura :
– M’est avis que ce drôle hait de haine mortelle l’homme qu’il vient de me dénoncer !
Il réfléchit un instant, sa physionomie eut une expression de dégoût et il ajouta :
– Peut-être est-ce quelque truand jaloux des exploits d’un confrère... Pourtant, ce Jehan le Brave est-il vraiment aussi redoutable ?
Il réfléchit encore et décida :
– Redoutable ou non, mon devoir est de prendre mes précautions. Ainsi ferai-je aujourd’hui même.
Cette résolution prise, Sully laissa tomber le marteau sur le timbre et reprit la suite de ses audiences.
Pardaillan n’avait pas perdu un mot de cet entretien. Quand il jugea qu’il touchait à sa fin, c’est-à-dire quand il eut entendu Sully dire qu’il interrogerait lui-même Jehan, il se retira doucement. Il sortit vivement et alla se poster à l’angle du quai des Célestins, à côté de la porte.
Entre le mur d’enceinte de l’Arsenal et la Seine, il y avait, sur la berge plantée d’arbres, une longue et étroite bande de terre. C’était un « palmail », ce qui était une sorte de jeu de balle. Des joueurs y exerçaient leur adresse en ce moment.
Pardaillan attendit là, très attentif, en apparence, à la partie qui se jouait. En réalité, il guignait la porte de l’Arsenal. Il n’attendit pas longtemps, du reste.
Saêtta sortit et tourna à droite dans la rue du Petit-Musc allant à la rue Saint-Antoine. Aussitôt, Pardaillan lâcha la partie de balle qui ne l’intéressait plus et se mit à le suivre.
Il n’avait pas encore pris de décision à son sujet, et en attendant, il voulait savoir où logeait cet homme, pour être sûr de le retrouver. En marchant, Pardaillan réfléchissait.
– Eh ! mais, pour peu que cela continue, tout ce qui a un nom et une situation dans Paris va se ruer à la chapelle du Martyr, dans l’espoir de s’emparer du prestigieux trésor. Mordieu ! la curée commence : voici déjà Concini qui va se trouver aux prises avec le roi !... Seulement, là, les chasseurs vont se déchirer entre eux... pour, finalement, aboutir tous à la même déception. Je m’ennuyais. Voilà un spectacle que je ne manquerai pas de suivre... J’ai idée qu’il ne sera pas dépourvu ni d’intérêt ni d’imprévu. Ce me sera une distraction.
Il ne perdait pas de vue Saêtta, tout en monologuant de la sorte. À un moment donné, il allongea le pas et parut vouloir l’accoster... Peut-être avait-il songé à l’obliger à s’expliquer séance tenante. Il dut se raviser, car il ralentit brusquement le pas et le laissa continuer paisiblement son chemin. Et il reprit le cours de ses réflexions.
– Tout de même, voici la deuxième personne que j’entends accuser catégoriquement Jehan le Brave de songer à s’approprier ces millions !... Est-ce que décidément ce jeune homme ?...
Il haussa les épaules et acheva :
– Je deviens stupide et mauvais, ma parole !... Est-ce qu’il n’est pas clair que tout ceci n’est qu’une abominable machination ? En attendant, le voilà bien loti, ce garçon ! Heureusement, il est taillé à se défendre de toutes les manières. Et puis, je l’aiderai bien un peu, que diable !
Et avec un sourire narquois :
– Je cherchais de la distraction. En voici. La comédie d’un côté, le drame de l’autre. Je n’ai qu’à choisir.
Saêtta demeurait rue de la Petite-Truanderie. En face de sa maison, il y avait un puits, qu’on appelait le Puits-d’Amour, et sur lequel on a écrit pas mal de légendes. La maison était donc facile à reconnaître. Elle se trouvait, en outre, à deux pas de la rue Saint-Denis, où demeurait Pardaillan.
Le Florentin rentra chez lui, sans se douter le moins du monde qu’il avait été suivi. Pardaillan attendit le temps nécessaire pour s’assurer qu’il demeurait bien là, et, tranquille, il s’en fut au Grand-Passe-Partout.
Jehan, qu’il espérait y rencontrer, ne s’y trouvait pas. Il alla à son logis, rue de l’Arbre-Sec, et, la porte n’étant pas fermée à clé, il entra délibérément. Jehan n’était pas chez lui.
Pardaillan jeta un coup d’œil sur le pauvre mobilier. Les ustensiles de cuisine retinrent un moment son attention. Et il sourit doucement. Puis, il hocha la tête, soupira, et tout pensif, il s’en fut à la lucarne et jeta un coup d’œil sur la maison de Bertille.
Et il s’oublia là un long moment, un sourire mélancolique aux lèvres. Évoquant sans doute un passé, combien lointain, et toujours si proche dans son cœur... Se revoyant lui-même, à vingt ans, perché sur une lucarne pareille, épiant patiemment, des heures durant, la maison d’en face... Emportant de la joie et du soleil plein le cœur et l’esprit lorsqu’une radieuse apparition, auréolée de fins cheveux d’or, s’était montrée une seconde à lui... Sombre, perdu dans le noir et la ténèbre, si la fenêtre d’en face était demeurée obstinément close !...
Le son prolongé du bronze égrenant lentement les onze coups au clocher de Saint-Germain-l’Auxerrois, vint l’arracher au pays des songes et le ramena à la réalité.
Il pensa tout haut :
– Sully n’agira que cet après-midi. J’ai au moins une couple d’heures devant moi. C’est plus qu’il ne m’en faut.
Il retourna à son auberge et se fit servir un copieux repas. Pendant qu’on dressait son couvert, il passa dans sa chambre, traça rapidement trois ou quatre lignes d’une écriture ferme et allongée, cacheta, scella et redescendit se mettre à table, sa lettre à la main.
– Dame Nicole, dit négligemment Pardaillan à l’avenante hôtesse qui le servait de ses blanches mains, il est possible que je ne rentre pas coucher ce soir. (Dame Nicole prit un air pincé. Pardaillan parut ne pas s’en apercevoir et continua imperturbablement.) Demain matin, à la première heure, vous m’entendez bien, à la première heure, vous entrerez vous-même dans ma chambre. Si vous ne m’y trouvez pas, vous irez, séance tenante, à l’Arsenal. Vous demanderez M. de Sully, de ma part, n’oubliez pas cela, dame Nicole : de ma part. On vous introduira près du ministre et vous lui remettrez la lettre que voici. Après quoi, vous pourrez revenir paisiblement chez vous.
Dame Nicole prit la lettre que le chevalier lui tendait.
Elle était sans doute bien dressée, car elle ne se permit aucune question. Seulement, son air pincé avait fait place à l’inquiétude. Pardaillan le vit, et, pour la rassurer, il ajouta avec un air froid qui lui fit passer un frisson sur la nuque :
– Si vous faites comme j’ai dit, vous me verrez revenir dans la journée en bonne santé... Si vous perdez cette lettre, si vous ne la remettez pas vous-même entre les mains du ministre lui-même, eh bien ! dame Nicole, regardez-moi bien... car c’est la dernière fois que vous me voyez.
Du coup, dame Nicole verdit et tomba lourdement sur une chaise qui se trouvait là à point nommé pour la recevoir, sans quoi, elle se fût étalée par terre. L’émotion lui avait coupé le souffle en même temps que les jambes.
– Ma chère amie, fit doucement Pardaillan, faites comme j’ai dit et tout ira bien, vous verrez.
Et, certain qu’elle obéirait, il se mit à dévorer en homme qui ne sait pas où et quand il pourra dîner.
Dame Nicole, cependant, avait filé, avec cette agilité spéciale que donne la terreur, jusqu’à sa chambre. Là, elle avait prudemment enfoui sous une pile de linge la précieuse lettre dont dépendait le salut de M. le chevalier. Après quoi, elle était revenue le servir avec une sollicitude touchante, des attentions délicates, qui dénotaient sa grande inquiétude.
Son repas achevé, Pardaillan eut un bon sourire pour dame Nicole, avec un regard qui signifiait : n’oubliez pas ! Et il s’en alla tranquillement, longtemps suivi des yeux par son hôtesse, qui avait voulu l’accompagner jusque sur le perron.
Vers deux heures de l’après-midi de ce même jour, une troupe d’une dizaine de soldats, commandés par un officier, escortant une litière, sortit de l’Arsenal, où le ministre Sully logeait en qualité de grand-maître de l’artillerie.
La troupe vint s’arrêter rue de l’Arbre-Sec, en face du logis de Jehan. L’officier fit ranger la litière, avec six hommes, dans le cul-de-sac, et lui-même, avec quatre hommes, entra dans la maison et monta jusqu’à la mansarde.
Selon son habitude, Jehan n’avait pas fermé sa porte à clé. Les soldats entrèrent doucement. Un homme, étendu sur une étroite couchette, roulé dans son manteau, dormait profondément. C’était Jehan le Brave évidemment.
En un clin d’œil, il fut saisi, solidement attaché, enlevé et porté dans la litière. Aussitôt les soldats entourèrent le véhicule et s’en retournèrent à l’Arsenal.
L’arrestation avait été si rapidement et si heureusement exécutée qu’elle passa inaperçue.
Le prisonnier fut enfermé à double tour dans un cachot. Par excès de précaution, on négligea de le débarrasser des liens qui l’enserraient. On le déposa sur une sorte de lit de camp, sur lequel, incapable de faire un mouvement, il fut contraint de demeurer dans la position où on l’avait placé.
On le laissa là jusqu’à six heures et demie. On avait ramené sur sa tête un pan du manteau, en sorte qu’on ne voyait pas sa figure. De plus, cela constituait un bel et bon bâillon sous lequel il devait étouffer quelque peu. Mais, de tout temps, un prisonnier a été considéré comme un animal malfaisant envers qui on ne saurait se montrer trop dur ni trop féroce.
Donc, vers six heures et demie, quatre solides gaillards entrèrent dans le cachot de Jehan le Brave. Ils le chargèrent sur leurs robustes épaules et, ouste ! ils l’enlevèrent, le portèrent il ne savait où, puisqu’il ne pouvait pas voir. On le déposa sur un siège et on dégagea sa tête, sans le détacher, toutefois. Ceci fait, les quatre hommes se placèrent derrière lui, attendant les ordres.
Lorsque le visage du prisonnier parut à la lumière, un homme qui se tenait assis devant une grande table de travail, se dressa tout effaré et s’écria :
– M. de Pardaillan !
C’était le ministre Sully. Pardaillan, car c’était bien lui, se trouvait, en prisonnier, dans ce même cabinet où il avait été reçu, dans la matinée, en visiteur de marque.
Il ne parut pas autrement étonné. On eût pu croire qu’il savait d’avance où il se trouvait. Il paraissait parfaitement calme et même quelque peu narquois.
Mais Sully, sous le coup de la stupeur que lui causait l’imprévu de cette rencontre, n’eut pas le loisir de faire ces remarques. Du reste, au même instant, Pardaillan grondait d’un air courroucé :
– Çà, monsieur, que signifie cette sotte plaisanterie ?... Vos hommes sont-ils fous ou enragés ?...
Jusque-là, Sully avait considéré le chevalier comme s’il ne pouvait en croire ses yeux. Le son de sa voix le rappela à lui. Il se précipita et commanda rudement :
– Drôles, qu’attendez-vous pour délier M. le chevalier ?... Ne voyez-vous pas qu’il y a erreur ?
Les hommes se hâtèrent de trancher les liens qui meurtrissaient le chevalier et s’esquivèrent sur un geste impérieux du ministre consterné, qui s’excusait de son mieux.
Pardaillan acceptait les excuses d’un air détaché en frictionnant ses membres endoloris. Mais il avait une lueur malicieuse au coin de l’œil.
– Mais enfin, s’écria Sully furieux, comment cette inconcevable méprise a-t-elle pu se produire ?
– Eh ! monsieur, bougonna Pardaillan, je veux que la peste m’étrangle si j’y comprends quelque chose !
– Il faut pourtant que je sache comment la chose s’est produite, insista Sully. Vous ne pensez pas que je vais laisser une pareille violence impunie ?
– Pourquoi pas ? fit Pardaillan, indulgent. Me voici hors d’affaire. C’est l’essentiel. La punition que vous infligerez à un pauvre diable ne changera rien à ce qui a été.
– Vous êtes généreux, comme toujours. Mais moi, j’ai besoin de savoir comment mes ordres sont exécutés.
– Puisque vous y tenez, voici tout ce que je puis vous dire, n’en sachant pas plus long : pendant que j’attendais, chez lui, le retour d’un ami absent, je me suis assoupi : vous savez, à mon âge... Pendant mon sommeil, j’ai été saisi, ficelé, emporté, avant que j’aie eu le temps de me reconnaître et sans que j’aie pu seulement faire ouf... Si vous pouvez tirer quelque chose du peu que je vous dis, vous m’obligerez en me le faisant connaître.
– Comment se nomme cet ami ?
– Jehan le Brave, dit Pardaillan, qui prit son air le plus naïf.
– Jehan le Brave, sursauta Sully. Ah ! je comprends alors ce qui s’est passé !
– Vous êtes plus perspicace que moi, fit Pardaillan, sans qu’il fût possible de savoir s’il raillait ou parlait sérieusement.
– Et vous dites que ce Jehan est votre ami ? reprit Sully qui paraissait au comble de l’étonnement.
– Je le dis parce que cela est, affirma énergiquement Pardaillan.
Sully se tut un instant pendant lequel il parut hésiter sur ce qu’il allait faire ou dire. Brusquement il se décida :
– J’avais donné l’ordre d’arrêter ce Jehan le Brave qui est de vos amis, paraît-il. L’officier chargé de l’arrestation, vous trouvant là, installé comme chez vous, vous a pris pour l’homme dont il devait s’assurer.
– Bon, bon, je comprends maintenant, s’écria Pardaillan de son air le plus candide.
Et il ajouta :
– Pourquoi diable cette arrestation ? Quel crime ce garçon, qui est mon ami, a-t-il commis ?
– Chevalier, dit Sully, en le regardant en face, cet homme m’a été signalé comme un truand redoutable, complotant contre le roi.
Pardaillan éclata de rire.
– On vous a mal renseigné, duc, fit-il. Je sais mieux que personne que Jehan le Brave ne complote pas contre le roi. Je vous l’affirme. D’ailleurs, le pauvre garçon a bien d’autres soucis en tête. Figurez-vous qu’il est féru d’amour pour une jolie fille à laquelle je m’intéresse tout particulièrement. Mais féru à ce point qu’il en est outré ! Or, cette jeune fille a disparu. Et il est bien trop occupé à la rechercher pour perdre son temps à comploter.
Et soudain, très froid, plongeant ses yeux étincelants dans les yeux de Sully :
– Quant à dire que c’est un truand...
– Il ne serait pas votre ami s’il en était ainsi, interrompit spontanément Sully. C’est bien ce que je pense aussi... À moins... À moins qu’il n’y ait deux Jehan le Brave !... C’est possible, après tout... Au fait, où demeure le vôtre ?
– Rue de l’Arbre-Sec, en face le cul-de-sac Courbâton, fit Pardaillan en le guignant du coin de l’œil.
– C’est le même ! s’exclama Sully.
Et, dépité :
– Je n’y comprends plus rien.
– Voyons, s’informa Pardaillan avec un naturel parfait. Moi, je suis sûr de mon fait. Jehan le Brave ne complote pas. Il n’est pas un misérable. Je l’affirme et je ne peux pas être suspecté.
Et comme Sully approuvait spontanément et vigoureusement du geste, il reprit :
– Bien, bien ! Mais vous, êtes-vous sûr de ceux qui vous ont renseigné ?
– Non, déclara loyalement Sully. On me l’a dénoncé ce matin, ici... J’avoue que je ne connais pas le dénonciateur.
Pardaillan le regarda d’une manière significative et, hochant la tête :
– Et il ne vous en a pas fallu davantage pour ordonner une arrestation ? Diable ! Savez-vous que cette manière expéditive n’est guère rassurante pour les honnêtes gens ?
– Je vous comprends, dit gravement Sully. Mais l’affaire dont il s’agit est d’une gravité exceptionnelle. Remarquez, d’ailleurs, qu’il ne s’agissait pas d’une arrestation. J’allais interroger l’homme moi-même. Et j’aurais décidé d’après ses réponses.
– Bon, fit Pardaillan d’un air méprisant, il n’en est pas moins vrai que l’anonyme qui est venu ici dénoncer ce brave garçon me fait l’effet d’être un lâche coquin qui poursuit je ne sais quelle basse vengeance... dont vous avez failli vous faire le complice.
– Ma foi, confessa Sully, je crois que vous avez raison. Et quant à ce garçon, je ne l’inquiéterai pas, puisque vous répondez de lui. Cependant...
– Cependant ? fit Pardaillan déjà hérissé.
– Qu’il évite, dit froidement Sully, qu’il évite d’aller rôder du côté de l’abbaye de Montmartre. Les parages de l’abbaye, d’ici peu, seront dangereux, peut-être mortels, pour quiconque je ne connaîtrai pas personnellement. À tout hasard, dites-le de ma part à ce Jehan le Brave.
Pardaillan s’inclina d’un air railleur, sans qu’on pût savoir s’il prenait bonne note de l’avertissement, ou s’il le dédaignait.
Pardaillan prit cordialement congé de Sully et s’en fut droit au Grand-Passe-Partout où il arriva comme la demie de sept heures venait de sonner.
Dame Nicole, qui le vit entrer, ne se livra pas à de bruyantes manifestations de joie. Seulement, sa figure soucieuse s’éclaira d’un bon sourire, et l’empressement qu’elle mit à dresser le couvert elle-même témoignait hautement que sa joie, pour être discrète, n’en était pas moins vive.
– Dame Nicole, fit paisiblement Pardaillan, vous me rendrez, s’il vous plaît, la lettre que je vous ai confiée. Elle devient inutile, puisque me voici de retour.
La lettre apportée, il la déchira en quatre et alla en jeter les morceaux dans le feu. Sur ces entrefaites, Jehan survint.
– Ma foi, dit joyeusement Pardaillan, vous arrivez à point pour m’éviter de retourner chez vous, d’abord. Ensuite, pour partager mon repas... Ne dites pas non... Vous n’avez pas dîné, je le vois à votre mine.
– J’avoue que je n’y ai pas pensé, fit le jeune homme non sans découragement.
– Quand je vous le disais !... Mettez-vous là, et me rendez raison. Morbleu ! je déteste manger seul. Nous causerons en même temps.
Les deux hommes s’attablèrent. Pardaillan remarqua avec satisfaction que Jehan faisait honneur au repas, bien qu’il fût amoureux, inquiet, triste et abattu. Ce qui, on en conviendra, était trois fois plus qu’il n’en fallait pour couper l’appétit à un homme ordinaire.
Le jeune homme fit le récit des recherches auxquelles il s’était livré toute la journée. Si long que fût ce récit, le résultat pouvait en être résumé en un seul mot : rien. Il n’avait pas découvert le plus petit indice qui pût le mettre sur la trace de Bertille.
Pardaillan l’avait écouté avec son inaltérable patience. Il n’eut garde de lui révéler qu’il s’était complaisamment laissé arrêter pour lui. Il ne parla pas davantage de la dénonciation de Saêtta – pour lui : Guido Lupini – et de la manière dont il l’avait réduite à néant – au moins pour un temps – en opposant sa parole à celle du dénonciateur.
Lorsque Jehan le Brave se leva pour prendre congé, il le retint doucement en disant :
– Je vous offre l’hospitalité... Je réfléchis que vous ne pouvez pas retournez chez vous.
– Pourquoi donc, monsieur ? s’étonna Jehan.
– Parce que vous n’y êtes pas en sûreté.
Et prévenant les questions :
– N’oubliez pas que vous n’en avez pas fini avec Concini. Il vous hait de haine mortelle et ne renonce pas à vous atteindre, soyez-en bien persuadé. Or, il sait que vous habitez là... Il est assez puissant pour vous faire arrêter.
Jehan haussa dédaigneusement les épaules et, pour toute réponse, frappa rudement sur la poignée de sa rapière.
– Sans doute, fit négligemment Pardaillan, vous êtes brave et ne redoutez rien. Mais Concini ne vous attaquera pas loyalement, eh pardieu ! vous devez le savoir, j’imagine ! Vous serez pris à l’improviste et par derrière. Si vous êtes arrêté ou blessé... que deviendra la demoiselle de Saugis ?
– Pardieu ! monsieur, vous avez toujours raison ! s’écria Jehan qui avait pâli.
Pardaillan eut un imperceptible sourire et :
– Alors, c’est dit ? Vous acceptez l’hospitalité que je vous offre.
– Je vous remercie, monsieur, et de tout mon cœur, fit Jehan d’un ton pénétré. Je sais où aller, ne vous inquiétez pas.
Pardaillan comprit à quel sentiment de fierté il obéissait en refusant l’hospitalité qui lui était offerte. Et comme lui-même eût agi de même, il n’insista pas et il recommanda :
– Si vous voulez me croire, vous ferez en sorte que nul ne connaisse votre nouveau domicile. Pas même...
Il allait dire : pas même votre père. Il s’arrêta interdit. Mais maintenant que les soupçons de Jehan se précisaient de plus en plus, maintenant qu’il était décidé à pénétrer coûte que coûte la pensée secrète de Saêtta, il se tenait sur ses gardes, à l’affût du moindre incident susceptible de le lancer sur une piste. Il devina ce que le chevalier avait voulu dire et acheva lui-même :
– Pas même mon père, soyez tranquille, monsieur.
Il dit cela d’un air très naturel, sans paraître attacher la moindre importance à cette extraordinaire recommandation.
Déjà Pardaillan se morigénait, regrettant les paroles imprudentes qui lui étaient échappées malgré lui. Mais il était trop tard.
Jehan, d’ailleurs, n’insista pas. Il s’éloigna, après un geste d’adieu amical, de ce pas rapide qui lui était particulier. Pardaillan le rappela :
– À propos, dit-il, connaissez-vous quelqu’un demeurant dans la maison qui fait l’angle de la rue de la Petite-Truanderie, en face du Puits-d’Amour ?
– La maison en face du Puits-d’Amour, fit Jehan en observant attentivement Pardaillan, je ne connais qu’une personne qui demeure là.
– Qui est-ce ? fit Pardaillan d’un air indifférent.
Jehan prit un temps et le regardant droit dans les yeux :
– C’est mon père ! dit-il.
Si maître de lui qu’il fût, Pardaillan ne put réprimer un sursaut. Jehan eut un indéfinissable sourire et s’éloigna sans ajouter une parole, laissant Pardaillan stupéfait sur le perron, jusqu’où il l’avait reconduit.
XXXV
Nous prions le lecteur de vouloir bien nous suivre dans le petit cabinet du roi. Ce petit cabinet touchait à cette petite chambre à coucher où nous l’avons déjà entrevu. Dans l’appartement royal, ces deux pièces formaient comme un retrait intime où il n’admettait que ses amis les plus anciens, les plus éprouvés.
Henri IV s’y trouvait en tête à tête avec Sully et ceci se passait le lendemain matin de ce jour où le ministre avait reçu la visite de Pardaillan et, ensuite, des mains de Saêtta, le papier, écrit en italien, qui donnait les indications sur le trésor.
Sully avait d’abord essayé de faire accepter l’idée suggérée par Pardaillan, qui était, si on s’en souvient, de paraître céder au désir de la reine et de fixer une date ferme pour la cérémonie du couronnement. Mais le roi n’était pas homme à se contenter de vagues explications. Sully, acculé, dut se résigner à le mettre au courant de l’avertissement déguisé donné par Pardaillan.
Dès les premiers mots, Henri avait pâli et s’était laissé tomber dans le fauteuil. La peur de l’assassinat, nous l’avons dit, était son chancre rongeur. Lorsque le ministre eut terminé ses explications, il tapa avec colère sur ses deux cuisses, et se levant, il s’exclama :
– Pardieu ! mon ami, ils me tueront, c’est certain !... Je ne sortirai pas vivant de cette ville !
– Ils ne vous tueront pas, Sire, si vous suivez le conseil qui vous est donné.
– Et après ?... Quand j’aurai gagné jusqu’au printemps prochain, en serai-je plus avancé ?
– Eh ! Sire, je vous dirai comme M. de Pardaillan : vous aurez gagné près d’un an. C’est beaucoup, il me semble... D’ici là, et avec de l’argent, nous serons prêts pour la mise à exécution de votre grand projet1. Au printemps, Sire, vous entrez en campagne et vous échappez au poignard des assassins. Et comme l’issue de la campagne n’est pas douteuse, vous revenez vainqueur d’Allemagne, si grand, auréolé d’un tel prestige de gloire que nul n’osera plus rien tenter contre vous.
Henri IV, selon son habitude, s’était mis à arpenter le cabinet à grands pas. Et tout en écoutant son ministre, il réfléchissait. Il comprit qu’à la proposition qui lui était faite, il n’avait rien à perdre. Il était l’homme des décisions promptes :
– Eh bien, soit ! dit-il. Aussi bien, je ne vois pas d’autre moyen d’en sortir. Mais pour avancer mes projets de quelques mois, vous l’avez dit, il faut de l’argent. En trouverez-vous ?
– Je trouverai ce qu’il faudra, assura Sully, et même plus qu’il ne faudra. Votre Majesté veut-elle jeter un coup d’œil sur ce papier ?...
En disant ces mots, Sully tendait à Henri le papier que lui avait donné Saêtta. Henri IV était plus instruit que la plupart de ses gentilshommes. Il parlait couramment l’espagnol et l’italien. Il put donc lire le papier qu’on lui tendait sans être obligé de recourir à un traducteur, comme Sully avait été obligé de le faire.
– Qu’est-ce que ce trésor ? fit-il en rendant le papier, après l’avoir lu. Et en quoi ceci nous intéresse-t-il ?
– Ce trésor se monte à dix millions, Sire.
– Peste ! la somme est respectable !
Sully raconta en quelques mots ce qu’il savait de l’histoire du trésor de Fausta et il termina en disant :
– À défaut d’autres, ces dix millions nous seront d’un réel secours pour activer nos préparatifs militaires.
– Mais, fit observer le roi, ces millions ne nous appartiennent pas.
– Pardon, Sire, dit froidement Sully, depuis plus de vingt ans ces millions sont enfouis chez vous, sans que le propriétaire ait donné signe de vie. Ni vous ni vos prédécesseurs n’avez pris, que je sache, aucun engagement à ce sujet. Ce qui se trouve sur les terres du roi, appartient au roi. Nous avons des juristes pour le démontrer.
Henri IV, comme Sully, quoique pas de la même manière, était intéressé. Ce chiffre de dix millions, qui, ne l’oublions pas, avait une valeur beaucoup plus considérable que de nos jours, n’avait pas été sans l’impressionner. Il n’insista pas davantage.
Sully obtint donc licence d’agir comme il l’entendrait pour faire entrer dans les coffres du roi les millions de Jehan le Brave. Et comme, lorsqu’il avait pris une décision, le Béarnais aimait aller droit au but, il résolut de liquider à l’instant même l’affaire du sacre et fit appeler la reine.
– Madame, dit-il rondement, lorsque la reine, assez inquiète, se fut assise, vous m’avez fait demander un entretien. J’imagine que c’est pour me parler encore de la cérémonie de votre couronnement.
C’était vrai. Marie de Médicis, obéissant aux suggestions de Concini, avait fait demander l’entretien dont le roi parlait. Elle crut que le roi allait refuser, comme toujours. Elle le crut d’autant plus que Sully assistait à la conversation. Aussitôt, elle se fit agressive :
– En effet, Sire, je désire vous entretenir à ce sujet. Mais je vois qu’il en sera de cette fois-ci comme des précédentes. La reine ne peut rien obtenir du roi. Elle est moins bien partagée que...
Henri vit venir la scène conjugale et qu’elle allait lui jeter à la tête ses maîtresses. Il interrompit à propos :
– Eh bien, madame, vous vous trompez. Il me plaît d’accorder aujourd’hui ce que j’ai refusé jusqu’à ce jour.
– Quoi ! balbutia Marie de Médicis toute saisie, vous consentez ?
– Je viens de prendre avec mon cousin Sully, des décisions très graves. Il est possible – ce n’est pas sûr, remarquez bien – il est possible que j’entre en campagne au printemps prochain. Pendant l’absence du roi, vous serez régente du royaume, madame. Et j’ai réfléchi qu’il est nécessaire d’assurer votre autorité autant qu’il est en mon pouvoir. Malgré les grandes dépenses que nécessitera cette cérémonie, elle a une utilité qui prime tout. C’est pourquoi j’y consens et je fais mieux : d’ores et déjà j’en fixe la date au vingt septembre.
Marie de Médicis ignorait quelle était la véritable intention des Concini en la poussant à réclamer son couronnement. Chez elle, c’était la femme, plus que la souveraine, qui désirait cette fastueuse cérémonie où elle devait tenir le principal rôle. Ce fut la femme qui, laissant momentanément l’étiquette de côté, bondit sur le roi, lui prit les deux mains et s’écria, sincèrement émue, toute radieuse :
– Vous êtes bon, Henri !... Vous me faites bien heureuse !...
– Oui, ma mie, répliqua le roi avec une pointe de mélancolie, je suis bon... Peut-être le reconnaîtrez-vous tout à fait... quand je ne serai plus là.
Déjà la nature sèche, profondément égoïste, de Marie de Médicis reprenait le dessus.
– Puisque le roi paraît si bien disposé à mon égard, dit-elle, j’en profiterai pour lui faire une autre demande.
– Qu’est-ce ? fit Henri sur la réserve.
– Sire, j’ai besoin d’argent.
– Encore ? s’écria Henri d’un air maussade.
– Sire, c’est peu de chose. Vingt mille livres seulement !
– En vérité ! madame, railla le roi mécontent. Vous trouvez que vingt mille livres ce n’est rien ?... Eh ! jarnicoton ! pensez-vous que nous allons pressurer nos peuples à seules fins que vous puissiez engraisser ces affamés de Concini, à qui vous donnez tout votre argent ?... Car c’est dans leurs coffres que passent toutes les sommes que nous vous donnons, je le sais. C’est pour les enrichir que vous vous dépouillez et voulez nous dépouiller. Ventre-saint-gris ! madame, je suis bon, mais non point bête !
– Dieu merci, riposta la reine avec aigreur, vous n’êtes pas si ménager de vos deniers quand il s’agit de satisfaire les caprices de vos maîtresses !
– Je suis le maître, s’écria Henri en tapant du pied avec colère. Je fais ce que je veux !
– Soit, fit Marie en faisant une révérence ironique. Je dirai à Mme l’abbesse de Montmartre que la reine de France n’est pas assez riche pour rendre à sa maison et à Dieu le service qu’elle est venue implorer. Je lui dirai de s’adresser à Mme de Verneuil, à qui le roi, qui est le maître, ne refusera pas ce qu’il refuse à la reine.
Et furieuse, ayant oublié déjà la grande satisfaction que le roi venait de lui accorder, elle se dirigea vers la porte.
Mais à ces mots, « l’abbesse de Montmartre », le roi avait échangé un rapide coup d’œil avec Sully. Et ils s’étaient entendus.
– Un instant, madame ! s’écria Henri radouci. Je refuse les fonds que vous demandez s’ils doivent servir à vos insatiables Italiens. Mais s’il s’agit d’une œuvre pieuse et charitable, c’est une autre affaire. Je ne veux pas qu’il soit dit que des filles de Dieu ont fait en vain appel à la générosité de la reine. Expliquez-vous donc, je vous prie.
La reine comprit qu’elle allait avoir gain de cause. Peu lui importaient les restrictions quelque peu humiliantes du roi. L’essentiel, pour elle, était d’obtenir ce qu’elle voulait.
Elle retrouva donc incontinent son sourire et ne se doutant pas qu’Henri possédait un papier en tout pareil à celui que Léonora lui avait montré, elle se trahit sans le vouloir et le savoir.
– Sachez donc, Sire, que Mme de Montmartre vient d’apprendre que, sous la chapelle du Martyr, doit exister une cave où se dresse un autel de pierre, qui n’est autre que celui sur lequel saint Denis célébrait, dans les temps reculés, l’office divin. L’abbesse voudrait faire faire des fouilles, remettre au jour ce lieu vénéré, en faire pour les fidèles un lieu de pèlerinage, qui rendrait à son abbaye tout son prestige d’antan. Mais elle est pauvre et c’est pourquoi elle s’est adressée à la reine, sous la protection de laquelle elle est venue tout d’abord se placer. Les vingt mille livres que je demande sont destinées à ces travaux. C’est une œuvre pieuse, comme vous voyez, et qui ne manquera pas d’attirer sur la maison de France les bénédictions du Seigneur.
Henri consulta Sully du regard. Celui-ci s’approcha de lui et lui dit quelques paroles à voix basse. Marie de Médicis suivit l’aparté d’un œil inquiet. C’était Sully, en effet qui était le grand trésorier du roi. C’était lui qui remettait à la reine, comme aux maîtresses du souverain, les fonds qu’il leur allouait. C’était sur lui qu’il se déchargeait et grâce à lui qu’il pouvait paraître accorder des sommes que le ministre refusait impitoyablement.
Le Béarnais roublard avait trouvé ce stratagème pour mettre un frein à la rapacité des nombreuses maîtresses qu’il entretenait.
Marie de Médicis fut vite rassurée, car le roi, redevenu aimable, lui dit :
– À Dieu ne plaise, ma mie, que je vous empêche de participer à une œuvre aussi édifiante et qui ne peut, en effet, qu’attirer sur nous les bénédictions du ciel. M. de Sully vous remettra donc la somme que vous demandez. Seulement, j’y mets une petite condition.
– Laquelle, Sire ?
– Cette œuvre me paraît si vénérable que je veux faire plus et mieux que donner mon obole. Je me réserve de faire surveiller et, au besoin, diriger les travaux qui vont être entrepris. Dites-le, je vous prie, de ma part, à Mme de Montmartre.
Marie de Médicis ne pouvait soupçonner qu’Henri IV avait une arrière-pensée. Elle le crut de bonne foi. Trop heureuse d’en être quitte à si bon compte, elle se hâta de dire :
– Le roi est le maître ! Partout et toujours.
Elle sortit et courut porter la bonne nouvelle à Léonora et à Concini qui la poussaient.
Ni Concini ni sa femme ne se doutèrent qu’ils allaient se trouver aux prises avec le roi et Acquaviva et que ni l’un ni l’autre de ces redoutables compétiteurs ne les laisserait s’approprier le trésor convoité, le trésor qu’ils croyaient déjà tenir.
Ces préparatifs sont ceux d’une campagne contre la Maison d’Autriche à propos des duchés de Clèves et de Juliers.
XXXVI
Ce même jour, à l’heure du dîner, Jehan le Brave avait emmené Carcagne, Escargasse et Gringaille au cabaret. Il voulait leur offrir un dîner qui, dans son esprit, était un dîner d’adieu.
Malgré les manières rudes qu’il affectait à leur égard, l’affection qu’il leur portait était réelle. Ce n’était pas sans un secret déchirement qu’il s’était résigné à se séparer d’eux.
Les trois ignoraient l’intention de leur chef. En conséquence, ils se livrèrent à la bombance et à la joie, sans contrainte et sans arrière-pensée. Jehan, pour ne pas les attrister, s’efforça de se montrer gai et insouciant.
Lorsque, le repas terminé, ils se trouvèrent dans la rue, les trois braves étaient fortement éméchés. Jehan, qui s’était montré plus sobre, avait tout son sang-froid. Avec une émotion qu’il ne parvint pas à maîtriser, il leur dit alors :
– Mes braves compagnons, nous ne pouvons plus vivre ensemble de notre vie d’autrefois. Il faut nous séparer. Tirez à droite, moi je vais à gauche... et que Dieu vous garde !
Et il voulut s’éloigner. Mais les trois, comme s’il n’avait rien dit, demandèrent :
– Les ordres, chef ?
Ils n’avaient pas compris. Cependant leur gaieté était tombée. Ils pressentaient que quelque chose de grave et de douloureux allait se décider. Jehan ne voulut pas les quitter sur un malentendu. Il dit avec douceur :
– Je n’ai plus d’ordres à vous donner. Je ne suis plus votre chef. Comprenez-vous ?... C’est fini entre nous. Il faut nous dire adieu et pour toujours.
Ils se regardèrent effarés. Ils étaient livides. Leur commencement d’ivresse était tombé d’un coup. Et brusquement, ils éclatèrent en accents douloureux :
– Alors, vous nous chassez ?
– Qu’est-ce que nous avons fait ?
– Que voulez-vous que nous fassions sans vous ?
– Je ne vous chasse pas, reprit Jehan avec la même douceur. Je n’ai rien à vous reprocher... Mais il faut nous séparer quand même.
Maintenant, ils comprenaient. Après la douleur, ce fut l’indignation et, pour la première fois, la révolte :
– Pourquoi nous séparer ? Cornes de Dieu ! rugit Gringaille. Quand on condamne les gens, on leur dit au moins pourquoi !
– C’est vrai ! appuyèrent les deux autres, pourquoi ?
– Parce qu’avec le nouveau genre d’existence que j’ai résolu d’adopter, si vous restiez avec moi, vous risqueriez fort de crever de faim.
Ils se regardèrent, ébahis. De nouveau, ils ne comprenaient plus. L’un après l’autre, ils demandèrent :
– Pourquoi crèverions-nous de faim ?
– N’avons-nous pas toujours ceci ?
Ils frappaient sur la poignée de la rapière.
– Et ne trouverons-nous pas toujours de ceux-là ?
Il montrait un bourgeois et faisait le geste de dévaliser.
– Justement, dit vivement Jehan, c’est ceci que je ne veux plus faire. Ceci s’appelle : voler.
– Voler !...
L’exclamation jaillit des trois bouches en même temps. Maintenant l’inquiétude se lisait sur leurs visages et ils avaient des airs de dire : « Il est malade ! »
Et Jehan qui les comprit, s’écria avec violence :
– Oui, vous ne comprenez pas !... Comme vous, j’ai longtemps cru qu’il était juste et légitime de prélever sur le riche la part du pauvre. Je sais que j’ai été un voleur !... oui, un voleur, moi !... Et je sens le rouge de la honte me monter au front à cette pensée... et, plutôt que de recommencer, j’aimerais mieux me couper le poignet et le jeter aux chiens !...
C’était sérieux, hélas ! Ils le comprirent cette fois. Et ils s’effarèrent. Ce diable d’homme avait toujours des idées bizarres, auxquelles ils ne comprenaient rien.
Ils se consultèrent du coin de l’œil. Ils se virent d’accord. Puisque c’était son idée, ils feraient ce qu’il voudrait. Ils se feraient honnêtes, ils se changeraient en petits saints, ils claqueraient du bec avec lui. Enfin, il commandait : ils obéiraient. C’était très simple. Et ils le dirent simplement.
Jehan fut touché de leur insistance et de leur soumission. Mais il se faisait un scrupule de leur imposer sa misère.
Sans lui, les pauvres diables, dénués de scrupules, se tireraient toujours d’affaire. Il le leur fit remarquer loyalement.
– Bon ! dit Gringaille avec insouciance, mourir de ceci ou de cela, il faut y passer quand même !...
Et avec une gravité soudaine :
– Quant à moi, si vous persistez à nous chasser, je vous donne ma parole que je vais de ce pas me jeter du haut du Pont-Neuf, la tête la première.
– Et moi, de même ! firent les deux autres d’une même voix.
Jehan s’était déclaré vaincu.
Il avait été convenu qu’ils continueraient comme par le passé à venir prendre ses ordres tous les jours. Ils étaient à lui corps et âme, plus que jamais. Et en attendant qu’il eût fait fortune – ce qui ne pouvait tarder – ils assureraient eux-mêmes leur pitance. Honnêtement, bien entendu. C’était juré.
D’ailleurs, pour l’instant, ils étaient riches des libéralités de Concini. Bien nippés, bien équipés, un logis confortable, de l’or et des bijoux en poche. C’était plus qu’il n’en fallait pour attendre la fortune.
Jehan ne se séparait d’eux que parce qu’il lui était impossible de les entretenir. Rassuré sur leur sort, il s’en alla bien tranquille, content, au fond, qu’il n’y eût rien de changé, bien résolu à les prendre à sa charge dès qu’il le pourrait.
Escargasse, Gringaille et Carcagne demeurèrent dans la rue, le regardant s’éloigner d’un œil mélancolique. Quand ils ne le virent plus, ils se regardèrent avec des mines graves. C’est que la situation leur paraissait telle. D’un commun accord, ils se dirigèrent vers leur logis ; ils éprouvaient le besoin de se concerter.
En route, ils réfléchirent que la discussion donne soif. Ils achetèrent une petite cruche qui ne contenait guère plus de six pintes de certain petit clairet des environs de Paris. C’était un vin qui avait un petit goût de pierre à fusil et vous râpait la langue, pour lequel ils avaient un faible prononcé. La petite quantité de liquide qu’ils emportaient prouvait bien qu’ils étaient résolus à discuter sérieusement.
L’un d’eux fit remarquer, très judicieusement, que boire sans manger est souverainement mauvais pour l’estomac. Les autres furent de cet avis. En conséquence, ils complétèrent leurs emplettes. Carcagne prit une oie qui lui parut agréablement juteuse. Escargasse jeta son dévolu sur certain quartier de porc piqué d’ail, de mine fort appétissante. Gringaille s’empara d’un joli jambonneau auquel il adjoignit un saucisson convenablement fumé.
Ils s’aperçurent alors que, pour un en-cas, c’était un peu trop. Pour un souper, au contraire, c’était un peu maigre. Ils n’hésitèrent pas : ils ajoutèrent un respectable pâté de bécasse, plus quelques tranches de venaison. Bien entendu, ils n’oublièrent pas une demi-douzaine de chapelets de pain tendre, bien croustillant et doré.
Pour compléter le tout, ils ajoutèrent trois flacons de vouvray, le vin préféré de messire Jehan. Naturellement, pour accompagner dignement le vouvray, il fallut ajouter un petit flan, plus quelques menues pâtisseries sans conséquence.
Chargés comme des baudets, ils se hâtèrent vers leur logis. Ils habitaient rue du Bout-du-Monde. Cette rue touchait aux remparts et allait depuis la porte Montmartre, jusqu’à la rue Montorgueil. Comme de juste, ils logeaient sous les combles.
Ce logis, qu’ils disaient des plus confortables, était un misérable taudis. Le mobilier se composait d’un grand coffre qu’ils laissaient au milieu de la pièce parce qu’ainsi il leur servait de table. Il y avait un banc en bois de pin et deux escabeaux dont l’un était amputé d’une jambe.
Dans un coin, trois paillasses étaient posées côte à côte, à terre. Elles étaient munies de couvertures, mais les draps brillaient par leur absence. Il y avait une grande cheminée. Elle était bien étonnée quand, par hasard, on y faisait du feu.
Enfin, et ceci c’était la merveille, il y avait deux lucarnes qui donnaient sur les derrières. Ce qui fait que, du haut de leur perchoir, ils découvraient des vergers, les remparts gazonnés et les fossés, le long desquels s’étendaient des jardins, des guinguettes, des jeux. Un peu plus loin, ils voyaient la Villeneuve-sur-Gravois1, dont une partie (celle qui avoisinait la porte Saint-Denis) était alors couverte des ruines occasionnées par l’artillerie du roi, lorsqu’il assiégeait sa bonne ville. Puis des marais, des vergers, des champs, des moulins, dont les ailes tournaient joyeusement. La campagne enfin, et la campagne présentement fleurie et embaumée. Tout un merveilleux panorama des environs du Paris d’alors dont, si fruste que fût leur nature, ils ne pouvaient pas ne pas sentir la beauté.
Chez eux, ils étalèrent leurs provisions sur le coffre-table. Il n’y avait guère plus de deux heures qu’ils avaient dîné. Mais ils venaient de subir une des plus rudes émotions de leur vie. Et on sait que les émotions ont le don de creuser. Il leur semblait que leur estomac était creusé à un tel point que jamais ils ne parviendraient à combler le trou. Ils s’installèrent et attaquèrent les victuailles, comme s’ils eussent été à jeun depuis la veille. En même temps, ils tinrent conseil.
De leurs observations réunies, ils tirèrent cette conclusion que Jehan devait être bien malade. Carcagne, qui avait failli se faire moine et qui avait de l’instruction, alla même jusqu’à dire qu’il le croyait possédé de quelque méchant démon qui s’acharnait à le persécuter. À son avis, quelques bonnes messes, dites à propos, suffiraient à expulser le démon. Ceci leur parut tellement évident, à tous trois, que, séance tenante, ils prélevèrent les fonds nécessaires aux messes.
– Et quant à nous, n’avons-nous pas toujours été d’honnêtes garçons, tripes du pape ?
– À preuve : quelqu’un s’est-il jamais avisé de dire devant nous que nous étions des voleurs ?... Non, n’est-ce pas ?... Alors ?...
– Oui, mais, c’est son idée... Alors !...
Il est à noter que la pensée ne leur vint pas de se dérober aux exigences de leur chef et de continuer leur genre d’existence habituel. Ils avaient promis. Ils se fussent crus déshonorés en manquant à leur parole. C’est très sincèrement qu’ils dressaient des plans pour devenir honnêtes, puisque Jehan le voulait ainsi.
Ceci les amena tout naturellement à faire le compte de leur fortune. Ils trouvèrent qu’ils possédaient environ quatre cents livres. Somme considérable.
Ce n’était pas tout. Ils avaient des bijoux qu’ils avaient soutirés à Concini. Ils allèrent les vendre. Ils en tirèrent la somme de deux mille huit cents livres qui, jointes aux quatre cents, faisaient trois mille deux cents livres. De quoi vivre largement toute une année. Mais...
Gringaille avait une sœur : Perrette la Jolie, dont nous lui avons entendu parler. Perrette allait maintenant sur ses dix-sept ans. Elle méritait grandement son surnom, car elle était en effet idéalement jolie. Fille d’une ribaude et d’un truand, élevée Dieu sait comme, cette étrange fille ne s’était-elle pas avisée de demeurer honnête et de vivre péniblement de son travail ?
Frêle et délicate, elle s’était astreinte au dur labeur de lavandière. Avec un courage rare, une volonté extraordinaire, elle s’était gardée chaste, pure de toute souillure, sage, comme ne l’étaient pas bien des filles de bonne bourgeoisie. On ne lui connaissait même pas d’amoureux.
Elle en avait un cependant : c’était Carcagne, qui était profondément et sincèrement épris de la jeune fille. Carcagne était un truand, un mauvais garçon, un spadassin, un bravo, un bandit, enfin. Que pensez-vous que fit ce bandit amoureux ? Il s’en alla trouver Gringaille, lequel, à tout prendre, était le chef de famille et bonnement, honnêtement, il lui demanda la main de sa sœur. Nous vous avions bien dit que Carcagne était un simple. Vous voyez bien que nous n’avions pas menti.
Gringaille transmit la demande de son ami en l’appuyant de toute son autorité. À sa grande stupeur et au grand désespoir de Carcagne. Perrette avait catégoriquement refusé le parti qui se présentait. Elle ne se sentait aucun goût pour le mariage, dit-elle. Sans se décourager, Gringaille était revenu à la charge avec acharnement. De guerre lasse, Perrette avait fini par dire qu’elle verrait plus tard, dans quelques années.
Force avait été à l’amoureux de se contenter de cette vague promesse. Dans son for intérieur, tant les amoureux sont tenaces, il se considérait comme le fiancé de la jeune fille. Il s’avançait peut-être beaucoup.
D’ailleurs, si réel et si profond que fût cet amour, il n’empêchait nullement Carcagne de bien boire, bien manger, bien dormir, de mener en somme une existence assez dissolue. Il pensait qu’il serait temps de se ranger et d’être fidèle quand il serait uni en justes et légitimes noces. Avait-il tort ou raison ? Ceci n’est pas notre affaire.
Quoi qu’il en soit, lorsqu’ils se virent à la tête d’une petite fortune, Carcagne se souvint à propos que Perrette était trop faible et délicate pour continuer son métier de lavandière. Son rêve était de posséder mille livres avec quoi elle s’établirait, prendrait quelques ouvrières et se réserverait le lissage de la fine lingerie des nobles dames. C’était là un travail plus délicat, plus en rapport avec ses forces physiques et auquel elle excellait.
Carcagne se souvint de tout cela. Il le rappela à Gringaille et proposa bravement de donner à eux deux, douze cents livres à la jeune fille, avec quoi elle pourrait réaliser son rêve. L’idée parut admirable à Gringaille, qui l’accepta sans hésiter.
L’argent fut aussitôt divisé en trois parts. C’était leur manie, innocente au bout du compte. Escargasse les vit prélever chacun six cents livres sur leur part et déposer le reste dans le coffre. Comme ils avaient les mines réjouies de gens qui se disposent à faire une bonne farce, il s’informa. On lui dit naïvement de quoi il retournait. Il arriva qu’Escargasse se fâcha tout rouge et prétendit contribuer pour sa quote-part au bonheur de Perrette. Et il allongea, lui aussi, ses six cents livres. C’étaient trois chenapans qui ne valaient pas la corde qui, un jour ou l’autre, les hisserait au haut de quelque maîtresse branche d’où ils se balanceraient pareils à des fruits monstrueux.
De ce fait, Perrette la Jolie eut dix-huit cents livres, au lieu de mille qu’elle ambitionnait, pour s’établir. Gringaille alla les lui porter sur-le-champ. Car cette fille étrange et fière n’eût pas accepté d’un autre que de son frère.
De ce fait aussi, les trois sacripants n’eurent plus que quatorze cents livres. Mais bah ! c’était de quoi vivre tranquille six bons mois.
Aujourd’hui quartier et boulevard Bonne-Nouvelle. (Note de M. Zévaco.)
XXXVII
Les quatorze cents livres durèrent quinze jours. Pas plus.
Est-ce à dire que les trois gaillards s’amusèrent à jeter leurs écus dans la Seine ?... Ou qu’ils firent des emplettes considérables ?... Ou qu’ils se livrèrent enfin à des orgies sans, nom ? Point. Ils ne firent aucune acquisition et ils vécurent assez raisonnablement. Au train qu’ils avaient adopté, ils auraient pu faire durer leur magot deux ou trois mois. Ce qui, en somme, eût été assez gentil.
Mais ils s’avisèrent de jouer dans les cabarets qu’ils fréquentaient. Et comme, maintenant qu’ils étaient devenus honnêtes, ils se figuraient naïvement que tout ce qu’il y avait de larrons dans Paris s’étaient convertis comme eux, ils ne songèrent pas à se méfier.
Un soir – soir de guigne noire – ils tombèrent sur un trio de maîtres pipeurs. Les choses ne traînèrent pas. En moins d’une heure, ils perdirent jusqu’à leur dernière maille. Il leur fallut fuir, courbant l’échine sous la raclée de coups de triques de l’hôtelier furieux de voir la dépense non réglée. Car les trois fripons s’étaient défilés à la douce emportant leur butin.
La catastrophe était terrible. Autrefois, une soirée passée à l’affût, au coin d’une rue, eût à peu près réparé le dommage. Mais aujourd’hui qu’ils étaient honnêtes, c’était la misère noire, les jours de famine et d’expédients prévus par leur chef.
Ils vendirent les armes et les costumes magnifiques payés par Concini. Ils ne gardèrent que leur bonne rapière et le costume qu’ils avaient sur le dos. Heureusement, ces vêtements étaient en excellent drap, presque neufs, et ils étaient ainsi encore présentables.
Ménagés avec une économie sordide, quoique un peu tardive, les quelques écus qu’ils tirèrent de cette vente durèrent une semaine. Jehan, qui les vit toujours très propres, insouciants à leur habitude, ne soupçonna pas leur détresse. Ils se gardèrent bien de l’avouer.
Au moment où nous les retrouvons, il était quatre heures de l’après-midi. On était aux premiers jours de juin. Le temps était radieux et le soleil versait à flots son éclatante lumière. C’était un de ces étincelants après-midi où tout respire la joie de vivre.
Ce jour-là, Gringaille, Escargasse et Carcagne avaient serré leur ceinture d’un cran. Déjeuner peu substantiel, on en conviendra. Et ils allaient, par les rues de la grand-ville, le nez au vent, l’œil au guet, à l’affût de l’occasion propice qui leur permettrait de dîner autrement que d’un nouveau cran à la ceinture.
Mélancoliques, mais non résignés, ils erraient sans but précis. Ils comptaient sur le hasard qui, jusque-là, ne se montrait guère favorable. Ils étaient parvenus au carrefour du Trahoir. Machinalement, ils s’engagèrent dans la rue de l’Arbre-Sec, se dirigeant vers la rivière.
Tout à coup, Carcagne s’administra sur le crâne un coup de poing à assommer un bœuf, et il beugla :
– J’ai trouvé !
– Quoi ? firent les autres, palpitants.
– Le moyen de dîner sans avoir rien à débourser et peut-être... qui sait ?... la pitance assurée pendant quelque temps. Vite, compères, la voici, entrez dans le cul-de-sac et n’en bougez pas jusqu’à ce que je vous appelle.
Ceci se passait devant la maison de dame Colline Colle. En la reconnaissant à travers les vitraux de sa fenêtre, Carcagne venait brusquement de se rappeler les avances qu’elle lui avait faites.
La matrone, depuis l’enlèvement de Bertille, passait la majeure partie de son temps à cette fenêtre. Elle était extraordinairement tenace et n’avait pas renoncé à son idée de tirer profit de cet enlèvement.
Elle avait cherché La Varenne. Mais le confident du roi se cachait chez lui. Il ne pouvait se résigner à montrer son visage avec sa balafre qui ressemblait par trop à un coup de cravache. Colline Colle n’avait pu le rencontrer. Elle avait concentré ses espoirs sur Carcagne.
Mais le bon jeune homme, comme elle disait, ne paraissait pas se décider à venir la voir, comme elle l’en avait prié. Et voici que, au moment où elle commençait à désespérer, elle l’apercevait, arrêté devant sa maison. Elle n’avait pas hésité à ouvrir sa fenêtre et l’avait appelé sans vergogne. C’est ce qui avait fait dire à Carcagne : « la voici ! »