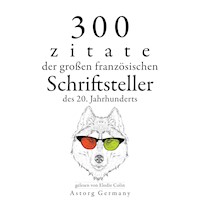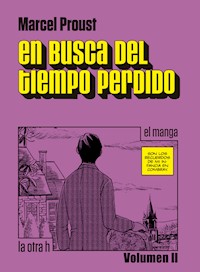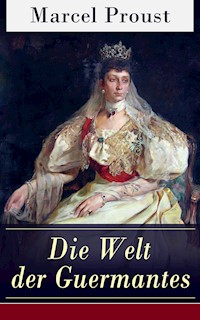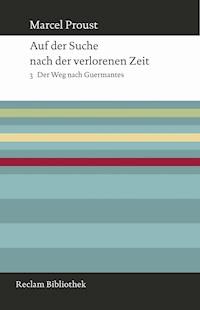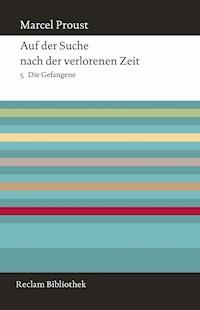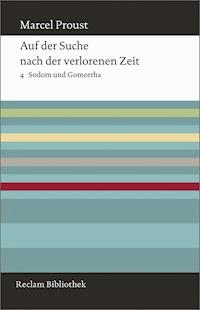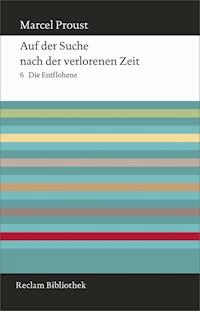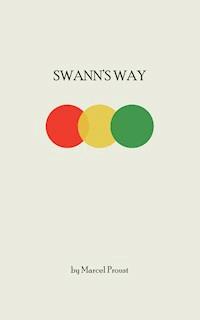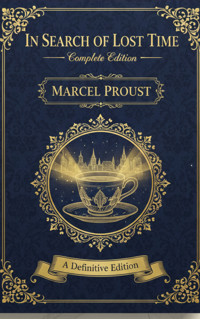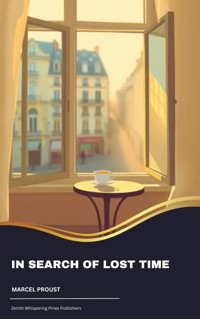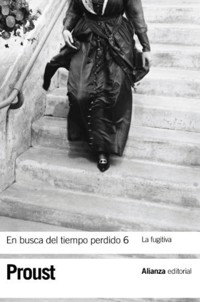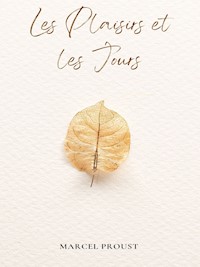
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Première oeuvre écrite, première oeuvre publiée de Proust, Les Plaisirs et les jours parurent en 1896. Aujourd'hui, à travers la diversité même des textes qui composent ce recueil, on peut se demander si cet ouvrage de jeunesse ne constitue pas une ébauche encore imparfaite et schématique d'À la recherche du temps perdu, et surtout s'il n'existe pas déjà en lui-même, avec ses lois et ses beautés irréductibles.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 251
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Les Plaisirs et les Jours
Les Plaisirs et les JoursÀ MON AMI WILLIE HEATHLA MORT DE BALDASSARE SILVANDE VICOMTE de SYLVANIEVIOLANTE OU LA MONDANITÉFRAGMENTS DE COMÉDIE ITALIENEMONDANITÉ ET MÉLOMANIE DE BOUVARD ET PÉCUCHETMÉLANCOLIQUE VILLÉGIATURE DE MADAME DE BREYVESPORTRAITS DE PEINTRES ET DE MUSICIENSLA CONFESSION D’UNE JEUNE FILLEUN DÎNER EN VILLELA FIN DE LA JALOUSIEPage de copyrightLes Plaisirs et les Jours
Marcel Proust
À MON AMI WILLIE HEATH
Mort à Paris le 3 octobre 1893
“Du sein de Dieu où tu reposes…
révèle-moi ces vérités
qui dominent la mort,
empêchent de la craindre
et la font presque aimer.”
Les anciens Grecs apportaient à leurs morts des gâteaux, du lait et du vin. Séduits par une illusion plus raffinée, sinon plus sage, nous leur offrons des fleurs et des litres. Si je vous donne celui-ci, c’est d’abord parce que c’est un livre d’image. Malgré les “légendes”, il sera, sinon lu, au moins regardé par tous les admirateurs de la grande artiste qui m’a fait avec simplicité ce cadeau magnifique, celle dont on pourrait dire, selon le mot de Dumas, “que c’est elle qui a créé le plus de roses après Dieu”. M. Robert de Montesquiou aussi l’a célébrée, dans des vers inédits encore, avec cette ingénieuse gravité, cette éloquence sentencieuse et subtile, cet ordre rigoureux qui parfois chez lui rappellent le XVIIe siècle.
Il lui dit, en parlant des fleurs :
“Poser pour vos pinceaux les engage à fleurir.
Vous êtes leur Figée et vous êtes la Flore
Qui les immortalise, où l’autre fait mourir !”
Ses admirateurs sont une élite, et ils sont une foule. J’ai voulu qu’ils voient à la première page le nom de celui qu’ils n’ont pas eu le temps de connaître et qu’ils auraient admiré. Moi-même, cher ami, je vous ai connu bien peu de temps. C’est au Bois que je vous retrouvais souvent le matin, m’ayant aperçu et m’attendant sous les arbres, debout, mais reposé, semblable à un de ces seigneurs qu’a peints Van Dyck et dont nous aviez l’élégance pensive.
Leur élégance, en effet, comme la vôtre, réside moins dans les vêtements que dans le corps, et leur corps lui-même semble l’avoir reçue et continuer sans cesse à la recevoir de leur âme : c’est une élégance morale. Tout d’ailleurs contribuait à accentuer cette mélancolique ressemblance, jusqu’à ce fond de feuillages à l’ombre desquels Van Dycka souvent arrêté la promenade d’un roi ; comme tant d’entre ceux qui furent ses modèles, vous deviez bientôt mourir, et dans vos yeux comme dans les leurs, on voyait alterner les ombres du pressentiment et là douce lumière de la résignation. Mais si la grâce de votre fierté appartenait de droit à l’art d’un Van Dyck, vous releviez plutôt du Vinci par la mystérieuse intensité de votre vie spirituelle. Souvent le doigt levé, les yeux impénétrables et souriants en face de l’énigme que vous taisiez, vous m’êtes apparu comme le saint Jean-Baptiste de Léonard.
Nous formions alors le rêve, presque le projet, de vivre de plus en plus l’un avec l’autre, dans un cercle de femmes et d’hommes magnanimes et choisis, assez loin de la bêtise, du vice et de la méchanceté pour nous sentir à l’abri de leurs flèches vulgaires.
Votre vie, telle que nous la vouliez, serait une de ces œuvres à qui il faut une haute inspiration. Comme de la foi et du génie, nous voulons la recevoir de l’amour.
Mais c’était la mort qui devait vous la donner. En elle aussi et même en ses approches résident des forces cachées, des aides secrètes, une “grâce” qui n’est pas dans la vie. Comme les amants quand ils commencent à aimer, comme les poètes dans le temps où ils chantent, les malades se sentent plus près de leur âme. La vie est chose dure qui serre de trop près, perpétuellement nous fait mal à l’âme. À sentir ses tiens un moment se relâcher, on peut éprouver de clairvoyantes douceurs.
Quand j’étais tout enfant, le sort d’aucun personnage de l’histoire sainte ne me semblait aussi misérable que celui de Noé, à cause du déluge qui le tint enfermé dans l’arche pendant quarante jours. Plus tard, je fus souvent malade, et pendant de longs jours je dus rester aussi dans l’“arche”. Je compris alors que jamais Noé ne put si bien voir le monde que de l’arche, malgré qu’elle fût close et qu’il fit nuit sur la terre. Quand commença ma convalescence, ma mère, qui ne m’avait pas quitté, et, la nuit même restait auprès de moi,“ouvrit la porte de l’arche” et sortit. Pourtant comme la colombe “elle revint encore ce soir-là”.
Puis je fus tout à fait guéri, et comme la colombe “elle ne revint plus”, Il fallut recommencer à vivre, à se détourner de soi, à entendre des paroles plus dures que celles de ma mère ; bien plus, les siennes, si perpétuellement douces jusque-là, n’étaient plus les mêmes, mais empreintes de la sévérité de la vie et du devoir qu’elle devait m’apprendre.
Douce colombe du déluge, en vous voyant partir comment penser que le patriarche n’ait pas senti quelque tristesse se mêler à la joie du monde renaissant ?
Douceur de la suspension de vivre, de la vraie “Trêve de Dieu” qui interrompt les travaux, les désirs mauvais, “Grâce” de la maladie qui nous rapproche des réalités d’au-delà de la mort – et ses grâces aussi, grâces de “ces vains ornements et ces voiles qui pèsent”, des cheveux qu’une importune main “a pris soin d’assembler”, suaves fidélités d’une mère et d’un ami qui si souvent nous sont apparus comme le visage même de notre tristesse ou comme le geste de la protection implorée par notre faiblesse, et qui s’arrêteront au seuil de la convalescence, souvent j’ai souffert de vous sentir si loin de moi, vous toutes, descendante exilée de la colombe de l’arche. Et qui même n’a connu de ces moments, cher Willie, où il voudrait être où vous êtes. On prend tant d’engagements envers la vie qu’il vient une heure où, découragé de pouvoir jamais les tenir tous, on se tourne vers les tombe qu’on appelle la mort, “la mort qui vient en aide aux destinées qui ont peine à s’accomplir”.
Mais si elle nous délie des engagements que nous avons pris envers la vie, elle ne peut nous délier de ceux que nous avons pris envers nous-même, et du premier surtout, qui est de vivre pour valoir et mériter.
Plus grave qu’aucun de nous, vous étiez aussi plus enfant qu’aucun, non pas seulement par la pureté du cœur, mais par une gaieté candide et délicieuse. Charles de Grancey avait le don que je lui enviais de pouvoir, avec des souvenirs de collège, réveiller brusquement ce rire qui ne s’endormait jamais bien longtemps, et que nous n’entendrons plus.
Si quelques-unes de ces pages ont été écrites à vingt-trois ans, bien d’autres “Violante, presque tous les Fragments de la comédie italienne, etc.) datent de ma vingtième année. Toute.s ne sont que la vaine écume d’une vie agitée, mais qui maintenant se calme. Puisse-t-elle être un jour. assez limpide pour que les Muses daignent s’y mirer et qu’on voie courir à la surface le reflet de leurs sourires et de leurs danses.
Je vous donne ce livre. Vous êtes, hélas ! le seul de mes amis dont il n’ait pas à redouter les critiques. J’ai au moins la confiance que nulle part la liberté du ton ne vous y eût choqué. Je n’ai jamais peint l’immoralité que chez des êtres. d’une conscience délicate. Aussi, trop faibles pour vouloir le bien, trop nobles pour jouir pleinement dans le mal, ne connaissant que la souffrance, je n’ai pu parler d’eux qu’avec une pitié trop sincère pour qu’elle ne purifiât pas ces petits essais.
Que l’ami véritable, le Maître illustre du bien-aimé qui leur ont ajouté, l’un la poésie de la musique, l’autre la musique de son incomparable poésie, que M. Darlu aussi, le grand philosophe dont la parole inspirée, plus sûre de durer qu’un écrit, a, en moi comme en tant d’autres, engendré la pensée, me pardonnent d’avoir réservé pour vous ce gage dernier d’affection, se souvenant qu’aucun vivant, si grand soit-il ou si cher, ne doit être honoré qu’après un mort.
Juillet 1894.
LA MORT DE BALDASSARE SILVANDE VICOMTE de SYLVANIE
I
“Apollon gardait les troupeaux d’Admète, disent les poètes ;
chaque homme aussi est on dieu déguisé qui contrefait le fou.”
EMERSON
“Monsieur Alexis, ne pleurez pas comme cela, M. le vicomte de Sylvanie va peut-être vous donner un cheval.
– Un grand cheval, Beppo, ou un poney ?
– Peut-être un grand cheval comme celui de M. Cardenio. Mais ne pleurez donc pas comme cela… le jour de vos treize ans !” L’espoir de recevoir un cheval et le souvenir qu’il avait treize ans firent briller, à travers les larmes, les yeux d’Alexis. Mais il n’était pas consolé puisqu’il fallait aller voir son oncle Baldassare SILVANDE, vicomte de Sylvanie. Certes, depuis le jour où il avait entendu dire que la maladie de son oncle était inguérissable, Alexis l’avait vu plusieurs fois. Mais depuis, tout avait bien changé. Baldassare s’était rendu compte de son mal et savait maintenant qu’il avait au plus trois ans à vivre. Alexis, sans comprendre d’ailleurs comment cette certitude n’avait pas tué de chagrin ou rendu fou son oncle, se sentait incapable de supporter la douleur de le voir. Persuadé qu’il allait lui parler de sa fin prochaine, il ne se croyait pas la force, non seulement de le consoler, mais même de retenir ses sanglots.
Il avait toujours adoré son oncle, le plus grand, le plus beau, le plus jeune, le plus vif, le plus doux de ses parents. Il aimait ses yeux gris, ses moustaches blondes, ses genoux, lieu profond et doux de plaisir et de refuge quand il était plus petit, et qui lui semblaient alors inaccessibles comme une citadelle, amusants comme des chevaux de bois et plus inviolables qu’un temple.
Alexis, qui désapprouvait hautement la mise sombre et sévère de son père et rêvait à un avenir où, toujours à cheval, il serait élégant comme une dame et splendide comme un roi, reconnaissait en Baldassare l’idéal le plus élevé qu’il se formait d’un homme ; il savait que son oncle était beau, qu’il lui ressemblait, il savait aussi qu’il était intelligent, généreux, qu’il avait une puissance égale à celle d’un évêque ou d’un général. À la vérité, les critiques de ses parents lui avaient appris que le vicomte avait des défauts. Il se rappelait même la violence de sa colère le jour où son cousin Jean Galeas s’était moqué de lui, combien l’éclat de ses yeux avait trahi les jouissances de sa vanité quand le duc de Parme lui avait fait offrir la main de sa sœur dl avait alors, en essayant de dissimuler son plaisir, serré les dents et fait une grimace qui lui était habituelle et qui déplaisait à Alexis) et le ton méprisant dont il parlait à Lucretia qui faisait profession de ne pas aimer sa musique.
Souvent, ses parents faisaient allusion à d’autres actes de son oncle qu’Alexis ignorait, mais qu’il entendait vivement blâmer.
Mais tous les défauts de Baldassare, sa grimace vulgaire, avaient certainement disparu. Quand son oncle avait su que dans deux ans petit-être il serait mort, combien les moqueries de Jean Galeas, l’amitié du duc de Parme et sa propre musique avaient dû lui devenir indifférentes. Alexis se le représentait aussi beau, mais solennel et plus parfait encore qu’il ne l’était auparavant. Oui, solennel et déjà plus tout à fait de ce monde. Aussi à son désespoir se mêlait un peu d’inquiétude et d’effroi.
Les chevaux étaient attelés depuis longtemps, il fallait partir ; il monta dans la voiture, puis redescendit pour aller demander un dernier conseil à son précepteur. Au moment de parler, il devint très rouge :
“Monsieur Legrand, vaut-il mieux que mon oncle croie ou ne croie pas que je sais qu’il sait qu’il doit mourir ?
– Qu’il ne le croie pas, Alexis !
– Mais, s’il m’en parle ?
– Il ne vous en parlera pas.
– Il ne m’en parlera pas ?” dit Alexis étonné, car c’était la seule alternative qu’il n’eût pas prévue : chaque fois qu’il commençait à imaginer sa visite à son oncle, il l’entendait lui parler de la mort avec la douceur d’un prêtre.
“Mais, enfin, s’il m’en parle ?
– Vous direz qu’il se trompe.
– Et si je pleure ?
– Vous avez trop pleuré ce matin, vous ne pleurerez pas chez lui.
– Je ne pleurerai pas ! s’écria Alexis avec désespoir, mais il croira que je n’ai pas de chagrin, que je ne l’aime pas… mon petit oncle !”.
Et il se mit à fondre en larmes. Sa mère, impatientée d’attendre, vint le chercher ; ils partirent.
Quand Alexis eut donné son petit paletot à un valet en livrée verte et blanche, aux armes de Sylvanie, qui se tenait dans le vestibule, il s’arrêta un moment avec sa mère à écouter un air de violon qui venait d’une chambre voisine. Puis, on les conduisit dans une immense pièce ronde entièrement vitrée où le vicomte se tenait souvent. En entrant, on voyait en face de soi la mer, et, en tournant la tête, des pelouses, des pâturages et des bois ; au fond de la pièce, il y avait deux chats, des roses, des pavots et beaucoup d’instruments de musique. Ils attendirent un instant.
Alexis se jeta sur sa mère, elle crut qu’il voulait l’embrasser, mais il lui demanda tout bas, sa bouche collée à son oreille :
“Quel âge a mon oncle ?
– Il aura trente-six ans au mois de juin.” Il voulut demander : “Crois-tu qu’il aura jamais trente-six ans ?” mais il n’osa pas.
Une porte s’ouvrit, Alexis trembla, un domestique dit :
“Monsieur le vicomte vient à l’instant.”
Bientôt le domestique revint faisant entrer deux paons et un chevreau que le vicomte emmenait partout avec lui. Puis on entendit de nouveaux pas et la porte s’ouvrit encore.
“Ce n’est rien, se dit Alexis dont le cœur battait chaque fois qu’il entendait du bruit, c’est sans doute un domestique, oui, bien probablement un domestique.” Mais en même temps, il entendait une voix douce :
“Bonjour, mon petit Alexis, je te souhaite une bonne fête.” Et son oncle en l’embrassant lui fit peur. Il s’en aperçut sans doute et sans plus s’occuper de lui, pour lui laisser le temps de se remettre, il se mit à causer gaiement avec la mère d’Alexis, sa belle-sœur, qui, depuis la mort de sa mère, était l’être qu’il aimait le plus au monde.
Maintenant, Alexis, rassuré, n’éprouvait plus qu’une immense tendresse pour ce jeune homme encore si charmant, à peine plus pâle, héroïque au point de jouer la gaieté dans ces minutes tragiques. Il aurait voulu se jeter à son cou et n’osait pas, craignant de briser l’énergie de son oncle qui ne pourrait plus rester maître de lui. Le regard triste et doux du vicomte lui donnait surtout envie de pleurer. Alexis savait que toujours ses yeux avaient été tristes et même, dans les moments les plus heureux, semblaient implorer une consolation pour des maux qu’il ne paraissait pas ressentir. Mais, à ce moment, il crut que la tristesse de son oncle, courageusement bannie de sa conversation, s’était réfugiée dans ses yeux qui, seuls, dans toute sa personne, étaient alors sincères avec ses joues maigries.
“Je sais que tu aimerais conduire une voiture à deux chevaux, mon petit Alexis, dit Baldassare, on t’amènera demain un cheval. L’année prochaine, je compléterai la paire et, dans deux ans, je te donnerai la voiture. Mais, peut-être, cette année, pourras-tu toujours monter le cheval, nous l’essayerons à mon retour. Car je pars décidément demain, ajouta-t-il, mais pas pour longtemps.
Avant un mois je serai revenu et nous irons ensemble en matinée, tu sais, voir la comédie où je t’ai promis de te conduire.” Alexis savait que son oncle allait passer quelques semaines chez un de ses amis, il savait aussi qu’on permettait encore à son oncle d’aller au théâtre ; mais tout pénétré qu’il était de cette idée de la mort qui l’avait profondément bouleversé avant d’aller chez son oncle, ses paroles lui causèrent un étonnement douloureux et profond.
“Je n’irai pas, se dit-il. Comme il souffrirait d’entendre les bouffonneries des acteurs et le rire du public !” “Quel est ce joli air de violon que nous avons entendu en entrant ? demanda la mère d’Alexis.
– Ah ! vous l’avez trouvé joli ? dit vivement Baldassare d’un air joyeux. C’est la romance dont je vous avais parlé.” “Joue-t-il la comédie ? se demanda Alexis. Comment le succès de sa musique peut-il encore lui faire plaisir ?”
À ce moment, la figure du vicomte prit une expression de douleur profonde ; ses joues avaient pâli, il fronça les lèvres et les sourcils, ses yeux s’emplirent de larmes.
“Mon Dieu ! s’écria intérieurement Alexis, ce rôle est au-dessus de ses forces. Mon pauvre oncle ! Mais aussi pourquoi craint-il tant de nous faire de la peine ? Pourquoi prendre à ce point sur lui ?” Mais les douleurs de la paralysie générale qui serraient parfois Baldassare comme dans un corset de fer jusqu’à lui laisser sur le corps des marques de coups, et dont l’acuité venait de contracter malgré lui son visage, s’étaient dissipées.
Il se remit à causer avec bonne humeur, après s’être essuyé les yeux.
“Il me semble que le duc de Parme est moins aimable pour toi depuis quelque temps ? demanda maladroitement la mère d’Alexis.
– Le duc de Parme ! s’écria Baldassare furieux, le duc de Parme moins aimable ! mais à quoi pensez-vous, ma chère ? Il m’a encore écrit ce matin pour mettre son château d’Illyrie à ma disposition si l’air des montagnes pouvait me faire du bien.” Il se leva vivement, mais réveilla en même temps sa douleur atroce, il dut s’arrêter un moment ; à peine elle fut calmée, il appela :
“Donnez-moi la lettre qui est près de mon lit.” Et il lut vivement :
“Mon cher Baldassare “Combien je m’ennuie de ne pas vous voir, etc., etc.”
Au fur et à mesure que se développait l’amabilité du prince, la figure de Baldassare s’adoucissait, brillait d’une confiance heureuse. Tout à coup, voulant sans doute dissimuler une joie qu’il ne jugeait pas très élevée, il serra les dents et fit la jolie petite grimace vulgaire qu’Alexis avait crue à jamais bannie de sa face pacifiée par la mort.
En plissant comme autrefois la bouche de Baldassare, cette petite grimace dessilla les yeux d’Alexis qui depuis qu’il était près de son oncle avait cru, avait voulu contempler le visage d’un mourant à jamais détaché des réalités vulgaires et où ne pouvait plus flotter qu’un sourire héroïquement contraint, tristement tendre, céleste et désenchanté. Maintenant il ne douta plus que Jean Galeas, en taquinant son oncle, l’aurait mis, comme auparavant, en colère, que dans la gaieté du malade, dans son désir d’aller au théâtre il n’entrait ni dissimulation ni courage, et qu’arrivé si près de la mort, Baldassare continuait à ne penser qu’à la vie.
En rentrant chez lui, Alexis frit vivement frappé par cette pensée que lui aussi mourrait un jour, et que s’il avait encore devant lui beaucoup plus de temps que son oncle, le vieux jardinier de Baldassare et sa cousine, la duchesse d’Alériouvres, ne lui survivraient certainement pas longtemps. Pourtant, assez riche pour se retirer, Rocco continuait à travailler sans cesse pour gagner plus d’argent encore, et tâchait d’obtenir un prix pour ses roses.
La duchesse, malgré ses soixante-dix ans, prenait grand soin de se teindre, et, dans les journaux, payait des articles où l’on célébrait la jeunesse de sa démarche, l’élégance de ses réceptions, les raffinements de sa table et de son esprit. Ces exemples ne diminuèrent pas l’étonnement où l’attitude de son oncle avait plongé Alexis, mais lui en inspiraient un pareil qui, gagnant de proche en proche, s’étendit comme une stupéfaction immense sur le scandale universel de ces existences dont il n’exceptait pas la sienne propre, marchant à la mort à reculons, en regardant la vie.
Résolu à ne pas imiter une aberration si choquante, il décida, à l’imitation des anciens prophètes dont on lui avait enseigné la gloire, de se retirer dans le désert avec quelques-uns de ses petits amis et en fit part à ses parents.
Heureusement, plus puissante que leurs moqueries, la vie dont il n’avait pas encore épuisé le lait fortifiant et doux tendit son sein pour le dissuader. Et il se remit à y boire avec une avidité joyeuse dont son imagination crédule et riche écoutait naïvement les doléances et réparait magnifiquement les déboires.
II
“La chair est triste, hélas…”
STÉPHANE MALLARMÉ
Le lendemain de la visite d’Alexis, le vicomte de Sylvanie était parti pour le château voisin où il devait passer trois ou quatre semaines et où la présence de nombreux invités pouvait distraire la tristesse qui suivait souvent ses crises.
Bientôt tous les plaisirs s’y résumèrent pour lui dans la compagnie d’une jeune femme qui les lui doublait en les partageant. Il crut sentir qu’elle l’aimait, mais garda pourtant quelque réserve avec elle : il la savait absolument pure, attendant impatiemment d’ailleurs l’arrivée de son mari ; puis il n’était pas sûr de l’aimer véritablement et sentait vaguement quel péché ce serait de l’entraîner à mal faire. À quel moment leurs rapports avaient-ils été dénaturés, il ne put jamais se le rappeler.
Maintenant, comme en vertu d’une entente tacite, et dont il ne pouvait déterminer l’époque, il lui baisait les poignets et lui passait la main autour du cou. Elle paraissait si heureuse qu’un soir il fit plus : il commença par l’embrasser ; puis il la caressa longuement et de nouveau l’embrassa sur les yeux, sur la joue, sur la lèvre, dans le cou, aux coins du nez. La bouche de la jeune femme allait en souriant au-devant des caresses, et ses regards brillaient dans leurs profondeurs comme une eau tiède de soleil.
Les caresses de Baldassare cependant étaient devenues plus hardies ; à un moment il la regarda ; il fut frappé de sa pâleur, du désespoir infini qu’exprimaient son front mort, ses yeux navrés et las qui pleuraient, en regards plus tristes que des larmes, comme la torture endurée pendant une mise en croix ou après la perte irréparable d’un être adoré. Il la considéra un instant ; et alors dans un effort suprême elle leva vers lui ses yeux suppliants qui demandaient grâce, en même temps que sa bouche avide, d’un mouvement inconscient et convulsif, redemandait des baisers.
Repris tous deux par le plaisir qui flottait autour d’eux dans le parfum de leurs baisers et le souvenir de leurs caresses, ils se jetèrent l’un sur l’autre en fermant désormais les yeux, ces yeux cruels qui leur montraient la détresse de leurs âmes, ils ne voulaient pas la voir et lui surtout fermait les yeux de toutes ses forces comme un bourreau pris de remords et qui sent que son bras tremblerait au moment de frapper sa victime, si au lieu de l’imaginer encore excitante pour sa rage et le forçant à l’assouvir, il pouvait la regarder en face et ressentir un moment sa douleur.
La nuit était venue et elle était encore dans sa chambre, les yeux vagues et sans larmes. Elle partit sans lui dire un mot, en baisant sa main avec une tristesse passionnée.
Lui pourtant ne pouvait dormir et s’il s’assoupissait un moment, frissonnait en sentant levés sur lui les yeux suppliants et désespérés de la douce victime.
Tout à coup, il se la représenta telle qu’elle devait être maintenant, ne pouvant dormir non plus et se sentant si seule.
Il s’habilla, marcha doucement jusqu’à sa chambre, n’osant pas faire de bruit pour ne pas la réveiller si elle dormait, n’osant pas non plus rentrer dans sa chambre à lui où le ciel et la terre et son âme l’étouffaient de leur poids. Il resta là, au seuil de la chambre de la jeune femme, croyant à tout moment qu’il ne pourrait se contenir un instant de plus et qu’il allait entrer ; puis, épouvanté à la pensée de rompre ce doux oubli qu’elle dormait d’une haleine dont il percevait la douceur égale, pour la livrer cruellement au remords et au désespoir, hors des prises de qui elle trouvait un moment le repos, il resta là au seuil, tantôt assis, tantôt à genoux, tantôt couché. Au matin, il rentra dans sa chambre, frileux et calmé, dormit longtemps et se réveilla plein de bien-être.
Ils s’ingénièrent réciproquement à rassurer leurs consciences, ils s’habituèrent aux remords qui diminuèrent, au plaisir qui devint aussi moins vif, et, quand il retourna en Sylvanie, il ne garda comme elle qu’un souvenir doux et un peu froid de ces minutes enflammées et cruelles.
III
“Sa jeunesse lui fait du bruit, il n’entend pas.”
MME DE SÉVIGNÉ
Quand Alexis, le jour de ses quatorze ans, alla voir son oncle Baldassare, il ne sentit pas se renouveler, comme il s’y était attendu, les violentes émotions de l’année précédente. Les courses incessantes sur le cheval que son oncle lui avait donné, en développant ses forces avaient lassé son énervement et avivaient en lui ce sentiment continu de la bonne santé, qui s’ajoute alors à la jeunesse, comment la conscience obscure de la profondeur, de ses ressources et de la puissance de son allégresse. À sentir, sous la brise éveillée par son galop, sa poitrine gonflée comme une voile, son corps brûlant comme un feu l’hiver et son front aussi frais que les feuillages fugitifs qui le ceignaient au passage, à raidir en rentrant son corps sous l’eau froide ou à le délasser longuement pendant les digestions savoureuses, il exaltait en lui ces puissances de la vie qui, après avoir été l’orgueil tumultueux de Baldassare, s’étaient à jamais retirées de lui pour aller réjouir des âmes plus jeunes, qu’un jour pourtant elles déserteraient aussi. Rien en Alexis ne pouvait plus défaillir de la faiblesse de son oncle, mourir à sa fin prochaine. Le bourdonnement joyeux de son sang dans ses veines et de ses désirs dans sa tête l’empêchait d’entendre les plaintes exténuées du malade. Alexis était entré dans cette période ardente où le corps travaille si robustement à élever ses palais entre lui et l’âme qu’elle semble bientôt avoir disparu jusqu’au jour où la maladie ou le chagrin ont lentement miné la douloureuse fissure au bout de laquelle elle réapparaît.
Il s’était habitué à la maladie mortelle de son oncle comme à tout ce qui dure autour de nous, et bien qu’il vécût encore, parce qu’il lui avait fait pleurer une fois ce que nous font pleurer les morts, il avait agi avec lui comme avec un mort, il avait commencé à oublier.
Quand son oncle lui dit ce jour-là : “Mon petit Alexis, je te donne la voiture en même temps que le second cheval”, il avait compris que son oncle pensait :
“parce que sans cela tu risquerais de ne jamais avoir la voiture”, et il savait que c’était une pensée extrêmement triste. Mais il ne la sentait pas comme telle, parce que actuellement il n’y avait plus de place en lui pour la tristesse profonde.
Quelques jours après, il fut frappé dans une lecture par le portrait d’un scélérat que les plus touchantes tendresses d’un mourant qui l’adorait n’avaient pas ému.
Le soir venu, la crainte d’être le scélérat dans lequel il avait cru se reconnaître l’empêcha de s’endormir. Mais le lendemain, il fit une si belle promenade à cheval, travailla si bien, se sentit d’ailleurs tant de tendresse pour ses parents vivants qu’il recommença à jouir sans scrupules et à dormir sans remords.
Cependant le vicomte de Sylvanie, qui commençait à ne plus pouvoir marcher, ne sortait plus guère du château.
Ses amis et ses parents passaient toute la journée avec lui, et il pouvait avouer la folie la plus blâmable, la dépense la plus absurde, faire montre du paradoxe ou laisser entrevoir le défaut le plus choquant sans que ses parents lui fissent des reproches, que ses amis se permissent une plaisanterie ou une contradiction. Il semblait que tacitement on lui eût ôté la responsabilité de ses actes et de ses paroles. Il semblait surtout qu’on voulût l’empêcher d’entendre à force de les ouater de douceur, sinon de les vaincre par des caresses, les derniers grincements de son corps que quittait la vie.
Il passait de longues et charmantes heures couché en tête à tête avec soi-même, le seul convive qu’il eût négligé d’inviter à souper pendant sa vie. Il éprouvait à parer son corps dolent, à accouder sa résignation à la fenêtre en regardant la mer, une joie mélancolique. Il environnait des images de ce monde dont il était encore tout plein, mais que l’éloignement, en l’en détachant déjà, lui rendait vagues et belles, la scène de sa mort, depuis longtemps préméditée mais sans cesse retouchée, ainsi qu’une œuvre d’art, avec une tristesse ardente. Déjà s’esquissaient dans son imagination ses adieux à la duchesse Oliviane, sa grande amie platonique, sur le salon de laquelle il régnait, malgré que tous les plus grands seigneurs, les plus glorieux artistes et les plus gens d’esprit d’Europe y fussent réunis. Il lui semblait déjà lire le récit de leur dernier entretien :
“… Le soleil était couché, et la mer qu’on apercevait à travers les pommiers était mauve.
Légers comme de claires couronnes flétries et persistants comme des regrets, de petits nuages bleus et roses flottaient à l’horizon. Une file mélancolique de peupliers plongeait dans l’ombre, la tête résignée dans un rose d’église ; les derniers rayons, sans toucher leurs troncs, teignaient leurs branches, accrochant à ces balustrades d’ombre des guirlandes de lumière. La brise mêlait les trois odeurs de la mer, des feuilles humides et du lait. Jamais la campagne de Sylvanie n’avait adouci de plus de volupté la mélancolie du soir.
“Je vous ai beaucoup aimé, mais je vous ai peu donné, mon pauvre ami, lui dit-elle.
“– Que dites-vous, Oliviane ? Comment, vous m’avez peu donné ? Vous m’avez d’autant plus donné que je vous demandais moins et bien plus en vérité que si les sens avaient eu quelque part dans notre tendresse. Surnaturelle comme une madone, douce comme une nourrice, je vous ai adorée et vous m’avez bercé. Je vous aimais d’une affection dont aucune espérance de plaisir charnel ne venait concerter la sagacité sensible. Ne m’apportiez-vous pas en échange une amitié incomparable, un thé exquis, une conversation naturellement ornée, et combien de touffes de roses fraîches. Vous seule avez su de vos mains maternelles et expressives rafraîchir moi front brûlant de fièvre, couler du miel entre mes lèvres flétries, mettre dans ma vie de nobles images.
“Chère amie, donnez-moi vos mains que je les baise…”
Seule l’indifférence de Pia, petite princesse syracusaine, qu’il aimait encore avec tous ses sens et avec son cœur et qui s’était éprise pour Castruccio d’un amour invincible et furieux, le rappelait de temps en temps à une réalité plus cruelle, mais qu’il s’efforçait d’oublier.
Jusqu’aux derniers jours, il avait encore été quelquefois dans des fêtes où, en se promenant à son bras, il croyait humilier son rival ; mais là même, pendant qu’il marchait à côté d’elle, il sentait ses yeux profonds distraits d’un autre amour que seule sa pitié pour le malade lui faisait essayer de dissimuler. Et maintenant, cela même il ne le pouvait plus. L’incohérence des mouvements de ses jambes était devenue telle qu’il ne pouvait plus sortir. Mais elle venait souvent le voir, et comme si elle était entrée dans la grande conspiration de douceur des autres, elle lui parlait sans cesse avec une tendresse ingénieuse que ne démentait plus jamais comme autrefois le cri de son indifférence ou l’aveu de sa colère. Et plus que de toutes les autres, il sentait l’apaisement de cette douceur s’étendre sur lui et le ravir.
Mais voici qu’un jour, comme il se levait de sa chaise pour aller à table, son domestique étonné le vit marcher beaucoup mieux. Il fit demander le médecin qui attendit pour se prononcer. Le lendemain il marchait bien. Au bout de huit jours, il lui permit de sortir. Ses parents et ses amis conçurent alors un immense espoir. Le médecin crut que peut-être une simple maladie nerveuse guérissable avait affecté d’abord les symptômes de la paralysie générale, qui maintenant, en effet, commençaient à disparaître. Il présenta ses doutes à Baldassare comme une certitude et lui dit :
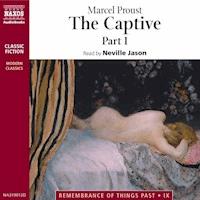
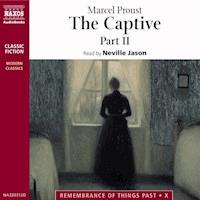
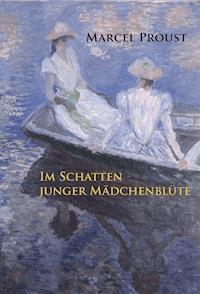
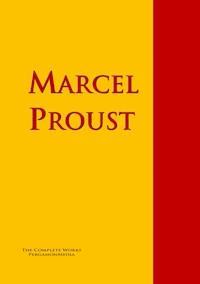
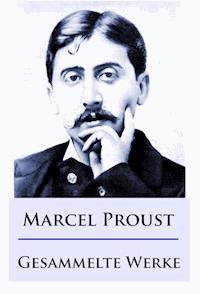

![In Search of Lost Time [volumes 1 to 7] - Marcel Proust - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/7bfeaa53b3db8b804e58de22616f49ec/w200_u90.jpg)