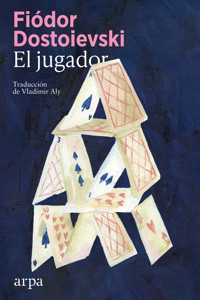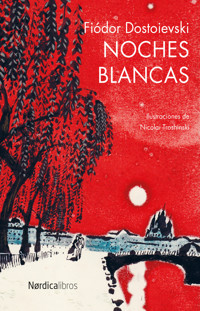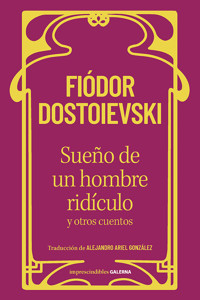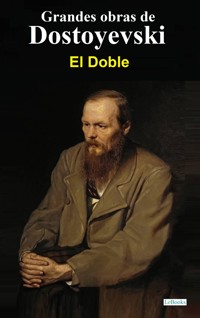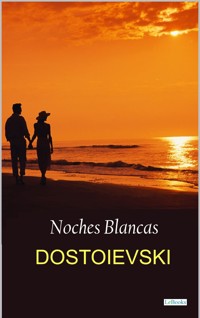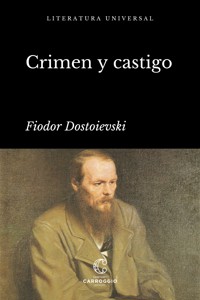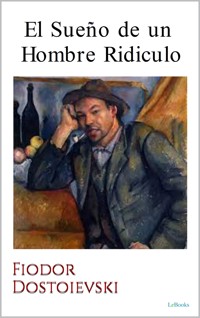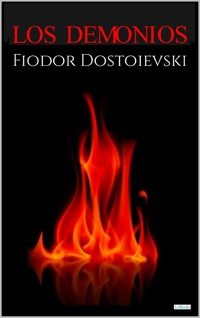Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "Nous sommes au commencement de novembre. Il fait un froid de onze degrés; il gèle. Il est tombé la nuit un peu de neige sur la terre glacée et un vent sec la chasse à travers les rues ennuyeuses de notre petite ville, et surtout vers la place du Marché. La matinée est brumeuse, mais la neige cesse de tomber."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 180
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335055771
©Ligaran 2015
Nous sommes au commencement de novembre. Il fait un froid de onze degrés ; il gèle. Il est tombé la nuit un peu, de neige sur la terre glacée et un vent sec la chasse à travers les rues ennuyeuses de notre petite ville, et surtout vers la place du Marché. La matinée est brumeuse, mais la neige cesse de tomber.
Il y a, non loin de la place, une petite maison bien propre au-dedans comme au dehors et qui appartient à la veuve du fonctionnaire Krasotkine.
Krasotkine, secrétaire provincial, est mort depuis longtemps déjà, quatorze ans environ ; mais sa veuve, qui n’a qu’une trentaine d’années, est encore fort avenante et vit de « ses rentes » dans sa maison coquette.
Elle mène une existence honnête et discrète. Son caractère est doux mais ne manque pas de gaieté. Elle avait environ dix-huit ans à la mort de son mari et ne vécut qu’un an avec lui, juste le temps de mettre au monde un fils. Elle s’est consacrée depuis lors à l’éducation de son petit Kolia. Pendant ces quatorze années, elle a toujours vécu pour lui et en a eu plus de souffrances que de joies, craignant toujours une maladie ou une espièglerie de son âge, craignant qu’il ne tombât d’une chaise, etc.
Lorsque Kolia commença à aller à l’école et plus tard au collège, sa mère voulut aussi apprendre toutes les sciences, pour l’aider, et elle répétait ses leçons avec lui. Elle faisait connaissance avec les professeurs de son fils, voyait leurs femmes, caressait ses camarades et faisait mille courbettes pour qu’on fût doux avec lui, pour qu’on ne battît pas son Kolia.
Le résultat de tout cela fut que les camarades se moquèrent tout à fait de Kolia, et qu’ils le taquinaient souvent en lui disant qu’il était bien sous les jupons de sa mère.
Le gamin, heureusement, sut se faire respecter. C’était un enfant qui avait de l’aplomb, était « terriblement fort », et il eut bientôt cette réputation dans l’école ; avec cela, adroit, entêté, d’un caractère audacieux et entreprenant.
C’était un bon élève, et l’on disait même qu’il aurait pu en mathématiques et en histoire en remontrer au professeur Dardanelov lui-même. Malgré cela et sa manière de regarder les gens en face, il était bon camarade et pas fier. Il acceptait comme une chose due la considération que lui accordaient ses condisciples, mais restait bon enfant, et observait en tout une certaine mesure ; il savait se contraindre et ne franchissait jamais cette certaine limite dans ses rapports avec ses supérieurs, au-delà de laquelle l’escapade devient un signe de révolte.
Il ne manquait pas une occasion de faire une espièglerie, tout comme le dernier des gamins, pour faire montre de chic et de bravoure.
Kolia avait beaucoup d’amour-propre et savait dominer sa mère jusqu’au despotisme. La pauvre femme se soumettait, et depuis longtemps, mais elle ne pouvait se faire à cette idée que son garçon « l’aimait peu ». Il lui semblait toujours que Kolia manquait à son égard de sensibilité, et elle lui reprochait souvent sa froideur.
Cela ne plaisait pas à l’enfant, et plus on lui demandait de preuves d’affection plus il semblait se raidir volontairement. Il est vrai de dire qu’il ne le faisait que malgré lui, parce que sa nature était ainsi faite.
Sa mère se trompait : il l’aimait beaucoup, mais ne pouvait souffrir « les sensibleries », comme il le disait lui-même en son langage d’écolier.
Kratsotkine père avait laissé une bibliothèque renfermant quelques volumes. Kolia aimait à lire et avait déjà lu la plupart de ces livres. Sa mère ne s’en inquiétait pas et se contentait de s’étonner de ce que son fils passât des heures entières avec un livre au lieu d’aller jouer.
C’est ainsi que Kolia avait lu bien des choses qu’il n’aurait pas dû connaître à son âge. Aussi, dans les derniers temps, il s’ôtait permis quelques escapades qui, bien que contenues dans certaines limites, avaient cependant effrayé sa mère. Il n’y avait là rien d’immoral, mais seulement de trop audacieux.
Pendant l’été dernier, en juillet, au moment des vacances, la mère et le fils étaient partis pour huit jours dans un autre district, en visite près d’une parente dont le mari était employé à la gare du chemin de fer.
Kolia examina en détail la voie ferrée et en étudia les côtés techniques pour faire valoir ensuite ses connaissances près des camarades du collège. Il y avait là justement des gamins avec lesquels il fit connaissance. Les uns habitaient dans la gare même et les autres dans le voisinage. Ils avaient tous de douze à quinze ans et deux d’entre eux étaient de notre ville.
Les gamins jouaient donc ensemble, le troisième ou le quatrième jour de l’arrivée de Kolia, à la gare, quand il s’en gagea entre eux un pari de deux roubles fort stupide, comme on va voir : Kolia, qui était le plus jeune et que pour cette raison les autres méprisaient un peu, proposait de se coucher la nuit entre les rails pendant le passage d’un train et de rester là, immobile, jusqu’à ce que tous les wagons fussent passés.
On fit d’abord des études préparatoires qui démontrèrent qu’on pouvait ainsi s’aplatir entre les rails sans que le train pût toucher celui qui serait dessous. Mais, malgré tout, il fallait l’oser !
Kolia affirmait obstinément qu’il le tenterait. On se moquait de lui, le traitant de menteur et de fanfaron, mais ce n’était que pour l’exciter plus encore. Ce qui était vexant pour lui, c’était que ces jeunes gens de quinze ans ôtaient fiers à son égard et ne voulaient pas le considérer comme un camarade parce qu’il était trop jeune.
Il fut décidé qu’on se mettrait en route le soir à une verste de la station pour que le train partant de la gare eût déjà tout son élan. Les gamins prirent rendez-vous.
La nuit était non seulement sombre, mais tout à fait noire.
À l’heure fixée Kolia se coucha entre les rails. Les cinq autres gamins qui avaient tenu le pari, le cœur serré d’effroi et de remords, attendaient dans le buisson en bas du talus.
Enfin on entendit le bruit du train qui s’avançait. Les deux lanternes rouges luirent dans l’obscurité, le monstre s’approchait avec un bruit formidable.
– Sauve-toi ! sauve-toi ! crièrent à Kolia les gamins mourants de frayeur.
Il était déjà trop tard : le train arriva et passa comme un éclair.
Les gamins se précipitèrent vers Kolia. Il restait immobile. On se mit à le secouer et à le soulever. Tout à coup il se releva lui-même et descendit le talus en silence.
Quand il fut en bas, il déclara qu’il était resté ainsi sans connaissance pour les effrayer, mais la vérité était qu’il avait bien perdu connaissance comme lui-même l’avoua longtemps, bien longtemps après à sa mère.
C’est ainsi que Kolia s’acquit pour toujours une renommée de casse-cou.
Il rentra à la maison pâle comme un linge. Il eut le lendemain une fièvre nerveuse, mais il avait l’esprit libre et content.
On ne connut pas tout de suite son escapade, et ce ne fut qu’à son retour qu’elle se répandit dans la ville et vint jusqu’aux oreilles des autorités scolaires. La mère de Kolia dut supplier les maîtres de son fils, et ce ne fut que grâce à l’influence du respectable professeur Dardanelov qu’on put étouffer l’affaire.
Ce Dardanelov était un célibataire relativement jeune et depuis longtemps amoureux de Mme Krasotkine. Une fois même, un an auparavant, il s’était risqué, tout tremblant de peur, à lui demander sa main. Elle lui refusa net, considérant une acceptation de sa part comme une trahison envers son fils, bien que Dardanelov, à certains signes, pût voir qu’il n’était pas trop désagréable à la charmante mais trop vertueuse veuve.
La folle escapade de Kolia sembla briser la glace, et l’on fit même une allusion aux espérances de Dardanelov, allusion, il est vrai, fort aléatoire ; mais comme Dardanelov était lui-même un modèle de délicatesse, il n’en fallait pas plus pour le rendre heureux.
Il aimait Kolia, mais considérait qu’il était malséant de lui faire des avances, et il gardait envers lui une attitude sévère et exigeante.
Kolia, d’ailleurs, le tenait aussi à distance respectueuse ; il préparait bien ses leçons avec son professeur, et tous ses camarades croyaient fermement qu’il était assez fort en histoire pour damer le pion à son professeur.
Kolia lui posa une fois cette question : « Quel est le fondateur de Troie ? »
Dardanelov répondit vaguement, parlant des peuples anciens, de leurs émigrations, de l’éloignement de ces temps, de la mythologie, mais ne dit pas exactement quel personnage avait fondé la ville et trouva même la question oiseuse. Les élèves en conclurent que Dardanelov ne savait pas qui avait fondé Troie. Kolia, lui, avait lu dans le traité d’histoire de Smaragdov, trouvé dans la bibliothèque de son père, les origines de Troie.
Tout le monde s’occupa de savoir qui avait fondé Troie, mais le jeune Krasotkine ne voulait pas livrer son secret, et sa renommée de profonde érudition resta inébranlable.
On remarqua quelques changements dans les rapports de Kolia et de sa mère, après l’évènement du chemin de fer.
En apprenant l’exploit de son diable de fils, Anna Fédorovna Krasotkine faillit devenir folle de frayeur, et eut de telles crises pendant plusieurs jours que Kolia lui donna sa parole d’honneur qu’il ne recommencerait jamais. Il le jura à genoux devant les images et sur la mémoire de son père, comme sa mère l’avait exigé. Le « viril » Kolia pleura comme un enfant, et pendant tout un jour, la mère et le fils ne firent que s’embrasser et pleurer.
Mais le lendemain, Kolia s’éveilla « insensible » comme jadis, gardant seulement de cette scène un air plus modeste et un peu attendri, quelque chose de grave et de rêveur, ce qui ne l’empêcha pas, six semaines plus tard, de commettre une autre escapade et de se faire connaître de notre juge de paix. Cet incident, il est vrai, était d’un autre genre, et même tant soit peu ridicule, ce qui revient à dire qu’il n’en était pas l’auteur principal, mais seulement un simple acteur.
Mme Krasotkine tremblait toujours, et l’espoir de Dardanelov croissait en raison même de ces inquiétudes.
Tout cela n’échappait pas à Kolia qui méprisait beaucoup Dardanelov au sujet de ses sentiments.
Il fut indélicat au point d’afficher un certain mépris devant sa mère, montrant ainsi qu’il voyait bien ce que visait Dardanelov.
L’évènement du chemin de fer eut pourtant ce résultat de faire changer son attitude à ce sujet ; il n’osait plus faire d’allusions et parlait de Dardanelov avec une sorte de respect. Anna Fédorovna remarqua bien vite ce changement et lui en témoigna une profonde reconnaissance, ce qui ne l’empêchait pas de rougir comme une rose si quelqu’un y faisait, devant Kolia, une allusion quelconque.
Kolia, lui, se contentait de froncer les sourcils en regardant par la fenêtre, ou feignant de voir si ses chaussures ne s’usaient pas, ou encore d’appeler Pérezvon un vilain et sale chien qu’il avait eu on ne sait d’où le mois précédent, et qu’il gardait mystérieusement dans sa chambre, loin des yeux de ses camarades.
Il aimait beaucoup ce chien et l’avait bien fait souffrir pour lui apprendre toutes sortes de tours. Le chien l’aimait bien aussi, hurlant quand son maître était absent, et témoignant sa joie, au retour, en faisant le beau, le mort, etc., toutes choses qu’on ne lui demandait point, mais qui prouvaient son exaltation de cœur et sa reconnaissance.
Ce matin de novembre où commence cette histoire, Kolia Krasotkine restait à la maison.
C’était un dimanche, et il n’y avait pas de classes. Onze heures venaient de sonner, et il lui fallait s’absenter absolument pour « une affaire d’importance ». Il restait pourtant à la maison parce qu’il était seul, tout le monde étant sorti.
Dans la maison de la veuve demeuraient, dans un appartement unique, composé de deux chambres, la femme d’un médecin et ses deux jeunes enfants.
Cette dame était du même âge que Anna Fédorovna et aussi sa grande amie. Son mari, le docteur, était parti depuis un an, d’abord à Orenbourg, puis à Tachkent, et l’on n’avait plus de ses nouvelles depuis six mois. Sans son amitié pour Mme Krasotkine qui la consolait, cette pauvre dame se fut desséchée de douleur.
Il se trouvait justement ce jour-là, et pour comble de malheur, que Katérina, l’unique bonne de la locataire, avait eu l’idée de mettre au monde un petit enfant, et comme elle était une excellente domestique, sa maîtresse l’avait conduite en lieu propice, chez une sage-femme, où elle était restée avec elle. On avait même eu besoin le matin du concours de Mme Krasotkine, qui pouvait obtenir, en cette occasion, la protection de quelque personnage et prouver avec son amitié les belles relations qu’elle possédait.
Agafia, la domestique des Krasotkine était au marché, et voilà comment Kolia eut, ce matin-là, la garde des « bambins », je veux dire du garçon et de la fillette du médecin.
Kolia n’avait pas peur de garder la maison. N’avait-il pas d’ailleurs avec lui Pérezvon, auquel il avait enjoint de se coucher « immobile » dans l’entrée. Et le bon chien restait là, osant à peine remuer la queue quand son maître passait d’une pièce dans une autre, et semblant implorer des yeux un sifflement qui l’eût délivré, mais qui ne se faisait pas entendre.
Kolia regardait Pérezvon d’un œil sévère, et le chien obéissait, se raidissant dans son immobilité.
Kolia s’inquiétait seulement des bambins. Il considérait avec un mépris profond l’accident qui arrivait à Katérina, mais il aimait les bambins abandonnés, et leur avait déjà apporté un livre d’images.
La fillette, Nastia, qui était l’aînée, avait huit ans et savait lire, et le petit garçon, Kostia, qui n’avait que sept ans, aimait beaucoup entendre lire sa sœur.
Krasotkine aurait bien pu les amuser d’une manière plus enfantine, c’est-à-dire les aligner comme les soldats ou jouer à cache-cache. Il avait déjà daigné le faire plus d’une fois, et l’on disait à l’école qu’il jouait au cheval avec ses petits locataires, en inclinant la tête de côté, comme un vrai cheval.
Krasotkine se défendait, il est vrai, de cette accusation en faisant valoir qu’en notre « siècle » il serait à la vérité très honteux de jouer au cheval avec des camarades de treize ans, mais qu’il le faisait avec les bambins, parce qu’il les aimait et que personne n’avait le droit de lui demander compte de ses sentiments.
Les bambins l’aimaient donc à l’adoration.
Ce jour-là, pourtant, il pensait à toute autre chose qu’au jeu. J’ai dit qu’il avait une affaire personnelle de la plus grande importance, une affaire presque mystérieuse, et justement Agafia, à laquelle il eut pu confier les enfants, ne revenait pas du marché.
Plusieurs fois déjà, il avait traversé le vestibule, regardant à travers la porte les bambins assis devant le livre, comme il le leur avait commandé, et qui lui souriaient de toute leur bouche, espérant qu’il allait leur faire voir quelque chose de bien joli et bien amusant. Mais Kolia les regardait d’un air grave et n’entrait pas.
Onze heures sonnèrent.
Kolia, exaspéré, décida que si dans dix minutes cette « maudite » Agafia n’était pas rentrée, il s’en irait, en recommandant aux bambins de ne pas avoir peur, de ne pas faire de sottises et de ne pas pleurer en son absence.
Kolia endossa donc son paletot fourré, passa son sac en bandoulière, et, malgré le froid et les recommandations de sa mère, il méprisa ses caoutchoucs et sortit en simples bottes.
En voyant son maître habillé, Pérezvon battit de la queue sur le parquet, tressaillit de tout son corps et poussa même un hurlement plaintif. Kolia trouva que cette passion trop accentuée de son chien était nuisible à la discipline, et il prit plaisir à le faire rester sous son banc et à ne le siffler qu’en ouvrant la porte de la rue.
Le chien accourut d’un bond et sauta devant lui fou de joie, Kolia traversa le vestibule et ouvrit la porte des « bambins ».
Ils étaient toujours assis devant la table, ne lisaient plus, mais discutaient avec animation. Ils causaient habituellement entre eux des questions de la vie de tous les jours, et Nastia, en sa qualité d’aînée, se donnait toujours raison. Pourtant quand Kostia n’était pas satisfait, ce qui arrivait très souvent, il en appelait au jugement de Krasotkine, qui était impartial pour les deux parties.
Ce jour-là, la discussion des bambins intéressa un peu Krasotkine, et il resta à la porte pour les écouter.
Les enfants s’en aperçurent, et ils continuèrent leur discussion avec plus de chaleur encore.
– Jamais, jamais je ne croirai, disait Nastia, que les sages-femmes trouvent les petits enfants dans le jardin sous les choux. Maintenant on est en hiver, et il n’y a pas de choux au jardin. La sage-femme n’a pas pu apporter une fille à Katérina.
– Euh ! fit à part lui Kolia.
– Cela arrive encore qu’on en apporte, je ne sais d’où, mais seulement à celles qui sont mariées.
Kostia regarda fixement Nastia d’un air grave et fit un effort pour comprendre.
– Que tu es sotte, Nastia, dit-il enfin tranquillement. Comment Katérina peut-elle avoir un enfant, puisqu’elle n’est pas mariée ?
Nastia s’anima davantage.
– Tu ne comprends rien, dit-elle, irritée. Elle a peut-être un mari, mais il est en prison, et c’est pourquoi elle a un enfant.
– Mais a-t-elle bien un mari en prison ? demanda gravement le positif Kostia.
– C’est qu’il y a cela encore, répliqua vivement Nastia, oubliant sa première hypothèse. Elle n’a pas de mari, tu as raison, mais elle veut se marier, et elle se demande comment elle peut se marier, elle y pense même tellement qu’elle a non un mari, mais un enfant.
– Ah si c’est comme cela !… fit Kostia convaincu, mais il fallait me le dire avant. Comment puis-je le savoir, moi ?
– Eh bien, marmots, dit Kolia en entrant dans la chambre, vous êtes dangereux comme je vois.
– Est-ce que Pérezvon va aussi avec vous ? demanda Kostia avec un sourire épanoui, et il claqua des doigts en appelant Pérezvon.
– Je suis dans une situation difficile, enfants, fit Krasotkine avec dignité, et vous devez me venir en aide. Agafia s’est cassé une jambe, c’est sûr, c’est une affaire réglée, et moi j’ai besoin de sortir. Voulez-vous ou non me laisser partir ?
Les enfants se regardèrent avec inquiétude. Leurs visages jusque-là souriants exprimèrent une sorte de frayeur. Ils ne comprenaient pas bien, d’ailleurs, ce qu’on attendait d’eux.
– Vous ne ferez pas de sottises en mon absence, vous ne monterez pas sur l’armoire pour vous casser les jambes, vous ne pleurerez pas ?
Les enfants parurent fort chagrins.
– Pour la peine, je vous montrerai un jouet, un petit canon en cuivre avec lequel on peut tirer avec de la poudre.
Les visages des enfants se rassérénèrent.
– Montre-nous le petit canon, dit Kostia enchanté.
Krasotkine mit la main dans son sac, en retira un petit canon en cuivre et le mit sur la table.
– Voilà, je vous le montre. Il y a des roulettes.
Et il fit rouler le canon sur la table.
– On peut même le faire partir. On le charge avec du plomb et on tire.
– Et il tue ?
– Il tue tout le monde. On n’a qu’à viser.
Krasotkine expliqua alors où l’on mettait la poudre, où l’on mettait le plomb, montra le petit trou où l’on mettait le feu, ajoutant qu’il y avait du recul.
Les enfants écoutaient avec une curiosité très grande et étaient surtout frappés de ce qu’il y eût un recul.
– Est-ce que vous avez de la poudre ? demanda Nastia.
– Mais oui, j’en ai.
– Montrez-nous alors la poudre, fit la fillette avec un sourire suppliant.
Krasotkine chercha encore dans son sac et retira une petite bouteille où il y avait de la poudre et aussi quelques grains de plomb soigneusement enveloppés dans un papier. Il déboucha même la petite bouteille et versa un peu de poudre dans sa main.
– Voilà la poudre. Pourvu qu’il n’y ait pas de feu ici car cela ferait explosion et vous tuerait tous, dit Krasotkine pour se donner de l’importance.
Les enfants regardaient la poudre avec une terreur respectueuse, qui ajoutait encore à leur joie.
Le plomb surtout enthousiasmait Kostia.
– Est-ce que le plomb brûle aussi ? demanda-t-il timidement.
– Non, cela ne brûle pas.
– Donnez-moi donc alors un peu de plomb, fit-il d’une voix suppliante.
– Je t’en donnerai un peu ; voilà ; mais ne le montre pas à ta maman avant mon retour, car elle croira que c’est de la poudre, aura peur et vous fouettera.
– Maman ne nous fouette jamais, fit remarquer bien vite Nastia.
– Je le sais, je l’ai dit seulement pour la phrase. Vous ne trompez pas votre maman, mais aujourd’hui vous ne direz rien avant que je ne revienne. Enfin, bambins, puis-je m’en aller ? Vous ne pleurerez pas de peur quand je serai parti ?
– Nous pleurerons, dit Kostia d’une voix traînante et comme s’il se préparait à pleurer.
– Oui, nous pleurerons, nous pleurerons certainement, ajouta tout de suite Nastia.
– Oh ! enfants ! enfants ! Comme cet âge est dangereux. Il n’y a rien à faire, mes pigeons. Il faudra que je reste avec vous, je ne sais combien de temps. Et le temps ! le temps…
– Si vous ordonniez à Pérezvon de faire le mort ? demanda Kostia.
– Que faire ! Il faut bien employer Pérezvon… Ici, Pérezvon !
Et Kolia commanda le chien, qui exécuta tout ce qu’on lui avait appris.