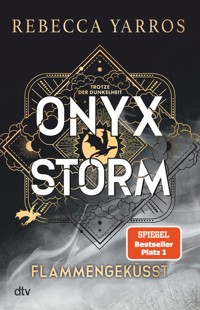Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Französisch
- Qui était Saint Ganton ? - Pourquoi a-t-on donné de nom insolites ou singuliers à certains villages ? - Quels sont les miracles attribués à Saint Nolff ? - Quelle est la légende du fils du Saint Pierre ? - Napoléon est'il né en Bretagne ? - Gargantua a-t-il vécu en Armorique ? - C'est un breton qui fonda la ville Doha au Qatar ? Quelques questions, parmi d'autres, qui trouvent des réponses dans cet ouvrage. De la Bretagne celte à la Bretagne chrétienne, ce recueil de 204 villages vous propose un voyage surprenant dans le merveilleux, à travers des légendes, des mythes et des histoires. C'est n'est pas un livre hagiographique mais un ouvrage de découverte du riche patrimoine matériel, culturel et spirituel de cette belle région, La Bretagne. Ferdinand Foch disait "Un homme sans mémoire est un homme sans vie et un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 636
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Qu’est-ce qu’un fleuve sans sa source ? Qu’est-ce qu’un peuple sans son passé ?
Victor Hugo
Si le Dieu n’existe pas mais je crois, alors je ne perds rien. Si le Dieu existe et je ne crois pas, alors je perds tout.
Nicolae Iorga
On dédie ce livre à nos chers parents, certains disparus,
Maris-Annick et Roman
La critique est plus facile que la pratique
George Sand
TABLE DES MATIERES
PREFACE
INTRODUCTION
LES SAINTS VILLAGES DE BRETAGNE
LISTE DES SAINTS VILLAGES BRETONS
PREFACE
Partout dans le monde et en France pullulent les localités qui portent le nom d’un saint. Afin de comprendre comment nous en sommes arrivés à ces attributions patronymiques, il nous faut d’abord nous pencher sur le destin parfois controversé des saints eux-mêmes. Roman et Marie-Annick Siretchi, curieux par nature et persévérants dans leurs recherches, ont trouvé au moins trois raisons de mener une telle entreprise :
- tout d'abord, personne ne peut comprendre parfaitement le pourquoi et le comment de ce phénomène religieux ancien et universel ;
- ensuite, les harmoniques culturelles et cultuelles propres au territoire couvert par les quelques départements de la Bretagne restent en grande partie inconnues ;
- et enfin, il se peut que les saints comptent encore pour nous : ils sont importants aussi dans notre monde contemporain, sans quoi nous aurions depuis longtemps changé les noms de ces localités.
La démarche de l’auteur repose sur une analyse minutieuse étymologique, historique et folklorique, tenant compte de divers aspects complémentaires : dimensions séculière, ecclésiale et universelle.
Depuis son existence historique, la Bretagne chrétienne est impensable sans ses pécheurs et invivable sans ses saints. Souvent l’hommage rendu aux saints a transformé des cimetières en sanctuaires et des cités en centres culturels et politiques d’envergure. Certes la carrière catholique d’un saint est formellement consacrée à Rome, mais cette route commence ailleurs. En fait, elle peut commencer n'importe où. Y compris en Bretagne. Tous ces noms bizarres, quasi-oubliés et ignorés par la culture moderne nous font resurgir la personnalité d'êtres insolites, plutôt des exceptions à la règle usuelle d'une vie humaine.
Mais leur vocation est universelle : tous sont appelés à une certaine sainteté, même si la sainteté n’est pas la même pour tous.
Car chaque vie est unique et inimitable. D’où la richesse infinie de toute existence qui contient dans ses germes la potentialité de se transcender elle-même vers ce qu’elle pense être la perfection. Les presque 300 noms sanctifiés dans la tradition bretonne et brièvement présentés dans ce livre, viennent s’ajouter à l’histoire des myriades de personnalités (canoniquement reconnues ou pas) immortalisées au firmament de la mémoire humaine universelle. Ils ne s’esquivent pas lorsqu'il s'agit de nous rappeler leur point de départ profondément humain.
Le plus grand acquis de ce début de siècle est la maniabilité de la communication mondiale. Les saints, rien que par leurs noms, apparaissent comme un éminent liant, sans pour autant faire de concessions aux mythes. À travers les temps, ce liant forge des groupes autour de racines d’espoir, en ennoblissant leur communion profondément humaine.
Puisque les noms des saints de Bretagne ont défié les siècles, quel genre d'histoire peuvent-ils encore écrire pour les générations futures ? L’héroïsme de leur vie pourrait être compris comme une histoire d’amour. Car ils ont été habités par ce qu’ils ont compris comme étant la quintessence de l’amour. Un amour qui défend l’infini et qui peut nous inspirer de métamorphoser l’histoire sacrée en notre histoire.
Roman Siretchi a réussi à faire du sacré le lieu de questionnement de l’énigme sociale, en conjuguant dans son ouvrage une exploration ethnographique et une reconstruction historique de ses propres motivations. Nous ne pouvons que lui dire « merci » pour ce sacerdoce qui rend au touriste la grâce du pèlerin averti, car on ne « reconnaît » que ce que l’on « connaît ».
Alois Balint
INTRODUCTION
Ce livre n’est pas une étude hagiographique, c’est un ouvrage qui essaye des donner des informations sur l’origine du nom de 204 communes de Bretagne.
Ce n’est pas un travail d’érudition et cela va décevoir les vrais chercheurs. Pour cette raison nous n’avons pas donné d’indications bibliographiques. Ce n’est pas un livre habituel de lecture suivie, ce n’est pas un livre d’étude, c’est un livre de diffusion de la grande richesse du passé des villages bretons. Pour chaque village on explique l’origine de son nom et le merveilleux qui entoure le personnage. B.Rio souligne le fait que les bases celtiques, druidiques vont attribuer aux saints bretons plutôt des miracles que des martyres. Le merveilleux suppose une propension à la pensée magique chère aux bretons.
Evidemment, des erreurs ou des imprécisions ont pu être commises lors de la rédaction. Les informations trouvées sont parfois rares, parfois contradictoires.
Pour cette raison, dès l’introduction, nous sollicitons par avance l’indulgence des lecteurs. J.Chardronnet dit « la figure de vieux saint d’Armorique ressemble on peu à ces navires qu’on voit s’éloigner du rivage. Pendant quelque temps, l’œil les suit distinctement, mais le ciel et la mer se confondent à l’horizon et bientôt le navire semble disparaître ».
Nous avons sélectionné seulement les communes ayant dans leur nom le mot SAINT ou SAINTE, écrit de manière distincte.
Le nom des villages est parfois associé à un saint oublié par l’histoire, des saints bretons, romains, venus d’Irlande, de Pays de Galles, de l’Ile Bretonne, ou d’Ecosse. La Bretagne en recèle près des huit cents, dont seuls quelques-uns sont reconnus par l’Église de Rome. Le choix adopté dans la présentation n’est pas chronologique, ni géographique, c’est une sélection donnée uniquement par le nom des villages. Les communes sont présentées par ordre alphabétique et à la fin de l’ouvrage elles sont groupés par département, en indiquant la page où on la trouve.
La documentation.
L’essentiel des nos recherches a été fait sur internet et dans des bibliothèques. En lisant ces documents nous rendons hommage aux anciens lettrés, aux vrais chercheurs et bollandistes. Tous ces écrits sont d’une importance capitale car un peuple sans histoire et sans racines disparait. Nier et juger sans essayer de comprendre serait dommage. Nous ne qualifions pas l’existence des personnages car l’absence de preuve n’est pas la preuve de l’absence.
Nous remercions tous ceux et celles qui nous ont répondu dans notre quête d’informations.
Des passionnés d’histoire, des amoureux de leur village, des centres d’informations touristiques, des mairies, des paroisses et d’autres gens formidables ont eu l’amabilité et la gentillesse de nous transmettre leur savoir et leurs informations. Nous leur disons à tous, de tout cœur, un Grand Merci !
Informations Annexes
Nous avons introduit dans cet ouvrage quelques informations qui nous paraissent intéressantes. Elle se trouvent dans des encadrées. Elles n’ont pas une liaison directe avec un village exposé mais, ajoutent du merveilleux au contenu exposé.
LES SAINTS VILLAGES DE BRETAGNE
COTES D’ARMOR –
FINISTERE –
ILLE ET VILAINE –
MORBIHAN –
A
56140 SAINT-ABRAHAM
Population : 529 hab. (2019) En breton : Sant-Abran MORBIHAN
1
Le bourg est attesté en 1433 sous le nom Sant Abran.
L’origine du nom de la commune Saint Abraham est difficile à établir, et plusieurs théories se confrontent.
Une théorie dit que le nom du village viendrait d’un saint qui était un chef religieux à l'époque des invasions bretonnes. Il a été attesté sous sa forme bretonne
Sant Abran
en 1433, mais on ne sait rien de plus sur lui. Probablement, son nom fut christianisé ensuite pour devenir Abraham.
Mais Abran, d’après d’autres sources, est un dérivatif du nom Abraham. Comme plusieurs Abraham sont connus, nous allons vous présenter les plus réputés, en supposant que c’est l’un d’eux qui a donné son nom à cette commune du Morbihan.
Abraham de l’Ancien Testament. C’est un personnage de la mythologie juive, considéré comme le principal patriarche des religions juive, chrétienne et musulmane (par la majorité des courants qui les constituent).
C’est peu probable que ce soit lui qui donna le nom au bourg, mais faisons sa présentation. Vers -1850 avant JC, à l'appel de Dieu, Abraham quitta sa patrie Our en Chaldée, et parcourut la terre promise à lui et à sa descendance. Il manifesta sa foi totale en Dieu, ne refusant même pas d'offrir en sacrifice son fils unique Isaac, que Dieu lui avait donné dans sa vieillesse par sa femme Sara, jugée jusqu'alors stérile.
Mais dans la Bible, Abraham n’est pas décrit toujours comme étant vertueux. L’histoire d’Abraham commence bien mais aussitôt, celui qui été considéré comme l’ami de Dieu et le père des croyants, se comporte de façon étrange. Pour sauver sa vie, il semble bien qu’il mente et pousse Sarah au mensonge, qu’il la prostitue, sans aucun remord et sans penser une seconde à Dieu. Abraham, dans la tradition Juive c’est le ‘croyant absolu’, prêt à tout sacrifier au Dieu Unique et, pour les Musulmans, il est avant tout ‘l’obéissant absolu’ aux décrets de l’Eternel.
Un autre Abraham est celui né en Syrie, au IV
ème
siècle. Il vient d’une famille riche et il est promis à un mariage arrangé à un âge précoce. Des années plus tard, pendant les festivités de son mariage, Abraham s'enfuit et se mure dans un bâtiment, laissant une petite ouverture par laquelle on pouvait lui faire passer de la nourriture et de l'eau.
Il explique alors son désir d'une vie religieuse. Sa famille cède difficilement et le mariage est annulé. Il va passer les dix années suivantes, enfermé dans sa cellule. On dit qu’après une décennie de cette vie, l'évêque lui ordonne de quitter sa cellule et il l’envoie comme missionnaire dans le village Beth-Kiduna, avec des habitants païens, très attachés à leurs idoles. Ici il construit une église, brise des idoles, subit des abus et des violences mais toujours plein de bonté. Au bout d’une année il réussit à convertir tout le village au christianisme.
Préférant la solitude, il prie Dieu d’envoyer un meilleur pasteur que lui, son vœu est exaucé. Il retourne alors vivre dans sa cellule. Il n'a quitté son cachot que deux fois de plus. Une fois pour sauver sa nièce, Sainte Marie d'Edesse, qui menait une vie désordonnée et sauvage. Abraham se déguisa en soldat pour aller chez elle et au cours du souper, il la persuada de l'erreur de ses manières ; émue, elle se convertit et changea son mode de vie. Abraham satisfait, retourna dans sa cellule.
La deuxième fois, ce fut pour ses funérailles, en présence d'une grande foule aimante. C’est une belle légende et c’est un candidat probable dans notre recherche sur l’origine du nom du village.
Une autre possibilité serait le Saint Abraham le Pauvre (Abraham l’Enfant ou le Simple). C’était un ermite égyptien du IV
ème
siècle et un saint. Une hypothèse affirme qu’il était originaire de Perse, une autre qu’il était né en Egypte. Il s'exila pour fuir la persécution dans le désert d'Egypte et on dit qu’il fut arrêté par des païens et retenu prisonnier durant cinq années. En Egypte, il devint un disciple de St. Pachome (Pacôme) pendant 23 ans et d’après une théorie il passa les dix-sept années suivantes comme un ermite des cavernes.
D’autres soutiennent qu’il s’exila en Auvergne, vers 480 dans le monastère Saint-Cirgues où il mourut très âgé. Dans ce cas, comme il était en France, c’est peut-être lui qui donna son nom à la commune.
C’est le moment de raconter la légende du riche et du pauvre.
Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui festoyait chaque jour. Devant son portail gisait un pauvre (Lazare), affamé et couvert d’ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche mais il n’avait pas le droit d’entrer. Seuls les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et les anges l’emportèrent auprès de Saint Abraham. Le riche mourut aussi et on l’enterra. Au séjour des morts, le riche était en proie à la torture. Il leva les yeux, il vit Abraham et près de lui le pauvre. Alors il cria « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie le pauvre tremper le bout de son doigt dans l’eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise ». Le saint lui répondit que le pauvre avait été malheureux toute sa vie et que lui, le riche, avait seulement eu du bonheur. Que maintenant, le pauvre trouve la consolation, et lui la souffrance. Le riche demanda alors au saint d’envoyer le pauvre avertir ses frères, pour qu’il leur porte son témoignage, de peur qu’eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. Abraham lui dit qu’ils devaient écouter Dieu et qu’aucun revenant du pays des morts ne pourrait les convaincre.
22390 SAINT-ADRIEN
Population : 356 hab. (2018) En breton : Sant-Rien CÔTES D’ARMOR
2
Le nom de la localité est attesté sous les formes : Parochia de Saint Rien en 1393, Saint-Derien en 1543, Saint Drien en 1581, Saint Adrien en 1682.
Le nom de la commune Saint-Adrien viendrait selon :
Une première hypothèse dit que Rien est un personnage, attesté semble-t-il, au sud de l'île de Bréhat en 1181, sous le nom de Riom/Rion.
Sur l’île Riom on trouve les ruines d’une chapelle portant son nom. Entre le XIIème et le XIIIème siècle, la chapelle servait de lieu de culte pour les lépreux reclus dans une léproserie toute proche, dont il ne reste aucun vestige. A l'intérieur de la chapelle en ruines se trouvent encore un bénitier d'origine, un baptistère (auge en pierre) et une statue de Saint-Rion, moine du VIIème siècle. Ce nom serait devenu par déformations successives Adrien. On peut trouver environ dix saints portant ce nom Adrien, dans la bibliographie catholique mais sur Rien/Rion on ne trouve rien.
Une deuxième hypothèse propose un Saint Rion qui fut un religieux de l'abbaye de Redon au IX
ème
siècle. Ses belles qualités le rendaient agréable et juste. Son humilité le faisait partager avec ses frères les travaux qui paraissaient les plus vils. Un jour qu'il fanait avec quelques-uns d'entre eux, il s’aperçut que le soleil approchait du milieu de sa course et il se hâta de passer la rivière, tout occupé de la sublime fonction qu'il allait remplir en célébrant la messe. On assure que Dieu, pour soutenir sa ferveur, le fit marcher sur les eaux. Même si cette petite légende est belle, ce n’est pas ce saint qui aurait donné son nom à la commune.
Une troisième et dernière hypothèse nous propose Adrien de Nicomédie comme donateur de son nom à la commune. Son histoire est présentée dans ‘
La Légende Dorée’.
Adrianus (Adrien) était officier dans l'armée de l'empereur romain Galère qui faisait appliquer avec zèle la persécution des chrétiens décidée par Dioclétien. Vers 306 à Nicomédie (Turquie), Galère ordonna de supplicier trente trois chrétiens en les faisant fouetter, en leur broyant la bouche et en les emprisonnant. Impressionné par le courage et la bravoure des condamnés, Adrianus qui avait vingt-huit ans, décida de se convertir. Apprenant cette conversion, l'empereur fou de rage, le fit fouetter et les coups furent si violents qu'à la fin les entrailles d'Adrianus sortaient de son corps. Nathalie son épouse, elle-même chrétienne, soignait en cachette les martyrs emprisonnés. Galère ordonna qu'on tranche les pieds, ensuite les jambes des prisonniers chrétiens, puis qu'on fasse brûler leur corps. Adrianus fut le premier supplicié et on lui coupa une main. La légende affirme qu’au moment où on jeta les corps des martyrs au feu, une pluie violente arriva et éteignit les flammes. Nathalie put récupérer la main de son mari qu'elle conserva précieusement. Réfugiée peu de temps après à Constantinople pour échapper à la proposition de mariage que lui avait faite un tribun, elle rendit l'âme, après avoir vu en songe Adrianus qui lui demandait de le rejoindre dans la paix éternelle.
Les reliques de Nathalie et d'Adrianus ont été transférées de Constantinople dans un monastère en Belgique, en 1110. Les bollandistes ont décrit aussi cette légende sur le martyre de Saint Adrien et la réaction de son épouse.
Il est le saint patron des soldats, il est invoqué contre les maux de ventre, mais surtout contre la peste. A partir du XVème siècle, son culte se répandit en Bretagne du nord, où on trouve des nombreuses statues le représentant.
La Légende Dorée est un ouvrage rédigé en latin entre 1261 et 1266 par Jacques de Voragine, qui raconte la vie d'environ 150 saints, saintes et martyrs chrétiens.
La Société des Bollandistes est une société savante belge fondée au XVIIèmesiècle par Jean Bolland dont le but premier est l'étude de la vie et du culte des saints.
22272 SAINT-AGATHON
Population : 2 273 hab. (2017) En breton : Zan Eganton CÔTES D’ARMOR
3
Le nom de la localité est attesté sous les formes:/Prior Sancti Guengontoni vers 1330, Saint Gueganton en 1447, Prioratus Sanctus Negantonii en 1516, Saint Negantonen en 1555, Sainct Eganton en 1574 et Sainct Aganthon en 1583.
Le nom de la commune vient du Saint Gwéganton, saint breton, qui se retrouve sous des noms différents Gwenganton, Guenganton, Hingueten, Ganton.
Voir 35550 SAINT-GANTON
Ce n’est pas le 79ème Pape Saint-Agathon, actuel patron de l'église qui a donné son nom au bourg. Dans la mesure où il y a des raisons de croire, ce personnage aurait 104 ans au moment de son élection comme pape.
56480 SAINT-AIGNAN
Population : 618 hab. (2018) En breton : Sant-Inan MORBIHAN
4
Le bourg est attesté sous les formes : Ecclesia Santi Inanni en 1184, Sant Iuan en 1630 et Sant Inan en 1654.
− Le nom d’origine de cette commune viendrait de Saint Iunan (Inan), un saint breton ou écossais, oublié par l’histoire. Voir la commune Saint Gelven (22) pour trouver quelques maigres informations.
− Plus tard, le nom de la commune a été remplacé par Saint Aignan, un personnage connu par des hagiographes, cité dans la liste des saints de l’église catholique romaine. On ne sait pas ni quand ni pourquoi a eu lieu ce changement. De nombreuses localités portent son nom en France car il fut considéré à l'époque comme sauveur. Saint Aignan (Agnan, Aignan d’Orléans, Anianus) naquit vers 358 à Vienne (38) d’une famille d’origine hongroise et il décèdera vers 453 comme évêque à Orléans (45). Il est le saint patron de la ville d’Orléans, supplanté dans les faits, presque mille ans plus tard, par Jeanne d'Arc. Le fait le plus marquant de son histoire fut son intervention salutaire pour protéger la ville, anciennement connue sur le nom d’Aurelianum, contre les hordes barbares des Huns.
Une légende locale dit qu’il aurait lors du siège de la ville, en invoquant le Ciel, jeté du haut des remparts une poignée de sable contre les assaillants. Chaque grain se métamorphosant alors en guêpe, celles-ci mirent les barbares en fuite et Attila décida de ne pas attaquer la ville, mais de la contourner.
Un texte, exposé dans la collégiale Saint-Aignan d'Orléans, n'évoque aucun miracle et s'en tient à une version à caractère historique, basée sur des sources des Vème et VIème siècles. Selon ces sources Aignan a contribué par la prière et par son habileté de négociateur, à préserver la ville d’Orléans en 451, d'une destruction totale par les Huns.
On dit que pendant le siège, il envoya les habitants venus lui demander de l’aide grimper en haut des murs et regarder si l’aide demandé à Dieu arrivait, en disant chaque fois ‘ne vois-tu rien venir ?’ En regardant du haut des murs, ils ne virent personne et revinrent près du Saint pour prier avec foi. Cette scène se répéta plusieurs fois et quand les murs de la cité commencèrent à tomber par suite des assauts barbares, ils virent au loin une armée nombreuse venant leur donner secours.
Les huns effrayés fuirent et furent pourchassés et écrasés près de Troyes. C’était l’armée demandée par Aignan au patriarche d’Arles qui arrivait en extremis pour les sauver.
Même si une polémique existe sur le rôle exact joué par Saint Aignan, une chose est sûre, la ville d’Orléans ne fut pas pillée et détruite comme Metz par exemple. Dom Berland conclut en 1979 en disant « C'est un fait bien connu, que les pasteurs d'âmes ont fait figure à cette époque, de protecteurs du peuple ».
Les Huns sont un ancien peuple nomade originaire de l’Asie centrale, dont la présence en Europe est attestée à partir du IVème siècle et qui y établirent le vaste empire. Ils étaient réputés pour leur violence. Païens, ils s’attaquaient avant tout aux monastères et aux églises.
22400 SAINT-ALBAN
Population : 2.160 hab. (2018) En breton : Sant-Alvan CÔTES D’ARMOR
5
Le nom de la localité est attesté sous les formes : Parochia de Sancto Albano en 1256, Parochia Sancti Albini en 1281, Parochia Sancti Albani en 1290, Ecclesia de Sancto Albano vers 1330, Parochia de Saint Aulban, Saint Treuen en 1430, Saint Aulban en 1463, Saint Aulbin en 1468, Saint Auban en 1480 et Saint-Alban dès 1640.
Le nom de la commune vient du Saint Alban de Verulamium, qui fut le premier martyr anglais du IIIème siècle, décapité en Grande-Bretagne. Alban (Aubin, Albain, Albans, Albe) fut martyrisé en 304(?) dans la ville actuellement nommé St. Albans City, au nord de Londres. On dit qu’il était un païen charitable qui offrit l’accueil à un prêtre chrétien cherché par la police. Ils discutèrent longtemps et impressionné par l’aura du prêtre il se fit baptiser et devint chrétien. Quand les policiers arrivèrent, ils arrêtèrent Saint Alban qui, pour sauver le prêtre, avait revêtu son uniforme religieux. Alban fut amené devant le légat romain qui, furieux, ordonna qu’Alban subisse le châtiment destiné au prêtre et il fut mis à mort à sa place. On dit qu’Alban aurait déclaré « je révère et j'adore le Dieu vivant et vrai qui a créé toutes choses », mots toujours utilisés dans la liturgie de l’abbaye de St-Alban.
Le poète Venance Fortunat (530-609), qui vivait dans la Gaule méridionale à la fin du VIème siècle écrivait de cette manière sur le Saint « La gloire de son triomphe a été si éclatante qu'elle s'est répandue dans toute l'Église ».
La légende affirme que sur le chemin de son martyre les miracles furent nombreux et qu'il convertit son bourreau qui fut exécuté en même temps que lui.
On dit aussi que ses bourreaux ayant soif, il fit jaillir une source miraculeuse sur le chemin le menant vers le lieu de son supplice. Cette source acquit par la suite la réputation de guérir les malades.
Une autre légende est celle des trois ermites. Il est très probable que l’Alban de cette légende est un autre Alban (?). Voila ce que dit cette légende : Un puissant seigneur mourut jeune et laissa trois fils Guiral, Alban et Suplice. La fille du seigneur voisin, très belle, aima les trois frères mais elle ne voulait pas choisir lequel d’entre eux serait son époux. Seul l’abbé du monastère pouvait faire ce choix pour elle. L’abbé interrogea les trois frères, chacun à son tour. Gurial et Suplice, en lisant la parole de Dieu, se prosternèrent en disant qu’ils renonçaient au mariage, voulant devenir ermites. Alban était tout content d’être l’heureux élu. Mais, en lisant lui aussi la parole de Dieu, il ne résista point à l’appel du ciel, et les trois frères chantèrent ensemble Te Deum. La jeune fille, touchée par la grâce, se retira dans un monastère de femmes, où en entrant, elle vit tomber sa blonde et belle chevelure sous les ciseaux d’une abbesse. Gurial et Alban sont devenus des guérisseurs réputés pour les aveugles et épileptiques. St. Suplice serait devenu le maître des eaux et on dit qu’il fut noyé par ses ennemis.
Une variante de cette légende nous dit qu’au temps des croisades trois jeunes chevaliers de la famille de Roquefeuil (Guiral - Loup et Alban), auraient été épris d'Irène, la fille du seigneur de Rogues. Pour les départager, le père de la fille leur demanda de partir et de combattre en terre sainte et celui qui ferait la plus grande prouesse deviendrait alors son gendre. Après plusieurs années, lorsque les trois chevaliers revinrent de croisade, enrichis de leurs exploits et de leur expérience, Irène venait juste de mourir.
Un troubadour qui passait au château de Rogues lui aurait annoncé la mort (fausse) des trois chevaliers et Irène n'aurait pu supporter un tel chagrin. Pour conjurer leur peine, les trois chevaliers auraient résolu de donner leur vie à Dieu en se faisant ermites. Chaque lundi de Pentecôte, les trois frères auraient allumé de grands feux du sommet de leurs lieu d’ermitage, pouvant ainsi s’assurer qu’ils sont encore en vie. Les feux s’éteignirent l’un après l’autre et Guiral serait mort le dernier.
56600 SAINT-ALLOUESTRE
Population : 634 hab. (2018) En breton : Sant-Aleustr MORBIHAN
6
Le nom du bourg est attesté sous les formes : Saint Argoestle en 1280, Saint Arnoulf en 1387, Saint Alouestre en 1406, Saint Anouestre en 1422 et Saint Allouestre en 1554.
Le nom de la commune Saint-Allouestre vient du Saint Arwystli. Saint Allouestre était à l'origine le saint protecteur des alevineurs (voir le bourg Saint Eloy - 29). Un alevineur, est une personne qui exerce son métier en aquaculture et en pisciculture.
Plusieurs hypothèses sont formulées pour expliquer l’origine d’Arwystli.
Une théorie suggère que St.Arwystli vient d’un saint breton, aujourd'hui tombé dans l'oubli, Saint Argoestli ou Saint Arouestli.
Une autre opinion avance l’idée que Saint Arwystli aurait été un gallois qui serait venu en Bretagne en VI
ème
siècle. Ce saint est reconnu dans le diocèse de Vannes puisque Saint Allouestre figure à la litanie des saints du pays vannetais.
Enfin, une autre hypothèse suppose que Saint Arwystli était un gallois, et qu’il est en réalité Aristobule de Britannia, un saint reconnu par le catholicisme romain. Il est cité dans des listes du début du III
ème
siècle, comme l'un des 70 disciples de Jésus et qui aurait été au siècle I
er
, le premier évêque de la province romaine Britannia.
Cette hypothèse parait la plus crédible pour l’origine du nom du bourg.
Pour la tradition chrétienne, c'est le premier évangélisateur de la Grande-Bretagne avec Joseph d'Arimathie. Il figure par la suite dans les martyrologes et les Calendriers des saints de l'église catholique.
56460 LE-ROC-SAINT-ANDRE
Population : 928 hab. (2013) En breton : Roz-Sant-Andrev MORBIHAN
7
Depuis 2016 VAL D’OUST
Le Roc-Saint-André était connu sous le nom de Le Rotz au XVème siècle.
Le nom initial de la commune vient du nom de la chapelle dédiée à Saint André, construite sur un rocher.
André vivait sur les bords du lac de Tibériade (actuellement en Israël) avec son frère Pierre ; ils vivaient de la pêche. C'était un assoiffé de Dieu. Il avait entendu la prédication de Jean le Baptiste, il avait sans doute reçu son baptême et il serait devenu l'un de ses disciples. Ensuite, il suivit Jésus pour ne plus le quitter, il fut ainsi le premier disciple. Il était diplomate et savait nouer des contacts. Après la Pentecôte il partit prêcher l’Évangile et il fit un long voyage tout autour des côtes de la mer Noire. Il finit crucifié sous l’empereur Néron, à Patras (en Grèce) en l’an 60, où l’on construisit plus tard la basilique portant son nom. Au IVème siècle, ses reliques furent transportées à Constantinople, mais reposent aujourd’hui à Amalfi en Italie. Saint Pierre et Saint André sont frères de sang. Outre leur parenté, les deux ont subi le martyre de mourir crucifiés.
L’un est considéré comme fondateur de l’Église de Rome (Église occidentale), l’autre comme fondateur de l’Église de Constantinople (Église orientale).
Le martyre de Saint André et ses légendes nous ont été racontés par des prêtres et des diacres de Grèce et d’Asie, témoins oculaires de ses derniers instants.
On en a sélectionné plusieurs légendes qui accompagnent la vie de ce saint.
Un jour, se promenant sur les bords du lac, où André et ses compagnons étaient occupés à pêcher, Jésus leur fit signe de jeter leurs filets, en leur disant : «
suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d’hommes
! » Ils le suivirent, et jamais plus ils ne revinrent à leur métier de pêcheurs. Après l’ascension du Seigneur, André alla pêcher en Scythie et Matthieu en Éthiopie. Or les Éthiopiens, refusant d’admettre la prédication de Matthieu, lui arrachèrent les yeux et le jettent en prison, avec la ferme intention de l’exécuter le lendemain. Un ange apparut à Saint André et lui demanda d’aller aider Matthieu. Saint André alla avec l’aide de l’ange délivrer Matthieu et priant Dieu, son ami retrouva la vue. Matthieu se rendit à Antioche mais André fut fait prisonnier et trainé, mains liées, en place publique. Son sang coulait en abondance mais il ne cessait de prier, de telle sorte qu’il finit par convertir tous les habitants de la contrée. Ensuite il partit en Grèce.
On dit aussi qu’un jeune homme fut converti par André mais les parents du jeune garçon n’étaient pas d’accord. Comme le garçon vivait avec André, les parents mirent le feu à la maison mais le jeune homme versa sur les flames de l’eau bénite, et aussitôt le feu s’éteignit. Mais les parents, n’acceptant pas la conversion de leur fils, apportèrent une échelle pour grimper et le récupérer. Subitement, ils devinent aveugles, de telle façon qu’ils ne pouvaient pas voir les marches de l’échelle. Ils comprirent que c’était un signe de Dieu et abandonnèrent leur projet de récupérer leur fils.
Une autre fois une femme, mariée à un assassin, se trouvait en couches et ne parvenait pas à enfanter. Elle dit alors à sa sœur d’invoquer la déesse Diane ; elle la fit mais au lieu de Diane ce fut le diable qui répondit qu’il ne pouvait rien faire. Elle alla alors trouver Saint André et l’amena près de sa sœur malade. L’apôtre dit qu’elle méritait de souffrir car elle était mal mariée, elle avait mal conçu et de plus elle avait invoqué l’idole de Diane. Il toucha ensuite le ventre de la femme et elle mit au monde un enfant mort et sa douleur cessa.
Une autre légende dit qu’un vieillard, nommé Nicolas, vint trouver Saint André pour lui dire qu’il croyait en l’Evangile et qu’il priait Dieu mais, à soixante-dix ans, il s’a donnait toujours à la luxure et aux mauvais désirs. Il raconta qu’il était allé dans une maison de débauche en oubliant qu’il tenait la bible dans la main. Là, une prostituée l’apercevant lui dit de partir, de ne pas la toucher et de ne plus revenir car elle avait vu qu’il était touché par Dieu. Le vieillard était triste, il reconnaissait ses péchés et il demanda l’aide d’André. Le saint commença à prier et jeûna cinq jours. Finalement Dieu exauça sa demande et le vieillard jeûna de lui-même, six mois d’eau et de pain, et s’endormit en paix.
Une autre histoire se passe quand l’apôtre était dans la ville de Nicée. Les habitants lui dirent que, aux portes de la ville sur le chemin, se tenaient sept démons qui tuaient les passants. Alors l’apôtre, en présence du peuple, ordonna à ces démons de venir vers lui, et aussitôt ils vinrent, sous forme de chiens. Il leur ordonna de partir, sur quoi les démons s’enfuirent. Les témoins de ce miracle reçurent la foi du Christ. Mais voilà qu’en arrivant aux portes d’une autre ville André rencontra le cadavre d’un jeune homme, qu’on emmenait pour l’ensevelir. Et on lui dit que sept chiens étaient venus la nuit et l’avaient tué dans son lit. Et l’apôtre, tout en larmes, comprit et ayant prié le Seigneur, ressuscita le jeune homme qui se releva et le suivit comme disciple.
Enfin, une autre légende dit que quarante hommes, venaient par mer vers l’apôtre afin de recevoir de lui la doctrine de la foi, lorsque le diable souleva une tempête si forte que tous furent noyés. Leurs corps ayant été jetés par les vagues sur le rivage, l’apôtre les ressuscita aussitôt. Chacun d’eux raconta ensuite le miracle qui lui était arrivé.
La
Légende Dorée
rapporte que son supplice fut ordonné par le proconsul dont Saint André avait converti l’épouse au christianisme. Il fut attaché à la croix et survécut pendant deux jours, durant lesquels il prêcha à la foule, qui s’indigna et menaça le proconsul de mort. Celui-ci ordonna donc à le faire descendre, mais on ne put le délier et le saint mourut dans une grande lumière. Certains disent que Saint André aurait baisé la croix avant d’être attaché.
Une fois, un évêque reçut une très belle femme qui venait lui dire qu’elle avait fui sa maison pour échapper à un mariage forcé et qu’elle voulait donner son âme à Dieu. L’évêque, L’évêque touché par cette confidence, lui proposa de l’héberger et ils allèrent dîner ensemble. Pendant le repas, les charmes de la dame commencèrent à déstabiliser la sainteté du prélat. Mais quelqu'un frappa à la porte et demanda à entrer. La dame, perturbée, dit qu’il pouvait entrer seulement s’il pouvait répondre à des questions difficiles. Elle lui posa donc des questions et l’homme à la porte lui donna des réponses bonnes et claires. L’évêque fut émerveillé des réponses mais, la femme pour se débarrasser demanda à l’inconnu de la porte quelle était la distance entre la terre et le ciel. L’étranger dit alors à la femme qu’elle devait questionner son supérieur car il devait savoir car c’est lui qui est tombé du ciel pour aller en enfer. L’évêque comprit alors, sortit sa croix et la femme disparût dans un nuage de fumé. Il courût ouvrir la porte mais l’inconnu n’était plus là. Et, cette nuit-là même, l’évêque reçut le message du ciel que c’était Saint André qui était venu à sa porte, pour le sauver.
Une dernière légende concerne le préfet d’une ville qui s’était emparé d’un champ dépendant d’une église de Saint André. Sur les prières de l’évêque, le préfet fut saisi de fièvres et il demanda au prélat de prier pour lui, promettant de restituer le champ s’il recouvrait la santé. Il retrouva sa santé mais il ne voulut pas restituer les terres. L’évêque se mit en prière et aussitôt le préfet fut de nouveau malade. Il redemanda au prélat d’intervenir pour lui mais ce dernier resta muet. Désespéré, le préfet se fit porter à l’église et arrivé là il tomba mort.
Certaines sources affirment que Saint André aurait passé vingt ans en ermite en Scythie mineure dans une grotte près d'un village Ion Corvin (Roumanie).
Censé avoir fait le tour de la mer Noire, Saint André est considéré comme le saint patron de l’église roumaine et celui de la marine russe.
La nuit du 30 novembre est particulière dans la mythologie roumaine. On dit que Saint-André est le maître et le protecteur des loups, qu’il descend sur Terre à minuit pour partager avec chaque loup la proie de l'hiver. Aujourd'hui encore, dans certaines régions reculées, les gens croient que la nuit, les loups deviennent si agiles qu'ils peuvent même tourner la tête pour voir leur propre queue et qu'aucune proie ne peut échapper à leur poursuite. Si le bétail commence à rugir à minuit, cela signifie que les loups se préparent pour leur chasse. Afin de les protéger, les gens préparent des croix de cire et les collent sur la corne droite des vaches.
Mais Saint-André ne concerne pas seulement les loups. Selon des croyances plus anciennes, les esprits des morts sont autorisés à rentrer, juste pour une nuit, dans le monde des vivants. Avec les loups et les esprits, les vampires et diables profitent également de ce moment, dansant et hantant les maisons abandonnées, tourmentant les gens et les animaux. Pour se protéger, les habitants frottent les portes et les fenêtres avec des gousses d’ail, suspendent de l'ail autour de leur maison ou préparent différents plats à base d'ail. Une tradition intéressante, ressemblant plus à une fête, est la garde de l'ail. Chaque fille participant au rituel apporte trois bulbes d'ail qui sont placés dans un vase. Le vase est ensuite gardé par une vieille femme pendant que les jeunes dansent et mangent et profitent de la fête jusqu'au matin. Ensuite, l'ail est partagé avec tous les participants et chacun le conserve toute l'année dans le lieu le plus sacré de la maison, près des icônes, pour être utilisé uniquement en cas de besoin, car l'ail est maintenant investi de propriétés magiques et curatives.
L'Ukraine affirme que Saint André fut le premier évangélisateur de Kiev et l'Écosse l’a choisi comme patron national.
X
La croix de Saint André est une croix en forme de X. Son nom provient de la forme de la croix qui aurait été utilisée selon la tradition pour supplicier le Saint. Ce symbole a été utilisé par de nombreux pays européens. La croix de Bourgogne est une croix de Saint André particulière. Ce type de croix est présente dans la culture européenne, dans l'art religieux, dans la symbolique identitaire de pays, de régions ou de forces politiques, dans la vie pratique.
Par analogie de forme, cette structure est présente dans un bâtiment à colombage, un assemblage de deux pièces de bois croisées qui assure une meilleure rigidité au panneau et permet, au moyen de la triangulation, d'éviter le roulement, la déformation de la charpente.
22630 SAINT-ANDRE-DES-EAUX
Population : 358 hab. (2018) En breton : Sant-Andrev-an-Dour CÔTES D’ARMOR
8
La localité est attestée sous les formes : Sanctus Andreas à la fin du XIVème siècle et Saint André des Eaux en 1480
Le nom de la commune Saint-André-des-Eaux vient de Saint-André. On prétend qu'un monastère abritant des templiers aurait été édifié à l’emplacement de l'ancienne chapelle de Fontlebon, au lieu-dit Le Besso. Le territoire de la commune est parcouru par la Rance et le Linon et d’ici vient le suffixe des eaux.
Voir 56460 LE-ROC-SAINT-ANDRE
56400 SAINTE-ANNE-D’AURAY
Population : 2.738 hab. (2017) En breton : Santez-Anna-Wened MORBIHAN
9
Ancien hameau d'une quarantaine d'habitations situé dans la paroisse de Pluneret qui portait le nom de Ker-Anna, et qui en breton signifie village d'Anne. Une tradition orale, diffusée par les fidèles chrétiens, voulait que Ker-Anna fût appelé ainsi en référence à Sainte Anne mais cette toponymie résulte d'un syncrétisme entre le vieux fond païen de la déesse Dana et le culte des saints chrétiens.
Première hypothèse sur l’origine du nom de la commune : celui-ci viendrait de Dana qui en gaëlique veut dire
rapide
. Dana est une grande déesse irlandaise, connue aussi sous le nom de Danu ou Ana. Chez les celtes, elle est la Déesse Mère universelle, à l’instar de Mari pour les basques, Isis pour les égyptiens, Déméter, Artémis ou Gaïa pour les grecs, Diane pour les romains, Dévî pour les hindous, Nûwa pour les chinois …
La Déesse Anna (Dana, Danu, Ana, Anna, Anu, Dôn, Danann, Dinann, Donnan) était une déesse-mère celte. Elle est d'une certaine façon l'équivalence de Gaïa pour les Grecs. Elle représente la mère des dieux celtes et en même temps la mère des humains. Le culte, très vivace dans l'ouest de la Bretagne, se retrouve ensuite dans le culte chrétien à Sainte Anne. Toujours présente dans les esprits, elle est la Sainte Patronne du pays Celte de Bretagne. En Bretagne, longtemps, un parallèle était fait entre la déesse celtique Ana/Dana et Sainte Anne, toutes les deux appelées en cas de la stérilité des couples.
Deuxième hypothèse sur l’origine du nom de la commune : celui-ci se référerait à Sainte Anne. Anne appartenait à la tribu de Juda, descendante de David. Elle serait originaire de Nazareth, d’une famille assez aisée. Elle serait née vers -55 av J-C et aurait déménagé à Jérusalem quand avait neuf ans. Elle fut envoyée au Temple pour obtenir une bonne éducation à l’âge de trois ans. Selon une tradition chrétienne orientale, la crypte de l'église Sainte-Anne de Jérusalem serait située sur le lieu de la maison dans laquelle serait née Marie. On raconte que Joachim serait venu faire sacrifier des bêtes de son troupeau au Temple où il vit Anne. Ils se marient à l'âge de 20 ans.
L’histoire d’Anne et de Joachim est décrite dans un texte apocryphe le Protévangile de Jaques. Le protévangile relate des événements antérieurs aux évangiles canoniques.
On dit que Joachim fut condamné et ses riches offrandes refusées par le Temple, car il n'avait pas eu de postérité en Israël. Il se retira alors dans le désert pour faire pénitence, tandis que son épouse Anne se lamentait sur sa stérilité.
Et voici qu'un ange se mit devant elle et lui annonça qu’elle enfanterait. Joachim reçut aussi la visite d'un ange qui lui annonça qu’il serait père. C'est alors que les deux époux, accourant l'un vers l'autre, se rencontrent à l'entrée de Jérusalem, à la Porte Dorée où ils échangent un baiser. Marie aurait été conçue d’après certains, lors de cette chaste étreinte. La croyance dans le ‘baiser fécondant’ persista longtemps, jusqu’à ce que le pape Innocent-XI la condamne officiellement dans un décret promulgué en 1677, affirmant que la Mère de Jésus avait été engendrée selon les lois de la nature.
Le culte d’Anne prit une extension importante à partir des apparitions en 1624 au paysan Nicolazic, pour arriver à être surnommée LA GRAND-MERE DES BRETONS.
L’histoire dit que Nicolazic vivait en couple et n’avait pas d’enfant. Anne lui apparut et lui demanda de construire une chapelle à son honneur. Elle l’informa qu’une chapelle existait déjà au VIIème siècle. Nicolazic, guidé par la lueur d'un grand cierge, déterra dans le lieu indiqué une ancienne statue abimée de Sainte Anne avec des restes de couleurs azurées et dorées. Il s’employa alors à construire une chapelle et découvrit avec bonheur que son couple était devenu fécond. Cette chapelle, détruite depuis, fut remplacée par un petit séminaire et une basilique qui seront les bases de la commune de Saint-Anne-d’Auray (56). Le pardon qui s'y déroule chaque année est le plus important de Bretagne et il est troisième lieu de pèlerinage en France après Lourdes et Lisieux. En 1914, le pape Pie-X déclara officiellement Sainte Anne patronne de la Bretagne.
Le Speculum Historiale du dominicain Vincent de Beauvais (?-1264) et la Légende Dorée relate à la postérité la vie de Sainte Anne avec son second époux Cléophas frère de Joseph, et de leur fille Marie Jacobé, ainsi celle avec son troisième époux Salomé et de leur fille Marie Salomé.
L'ensemble de cette postérité appelée La Sainte Parenté, a donné lieu en Allemagne et dans l’Europe du Nord à des nombreuses représentations iconographiques.
Plusieurs légendes entourent Sainte Anne en Bretagne, la plus connue fut rapportée par Anatole le Braz. Anne serait originaire de Plonévez-Porzay (29), mariée à un seigneur cruel et jaloux, qui lui interdit d’avoir des enfants. Lorsqu’elle devient enceinte, il la chasse du château, menaçant de la tuer. Elle part se cacher et donne vie à Marie et, cherchant un lieu où s’arrêter, elle arrive avec sa fille sur la plage de Tréfuntec (29). Ici l’attend un ange, près d’une barque, qui lui dit qu’il l’attendait pour l’amener en Galilée. Ils montent dans cette barque et, en quelques coups de rame, l’ange arrive à destination.
Bien des années plus tard, Marie épousa Joseph et devint la mère du Christ. Anne revint en Bretagne, sa terre natale, pour y finir sa vie dans la prière et distribua ses biens aux pauvres. On ajoute même que des années après son retour, elle reçut la visite de son petit-fils Jésus, venu pour solliciter sa bénédiction avant de commencer à prêcher l'Évangile. Jésus, sur le désir de son aïeule, fit jaillir une fontaine auprès de laquelle on bâtit une chapelle.
C'est en effet une coutume fréquente de la région de gratifier miraculeusement des personnages importants d'une ascendance bretonne ou d'un séjour dans cette province.
En 2015, Sainte Anne était le vingt-quatrième personnage le plus célébré qui aurait donné son nom à un établissement français.
Les bretons de Haute-Bretagne comme de Basse-Bretagne la revendiquent comme leur compatriote :
- Dans les Côtes-d'Armor, les habitants de Merléac (22) affirment qu'elle est née chez eux, au village de Vau-Gaillard, et qu'elle avait une sœur s'appelant Pitié.
- Dans le Finistère, une légende fait d'elle une princesse cornouaillaise de sang royal vénérée à Sainte-Anne-la-Palud (29)
Elle est à la fois la patronne des laïcs et des clercs, des matrones et des veuves. Elle préside à la sexualité du couple autant qu'à l'abstinence des moines, elle favorise les accouchements et ressuscite même les enfants morts nés. Elle assure sa protection aux tourneurs, sculpteurs, ébénistes, orfèvres, fabricants de balais, navigateurs et mineurs, mais surtout à des métiers manuels féminins : gantières, bonnetières, couturières, lavandières, blanchisseuses, cardeurs, chiffonniers, dentellières, brodeuses, fabricants de bas.
Sainte Anne est la sainte patronne d'Apt, où se trouvent une partie de ses reliques.
Benoît-XVI (Angélus 2009), fait un joli éloge aux grands-parents « La mémoire des saints parents de la Vierge et donc grands-parents de Jésus, m'offre un point de réflexion sur le thème de l'éducation. Elle nous invite en particulier à prier pour les grands-parents, qui, dans la famille, sont les dépositaires et souvent les témoins des valeurs fondamentales de la vie. La tâche éducative des grands-parents est toujours très importante et elle le devient encore davantage quand les parents ne sont pas en mesure d'assurer une présence adéquate auprès de leurs enfants, à l'âge de la croissance. Je confie à la protection de Sainte Anne et Saint Joachim tous les grands-parents du monde en leur adressant une bénédiction spéciale. »
35390 SAINTE-ANNE-SUR-VILAINE
Population : 1.028 hab. (2018) En breton : Santez-Anna-ar-Gwilen ILLE ET VILAINE
10
La commune a été créée en 1880, par démembrement de la commune de Grand-Fougeray, sous le nom de Sainte-Anne. Sainte-Anne devient officiellement Sainte-Anne-sur-Vilaine en 1971.
− La première partie du nom de la commune vient de la Sainte Anne mère de la Vierge,
− La deuxième partie du nom de la commune vient du nom de la rivière qui traverse le bourg. La Vilaine est un fleuve de Bretagne. Il prend sa source dans l’ouest du département de la Mayenne avant de traverser l’Ille-et-Vilaine d’est en ouest puis du nord au sud après Rennes. Il se jette dans l’océan Atlantique après avoir parcouru 217,8km.
Voir 56400 SAINTE-ANNE D’AURAY
35230 SAINT-ARMEL
Population : 2.094 hab. (2018) En breton : Sant-Armael-ar-Gilli ILLE ET VILAINE
11
La commune est attestée sous les formes suivantes : Bochod au VIème siècle, Sancto Ermagero en 1152 et Sancti Armagilli en 1516.
Saint Armel (Arzel) fut un moine d'origine galloise venu en Bretagne au VIème siècle. Il donna son nom à deux communes, une en Ille et Vilaine, l’autre en Morbihan.
Né en Irlande en 482 de parents nobles et riches, Armel quitte son pays pour migrer vers la Bretagne continentale. Lorsque le roi de la Grande Il fait appel aux Saxons et aux Angles pour défendre son territoire contre les Scots venus du Nord, les « protecteurs », qui sont païens, s'en prennent bientôt à la population chrétienne de la région. Saint Armel quitte alors la Bretagne insulaire lors de la grande migration bretonne. Il s'installe sur le continent armoricain auquel ils donnent leur nom, leurs traditions, leurs structures et leur foi.
Nombreux furent les fugitifs qui préférèrent rejoindre l'Armorique païenne. Ils s'embarquèrent avec leurs prêtres, évêques, abbés et ermites, avec leurs ornements sacrés, leurs croix et leurs livres liturgiques, et cinglèrent vers la péninsule, dans laquelle ils s'installèrent sans être repoussés, et furent extrêmement bien assimilés par la population, le gaulois et ses traditions furent lentement oubliés.
Ermite dans la région de Quimper, Armel fonde un monastère à Plouarzel (29). Ici il construit avec ses disciples un oratoire et de petites cellules. Sous la conduite d'Armel, qu'ils vénéraient comme leur maître et chérissaient comme leur père, ses disciples commencèrent à pratiquer tous les exercices d'une vie d'austérité, de contemplation et de prière. Ensuite il partit pour un séjour de six ans à la cour de Childebert-Ier. Il y guérit un boiteux et un aveugle mais, finalement, il fut chassé à la suite d’intrigues. Il vient alors s'installer au sud de Rennes où il finit son existence en grande sainteté. Il meurt en 552. Sa mâchoire, relique, est encore visible à l'église de Saint-Armel-des-Boschauts (35). Dans cette même église est conservé un sarcophage qui serait sa tombe. Ces précieuses reliques furent recueillies lors de la Révolution par une pieuse femme, qui les garda avec respect et les rendit à l’église à la fin de la persécution républicaine.
D'après la légende, un dragon dévastait le pays près de la forêt du Theil. Armel prit son étole et de l'eau bénite, dompta le dragon et le chassa du pays. On dit que l’herbe n’a jamais poussé depuis sur le sol où glissa le serpent en tombant dans la rivière. Cette histoire est représentée de nos jours sur un
vitrail de l'église de Marcillé-Robert (35)
, sur un vitrail de la chapelle St.Alexis à Noyal-sur-Vilaine (35) et aussi, sur les vitraux du chœur de l'église qui lui est consacrée à Plouharnel (56). Le moine habitait alors le monastère qu'il avait fondé aux Boschauts.
Mais le pays de Ploërmel revendique aussi ce miracle comme sien, et voici ce que nous lisons à ce sujet dans "Les Légendes locales de la Haute-Bretagne", de P.Sébillot (ethnologue 1843-1918). Dans les environs de Ploërmel vivait un monstre, serpent ou dragon, que la populace appelle ‘la guibre’. La guibre désolait le pays, en attaquant les grandes personnes, et dévorant les moutons, les poulains et les petites vaches bretonnes. Tout comme Saint-Michel terrassa le dragon, image du démon, ainsi Saint-Armel terrassa la guibre. Lorsqu’il l’eut vaincue, il la lia avec son étole, ainsi qu’en témoignent toutes les vieilles statues et les anciens vitraux du pays ; et, la guibre devenant aussi faible qu’un mouton, Saint-Armel la précipita dans la rivière d'Yvel. Certains prétendent que c’est dans un chemin creux que se livra le combat entre la guibre et Saint-Armel.
Au milieu de ce chemin on voit une grosse roche qui porte la trace d’une patte ; et ce pied est celui de la guibre, qui, précipitée du haut de la butte des châteaux alla rouler dans le ravin et se noya dans le ruisseau. Ce serait en reconnaissance de ce miracle, que le seigneur de Jerguy aurait donné à Saint-Armel le territoire qui s’appela depuis Ploërmel.
Une autre légende fondatrice mentionne le rôle que Saint Armel joua durant la plus grave sécheresse connue de l'histoire de la commune. Une fois l'intégralité des puits asséchés et l'ensemble des récoltes dévastées, la population désespérée supplia le saint de la délivrer de ses tourments. Saint Armel planta alors un bâton dans le sol et pria. L'eau se mit alors à jaillir abondamment de ce point pour mettre éternellement à l'abri de la sécheresse la population. Cette fontaine miraculeuse existe toujours et est visitée chaque année par de nombreux chrétiens en quête de ses vertus miraculeuses. Cette légende est similaire à celle de Moïse qui fit aussi jaillir l’eau d’un rocher, avec son bâton en période de sécheresse.
Armel a la réputation d'un guérisseur plein de puissance et de bonté. Il est encore invoqué par le peuple contre les maux de tête, la fièvre, les coliques, les enflures, et surtout contre la goutte et les rhumatismes. Les jeunes filles souhaitant se marier devait en planter une épingle dans le nez ou le pied de la statue du Saint.
Henry-VII, roi d’Angleterre, avait une dévotion particulaire pour ce saint. On disait que toute sa force et tous ses muscles se sont forgés lors de son bain pris dans la fontaine miraculeuse de St. Armel, sur le continent.
Depuis fort longtemps, il est une tradition pour l'expression théâtrale à Ploërmel et la représentation de la ‘Légende de Saint-Armel’ a été longtemps une institution dans la ville. Cette tragédie écrite en vers par Messire Jean Baudeville, prêtre et maître d'école à Ploërmel, raconte la vie de Saint-Armel. Elle sera d'abord jouée par les élèves de l'auteur à partir de 1600 et présentée en public, pour la première fois en 1611. Le peuple puisait à ce spectacle des leçons de vertus chrétiennes, cette tragédie valait souvent les meilleurs sermons. Cette tradition tiendra jusqu’en 1790.
56450 SAINT-ARMEL
Population : 880 hab. (2018) En breton : Sant-Armael MORBIHAN
12
La commune est attestée sous les formes : Sant Hermel en 1304, Prosat en 1367 et Provosat en 1475.
‘Prosat’ ou ‘Provosat’ était le toponyme originel du lieu et le nom d'une frairie dépendant de Sarzeau. Le nom de la commune Saint Armel vient du nom du patron de l’église. L’église fut reconstruite en 1857 et le bourg adopte son nom actuel en 1858.
Voir 35230 SAINT-ARMEL
35140 LA-CHAPELLE-SAINT-AUBERT
Population : 446 hab. (2018) En breton : Chapel-Sant-Alverzh ILLE ET VILAINE
13
La commune est attestée sous les noms suivants : Capella Sancti Oberti ou Sancti Osberti en 1095 et Capella Sancti Auberti en 1516.
Le patron de la commune est Saint Aubert, l'évêque d'Avranches fondateur du Mont-Saint-Michel. Saint Aubert vécut entre 670 et 725, naît aux environs d'Avranches( 50) dans la famille des Seigneurs de Genêts (50), famille très pieuse et fort considérée, au temps du roi Childebert IV. À la mort des siens, il distribue son héritage aux pauvres et se fait prêtre. Pieux et solitaire, Aubert a coutume de se retirer au Mont Tombe pour se recueillir dans l’oraison et échanger avec les solitaires qui y mènent une vie érémitique sur ce rocher. Prélat charitable et sage, il est élu évêque d'Avranches en 704 à la mort de son prédécesseur. On sait relativement peu des choses sur lui, il est resté dans l’histoire grâce à St. Michel et au Mont qui porte son nom. On ajoute à cela les réformes canoniques entreprises par les empereurs carolingiens et on obtient une période chargée où les dragons apparaissaient facilement. Le début du IXème siècle est assez agité par la lutte entre la Bretagne, la Normandie et le royaume Franc, chacun voulant plus de terres et plus de pouvoirs. Les légendes en parlent !
Selon ce récit, Aubert protégea et délivra ses fidèles du dragon harcelant leurs troupeaux. Il fit le signe de la croix et jeta son étole sur l'animal, il lui commanda de rejoindre la mer et de ne plus réapparaître. Et cela se produira ! Le même texte hagiographique rapporte que le Saint Aubert fut le témoin d'un combat acharné entre l'archange Saint Michel et un autre dragon, encore plus féroce. Cette lutte débuta sur le Mont-Dol et s’acheva sur le Mont-Tombe, avec la grande victoire du Saint, évidemment.
L’histoire légendaire nous dit que l’évêque Aubert aurait reçu, dans un songe, la visite de l'archange Saint Michel, qui lui demanda de fonder un lieu de culte sur le Mont Tombe, où il avait terrassé le dragon. Ce n'était pas un lieu commode - une pointe rocheuse à peine rattachée au continent. Aubert, une fois réveillé, préféra penser que ce rêve venait du Malin, et il ne fit rien. Quelques nuits plus tard, le rêve se répéta, Aubert, campant sur ses positions, redoubla de prières et de jeûnes pour faire disparaître cette idée désastreuse. L'Archange alors se fâcha, il apparut une troisième fois à Aubert, en lui enfonçant dans la tête sa demande. Une fois réveillé, l'évêque portait sur son os pariétal cette marque en creux que l'on peut encore constater sur ses reliques. Aubert comprit alors qu'il fallait s'exécuter. Il entreprit aussitôt de faire bâtir un petit sanctuaire dédié à Saint Michel.
Des événements providentiels le guidèrent dans sa tâche :
un rond de rosée, un matin de septembre, lui indiqua la forme de l'oratoire
un taureau attaché en montra l'emplacement
une source d’eau douce fut trouvée, un puits creusé
une pierre cultuelle païenne fut arrachée comme par miracle
En 708 environ, Aubert envoya des moines chercher des reliques au sanctuaire du Mont Gargano en Italie, dédié à Saint Michel. Le Mont Saint-Michel était né. La tradition veut que la première messe fût célébrée en 709 par Aubert. Il établit une collégiale de 12 chanoines désignés dans son diocèse, pour accueillir les pèlerins. Le Mont-Tombe prend alors le nom de Mont Saint-Michel au Péril de la Mer. À la mort du saint son corps fut probablement placé dans un sarcophage de pierre, comme le voulait la coutume mérovingienne. Selon ses vœux il fut placé dans le chœur du Mont-Saint-Michel, la tête vers l’autel. Les chanoines gardant son crâne et son bras droit comme reliques.
35250 SAINT-AUBIN-D’AUBIGNE
Population : 3.859 hab. (2018) En breton : Sant-Albin-Elvinieg ILLE ET VILAINE
14
Le nom de la localité est attesté sous les formes : Sanctus Albinus de Albiniaco en 1161, Ecclesia Sancti Albini au XVème siècle et Sanctus Albinus Prope Albigneyum en 1516.
− La première partie du nom de la commune vient du Saint Aubin d’Angres.
− La deuxième partie du nom de la commune vient du nom d’une puissante seigneurie du XIème siècle, seigneurie d’Aubigné.
Voir 35140 SAINT-AUBIN DU CORMIER
35500 SAINT-AUBIN-DES-LANDES
Population : 935 hab. (2018) En breton : Sant-Albin-ai-Lann ILLE ET VILAINE
15
Le nom de la localité est attesté sous les formes : Capella Sancti Albini en 1158 et Ecclesia Sancti Albini de Landis en 1516.
Le bourg doit son nom à Saint Aubin, qui fut évêque d'Angers au début du VIème siècle.
Voir 35140 SAINT-AUBIN DU CORMIER
35140 SAINT-AUBIN-DU-CORMIER
Population : 3.901 hab. (2018) En breton : Sant-Albin-an-Hiliber ILLE ET VILAINE
16
La forme ancienne du nom du village est Sanctum Albinum de Cormerio en 1308.
− La première partie du nom de la commune vient de nom du Saint portant le nom Aubin
− La deuxième partie du nom de la commune vient du nom de l’arbre cormier.
Ce village est intimement lié à la défaite du duc de Bretagne François-II face aux troupes du Roi de France Charles-VIII en 1488 et à la Duchesse Anne de Bretagne qui deviendra reine de France. Anne de Bretagne, née en 1477 à Nantes, est restée très populaire dans l'esprit des Bretons. « Elle a été Bretonne sans jamais se poser de questions » explique l’historienne Claire L’Hoër dans son ouvrage consacré à Anne de Bretagne.
Les événements qui font date dans l'histoire de Saint-Aubin-du-Cormier sont intimement liés à son histoire et elle a laissé quelques légendes dans la ville et ses environs. Fille du duc de Bretagne François-II et de Marguerite de Foix, elle n'a pas douze ans à la mort de son père en 1488.
La Bretagne est alors en plein chaos après la campagne militaire menée par le roi Charles-VIII, excédé par les actions du duc. La dernière étant la création d'un Parlement à Vannes en 1485. Les troupes royales, avec qui combattaient d'autres Bretons, avaient pénétré, en octobre 1487, dans la forteresse de Saint-Aubin-du-Cormier. Nantes avait résisté vaillamment mais plusieurs cités bretonnes avaient été prises. En 1488, à Saint-Aubin-du-Cormier, l'armée bretonne et ses alliés étrangers sont écrasés par l'armée du roi et perdent 6.000 soldats. La tradition fit assister Anne de Bretagne à la bataille de Saint-Aubin, même si à ce moment précis, elle était loin du lieu où s'était décidée la destinée bretonne.
Selon cette légende, après la défaite de l'armée bretonne, elle aurait tenté de se sauver par le souterrain du château de Saint-Aubin long de vingt-cinq kilomètres, et pour cela, elle avait fait ferrer son cheval à l'envers. Ainsi ses poursuivants firent d'abord fausse route. Mais elle fut vendue par son valet, qui paya cher sa trahison, puisqu'on le tua quelque temps après.
Une variante de cette légende contredit la précédente et affirme que la duchesse ne devra son salut qu'à un stratagème : elle fit tuer, éventrer et vider son cheval, qui fut placé sur un haquet. Elle se cacha dans le corps de l'animal et passa ainsi au milieu de ses ennemis qui ne se doutèrent pas que la carcasse de la bête dérobait à leurs yeux la jolie duchesse !
Après la mort du duc, Anne s'opposa à son tuteur qui voulait lui faire épouser Alain d'Albret, et elle épousa par procuration Maximilien d'Autriche, futur empereur d'Allemagne, en 1490, à Rennes, où elle s'était réfugiée et avait été couronnée duchesse. Le prétendant éconduit proposa au roi de lui livrer Nantes et son château et la Bretagne fut envahie en 1491.