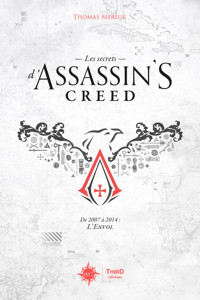
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Third Editions
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Französisch
Ce premier tome vous propose d’explorer la genèse de la série Assassin’s Creed de 2007 à 2014 à travers les témoignages de ses très nombreux développeurs. Assassin’s Creed est une saga culte qui a réinventé une certaine vision du jeu vidéo. Cet ouvrage retrace l’éclosion du concept novateur du volet original, un jeu qui a posé les bases de la franchise. Le livre présente ensuite les nombreuses évolutions incarnées par la trilogie Ezio, des changements qui ont guidé la série jusqu’à la petite révolution portée par Assassin’s Creed III, dont les chapitres Black Flag et Rogue brandiront haut les couleurs dans deux épisodes tournés vers l’exploration maritime.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 430
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
À Céline,
De 2007 à 2014 :L'ENVOL
PRÉFACE
JE ME SOUVIENS d’une soirée fatidique sur la rue Chambord, à Montréal. Une soirée où tout m’est venu et où ma vie a changé. Et par conséquent les vôtres.
Je me souviens d’avoir eu 30 ans et de me poser cette question fondamentale : Vais-je créer des jeux vidéo toute ma vie ? Je me souviens de cette chanson de Cohen dans laquelle il chante « change the system within it… » Je me souviens de ces heures passées à comprendre qui était Altaïr, son passé, son présent, son avenir… De ma lecture d’un J’ai Lu sur les sociétés secrètes et du chapitre sur le Vieux de la Montagne.
Je me souviens que mes filles, Alice et Pénélope, sont nées à la suite des sorties de AC1 et AC2, des enfants du credo en quelque sorte. Je me souviens d’avoir fait de ce credo une vraie philosophie de vie : « Rien n’est vrai, tout est permis. »
Je me souviens de cette réunion où j’ai dû expliquer que ma suite de Prince of Persia : Les Sables du Temps, dans laquelle je devais redéfinir le genre action-aventure pour la prochaine génération de consoles (tel était mon mandat, rien de moins), allait se passer en Iran, dans un cadre historique… alimenté par une machine futuriste qui permet de revivre les mémoires de nos ancêtres enfouies dans notre ADN…
Je me souviens d’une équipe formidable, dévouée et professionnelle, dont je considère la plupart des membres comme des amis. Quelle chance j’ai, quand même…
***
Je me souviens de tout ça et je ne me rappelle rien. Voilà tout le paradoxe du rôle de visionnaire, être constamment tourné vers l’avenir. Un futur potentiel, nouveau et magique où la nostalgie n’a pas trop la cote. À tout le moins pour moi. Toujours la tête et le cœur pris par le prochain projet, le nouvel univers ludique, le nouveau personnage de fiction ainsi que ses habilités jamais vues auparavant.
J’applaudis ainsi cet ouvrage pour le travail de mémoire qu’il représente. La mémoire d’une aventure épique, d’une création originale et sans précédent pour votre humble serviteur, ainsi que pour toutes celles et tous ceux qui ont eu la chance de la fabriquer.
Bonne lecture, et n’oubliez jamais que rien n’est vrai et que tout est permis.
Patrice.
Papa des Assassins…
De 2007 à 2014 :L'ENVOL
AVANT-PROPOS
NOTRE MÉMOIRE est un curieux mécanisme. Elle va et vient, reconstruit, interprète, modifie, tord, inverse, confond. Souvent, plus tristement, elle s’effiloche peu à peu sans qu’on y prenne garde et s’estompe irrémédiablement jusqu’à l’oubli. Mais il est des souvenirs qui savent rester intacts malgré les remous du temps, non pas dans notre ADN, mais bien dans un coin de notre tête, prêts à venir nous submerger de sensations passées aux saveurs parfois douces-amères de nostalgie. J’écris sur les jeux vidéo depuis la fin des années 1990 et ai même le privilège de pouvoir le faire dans un cadre professionnel depuis 2004. Des souvenirs liés à notre médium, notre passion, notre culture, je n’en manque pas. L’un d’eux est particulièrement cher à mes yeux et depuis des années il me poursuit, réveillé à la même période, peu après l’arrivée de l’automne…
Je me revois sortant de la station Campo-Formio de la ligne 5. Ç’aurait été bien plus court d’arriver directement par la station Chevaleret, mais venant de Bastille, le jeu des correspondances aurait considérablement rallongé mon trajet. Nous sommes en octobre, mais la température est encore douce pour Paris ; l’idée de marcher un kilomètre pour rejoindre le lieu de rendez-vous n’a rien de déplaisant. Les vibrations mélancoliques de Kid A s’écoulent de mes écouteurs tandis que je file dans une rue grisâtre longeant une partie des bâtiments de la Pitié-Salpêtrière et menant en pente douce vers un large boulevard survolé par les arches métalliques du métro aérien à l’ombre des immenses barres d’immeubles si typiques du 13e arrondissement. La rue du Chevaleret s’annonce enfin. Encore quelques dizaines de mètres et me voilà devant un bloc de neuf étages à l’architecture austère et dépourvue du moindre signe distinctif. Difficile d’imaginer que je suis face à une partie des locaux du principal éditeur de jeux vidéo français.
Je retrouve quelques confrères dans le sombre hall cerné d’ascenseurs, et l’attaché de presse nous guide deux étages plus haut où l’on circule dans un étroit couloir bardé d’affiches et goodies à l’effigie de Sam Fisher et Prince of Persia. Nous arrivons finalement dans une petite pièce sans fenêtre où soufflent une dizaine de PC raccordés à autant d’écrans plats. Au fond de la salle, un jeune barbu à casquette, chemise à carreaux ouverte laissant apparaître un tee-shirt blanc marqué d’un large « A » stylisé. Il nous accueille avec un grand sourire cachant difficilement une pointe de stress. Le RP1 brise le silence gênant avec un enthousiasme communicatif : « Je vous présente Patrice Désilets. » Celui-ci s’avance de quelques pas et enchaîne alors avec un « Bonjour, tout le monde » qui dévoile immédiatement un fort accent québécois. Nous prenons tous place derrière nos écrans et la présentation commence.
C’était mon tout premier contact avec Assassin’s Creed : deux heures de jeu sur la version bêta de l’épisode originel à quelques semaines de sa sortie officielle. Je dois avouer que mes débuts sous la capuche ne furent pas très glorieux. J’avais encore trop ce vieux réflexe de joueur de cliquer sans cesse sur le bouton A pour sauter alors qu’une simple pression de la gâchette suffisait pour se lancer dans les plus folles cascades ; de même lors des combats, de vouloir donner des coups d’épée à tout-va sans comprendre que patience et timing étaient les maîtres-mots. Ce démarrage chaotique aurait pu me rebuter, mais ce fut tout l’inverse qui se produisit. Le jeu exerça déjà sur moi une étonnante fascination attisée par cette sensation de découvrir une œuvre singulière, un titre vraiment différent, novateur et spectaculaire. Je ne jouerai pas aux faux prophètes en lançant confortablement a posteriori que l’on pressentait déjà le phénomène qu’allaient devenir le jeu et sa future saga. Mais je crois que son potentiel et celui de ses hypothétiques suites étaient déjà largement palpable et terriblement exaltant.
Depuis ce premier contact avec Assassin’s Creed en octobre 2007, j’ai beaucoup écrit sur la série, vraiment beaucoup. Quand on est journaliste pigiste, on a vite tendance à essayer de se montrer indispensable, et cela passe souvent par une certaine spécialisation ; devenir l’« expert » de tel genre, de telle série ou de tel jeu, c’est s’assurer de devenir quasi incontournable aux yeux de votre rédacteur en chef. C’est exactement ce qui s’est passé avec Assassin’s Creed – et, le moins que l’on puisse dire, c’est que je suis sacrément bien tombé. Après la preview publiée après mes premières heures de jeu, le test m’est revenu tout naturellement et dès lors mon destin fut scellé : je fus automatiquement désigné pour m’occuper de toutes les suites et spin-offs qui suivirent au fil des années. Oui, j’en ai signé des articles sur cette série, mais très souvent à travers le regard biaisé de testeur de jeu vidéo, ce drôle de métier où l’on met des notes sur dix ou vingt, comme à l’école ; où l’on reçoit un jeu quelques jours (semaines, quand on a de la chance) avant sa sortie pour le finir aussi vite que possible avant de livrer un avis argumenté et que l’on espère sinon objectif, au moins honnête. Pour cela, on se base sur des critères fluctuants, un ressenti qui dépend largement de notre affinité avec le genre de jeu testé et que l’on essaie parfois de tempérer par des discussions, des recherches, des comparaisons et mises en perspective, et une certaine capacité d’abstraction.
Pour ma part, il y a un autre élément qui entre parfois en ligne de compte : oublier l’humain et le contexte de développement. Écrire une critique, c’est tantôt être enthousiaste et élogieux, tantôt acerbe et intransigeant. Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, aucun de ces cas de figure n’est aisé. D’un côté, quelle que soit la taille d’un coup de cœur, on peut être rattrapé par ses propres doutes, craindre de s’enflammer aveuglément et de pousser ses lecteurs vers une potentielle déception. De l’autre, le risque est simplement de passer à côté d’une expérience que l’on n’aurait pas comprise, d’un coup de génie exceptionnel, ou plus simplement d’être non seulement injuste, mais surtout blessant à l’égard de celles et ceux qui ont dédié parfois plusieurs années de leur vie à travailler dessus.
Or, trop se focaliser sur ces facteurs, c’est à mon sens oublier qu’un jeu vidéo est un produit artistique et culturel souvent très coûteux. Il y a donc un impératif d’exigence très prosaïque vis-à-vis des joueurs en tant que consommateurs prêts à investir dans leur passion. J’aime aussi à croire que cette exigence sert notre médium dans son ensemble, en donnant des pistes de réflexion à celles et ceux qui le façonnent et en montrant aux éditeurs qu’un jeu ne se résume pas à un chiffre de ventes ou au nombre de likes sur un trailer, que donner du temps et des moyens aux studios pour qu’ils puissent s’exprimer et dévoiler tout leur potentiel a un réel impact en fin de compte.
Quand je teste un jeu, ma focale est donc braquée sur lui et rien d’autre. Quel qu’il soit, il est indispensable d’avoir conscience que c’est toujours le fruit de dizaines, de centaines de personnes qui méritent un respect total. Comme vous le verrez dans ces pages, certains développeurs sont encore personnellement affectés par la virulence de critiques reçues à l’époque. Néanmoins, au moment de dénoncer un level design raté ou une direction artistique insipide, il faut réussir à mettre de côté quelques instants ce facteur humain pour livrer une critique aussi objective et juste que possible. Ce ne serait rendre service à personne que de se laisser submerger par cela. C’est tout du moins quelque chose qui n’a, à mon sens, pas sa place dans le strict cadre de cet exercice si singulier qu’est le test de jeu vidéo.
Voilà pourquoi l’idée d’écrire sur Assassin’s Creed depuis un autre point de vue m’a rapidement captivé. Une partie de moi était déjà ravie de se replonger dans chaque jeu de la série, un à un, de bout en bout, dans l’ordre chronologique de leurs sorties. J’avais terriblement hâte de les confronter à mes souvenirs et aussi de les observer à la lumière de ce que la série est devenue aujourd’hui. Mais l’une des raisons qui m’a le plus motivé, c’est l’opportunité de regarder cette fois de l’autre côté du miroir, de ne plus me contenter de décortiquer un jeu vidéo ; de m’intéresser à celles et ceux qui le font, à la manière dont les idées naissent, dont elles circulent, se transforment, se transmettent ou disparaissent. Pour cela, j’ai lu et regardé un nombre incalculable d’interviews dans le but de glaner toutes les informations susceptibles de nourrir cette curiosité qui, par un effet boule de neige, grossissait à la faveur de mes découvertes. J’ai surtout eu le privilège de rencontrer celles et ceux qui ont fait Assassin’s Creed. Directeur créatif ou artistique, producteur… J’ai pu échanger directement avec toutes ces figures pour en apprendre plus sur les coulisses de la création de chaque jeu et mieux comprendre les choix faits, les orientations prises. Cela m’a aussi aidé à démêler le vrai du faux. Si le credo des Assassins nous apprend que « rien n’est vrai, tout est permis », quand cela touche à Ubisoft, on comprend vite que « tout est vrai, rien n’est permis ». Les versions officielles et les éléments de langage marketing ont la vie dure et il a souvent été compliqué d’aller au-delà pour assembler les pièces de puzzles complexes. J’ai eu la chance de rencontrer des gens passionnants et passionnés, mais approcher des personnes encore en poste chez Ubisoft était presque impossible tant la communication de l’éditeur est verrouillée et ses employés enserrés dans des contraintes insurmontables. Même pour celles et ceux qui n’y travaillent plus aujourd’hui, ce n’était pas toujours simple d’accepter de se livrer. Malgré de très nombreuses tentatives, je n’ai ainsi jamais réussi à discuter avec d’anciens développeurs du studio de Québec. Ébranlé par de multiples scandales, notamment durant l’année 2020, Ubisoft a, semble-t-il, réussi à dissuader ses employés d’être trop volubiles. Loin de me refroidir, ces complications ont, au contraire, donné à mon travail les atours d’une véritable enquête pour tenter de découvrir ce qui pouvait bien se cacher derrière ces silences ou ces mots trop lisses et convenus. J’ai ainsi pu mettre au jour quelques secrets et reconstituer aussi fidèlement que je le pouvais la trame de la construction de cette vaste saga à partir d’éléments factuels, de déductions et de souvenirs parcellaires et lointains, parfois encore restreints par la volonté de ne pas trop écorcher la version officielle, parfois magnifiés pour tenter de se mettre en avant.
J’ai donc essayé de citer souvent les acteurs de cette grande aventure, car il m’apparaissait indispensable de mettre en avant leurs regards et leurs propres mots. Cela mérite d’ailleurs un petit point de méthodologie. Les sources de toutes les citations du livre sont indiquées en note de bas de page. Quand il n’y en a pas, c’est tout simplement que ce sont des extraits de mes propres discussions avec les différents intervenants2. Inclure ainsi tous ces développeurs participait aussi de mon envie de leur rendre hommage et de rappeler qu’un jeu vidéo est un travail collectif, le fruit de mois et d’années de travail souvent acharné qui mérite autant de respect que de gratitude. Face à une série à succès comme Assassin’s Creed, on a tôt fait de ne l’observer que d’un point de vue business et de juger sèchement les choix d’un éditeur et dès lors, par métonymie, de dévaloriser la quantité et la qualité du travail de toutes les équipes derrière. J’avais vraiment à cœur de rappeler qu’il y avait de l’humain derrière ces colosses AAA. Évidemment, vous verrez souvent revenir les mêmes noms au fil des pages et des chapitres. Mais, comme toutes les personnes que j’ai interviewées l’ont dit d’une manière ou d’une autre, il ne faut pas que cela occulte le travail des centaines d’anonymes qui s’attellent chaque jour à créer ces œuvres. Un jeu vidéo ne se saurait se résumer à un seul nom, un seul poste, un Patrice Désilets ou un Jean Guesdon. Ce dernier le dit lui-même : « Un directeur créatif ne fait pas un jeu tout seul. Du tout ! Le mec qui se pète les bretelles3 en disant que tout est grâce à lui… “Excuse-moi, grand ! Mais tout seul dans ton garage, t’as beau avoir de grandes idées, tu ne feras rien ! ” Si tu n’as pas une équipe derrière, c’est chaud. » Difficile de faire plus clair !
Après des mois de travail, j’ai le plaisir de vous inviter à un long voyage. Ensemble, nous allons redécouvrir la saga Assassin’s Creed. Le parcours promettait déjà d’être long donc j’ai souhaité me focaliser sur les épisodes principaux, ceux sortis sur consoles de salon à l’automne de presque chaque année depuis 2007. Sans utiliser d’Animus4, nous allons remonter dans le temps pour revenir chronologiquement jusqu’à nos jours en passant par chaque jeu dans leur ordre de parution. J’ai procédé ainsi5 pour que l’histoire de leur développement soit plus facile à appréhender, mais surtout pour mieux comprendre la manière dont les épisodes ont pu se nourrir les uns des autres ou parfois se contredire au gré des aspirations de chaque équipe. Assassin’s Creed, le porte-étendard multimillionnaire d’Ubisoft, est très souvent la cible de critiques, certaines fondées, d’autres plutôt issues de vilains préjugés. Ces derniers ont souvent été inspirés par ce rythme de sortie annuel dans lequel s’est rapidement enfermée la série, et le plus tenace d’entre eux pourrait sans doute se résumer par un ironique et désabusé « encore un Assassin’s Creed » ! Pourtant, avec du recul, elle en a fait du chemin, cette série ! Dans son gameplay, son game design, sa narration, elle a su évoluer au fil des années jusqu’à devenir presque méconnaissable, se transcender ou parfois se perdre et oublier ses racines. C’est tout cela que j’ai voulu décrire et, pour ce faire, j’ai cherché à retranscrire les événements tels qu’ils étaient alors, sans invoquer le futur, sans me risquer à des comparaisons entre un jeu et ses suites sorties plusieurs années après. Un peu à l’image d’un jeune barman qui revivrait les souvenirs d’un de ses ancêtres grâce à une machine de haute technologie, j’ai cherché dans chaque chapitre à rester dans la temporalité des développements. C’est aussi une manière de mettre encore plus l’emphase sur le caractère itératif de la création d’un jeu vidéo et de mieux saisir comment une telle série s’est bâtie. Ce choix a une petite conséquence : certains grands thèmes ne seront abordés que lorsque nous aurons accumulé assez de matière au fil de notre parcours. La musique, certains procédés narratifs, des éléments du lore (dont la célèbre métahistoire, si iconique pour la série)… Nous entrerons dans les détails de tous ces aspects quand le moment sera venu.
Cela me mène d’ailleurs à une ultime précision. Comme Frodon franchissant pour la première fois les frontières de la Comté, Luke montant à bord du Faucon Millenium à Mos Eisley, ou Kassandra embarquant pour Megaris, un très long périple nous attend. Celui-ci aura donc lieu en deux étapes correspondant aux générations de consoles qui ont accueilli la saga. Pour ce premier tome, je vous propose de découvrir la genèse de la série, comment son concept s’est cristallisé avant de prendre réellement corps dans ses suites et de quelles manières celui-ci a évolué au gré des épisodes pour laisser entrevoir l’évolution radicale qu’il connaîtra plus tard. Depuis la belle esquisse qu’est l’épisode originel, nous parcourrons la Trilogie Ezio avant d’explorer la petite révolution amorcée par Assassin’s Creed III, et finalement réinterprétée et magnifiée dans Black Flag et sa pâle copie Rogue. Il sera question d’aigle, de foule, de la hauteur des bâtiments de Venise, d’angles d’inclinaison des surfaces, de boucles de gameplay ; mais aussi de chevauchées de serpent géant, de duels à l’épée dans des parkings, de lasagnes, de vaisseau spatial, de rampe d’escalier et de Kanien’kéha.
Maintenant, nous sommes prêts. Le voyage peut commencer. Il y a juste une toute dernière chose à garder à l’esprit quand on parle d’Assassin’s Creed : rien n’est vrai, tout est permis !
L’AUTEUR : THOMAS MÉREUR
Thomas Méreur écrit ses premiers articles sur le jeu vidéo en amateur vers la fin des années 1990 (la légende raconte que son premier test fut pour un fanzine vendu 10 francs dans la cour de son collège en 1994). C’est en 2004 que les choses sérieuses commencent quand il intègre la rédaction de Gamekult en tant que pigiste. Il y restera plus de dix-huit ans, le temps d’écrire quelque sept cents tests en véritable touche-à-tout, capable de passer d’un jeu mobile confidentiel à un gros AAA spectaculaire. Au fil du temps, il aura du mal à cacher sa passion pour les open worlds et sa tendance à écrire des articles interminables. Qu’il écrive un livre sur Assassin’s Creed était presque une évidence.
1. Pour « Relations Presse » ou « Relations Publiques » qui sert communément à désigner les attachés de presse.
2. Tel un tutoriel de jeu vidéo, vous trouverez immédiatement une illustration de cela à la fin de ce paragraphe.
3. Jean Guesdon, québécois de cœur, est friand de ce genre d’expression typique de là-bas. « Se péter les bretelles » signifie « faire le fier ».
4. Les effets secondaires de la machine ne sont pas toujours agréables. Il n’y a qu’à voir ce pauvre Sujet 16…
5. Plutôt que d’opter pour une vision transversale ou purement thématique, par exemple.
De 2007 à 2014 :L'ENVOL
CHAPITRE 1 : ASSASSIN’S CREED,DANS L’OMBRE DU PRINCE
Redéfinir un genre
Dans le quartier du Plateau-Mont-Royal à Montréal, au croisement du boulevard Saint-Joseph Est et de la rue Chambord, un petit immeuble de deux étages, typique de l’architecture québécoise, et protégé par une rangée d’arbres blanchis par la neige. Nous sommes en janvier 2004, et Patrice Désilets rentre tout juste de ses congés de Noël pour retrouver son petit appartement au premier étage. Les vacances étaient largement méritées, cette année. Quelques semaines plus tôt venait de sortir Prince of Persia : Les Sables du Temps sur lequel il était directeur créatif. Entre la stressante dernière ligne droite du développement, passée notamment à éliminer les derniers bugs (et à l’époque, pas question d’imaginer un patch qui viendrait régler cela ultérieurement !), la brutale sensation de vide une fois la version finale envoyée à la duplication, l’exultation après sa sortie et l’accueil dithyrambique de la presse et du public avec des ventes déjà très prometteuses… Oui, après tout cela, un peu de repos n’était vraiment pas de refus. Mais Désilets est un créatif, toujours bouillonnant et à la recherche de projets pour stimuler son esprit. Il a déjà dans la tête de nouvelles idées : « J’adorerais faire un jeu qui se déroule en temps réel sur vingt-quatre heures ou un jeu d’horreur où on ne combattrait qu’un seul ennemi pendant toute l’aventure1. » Pourtant, c’est un tout autre destin qui attend le directeur créatif.
Dès le lundi matin, le voici de retour chez Ubisoft Montréal, dans l’imposant bâtiment de briques rouges bordé par le boulevard Saint-Laurent, cette ancienne manufacture de chaussures devenue l’un des studios de jeux vidéo les plus en vue du moment. Il faut dire qu’en quelques années seulement, ses équipes ont enchaîné les succès : l’excellent jeu d’infiltration Tom Clancy’s Splinter Cell en 2002 puis, l’année suivante, l’audacieuse adaptation de la bande dessinée XIII et Tom Clancy’s Rainbow Six 3 : Raven Shield. Et les chiffres de vente de Prince of Persia : Les Sables du Temps sont déjà très bons, allant même en s’améliorant, sans doute grâce au bouche-à-oreille bien aidé par les vacances de Noël qui viennent de passer. Il y aura une suite, c’est acté. Mais Ubisoft va confier un mandat un peu différent à Patrice Désilets. Non pas de travailler sur la suite directe, plutôt de se projeter dans l’avenir et de créer un Prince of Persia sur la nouvelle génération de consoles tout en « redéfinissant le genre action-aventure », rien de moins.
Faire un Prince of Persia next gen ? Cela soulève tellement de questions, d’autant plus que, pour l’heure, on ne sait encore rien des hypothétiques nouvelles Xbox et PlayStation. Le plus gros problème pour Désilets, c’est l’idée de base : faire un nouveau Prince of Persia. Voilà plusieurs années qu’il est plongé dans cet univers des Mille et une Nuits, coincé avec un héros qu’il finit par trouver un peu insipide. Après tout, ce n’est qu’un prince dont l’ambition ultime est d’attendre la mort de papa et maman pour récupérer le trône ; on a vu plus glorieux comme parcours de vie. En outre, une suite directe aux Sables du Temps est d’ores et déjà prévue… C’est un véritable casse-tête. Une chose est sûre, en revanche : le cœur de l’équipe qui a conçu le dernier Prince of Persia veut continuer à travailler ensemble. David Châteauneuf au level design, Alex Drouin aux animations, Nicolas Cantin pour la direction artistique, Richard Dumas en charge du gameplay, Mathieu Mazerolle responsable de la programmation… Tous veulent rempiler pour une nouvelle aventure.
Les toutes premières réflexions les mènent naturellement vers l’idée d’un jeu d’action-aventure linéaire, mais spectaculaire, avec plusieurs embranchements possibles ; un Prince of Persia plus épique et ouvert, en somme. Sans contrainte technique de par sa nature next gen encore inconnue, l’équipe laisse ses envies et son imagination s’exprimer pleinement, quitte à plonger dans la démesure. « Dans notre première version, on avait prévu soixante-douze missions2 », se souvient Philippe Bergeron, alors level designer sur le projet. Et de compléter : « C’était de la folie. » L’une d’elles aurait mené le joueur dans une citadelle perdue en plein désert où une immense tour de lumière dynamique s’enfonçait dans le sol, transformant l’ascension du joueur en plongée souterraine vertigineuse avant de remonter soudainement vers le ciel. Une autre mettait en scène un serpent géant qu’il aurait fallu chevaucher pour parcourir les égouts d’une ville dans une course folle. « Corey May et les scénaristes ont vraiment pété un câble en écrivant tous ces trucs3 », conclut ironiquement Bergeron. Rapidement, cette vision débridée de Prince of Persia atteint toutefois ses limites. Elles sont principalement techniques : il semble évident que le futur moteur sera incapable de concrétiser le tiers de ce que l’équipe est en train d’esquisser. Un petit retour à la réalité s’impose, et il va conduire à une avancée vers le réalisme.
Car ces limitations techniques, devenues de facto créatives, rejoignent une aspiration de Patrice Désilets : il veut trouver un moyen de se débarrasser du prince, d’une manière ou d’une autre. Il fait une petite liste des choses qu’il voulait accomplir sur Les Sables du Temps, mais qui n’ont pas pu être concrétisées alors. Il s’appuie également sur une étude marketing de prospective dessinant les grandes tendances à venir dans le jeu vidéo. Il comprend que l’ère du fantastique est révolue et que, bientôt, c’est le réalisme qui primera. Si Prince of Persia doit tendre vers cela, il va donc falloir se tourner vers l’histoire. Cette orientation parle évidemment au passionné qu’il est. Déjà tout petit, alors qu’il a 3 ou 4 ans, il retrouvait sa mère au bord de la rivière Richelieu. Elle travaillait dans un ancien fort français, lieu ô combien stratégique à l’époque de la colonisation européenne et théâtre de plusieurs batailles entre les armées française et anglaise. Le petit Patrice est fasciné par ces ruines qui semblent raconter mille histoires. Ce sera pour lui le début d’une véritable fascination pour le passé qu’il définit lui-même comme un « monde fantastique ». Il précise sa vision : « C’est tellement différent. De là où nous sommes aujourd’hui, c’est presque comme si l’on était sur une autre planète. Le XXe siècle nous a changés, complètement. Et c’est là où je nous trouve fascinants : on s’imagine toujours comme la finalité d’un récit4. »
Pour nourrir cette aspiration historique, il se lance dans des recherches, il lit beaucoup et finit par tomber sur un de ses vieux bouquins achetés à l’époque où il étudiait le cinéma, le théâtre et la littérature à l’université de Montréal. Ce livre, c’est Les Sociétés secrètes d’Arkon Daraul qui traite, entre autres, des Castrateurs de Russie, des Thugs en Inde, des Maîtres de l’Himalaya ou encore des Illuminés de Bavière. Peut-être par un petit coup de pouce du destin, le premier récit sur lequel il tombe va particulièrement retenir son attention, car il prend place au Proche-Orient au XIe siècle, précisément le lieu et la période où se déroule Prince of Persia. Il y est question d’une mystérieuse secte islamique, fondée par Hassan ibn al-Sabbâh, surnommé « le Vieux de la Montagne », son fief étant une forteresse perdue dans une région montagneuse aux confins de l’Iran. On les appelle les nizârites, mais ils sont connus sous un autre nom : les haschischins (qui, pour certains, est à l’origine du mot « assassin »). Désilets imagine alors que le héros pourrait être le numéro deux de cette organisation, en quelque sorte, un autre prince de Perse : le prince… des assassins.
La perspective est bien plus qu’enthousiasmante ! Elle semble se cristalliser dans son esprit et déjà des dizaines d’idées lui viennent en tête pour donner vie à ce héros. L’équipe est rapidement conquise par le concept exposé par Désilets et se met au travail. Au bout de quelques mois, une vidéo est prête. C’est une ébauche de ce que pourrait être le jeu, destinée à convaincre l’équipe éditoriale d’Ubisoft que le projet est viable. Il s’agit d’une séquence de quelques minutes de faux gameplay dans laquelle le prince de Perse est encore présent, mais ce n’est plus qu’un enfant secouru par deux assassins, les vrais héros de ce premier jet. Ils bondissent avec vivacité, escaladent les murs… À la toute fin de la séquence, leur assassinat réussi, on les voit s’enfuir en bondissant au-dessus des remparts d’une cité médiévale avant de filer à dos de cheval. Déjà tant d’éléments du jeu final sont présents. L’équipe part même dans un premier temps sur l’idée d’un jeu en coopération où deux joueurs pourraient incarner chacun un assassin et s’entraider, comme le montre la vidéo. Mais l’idée sera finalement écartée, notamment en raison des importantes contraintes techniques posées par une telle idée. Leur jeu sera donc bel et bien une aventure solitaire.
Ce qui finit par mettre le projet vraiment sur les rails, c’est la lecture du livre Alamut de l’auteur slovène Vladimir Bartol. Désilets tombe dessus au printemps 2004 alors qu’il se documente abondamment pour avancer dans la préproduction du jeu, et ça devient une évidence. Ce roman de 1938 s’inspire du mythe du Vieux de la Montagne et plonge ses deux protagonistes au cœur de la secte ismaélienne basée dans la forteresse d’Alamut. L’un des héros, Avani ibn Tahir, y gravira les échelons, aveuglé par le culte autour de Hassan ibn al-Sabbâh qui l’envoie assassiner des leaders d’autres sectes islamiques. Il finira par se retourner contre son mentor quand une de ses cibles saura lui révéler la terrible manipulation dont il est victime. Lors d’une ultime confrontation, Hassan ibn al-Sabbâh dira à son disciple : « Rien n’est vrai, tout est permis », un emprunt à Nietzsche5 qui deviendra la devise de la confrérie des assassins et un véritable leitmotiv pour la future série Assassin’s Creed. Plus qu’une devise, l’équipe va puiser dans Alamut toutes les ficelles scénaristiques qui permettront de tisser l’histoire de leur futur jeu : un héros proche du grand maître d’un Ordre secret, des manipulations et trahisons… Petite entorse à la trame originelle, l’équipe va décider de changer légèrement de période pour planter son décor : ce ne sera pas la fin du XIe siècle comme dans le livre, mais plutôt la fin des années 1100 pour découvrir un cadre historique plus dramatique dans lequel les enjeux seront plus forts : la troisième croisade. Voilà qui pourrait emmener le futur héros du jeu en plein cœur de la Terre sainte pour y découvrir des villes dont la simple évocation du nom charrie tout un tas de fantasmes : Jérusalem, Acre et Damas.
Un véritable eurêka
Si l’équipe est convaincue de tenir son nouveau héros et la ligne directrice pour cette nouvelle aventure, le nom de code du jeu est toujours Prince of Persia : Next Gen dans les communications internes, avant de devenir Prince of Persia : Assassins. Il faut dire que la direction d’Ubisoft reste réticente quant à l’idée de laisser filer le prince de Perse et d’aller vers une nouvelle franchise alors que, déjà, le jeu doit passer le cap d’une génération de console. L’idée de simplement retrouver un Prince of Persia : Next Gen est bien plus rassurante et vendeuse, semble-t-il. Pourtant, dès les premières présentations du jeu en interne, notamment quand une petite délégation montréalaise se rend à Paris pour dévoiler leurs premiers travaux, il n’est question que d’assassins. Le nom Prince of Persia n’est même jamais cité par l’équipe qui, à la place, évoque déjà abondamment le livre Alamut comme référence pour dessiner le contexte du jeu. Les discussions et débats seront âpres pendant les premiers mois, mais l’équipe tient bon avec en première ligne Désilets, dont la volonté est de s’extirper du carcan narratif de Prince of Persia, trop prégnant avec son héros à la fois lisse et auquel il est difficile de s’identifier. Tout l’inverse de ce qu’il recherche : impliquer réellement le joueur, lui donner l’impression d’être dans la peau d’un véritable assassin tapi dans la foule, prêt à frapper à tout moment. Comme il l’explique : « Bien qu’il y ait une histoire, on ne va pas te traîner de force dedans, mais t’y emmener pour que tu puisses alors incarner le personnage tel que tu veux l’être6. »
D’une certaine manière, Patrice Désilets a déjà en tête l’idée de faire d’Assassin’s Creed un jeu de rôle : « On a tendance à oublier le sens du terme RPG. On se dit qu’un jeu de rôle, ce n’est qu’une question de chiffres et de statistiques alors qu’en fait, c’est l’idée d’incarner un personnage, jouer un rôle7. » Plus tard au cours du développement, cela va d’ailleurs être à l’origine d’un autre débat avec la direction d’Ubisoft, car Désilets veut pousser l’expérience jusqu’au bout et rêve d’un jeu sans HUD8, c’est-à-dire sans affichage d’informations à l’écran comme on a tant l’habitude de le voir dans un jeu vidéo (barre de vie, mini-carte, etc.). L’idée d’immerger totalement le joueur dans le monde d’Assassin’s Creed est toujours sa ligne directrice. C’est donc ainsi que le jeu est initialement pensé pour pousser celui qui s’y aventure à observer et à écouter autour de lui, à se fier à l’environnement qui recèle les informations dont il a besoin : s’asseoir sur un banc, écouter des conversations, regarder le comportement de certains PNJ… Mais la vision du directeur créatif paraît trop radicale et il doit faire cette concession et trouver un moyen d’intégrer un HUD au jeu. Il s’accroche pour cela à l’un de ses leitmotivs : « L’histoire doit toujours justifier le gameplay et inversement9. » Heureusement, grâce à la narration, il va réussir à parfaitement intégrer ces éléments visuels invasifs au jeu.
Dans un premier temps, l’équipe avait envisagé de raconter l’histoire du jeu à la manière de Prince of Persia : Les Sables du Temps. Ici, le prince raconte lui-même son histoire a posteriori, ce qui permettait notamment de supprimer les game over. Si l’on ratait un saut ou finissait empalé sur la lance d’un ennemi, le prince lançait un « Non, ça ne s’est pas passé comme ça » et l’action se rembobinait pour effacer notre échec comme si rien ne s’était passé ; et pour cause, ça ne pouvait pas s’être déroulé ainsi ! Cela s’inscrivait parfaitement dans la logique narrative du jeu et permettait d’éviter de frustrer le joueur et de fluidifier l’action. Pour Assassin’s Creed, Désilets part donc sur cette même idée et imagine un assassin âgé, sévèrement blessé et sur le point de mourir, qui reviendrait sur son passé et raconterait les souvenirs marquants de sa vie. Mais, en plus d’être trop dans la lignée de Prince of Persia, l’idée est un tantinet cliché. Yannis Mallat, alors producteur exécutif du jeu (il prendra la direction d’Ubisoft Montréal quelques mois plus tard), n’est vraiment pas convaincu et demande au directeur créatif de revoir sa copie.
Tout va se débloquer au hasard d’une simple soirée télé pendant laquelle Patrice Désilets zappe nonchalamment de chaîne en chaîne jusqu’à tomber sur TLC10 qui diffuse un reportage sur l’ADN et là, il n’y a pas d’autre terme, c’est une réelle épiphanie, un eurêka. Devant sa télévision, il imagine : « Et si, dans l’ADN, étaient emmagasinées, d’une certaine façon, des mémoires d’ancêtres ? Et s’il y avait une machine qui permettrait de revivre ces mémoires-là ? On pourrait avoir un personnage, aujourd’hui dans cette machine, qui revit ces souvenirs ! » L’Animus est né. La culbute est formidable, car elle crée une mise en abyme parfaite : le joueur va véritablement incarner le héros qu’il voit à l’écran en revivant ses souvenirs. Et cette petite idée sera l’étincelle qui mènera à énormément d’éléments du jeu.
Naissance d’un héros
Depuis le début, Désilets a en tête d’aller à contre-courant de ce qui se fait souvent dans un jeu vidéo : mettre en scène un quidam ou, tout du moins, un personnage pas trop fort, pas trop débrouillard, pas trop sûr de lui… un débutant en somme, à l’image du joueur (ah, le fameux trope du héros amnésique !) qui progressera au fil de son aventure pour gagner en puissance. Le directeur créatif, lui, veut tout de suite nous présenter un héros fort, classe, qui en impose, qui donne véritablement envie d’être incarné, tout simplement. Selon ses lectures, les assassins portaient des tenues blanches avec une ceinture rouge et masquaient leur visage sous une capuche. Désilets voit son héros comme un homme tapi dans l’ombre, évoluant sans être vu, observant au loin avant de passer à l’attaque d’un coup pour s’enfuir aussitôt. Quand on crée ainsi de toutes pièces un personnage de jeu vidéo, c’est souvent un travail itératif de longue haleine qui va d’évolution en évolution pour réussir à modeler un véritable héros, unique, mémorable et reconnaissable. On couche des idées, fait des croquis, cerne peu à peu ses traits de caractère, ses attitudes, mais aussi son look… Cela peut même passer par une espèce de portrait chinois pour définir par analogie ce à quoi il pourrait ressembler. Pour l’équipe créative, ça ne fait aucun doute : si leur héros était un animal, ce serait un oiseau de proie. La capuche va alors s’affiner pour former une pointe sur le front du personnage évoquant un bec, ses postures lorsqu’il surplombe la ville depuis les hauteurs évoquent celles d’un aigle, sa longue robe fendue dans le dos volette quand il saute pour former comme des ailes sur son ombre et son nom sera Altaïr, littéralement « oiseau de proie » en arabe11. Encore une coïncidence marquante, Alamut, qui fut une telle source d’inspiration pour le jeu, signifierait « nid d’aigle » en persan.
Il faudra près de trois années à l’équipe pour finir de façonner Altaïr tel qu’on le connaît aujourd’hui, ce maître Assassin sûr de lui et insolent, fonceur et incapable de respecter la moindre consigne. Mais il est aussi expérimenté et terriblement efficace – pour un jeu vidéo, c’est toujours un challenge de confier ce genre de héros aux mains du joueur – et difficile d’imaginer un Gran Turismo qui vous confierait une Ferrari dès la première course. C’est là que l’Animus joue un premier rôle intéressant. Pour pouvoir y recourir, encore faut-il trouver quelqu’un qui partage l’ADN d’Altaïr dans une époque où une telle machine pourrait exister. Assassin’s Creed va donc s’inscrire dans le présent, enfin… un futur proche à l’époque de la sortie du jeu, car il commence en septembre 2012 et mettra en scène Desmond Miles, un très lointain descendant de notre Assassin. Là encore, l’idée de l’Animus est remarquable puisque cette machine à voyager dans l’arbre généalogique de Desmond permettra, avec un peu d’habileté scénaristique, d’accéder à différentes époques et autant de nouveaux cadres pour de futurs jeux ! C’est probablement ce qui convainc le plus lorsque Désilets pitche son idée à l’équipe. Comme il me l’a dit : « [Avec l’Animus], là, on tient quelque chose. Là, on a une propriété intellectuelle. » En outre, avec Desmond, l’équipe a sous la main un personnage parfait pour projeter les joueurs dans son aventure. C’est lui qui sera le néophyte en découvrant son ancêtre en même temps que nous. Cela va donner lieu à la création d’une mécanique de gameplay intéressante : la synchronisation.
Desmond va, en effet, revivre les souvenirs de son ancêtre, souvenirs que nous allons en tant que joueur créer par nos actions dans le jeu. Pour Désilets, c’est toujours une sacrée gageure de proposer un tel mécanisme narratif : donner l’impression au joueur qu’il est libre de dérouler un récit et vivre une histoire qui lui est propre alors que celle-ci, non seulement est déjà écrite, mais en plus a déjà un dénouement clairement établi et connu. Pour que l’Animus fonctionne bien, Desmond doit donc être « synchronisé » avec Altaïr. En d’autres termes, le joueur doit faire de son mieux pour agir tel que l’aurait fait notre Assassin du XIIe siècle pour éviter la désynchronisation, c’est-à-dire un simili game over à la Prince of Persia. Puisque l’on explore le passé, Altaïr n’a pas pu mourir d’un coup d’épée de garde, faire une malencontreuse chute depuis un clocher ou encore louper quelque action importante pour le bon déroulement de l’histoire. En somme, si je joue mal (prends des coups, me blesse en ratant des sauts…), je ne suis pas assez comme Altaïr, l’assassin fier et puissant et, ultimement, je finis par être désynchronisé de ma partie. Cette idée de synchronisation va donc logiquement prendre sa place sur notre écran sous la forme d’une barre tout à fait similaire à ce que serait une jauge de vie dans un jeu classique. Voilà comment notre interface à l’écran finit par prendre tout son sens. Nous sommes Desmond en 2012, coincé dans une machine ultra-perfectionnée qui recrée les souvenirs d’un lointain passé. Pour être certain que Desmond développe comme il faut l’histoire d’Altaïr, l’Animus lui fournit logiquement toutes les informations dont il a besoin pour réussir. Par ce biais, sur le principe de la réalité augmentée rendue possible grâce à cette technologie avant-gardiste, le jeu peut ainsi afficher une barre de vie, un radar affichant des informations importantes (puisque Altaïr a forcément une bien meilleure conscience des environnements qui l’entourent) ou encore un rappel des différentes touches.
Désilets a finalement trouvé une solution élégante et maligne à ce casse-tête du HUD, mais il tient bon sur son idée originelle et glisse dans les options d’affichage la possibilité de désactiver toutes ces aides visuelles pour permettre aux joueurs qui le veulent de vivre l’expérience au plus près et de s’immerger dans le monde d’Assassin’s Creed en se fiant uniquement aux informations délivrées par l’observation des environnements et des indices sonores. Pourtant, paradoxalement, cela n’empêchera pas le jeu d’être critiqué, voire raillé pour son interface invasive, pas assez réaliste ; une réputation portée comme un véritable fardeau par la série depuis, aussi indélébile qu’une giclée de sang sur une tunique blanche.
Mais l’Animus et son concept de synchronisation pourront jouer un autre rôle dans le game design, celui de garde-fou pour limiter naturellement les actions du joueur dans le cadre voulu. Il n’est, par exemple, pas possible de tuer des innocents. Oui, on est un Assassin, mais ça n’empêche pas d’avoir des principes : Dexter Morgan a son code, Altaïr doit, lui, vivre selon le credo de son Ordre. L’un des trois commandements principaux est limpide : « Ton épée ne versera pas le sang d’un innocent. » Si l’on se lance dans une folie meurtrière comme dans un vieux Grand Theft Auto, le jeu nous ramène tout de suite à la raison avec un message d’avertissement et même des artefacts visuels pour signaler à quel point on trahit les actions d’Altaïr. L’idée est de guider subtilement le joueur vers un certain idéal pour incarner au mieux le héros du jeu en le sanctionnant, mais aussi en le récompensant lorsque la barre de synchronisation est complète. En effet, cela débloque l’utilisation de la vision d’aigle qui deviendra une véritable signature de la série. C’est une espèce de sixième sens que l’on peut utiliser à l’envi pour basculer temporairement en vue à la première personne et observer les alentours au travers d’une espèce de brouillard flou en noir et blanc, où seuls les ennemis, et plus particulièrement nos cibles ainsi que les éléments importants du gameplay, apparaîtront en surbrillance colorée. Un petit bonus bien pratique lors de certaines missions d’assassinat pour distinguer quelle silhouette dans la foule doit tomber d’un coup de lame secrète.
La logique de l’Animus permet également de délimiter certaines zones du jeu. Puisque l’on est dans les souvenirs du héros, on ne va pas toujours pouvoir errer à notre guise dans les villes pour la même raison toute bête que si l’un de mes descendants veut revivre mon samedi 17 mars 2018, il pourra effectivement se promener sur l’incroyable péninsule de Dyrhólaey en Islande où j’étais en vacances alors, mais, de facto, ne pourra pas visiter Reykjavik. Pas besoin d’explosion ou d’invoquer la menace d’un cyclone pour fermer des ponts comme dans GTA, l’Animus pourra placer des murs artificiels pour garder le joueur dans le cadre voulu, le cas échéant. Le fait d’explorer les souvenirs d’Altaïr est également utile pour pouvoir recourir à des ellipses narratives par moments. Seuls les souvenirs importants nous intéressent. Dès lors, sauter de séquence en séquence sans se soucier de comment Altaïr est arrivé là ou sans s’inquiéter sur l’endroit où il a bien pu passer la nuit devient presque naturel.
L’aventure est ainsi bien mieux rythmée en s’autorisant des « avances rapides » pour aller à l’essentiel tout en laissant, évidemment, tout le temps et la place pour le joueur d’explorer et avancer à sa guise dans ce cadre.
L’Animus a même un avantage insoupçonné et très pratique : il justifie l’emploi d’une seule et même langue pour les doublages du jeu. Ce n’est peut-être pas la première chose à laquelle on pense quand on découvre le jeu, pourtant l’ensemble des personnages s’y exprime en anglais, quelles que soient leur origine et langue natale (arabe, hébreux ou anglais). L’explication à cette, a priori, grosse entorse au réalisme sera livrée par un des personnages du jeu, la jeune scientifique Lucy Stillman qui supervise le projet Animus, et elle est finalement toute simple : en tant que gros ordinateur surpuissant, l’Animus traduit automatiquement les dialogues dans la langue voulue pour que les souvenirs puissent être facilement récupérés.
Discrètement, mais toujours avec une logique narrative solide, Assassin’s Creed réussit à garder les joueurs sur des rails en conservant une grande cohérence avec son propos et en lui montrant subtilement comment être un bon Assassin. L’une des grandes forces du jeu, c’est de ne pas sacrifier la sensation de liberté que l’on peut ressentir en se glissant sous la capuche immaculée d’Altaïr. Bien au contraire, toute une partie du gameplay va être entièrement dédiée à cela, révélant encore mieux la richesse d’une saga en devenir…
Un monde à créer
Tout en scellant le sort du prince afin de le détrôner pour créer un jeu autour d’un Assassin, l’équipe d’Ubisoft Montréal doit s’occuper de l’autre partie du problème posé initialement : faire un jeu next gen. Dès l’amorce du projet, l’idée de créer un open world s’est imposée. Pour Patrice Désilets, cette solution est même évidente : « Comment redéfinir le prince ? Déjà si on le met dans une ville ouverte plutôt que dans un palais, dans des pièces. Là, on est next gen. » Et le fait de ne pas savoir exactement ce que cette nouvelle génération sera exactement, quelles seront les réelles capacités des consoles, leur puissance, leurs limites, a permis à l’équipe de mettre totalement ces considérations de côté dans un premier temps. « On a pu pousser plein de concepts sans se soucier de l’aspect technologique et de la capacité à réaliser nos idées, ce qui est très libérateur d’un point de vue créatif », m’a-t-il expliqué.
Envisager de créer un jeu en monde ouvert en 2004 semble assez logique finalement. Bien que le genre soit encore très jeune, l’engouement qu’il suscite est fulgurant. La révolution initiée par GTA III n’a grondé qu’à peine plus de deux ans plus tôt (suivi de Vice City en 2002, puis San Andreas en 2004), mais la plupart des jeux en open world entrent alors sagement dans le sous-genre GTA-like : Mafia et The Getaway en 2002, True Crime : Streets of L.A. en 2003… Tous reprennent les codes de Rockstar et centrent généralement leur gameplay autour de l’utilisation de véhicules qui sont très souvent au cœur même de l’architecture de leurs missions. Il y a bien la série The Elder Scrolls de Bethesda Softworks, dont le dernier épisode était sorti en 2002 et qui permettait d’explorer à pied et à cheval l’immense open world de Morrowind. Mais le jeu était principalement jouable en vue subjective (la caméra à la troisième personne était assez catastrophique) et il avait surtout une orientation action-RPG assez rigide loin de ce qu’Ubisoft Montréal imagine alors, Patrice Désilets en tête.
Avec Les Sables du Temps, le studio avait déjà magnifiquement réinterprété le genre action-platformer en créant un héros d’une habileté impressionnante, capable d’exécuter les plus périlleuses acrobaties avec une désarmante facilité – la manière dont le prince peut courir sur les murs en est sans aucun doute le plus parfait exemple. Désilets imagine une orientation assez similaire, cette fois à l’échelle d’un open world avec une idée folle en tête : « Est-ce qu’on peut remplacer la voiture par le personnage principal. Dans GTA, je peux aller où je veux en voiture. Est-ce que ce serait possible d’aller n’importe où avec mon personnage12 ? » L’équipe va alors s’inspirer d’une discipline sportive urbaine rendue très populaire depuis la sortie du film Yamakasi (Zeitoun) en 2001 : le Parkour.
Car Désilets n’oublie pas la tonalité réaliste qu’il veut donner à son jeu. Luc Tremblay, programmeur gameplay, précise cette vision : « Il faut qu’on ait l’impression qu’un humain pourrait faire ça ; pas de saut périlleux comme le prince sur le dos des ennemis dans Les Sables du Temps. Un homme vraiment, vraiment athlétique, un homme avec tous les talents et une endurance infinie, voilà ce qu’on a essayé de faire. Ce n’est en aucun cas un super héros13. » Alex Drouin, responsable des animations, prolonge cette idée en expliquant que l’enjeu n’est pas tant d’être réaliste, que d’avoir l’air crédible : « Le problème, c’est que les humains sont trop lents. On essaie de faire quelque chose de réaliste, mais si notre personnage bouge trop comme un humain, c’est plat. Un joueur qui demande à son personnage de sauter s’attend à une réponse immédiate, pas à ce que son personnage doive d’abord prendre une impulsion. Dans la réalité, il y a toujours une intention qui précède un geste. Dans un jeu, nous n’avons pas ce luxe de savoir à l’avance ce que le joueur veut faire14. »
Voilà comment va naître ce qu’Ubisoft baptisera le free running, une espèce de Parkour version jeu vidéo. Dès le départ, un souvenir frustrant trotte dans la tête de Désilets, celui d’un niveau des Sables du Temps finalement écarté du jeu final : le village. C’était une zone en dehors du palais dans laquelle le prince bondissait de toit en toit, mais trop gourmande pour la PlayStation 2 alors. Quand le directeur créatif pense à son futur jeu, c’est ce genre de scène qu’il imagine. L’environnement sera donc urbain, d’immenses villes que le joueur doit pouvoir explorer sans contrainte. Courir, sauter, escalader les murs… Tout doit être possible et surtout intuitif, facile. Comme il le résume : « Ce qui est complètement novateur, c’est cette idée d’avoir un personnage qui, s’il se met à courir tout droit, ne pourra pas être freiné par l’architecture. » En somme, une liberté de mouvements quasi totale.
Pour cela, le décor doit être complètement interactif. Sur le papier, rien ne doit empêcher la progression d’Altaïr, si ce n’est les limites mêmes des villes entourées d’impressionnants remparts ou certains bâtiments de la ville pour les besoins de missions (et contrôler ainsi la route que pourra emprunter le joueur). Le projet est plus que compliqué ; Mathieu Mazerolle, lead programmer, n’hésite pas à parler de « véritable enfer » à concrétiser, à tel point que l’idée sera plusieurs fois sur la sellette à certains moments critiques du développement du jeu.
Comme souvent, Patrice Désilets arrive avec sa vision du jeu et ses idées, à charge ensuite aux personnes concernées de réussir à concrétiser les choses. En l’occurrence, le défi va être principalement relevé par deux hommes : Richard Dumas et Alex Drouin. Le premier est un technicien, un acharné du code en charge de la programmation ; le second s’occupe des animations d’Altaïr. Ils se connaissent depuis longtemps. Tous deux font partie de la première vague d’embauches lors de la création d’Ubisoft Montréal en 1997. Ils ont déjà travaillé ensemble sur Batman : Vengeance sorti en 2001 (Dumas y est content programmer, tandis que Drouin est alors directeur artistique en charge des animations in game), mais c’est sur Les Sables du Temps que leur duo se formera pour donner littéralement vie au prince de Perse. Drouin ira jusqu’à créer plus de sept cents animations différentes qui confèrent cette impressionnante fluidité au héros et Dumas a, lui, entièrement codé le prince. Ils sont devenus très proches et travaillent incroyablement bien ensemble, échangeant constamment et cherchant à repousser toujours plus loin les possibilités d’interactions d’Altaïr avec les décors du jeu.
Ils vont se lancer dans un travail titanesque et de longue haleine qui va commencer sur le Jade Engine, le moteur initialement créé par Ubisoft Montpellier pour Beyond Good & Evil15 et qu’ils connaissent très bien puisque c’est aussi celui de Prince of Persia : Les Sables du Temps. Ils travailleront ainsi près de deux ans, le temps que l’équipe d’une quarantaine de programmeurs et programmeuses, dirigée par Claude Langlais, livre une première version du Scimitar Engine. Avec la next gen

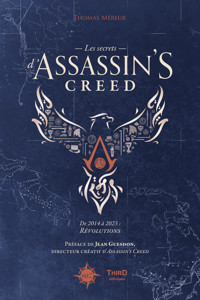













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)













