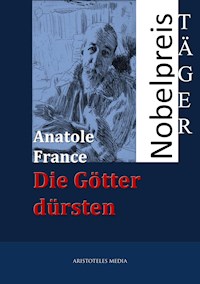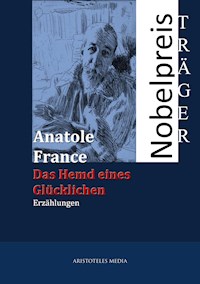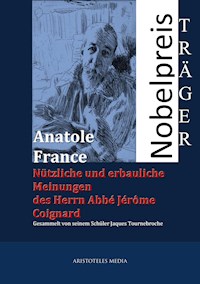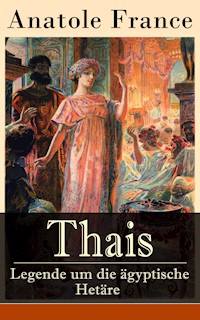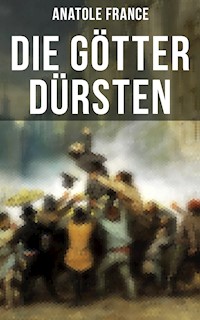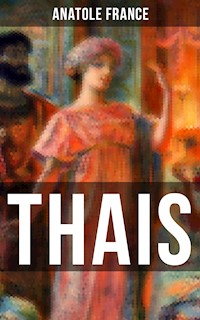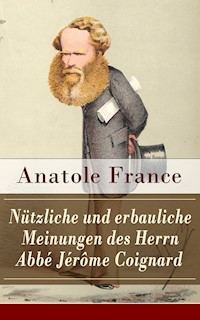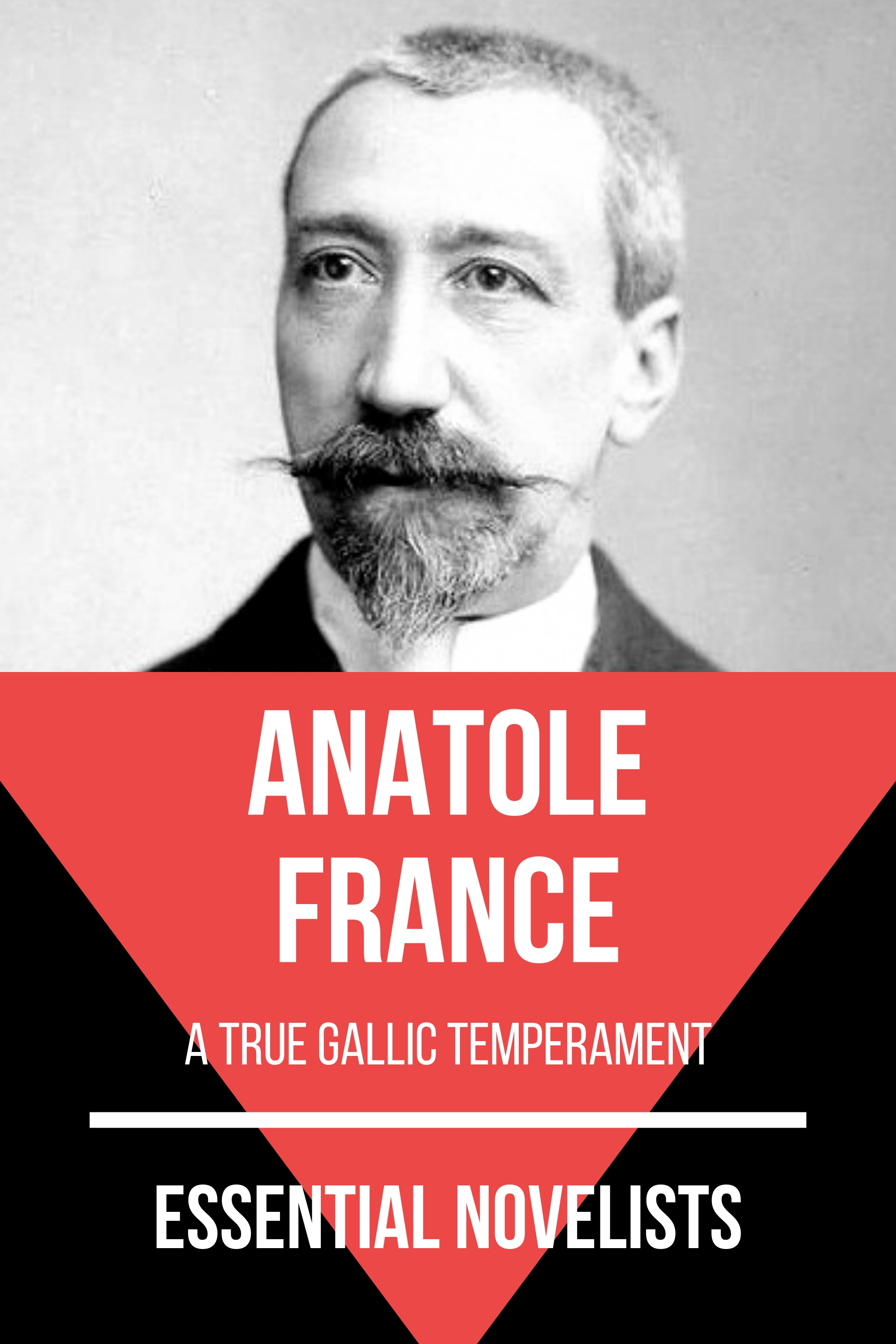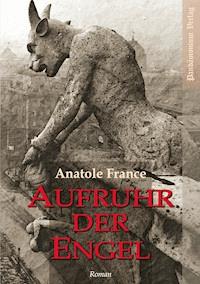0,88 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: WS
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Französisch
Les Sept Femmes de la Barbe-Bleue et autres contes merveilleux was written in the year 1886 by Anatole France. This book is one of the most popular novels of Anatole France, and has been translated into several other languages around the world.
This book is published by Booklassic which brings young readers closer to classic literature globally.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 182
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Les Sept Femmes de la Barbe-Bleue et autres contes merveilleux
Anatole France
LES SEPT FEMMES DE LA BARBE-BLEUE
D’APRÈS DES DOCUMENTS AUTHENTIQUES
I
On a émis sur le personnage fameux, vulgairement nommé la Barbe-Bleue, les opinions les plus diverses, les plus étranges et les plus fausses. Il n’en est peut-être pas de moins soutenable que celle qui fait de ce gentilhomme une personnification du soleil. C’est à quoi l’on s’est appliqué, il y a une quarantaine d’années dans une certaine école de mythologie comparée. On y enseignait que les sept femmes de la Barbe-Bleue étaient des aurores et ses deux beaux-frères les deux crépuscules du matin et du soir, identiques aux Dioscures qui délivrèrent Hélène ravie par Thésée. A ceux qui seraient tentés de le croire, il faut rappeler qu’un savant bibliothécaire d’Agen, Jean-Baptiste Pérès, démontra, en 1817, d’une façon très spécieuse, que Napoléon n’avait jamais existé et que l’histoire de ce prétendu grand capitaine n’était qu’un mythe solaire. En dépit des jeux d’esprit les plus ingénieux, on ne saurait douter que la Barbe-Bleue et Napoléon n’aient réellement existé.
Une hypothèse qui n’est pas mieux fondée consiste à identifier cette Barbe-Bleue avec le maréchal de Rais, qui fut étranglé par justice au-dessus des ponts de Nantes, le 26 octobre 1440. Sans rechercher avec M. Salomon Reinach si le maréchal commit tous les crimes pour lesquels il fut condamné ou si ses richesses, convoitées par un prince avide, ne contribuèrent point à sa perte, rien dans sa vie ne ressemble à ce qu’on trouve dans celle de la Barbe-Bleue ; c’en est assez pour ne pas les confondre et pour ne pas faire de l’un et de l’autre un seul personnage.
Charles Perrault qui, vers 1660, eut le mérite de composer la première biographie de ce seigneur justement remarquable pour avoir épousé sept femmes, en fit un scélérat accompli et le plus parfait modèle de cruauté qu’il y eût au monde. Mais il est permis de douter, sinon de sa bonne foi, du moins de la sûreté de ses informations. Il a pu être prévenu contre son personnage. Ce ne serait pas le premier exemple d’un historien ou d’un poète qui se plaît à assombrir ses peintures. Si nous avons de Titus un portrait qui semble flatté, il parait, au contraire, que Tacite a beaucoup noirci Tibère. Macbeth, que la légende et Shakespeare chargent de crimes, était en réalité un roi juste et sage. Il n’assassina point par trahison le vieux roi Duncan. Duncan, jeune encore, fut défait dans une grande bataille et trouvé mort le lendemain en un lieu nomme la Boutique de l’Armurier. Ce roi avait fait périr plusieurs parents de Gruchno, femme de Macbeth. Celui-ci rendit l’Écosse prospère ; il favorisa le commerce et fut regardé comme le défenseur des bourgeois, le vrai roi des villes. La noblesse des clans ne lui par donna ni d’avoir vaincu Duncan, ni de protéger les artisans : elle le détruisit et déshonora sa mémoire. Après sa mort le bon roi Macbeth ne fut plus connu que par les récits de ses ennemis. Le génie de Shakespeare imposa leurs mensonges à la conscience humaine. Depuis longtemps je soupçonnais que la Barbe-Bleue était victime d’une fatalité semblable. Toutes les circonstances de sa vie, telles que je les trouvais rapportées, étaient loin de contenter mon esprit et de satisfaire ce besoin de logique et de clarté qui me dévore incessamment. J’y découvrais, à la réflexion, des difficultés insurmontables. On voulait trop me faire croire a la cruauté de cet homme pour ne pas m’en faire douter.
Ces pressentiments ne me trompaient point. Mes intuitions, qui procédaient d’une certaine connaissance de la nature humaine, devaient bientôt se changer en une certitude fondée sur des preuves irréfutables. Je découvris chez un tailleur de pierres de Saint-Jean-des-Bois divers papiers concernant la Barbe-Bleue ; entre autres son livre de raison et une plainte anonyme contre ses meurtriers, a laquelle, pour des motifs que j’ignore, il ne fut jamais donné suite. Ces documents me confirmèrent dans l’idée qu’il fut bon et malheureux et que sa mémoire succomba sous d’indignes calomnies. Dès lors, je considérai comme un devoir d’écrire sa véritable histoire, sans me faire aucune illusion sur le succès d’une telle entreprise. Cette tentative de réhabilitation est destinée, je le sais, à tomber dans le silence et l’oubli. Que peut la vérité froide et nue contre les prestiges étincelants du mensonge ?
II
Vers 1650 résidait sur ses terres, entre Compiègne et Pierrefonds, un riche gentilhomme, nommé Bernard de Montragoux, dont les ancêtres avaient occupé les plus grandes charges du royaume ; mais il vivait éloigné de la Cour, dans cette tranquille obscurité, qui voilait alors tout ce qui ne recevait pas le regard du roi. Son château des Guillettes abondait en meubles précieux, en vaisselle d’or et d’argent, en tapisseries, en broderies, qu’il tenait renfermés dans des garde-meubles, non qu’il cachât ses trésors de crainte de les endommager par l’usage ; il était, au contraire, libéral et magnifique. Mais en ces temps-là les seigneurs menaient couramment, en province, une existence très simple, faisant manger leurs gens à leur table et dansant le dimanche avec les filles du village. Cependant ils donnaient, à certaines occasions, des fêtes superbes qui tranchaient sur la médiocrité de l’existence ordinaire. Aussi fallait-il qu’ils tinssent beaucoup de beaux meubles et de belles tentures en réserve. C’est ce que faisait M. de Montragoux.
Son château, bâti aux temps gothiques, en avait la rudesse. Il se montrait du dehors assez farouche et morose, avec les tronçons de ses grosses tours abattues lors des troubles du royaume, au temps du feu roi Louis. Au-dedans il offrait un aspect plus agréable. Les chambres étaient décorées à l’italienne, et la grande galerie du rez-de-chaussée, toute chargée d’ornements en bosse, de peintures et de dorures.
A l’une des extrémités de cette galerie se trouvait un cabinet que l’on appelait ordinairement « le petit cabinet » C’est le seul nom dont Charles Perrault le désigne. Il n’est pas inutile de savoir qu’on le nommait aussi le cabinet des princesses infortunées, parce qu’un peintre de Florence avait représenté sur les murs les tragiques histoires de Dircé, fille du Soleil, attachée par les fils d’Antiope aux cornes, d’un taureau ; de Niobé pleurant sur le mont Sipyle ses enfants percés de flèches, divines ; de Procris appelant sur son sein le javelot de Céphalé. Ces figures, paraissaient vivantes, et les dalles de porphyre dont la chambre était pavée semblaient teintes du sang de ces malheureuses femmes. Une des portes de ce cabinet donnait sur la douve, qui n’avait point d’eau.
Les écuries formaient un bâtiment somptueux, situé à quelque distance du château. Elles contenaient des litières pour soixante chevaux et des remises pour douze carrosses dorés. Mais ce qui faisait des Guillettes un séjour enchanteur, c’étaient les canaux et les bois qui s’étendaient alentour et où l’on pouvait se livrer aux plaisirs de la pêche et de la chasse.
Beaucoup d’habitants de la contrée ne connaissaient M. de Montragoux que sous le nom de la Barbe-Bleue, car c’était le seul que le peuple lui donnât. En effet, sa barbe était bleue, mais elle n’était bleue que parce qu’elle était noire, et c’était à force d’être noire qu’elle était bleue. Il ne faut pas se représenter M. de Montragoux sous l’aspect monstrueux du triple Typhon qu’on voit à Athènes, riant dans sa triple barbe indigo. Nous nous approcherons bien davantage de la réalité en comparant le seigneur des Guillettes à ces comédiens ou à ces prêtres dont les joues fraîchement rasées ont des reflets d’azur. M. de Montragoux ne portait pas sa barbe en pointe comme son grand-père à la cour du roi Henry II ; il ne la portait pas en éventail comme son bisaïeul, qui fut tué à la bataille de Marignan. Ainsi que M. de Turenne, il n’avait qu’un peu de moustache et la mouche ; ses joues paraissaient bleues ; mais quoi qu’on ait dit, ce bon seigneur n’en était point défiguré, et ne faisait point peur pour cela. Il n’en semblait que plus mâle, et, s’il en prenait un air un peu farouche, ce n’était pas pour le faire haïr des femmes. Bernard de Montragoux était un très bel homme, grand, large d’épaules, de forte corpulence et de bonne mine ; quoique rustique et sentant plus les forêts que les ruelles et les salons. Pourtant, il est vrai qu’il ne plaisait pas aux dames autant qu’il aurait dû leur plaire, fait de la sorte et riche. Sa timidité en était la cause, sa timidité et non pas sa barbe. Les dames exerçaient sur lui un invincible attrait et lui faisaient une peur insurmontable. Il les craignait autant qu’il les aimait. Voilà l’origine et la cause initiale de toutes ses disgrâces. En voyant une dame pour la première fois, il aurait mieux aimé mourir que de lui adresser la parole, et, quelque goût qu’il en conçût, il restait devant elle dans un sombre silence ; ses sentiments ne se faisaient jour que par ses yeux, qu’il roulait d’une manière effroyable. Cette timidité l’exposait à toutes sortes de disgrâces, et surtout elle l’empêchait de se lier d’un commerce honnête avec des femmes modestes et réservées, et le livrait sans défense aux entreprises des plus hardies et des plus audacieuses. Ce fut le malheur de sa vie.
Orphelin dés son jeune âge, après avoir rebuté par cette sorte de honte et d’effroi, qu’il ne savait vaincre, les partis avantageux et très honorables qui se présentaient, il épousa une demoiselle Colette Passage, nouvellement établie dans le pays, après avoir gagné quelque argent à faire danser un ours dans les villes et les villages du royaume. Il l’aimait de tout son pouvoir et de toutes ses forces. Et, pour être juste, elle avait de quoi plaire, telle qu’elle était, robuste, la poitrine abondante, le teint encore assez frais bien que hâlé par le grand air. Sa surprise et sa joie furent grandes d’abord d’être une dame de qualité ; son cœur, qui n’était pas mauvais, se laissait toucher par les bontés d’un mari d’une si haute condition et d’une si forte corpulence qui se montrait pour elle le plus obéissant des serviteurs et le plus épris des amants. Mais, au bout de quelques mois, elle s’ennuya de ne plus courir le monde. Au milieu des richesses, comblée de soins et d’amour, elle ne goûtait pas d’autre plaisir que d’aller trouver le compagnon de sa vie foraine dans la cave où il languissait, une chaîne au cou et un anneau dans le nez, et de l’embrasser sur les yeux en pleurant. M. de Montragoux, la voyant soucieuse, en devenait soucieux lui-même et sa tristesse ne faisait qu’accroître celle de sa compagne. Les politesses et les prévenances dont il la comblait tournaient le cœur de la pauvre femme. Un matin, à son réveil, M. de Montragoux ne retrouva plus Colette à son côté. Il la chercha vainement par tout le château. La porte du cabinet des princesses infortunées était ouverte. C’est par-là qu’elle avait passé pour gagner les champs avec son ours. La douleur de la Barbe-Bleue faisait peine à voir. Malgré les courriers innombrables envoyés à sa recherche, on n’eut jamais nouvelles de Colette Passage.
M. de Montragoux la pleurait encore quand il lui advint de danser, à la fête des Guillettes, avec Jeanne de la Cloche, fille du lieutenant criminel de Compiègne, qui lui inspira de l’amour. Il la demanda en mariage et l’obtint incontinent. Elle aimait le vin et en buvait avec excès. Ce goût augmenta tellement qu’en peu de mois elle eut l’air d’une trogne dans une outre. Le pis est que cette outre, devenue enragée, roulait perpétuellement par les salles et les escaliers, avec des cris, des jurements, des hoquets et vomissant l’injure et le vin sur tout ce qu’elle rencontrait. M. de Montragoux en tombait étourdi de dégoût et d’horreur. Mais tout aussitôt il rappelait son courage et s’efforçait, avec autant de fermeté que de patience, de guérir son épouse d’un vice si répugnant. Prières, remontrances, supplications, menaces, il employa tous les moyens. Rien n’y fit. Il lui refusait le vin de sa cave ; elle s’en procurait du dehors qui l’enivrait encore plus abominablement.
Pour lui ôter le goût d’une boisson trop aimée, il lui mit de l’herbe aux chats dans ses bouteilles. Elle crut qu’il voulait l’empoisonner, bondit sur lui et lui planta trois pouces d’un couteau de cuisine dans le ventre. Il en pensa mourir, mais ne se départit point de sa douceur coutumière. « Elle est, disait-il, plus à plaindre qu’à blâmer. » Un jour qu’on avait oublié de fermer la porte du cabinet des princesses infortunées, Jeanne de la Cloche y entra tout égarée, à son habitude, et voyant les figures peintes sur la muraille dans l’attitude de la douleur et près de rendre l’âme, elle les prit pour des femmes véritables et s’enfuit épouvantée dans la campagne, en criant au meurtre. Entendant la Barbe-Bleue, qui l’appelait et courait à sa poursuite, elle se jeta, folle de terreur, dans la pièce d’eau et s’y noya. Chose difficile à croire et pourtant certaine, son époux fut affligé de cette mort, tant il avait l’âme pitoyable.
Six semaines après l’accident, il épousa sans cérémonie Gigonne, la fille de son fermier Traignel. Elle n’allait qu’en sabots et sentait l’oignon. Assez belle fille à cela près qu’elle louchait d’un œil et clochait d’un pied. Sitôt qu’elle fut épousée, cette gardeuse d’oies, mordue par une folle ambition, ne rêva plus que grandeurs nouvelles et nouvelles splendeurs. Elle ne trouvait point ses robes de brocart assez riches, ses colliers de perles assez beaux, ses rubis assez gros, ses carrosses assez dorés, ses étangs, ses bois, ses terres assez vastes. La Barbe-Bleue, qui ne s’était jamais senti d’ambition, gémissait de l’humeur altière de son épouse ; ne sachant, dans sa candeur, si le tort était de penser glorieusement comme elle ou modestement comme lui, il s’accusait presque d’une médiocrité d’humeur qui contrariait les nobles désirs de sa compagne, et, plein d’incertitude, tantôt il l’exhortait à goûter avec modération les biens de ce monde, tantôt il s’excitait à poursuivre la fortune au bord des précipices. Il était sage, mais chez lui l’amour conjugal l’emportait sur la sagesse. Gigonne ne pensait plus qu’à paraître dans le monde, à se faire recevoir à la Cour, et à devenir la maîtresse du roi. N’y pouvant parvenir, elle sécha de dépit, et en prit une jaunisse dont elle mourut. La Barbe-Bleue, tout gémissant, lui éleva un tombeau magnifique. Ce bon seigneur, abattu par une si constante adversité domestique, n’aurait peut-être plus choisi d’épouse ; mais il fut lui-même choisi pour époux par demoiselle Blanche de Gibeaumex, fille d’un officier de cavalerie qui n’avait qu’une oreille ; il disait avoir perdu l’autre au service du roi. Elle avait beaucoup d’esprit, dont elle se servit à tromper son mari. Elle le trompa avec tous les gentilshommes des environs. Elle y mettait tant d’adresse qu’elle le trompait dans son château et jusque sous ses yeux sans qu’il s’en aperçût. La pauvre Barbe-Bleue se doutait bien de quelque chose, mais il ne savait pas de quoi. Malheureusement pour elle, mettant toute son étude à tromper son mari, elle n’était pas assez attentive à tromper ses amants, je veux dire à leur cacher qu’elle les trompait les uns avec les autres. Un jour elle fut surprise, dans le cabinet des princesses infortunées, en compagnie d’un gentilhomme qu’elle aimait, par un gentilhomme qu’elle avait aimé et qui, dans un transport de jalousie, la perça de son épée. Quelques heures plus tard, la malheureuse dame y fut trouvée morte par un serviteur du château et l’effroi qu’inspirait cette chambre s’en accrut. La pauvre Barbe-Bleue, apprenant d’un coup son abondant déshonneur et la fin tragique de sa femme, ne se consola pas de ce second malheur en considération du premier. Il aimait Blanche de Gibeaumex d’une ardeur singulière et plus chèrement qu’il n’avait aimé Jeanne de la Cloche, Gigonne Traignel et même Colette Passage. A la nouvelle qu’elle l’avait trompé avec constance et qu’elle ne le tromperait plus jamais, il ressentit une douleur et un trouble qui, loin de s’apaiser, redoublaient chaque jour de violence. Ses souffrances étant devenues intolérables, il en contracta une maladie qui fit craindre pour ses jours.
Les médecins, ayant employé divers médicaments sans effet, l’avertirent que le seul remède convenable à son mal était de prendre une jeune épouse. Alors il songea à sa petite cousine Angèle de la Garandine, qu’il pensait qu’on lui accorderait volontiers, parce qu’elle n’avait pas de bien. Ce qui l’encourageait à la prendre pour femme, c’est qu’elle passait pour simple et sans connaissance. Ayant été trompé par une femme d’esprit, une sotte le rassurait. Il épousa mademoiselle de la Garandine et s’aperçut de la fausseté de ses prévisions. Angèle était douce, Angèle était bonne, Angèle l’aimait ; elle n’était pas d’elle-même portée au mal, mais les moins habiles l’y induisaient facilement a toute heure. Il suffisait de lui dire : « Faites ceci de peur des oripeaux ; entrez ici de crainte que le loup-garou ne vous mange » ; ou bien encore : « Fermez les yeux et prenez ce petit remède » ; et aussitôt l’innocente, faisait au gré des fripons qui voulaient d’elle ce qu’il était bien naturel d’en vouloir, Car elle était jolie. M. de Montragoux, trompé et offensé par cette innocente autant et plus qu’il ne l’avait été par Blanche de Gibeaumex, avait en outre le malheur de le savoir, car Angèle était bien trop candide pour lui rien cacher. Elle lui disait : « Monsieur, on m’a dit ceci ; on m’a fait ceci ; on m’a pris ceci ; j’ai vu cela ; j’ai senti cela. » Et, par son ingénuité, elle faisait souffrir à ce pauvre seigneur des tourments inimaginables. Il les souffrait avec constance. Cependant il lui arrivait de dire à cette simple créature : « Vous êtes une dinde ! » et de lui donner des soufflets. Ces soufflets lui commencèrent une renommée de cruauté qui ne devait plus s’éteindre. Un moine mendiant, qui passait par les Guillettes, tandis que M. de Montragoux chassait la bécasse, trouva madame Angèle qui cousait un jupon de poupée. Ce bon religieux, s’avisant qu’elle était aussi simple que belle, l’emmena sur son âne en lui faisant croire que l’ange Gabriel l’attendait dans un fourré du bois pour lui mettre des jarretières de perles. On croit que le loup la mangea car on ne la revit oncques plus.
Après une si funeste expérience, comment la Barbe-Bleue se résolut-il à contracter une nouvelle union ? C’est ce qu’on ne pouvait comprendre si l’on ne savait le pouvoir d’un bel œil sur un cœur bien né. Cet honnête gentilhomme rencontra dans un château du voisinage, où il fréquentait, une jeune orpheline de qualité, nommée Alix de Pontalcin, qui, dépouillée de tous ses biens par un tuteur avide, ne songeait plus qu’à s’enfermer dans un couvent. Des amis officieux s’entremirent pour changer sa résolution et la décider à accepter la main de M. de Montragoux. Elle était parfaitement belle. La Barbe-Bleue, qui se promettait de goûter entre ses bras un bonheur infini, fut une fois de plus trompé dans ses espérances, et cette fois éprouva un mécompte qui, par l’effet de sa complexion, lui devait être plus sensible encore que tous les déplaisirs qu’il avait soufferts en ses précédents mariages. Alix de Pontalcin refusa obstinément de donner une réalité à l’union à laquelle elle avait pourtant consenti. En vain M. de Montragoux la pressait de devenir sa femme ; elle résistait aux prières, aux larmes, aux objurgations, se refusait aux caresses les plus légères de son époux et courait s’en fermer dans le cabinet des princesses infortunées, où elle demeurait seule et farouche des nuits entières. On ne sut jamais la cause d’une résistance si contraire aux lois divines et humaines ; on l’attribua à ce que M. de Montragoux avait la barbe bleue, mais ce que nous avons dit tout à l’heure de cette barbe rend une telle supposition peu vraisemblable. Au reste, c’est un sujet sur lequel il est difficile de raisonner. Le pauvre mari endurait les souffrances les plus cruelles. Pour les oublier, il chassait avec rage, crevant chiens, chevaux et piqueurs. Mais, quand il rentrait harassé, fourbu dans son château, il suffisait de la vue de mademoiselle de Pontalcin pour réveiller à la fois ses forces et ses tourments. Enfin, n’y pouvant tenir, il demanda à Rome l’annulation d’un mariage qui n’était qu’un leurre, et l’obtint selon le droit canon et moyennant un beau présent au Saint-Père. Si M. de Montragoux congédia mademoiselle de Pontalcin avec les marques de respect qu’on doit à une femme et sans lui casser sa canne sur le dos, c’est qu’il avait l’âme forte, le cœur grand et qu’il était maître de lui comme des Guillettes. Mais il jura que rien de femelle n’entrerait désormais dans ses appartements. Heureux s’il avait jusqu’au bout tenu son serment !
III
Quelques années s’étaient passées depuis que M. de Montragoux avait congédié sa sixième femme, et l’on ne gardait plus, dans la contrée, qu’un souvenir confus des calamités domestiques qui avaient fondu sur la maison de ce bon seigneur. On ne savait ce que ses femmes étaient devenues, et l’on en faisait le soir, au village, des contes à faire dresser les cheveux sur la tête ; les uns y croyaient et les autres non. A cette époque, une veuve sur le retour, la dame Sidonie de Lespoisse, vint s’établir avec ses enfants dans le manoir de la Motte-Giron, à deux lieues, à vol d’oiseau, du château des Guillettes. D’où elle venait, ce qu’avait été son époux, tout le monde l’ignorait. Les uns pensaient, pour l’avoir entendu dire, qu’il avait tenu certains emplois en Savoie ou en Espagne ; d’autres disaient qu’il était mort aux Indes ; plusieurs s’imaginaient que sa veuve possédait des terres immenses ; quelques-uns en doutaient beaucoup. Cependant elle menait grand train et invitait à la Motte-Giron toute la noblesse de la contrée. Elle avait deux filles, dont l’aînée, Anne, près de coiffer Sainte-Catherine, était une fine mouche. Jeanne, la plus jeune, bonne à marier, cachait sous les apparences de l’ingénuité une précoce expérience du monde. La dame de Lespoisse avait aussi deux garçons de vingt et vingt-deux ans, fort beaux et bien faits, dont l’un était dragon et l’autre mousquetaire. Je dirai, pour avoir vu son brevet, que celui-ci était mousquetaire noir. Il n’y paraissait pas quand il allait à pied, car les mousquetaires noirs se distinguaient des mousquetaires gris, non par la couleur de leur habit, mais par la robe de leur cheval. Ils portaient, les uns comme les autres, la soubreveste de drap bleu galonné d’or. Quant aux dragons, ils se reconnaissaient à une espèce de bonnet de fourrure dont la queue leur tombait galamment sur l’oreille. Les dragons avaient la réputation de mauvais garnements, témoin la chanson :
Ce sont les dragons qui viennent : Maman, sauvons-nous !
Mais on aurait cherché vainement dans les deux régiments des dragons de Sa Majesté un aussi grand paillard, un aussi grand écornifleur et un aussi bas coquin que Cosme de Lespoisse. Son frère était, auprès de lui, un honnête garçon. Ivrogne et joueur, Pierre de Lespoisse plaisait aux dames et gagnait aux cartes ; c’étaient là les seuls moyens de vivre qu’on lui connût.