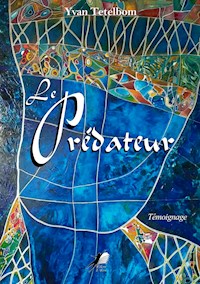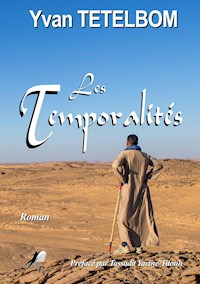
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Libre2Lire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
La mémoire mélange les temporalités, brouille l’ordonnancement chronologique des événements. Leur connexion instantanée écrase les distances.
Nous raisonnons par émotions, par croyances, sous le joug de nos perceptions sensées ou erronées. Comment rester lucide dans ces zones errantes, où le temps n’existe pas, à évoluer dans des lieux inattendus, des époques datées, futuristes ou imaginaires ?
Un récit qui interroge l’actualité politique, sociétale, culturelle de notre époque. Les personnages sont ubuesques, shakespeariens, désincarnés. Tous sont habités par la poésie et portés par un vent sec qui pousse l’horizon et produit des étés chauds, des hivers doux ou pluvieux, lesquels remontent depuis des millénaires vers la Kabylie, à partir d’Alger, pour atteindre les cimes du Djurdjura.
Un roman à l’écriture dense, sauvage, orgasmique, parsemée d’incises géographiques, historiques et spirituelles.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 180
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Yvan TETELBOM
Les Temporalités
Roman
Cet ouvrage a été composé et imprimé en France par Libre 2 Lire
www.libre2lire.fr – [email protected] Rue du Calvaire – 11600 ARAGON
Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction intégrale ou partielle réservés pour tous pays.
ISBN Papier : 978-2-38157-268-0ISBN Numérique : 978-2-38157-269-7
Dépôt légal : 2022
© Libre2Lire, 2022
« Si le temps pouvait s’expliquer, il serait statique, donc le temps serait éternité. Le fait que le temps soit dans la conscience est appelé temporalité. Ainsi, le présent est à la fois mémoire et anticipation. »
Bergson
« Entre la certitude que j’ai de mon existence et le contenu que j’essaie de donner à cette assurance, le fossé ne sera jamais comblé. Pour toujours, je serai étranger à moi-même. »
Albert Camus, Le Mythe de Sisyphe
« Rien de plus fragile que la faculté humaine d’admettre la réalité, d’accepter sans réserve, l’impérieuse prérogative du réel. »
Clément Rosset. Le Réel et son Double
Elle est retrouvée.Quoi ? – L’Éternité.C’est la mer alléeAvec le soleil.
Âme sentinelle,Murmurons l’aveuDe la nuit si nulleEt du jour en feu.
Des humains suffrages,Des communs élansLà tu te dégagesEt voles selon.
Puisque de vous seules,Braises de satin,Le Devoir s’exhaleSans qu’on dise : enfin.
Là pas d’espérance,Nul orietur.Science avec patience,Le supplice est sûr.
Elle est retrouvée.Quoi ? – L’Éternité.C’est la mer alléeAvec le soleil.
Arthur Rimbaud, « L’Éternité », Dernier Vers, mai 1872
Préface
Le juste fleurira comme un palmier
Ivan est sorti tout droit de la légende… celle des Slaves ; peut-être d’ailleurs, de ces vastes contrées d’Europe centrale… Mais, pour moi, Yvan ce nom peu familier, je l’avais pourtant entendu pour la première fois à Oran, en Algérie, c’est un pseudonyme porté par un syndicaliste, communiste, qui avait apporté cette légende, d’ailleurs pour se l’approprier et la plaquer sur la sienne, celle de son pays et de ses ancêtres…
En ces années premières d’indépendance, il fallait appartenir à tout prix à la grande famille révolutionnaire, pas seulement dans sa branche algérienne mais celle de la grande URSS. Beaucoup y croyait et Ivan Ivanovitch1 encore plus que les autres…
Dans les années 80, j’ai rencontré Yvon2, à Paris, un historien, philosophe, sociologue spécialiste de l’autogestion, qui n’a rien à voir avec Yvan (celui qui fait l’objet de ce texte) me direz-vous… Mais, cela n’est qu’apparence, car derrière ’Yvon, il y a encore un nœud que j’ai perçu sans pourtant me l’expliquer et encore moins analyser. Au bout d’un certain temps, je découvris qu’il n’était pas sans lien avec les deux prénoms dont il s’agit plus haut. Yvon cache bien son histoire, il cache son jeu.
Bien plus tard, j’apprends en fait qu’Yvon était en réalité un masque ; un prénom français, un double à peine déformé, à une lettre près, de son véritable prénom : Yvan. Yvan, l’occitan, comme Yvan, l’auteur de ce livre, est lui aussi une légende, une culture et une mémoire d’un monde dominé. Pour exister, continuer parmi les autres, il fallait devenir comme eux, il fallait être eux… Il fallait se transformer au moins au niveau des apparences, du son : Yvan ne sonnait pas bien aux oreilles des gens venus du nord, ceux qui prônaient hégémonie culturelle : unifier la langue, les prénoms. Le père d’Yvan Bourdet ne changea pas son prénom mais seulement une voyelle, il a troqué un a contre un o. C’est ainsi qu’Yvan est devenu Yvon.
Yvan, auteur de ce livre a donc des liens avec ces deux personnes même si son histoire est bien singulière, elle est encore plus compliquée, plus longue car elle nous ramène à la Grande Histoire, celle que nous ne connaissons plus parce qu’elle est trop éloignée de nous, ou bien parce qu’elle est complexe. Si son prénom est légende son nom est Histoire, celle de l’histoire de l’humanité, celle des religions du Livre.
Il s’appelle Tetelbom qui vient de Teitelbaum, (son nom d’origine, hélas modifié par les officiers de l’état civil en exercice au XIXème siècle), un nom juif ashkénaze, qui signifie "l’homme à la datte"3.
Yvan est donc un homme, un poète enraciné dans l’Histoire, dans son histoire, familiale, embourbée dans le conflit algéro-français ; elle est tellement importante qu’il ne sait plus par quel bout la prendre. Tel un enfant avec un puzzle, colle des morceaux, les ajuste, pour les recomposer et trouver un sens, une issue… Il perd son lecteur dans sa quête, car il y a un trop plein d’histoires… C’est lourd pour ses frêles épaules… mais ce n’est pas fini. Yvan, venu tout droit (C’est ce qu’on dit en tout cas) d’Europe Centrale, il est donc Tetelbom (Teitelbaum), en plus kabyle, algérien, puis français et, maintenant ? Que lui reste-il de cet héritage ? de ces fils entremêlés de ses différentes « lignages » ?
Ce qu’il recherche avant tout, c’est l’avant dernière, ou la dernière version de son histoire personnelle et collective. Elle n’est pas éloignée dans le temps, c’est peut-être aussi pour cela que la blessure est encore vive. On se perd dans l’océan de ses identités multiples, de ses histoires complexes, douloureuses. À l’homme « moderne » (si la modernité signifie encore quelque chose), une identité suffit. Pourquoi s’encombrer de cette filiation surchargée, pleine de maux, de blessures ?
Mais Yvan ne veut pas oublier, il s’accroche à son histoire, à ses ancêtres kabyles. C’est après tout là, à Azeffoun (Port Gueydon) que la barque, à l’instar de Noé a peut-être jeté l’ancre… Elle y a déposé un Teteilbaum (Teteibaum 1er) avec un plant d’olivier et un autre de figuier.
Le patriarche Teteilbaum a fait des enfants, puis des petits enfants, il a construit une vie, fondé une filiation.
De père en fils jusqu’à Yvan. Yvan est né là avec ses « frères », il a joué, il a attrapé des étoiles et la lune à pleine main sur les collines d’Azeffoun (Port Gueydon), il a nagé dans la Mer Méditerranée. Mais, il savait qu’il était arrivé une bonne fois pour toutes, il a trouvé sa place, son pays, sa culture, il ne voulait plus partir. Un jour, Teitelbaum 1er, le patriarche, lui murmura : il ne faut pas traverser la mer : ailleurs, il fait froid, le ciel gris et les nuages, bas… Partir, c’est mourir !
Yvan savait tout cela d’intuition, il est accroché telle une moule à son rocher, car cette terre est la sienne, ces hommes, ses frères…. Il a rêvé avec eux, chanté, dansé avec les musiques de la langue… Yvan est poète, il a perdu la langue mais a conservé les mélodies. Il a perdu l’Algérie et la Kabylie mais il les a enserrées pour l’éternité au fond de son cœur et au creux de sa mémoire. Il écrit des livres, il les remplit à craquer d’histoires, de légendes, de héros ; car il veut remplir un vide, celle de la perte, il trace et retrace les repères, dans l’espoir de retrouver le chemin du retour ; il clame son identité kabyle, il veut qu’on l’entende, qu’on le reconnaisse. Il est le frère de Djaout, de Mammeri, Féraoun, Pellégri, Jean Sénac et tous ceux (et celles) qui, comme lui, aiment cette terre amoureusement, sensuellement, qui sont morts pour elle. Sans elle, la vie n’a pas de saveur. Incompris des hommes d’ici-bas, Yvan, finit par s’adresser aux esprits de l’au-delà… Peut-être comprendront-ils sa quête… son histoire, celle d’un homme sincère qui recherche sa terre ! Celle du juste qui fera fleurir l’arbre de vérités, celle d’Ivan Noé.
Tassadit Yacine
Tassadit Yacine-Titouh, née le 14 novembre 1949, à Metchik est une anthropologue algérienne spécialiste du monde Berbère. Directeure d’études à l’école des hautes études en sciences sociales (EHESS) et membre du laboratoire d’anthropologie sociale du Collège de France. Elle dirige également la revue d’études berbères Awal (« la parole »), fondée en 1985 à Paris avec l’anthropologue algérien Mouloud Mammeri et le soutien du sociologue Pierre Bourdieu. On lui doit de nombreux ouvrages sur le monde berbère.
L’EMBARRAS
« Je me sentais à l’aise dans la tempête de la vie. Un peu de calme eut été plus sain, mais impossible. »
Paul Klee, Journal, 1957
Je sens une main sur mon épaule. Je me retourne.
Je me frotte les yeux, tout ébloui par la lumière vive des projecteurs. Je découvre, surpris, que je suis dans un théâtre. Il est archiplein. Les spectateurs applaudissent à tout rompre. J’ai dans la tête cette dernière tirade, probablement prononcée par un acteur : « Je ne saurais jurer que cela soit ou ne soit pas réel ».
Je me retrouve dehors, il fait froid et humide. Je remonte le col de mon manteau. On me pousse sur le siège arrière d’une BMW.
CHAMBRE 19
« Ils parlaient tous à la fois, et leurs voix insistantes, contradictoires, impatientes, rendaient l’irréel possible. »
William Faulkner, Le Bruit et la Fureur, 1929
Paris. Il est presque minuit. La BMW roule à vive allure depuis la place Colette, en direction de la rue de Richelieu, serre à droite sur l’avenue de l’Opéra, vire à gauche sur la rue Casanova, contourne la place de la Madeleine. Celle-ci est noire de monde. Je demande au chauffeur où il va. Il me dit que Johnny Halliday est mort et qu’on lui rend hommage. Ce n’est pas ce que je voulais entendre. Le véhicule s’engage sur la rue de Laborde, continue sur le boulevard Haussmann, bifurque à gauche sur la rue Lord Byron.
Je ne comprends pas ce qu’il se passe. J’ai l’impression qu’on m’a injecté, à mon insu, une substance narcotique. Je dévisage les passagers qui m’accompagnent. Je ne les connais pas. Je ne les ai jamais vus. Je me frotte les yeux. Qui est cette femme d’âge mûr qui m’observe avec de grands yeux suaves ? Elle se colle à moi et m’appelle« mon chéri ». À ses côtés, se tient une jeune femme toute guillerette. Il y a aussi un jeune homme très excité, au verbe haut. Ils m’appellent « papa ». C’est incompréhensible !
Le taxi pile devant un restaurant, encastré dans un immeuble à l’architecture Arts Déco. Un homme, l’air sévère, nous attend sur le seuil. Il regarde sa montre. J’en déduis que c’est le patron et que nous sommes en retard.
Un serveur nous installe en fond de salle. Il est de petite taille, il a la peau basanée, un corps trapu, des cheveux crépus, un faciès de proxénète. Il se dirige vers les cuisines et revient avec quatre coupes de champagne. Sous l’effet de l’alcool, je ris bêtement. D’ailleurs, tout le monde s’esclaffe.
J’ai les bras chargés de cadeaux. Je défais l’emballage du premier paquet, d’une main maladroite. La femme de mon âge m’embrasse goulûment sur la bouche lorsque j’extirpe un oiseau miniature en bois. Sur son socle est inscrit, gravée en lettres blanches, la citation : « Va lui dire que je l’aime ». Je pense que ça vient d’elle. Les autres me regardent tendrement lorsque je me saisis du roman « L’Art de perdre » d’Alice Zeniter, puis d’un cahier de notes à couverture bleue exotique. Je parie que ça vient d’eux. Tous reprennent en chœur « joyeux anniversaire ». J’en conclus que c’est mon anniversaire.
Des clients ringards, sérieusement éméchés, entonnent au comptoir « que je t’aime, que je t’aime » à la gloire du rocker disparu, qu’on reprend tous à tue-tête. Le serveur enchaîne les plats sans délicatesse, puis en guise de dessert, nous amène un fondant au chocolat, surmonté de quelques bougies d’ambiance « fontaine d’artifice ».
Le patron s’impatiente. Il regarde sa montre. Nous devrions être fermés, nous dit-il. Une heure du matin. Il pleut toujours. Il fait froid. Un vent glacial gifle mon visage. Je claque des dents. J’enroule à double nœud mon écharpe en laine mérinos, autour de mon cou. Je suis hébété. J’ai l’impression de tourner une scène de La taupe, un film d’espionnage d’après le livre de John le Carré, réalisé par Tomas Alfredson avec Gary Oldman, Tom Hardy et Colin Firth.
Une berline vient se ranger discrètement devant l’établissement. Je me retrouve projeté sur le siège arrière, revêtu de cuir noir. Le chauffeur roule à toute berzingue, avalant les rues, les places, les boulevards. Je n’ai aucune idée de sa destination. Le véhicule stoppe à quelques mètres de l’entrée d’un hôtel classé trois étoiles. La femme se dirige vers le veilleur de nuit qui lui remet des clés. Je suis un automate. Je n’ai aucune prise sur les événements. Nous prenons l’ascenseur. L’inconnue ouvre la porte de la chambre 19. Elle ôte ses bas résille, fait glisser sa robe noire sur ses reins, me demande de dégrafer son soutien-gorge. Elle veut que je lui suce les seins. Elle me dit :
Je n’offre pas de résistance. Elle éteint la lumière, se blottit nue, contre moi.
Je suis fatigué. Je tombe dans un sommeil profond. J’ai encore dans la tête des visages, des couleurs, des paysages, des situations, des époques, des sentiments.
Qu’est-ce qui relève du Rêve ou de la Raison ? Une question me taraude : et si l’inconscient était le refuge d’images du passé le plus reculé de l’humanité avec ses croyances ancestrales où se mêlent vies antérieures, vies réelles, vies supposées ? Adhérer à ces thèses est enivrant et poétique. C’est aussi une façon de vivre l’éternité.
L’APPEL DES ORIGINES
« Quiconque a le malheur d’immigrer une fois – une seule ! – restera toujours métèque toute sa vie et étranger partout, même dans son pays d’origine. C’est notre malédiction à nous, immigrants. »
Pan Bouyoucas
J’ai une vie ordinaire. Je me morfonds. Mélancolie. Solitude subie. Présent désaccordé. Le ciel est recouvert de taches inhabituelles, couleur boue d’une mauvaise terre. Aujourd’hui se confond avec hier. Demain sera comme aujourd’hui. Défilé morne des heures, des jours, des nuits. Lassitude. Impression de vide.
J’occupe un poste d’agent administratif au sein d’un établissement public, le « Fonds d’intervention de régularisation des activités du Sucre », dont la principale mission consiste à soutenir, organiser les marchés auprès des fabricants et négociants sucriers et des industries utilisatrices de cette substance.
Je suis rapide. J’ai plein d’énergie. C’est normal, je suis jeune au regard de mes collègues, à la démarche pachydermique, au verbe lent, au visage cireux, à l’humour graveleux. Ils ne se remettent jamais en question. Ils sont trop lâches pour ça. La pause-café est un moment incontournable de la vie de bureau. Ça les occupe trois fois par jour. À 10 heures, 13 heures, 15 heures. Et ils prennent leur temps ! C’est immuable. Les sujets de conversation qu’ils abordent, tournent principalement autour de la météo, des vacances d’été, des gosses, de la vie chère, de l’âge de la retraite, des grèves de trains, de métros, quand elles se produisent. Ils préfèrent se réunir entre hommes pour persifler à propos des filles. « Toutes des putes », chuchotent-ils en ricanant sottement. Dès que l’un d’entre eux quitte le groupe, avant les autres, il faut voir toutes les saloperies qu’ils disent sur lui. Un jour, agacé, je leur ai lancé : « Bande de débiles ! Espèces de marmottes ! Vous n’êtes pas gênés ? » Ils m’ont regardé, médusés. La guerre était déclarée.
Pour eux, être vif n’est pas une vertu. Leurs allusions répétées à propos de ma vitesse d’exécution les énervent, à tel point qu’un jour, excédés, ils m’ont apostrophé violemment :
Mon espace de travail se situe au centre d’une vaste pièce éclairée par de vieux néons fluorescents qui diffusent une lumière d’un blanc clinique sur tous les postes de travail réunis en espace partagé.
J’ai une carte de tâches à assumer : traitement, distribution du courrier, réception des appels téléphoniques, mise à jour de dossiers, classement, gestion du stock.
Seul, mon chef de service, monsieur Martinez, a droit à un bureau individuel aux cloisons semi-vitrées, à partir duquel il profite d’une vue panoramique sur l’ensemble du personnel.
C’est un homme d’âge moyen, la quarantaine, trapu, plutôt courtaud, de petite taille, à la calvitie rampante, le visage bouffi, piqué de papules, la bouche aux lèvres charnues, en partie cachée par une épaisse moustache syndicale d’un gris funèbre. Il porte des lunettes aux verres fins de forme concave, ce qui lui donne un air faussement intellectuel. Il a la voix bourrue d’un Jean Gabin, où se glisse subrepticement un léger accent méditerranéen.
En cette fin d’après-midi, j’étais resté au bureau, au-delà de mon horaire habituel, pour achever une tâche ardue. Monsieur Martinez se croyant seul, avait marmonné un juron, communément employé dans les quartiers populaires, considérés aujourd’hui, comme des zones de non-droit : « Nardinamouk ».
Je fus pris soudain d’un fou rire nerveux difficile à endiguer, doublé d’une quinte de toux sèche. J’eus à peine le temps de me pincer le nez en me dissimulant derrière ma pile de dossiers, tant cette circonstance singulière m’avait surpris, ébranlé.
Ce fait me ramena à une soirée au cours de laquelle, mes amis Rachid et Mohammed m’avaient convié aux « Trois Frères », un restaurant familial situé au cœur du XVIIIème arrondissement, dans une toute petite rue pavée aux lampadaires désuets, loin des lieux touristiques et de l’agitation des temps modernes.
Ils avaient insisté pour que je goûte au couscous kabyle el mesfouf aux fèves et aux petits pois, arrosé d’huile d’olive et accompagné d’un bon verre de lben.
Sais-tu, m’avaient-ils dit en chœur, en bombant le torse pour montrer leur fierté, que le couscous du Maghreb est désormais inscrit au patrimoine immatériel de l’UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture).
Les larmes sont le signe extérieur d’une émotion intense. En cette circonstance, je ne pus les retenir. J’éprouvais une détresse intérieure, mêlée à une grande joie. Je prenais conscience que j’avais souffert d’un manque d’Algérie, de son soleil, de ses criques sauvages, de ses plages qui courent au-delà de l’horizon, de ses falaises peintes au couteau, de ses vestiges antiques, de ses ports abandonnés, dissimulant une multitude de rafiots, de son Djurdjura, culminant à 2308 m et s’étalant sur une longueur de 250 km, au creux d’un décor féérique, depuis le premier matin du monde.
Mes amis m’avaient alors observé longuement. C’était une situation gênante parce qu’ils étaient restés silencieux. C’était pire que s’ils m’avaient questionné. Reprenant mes esprits, je leur avais dit, à la dérobée, d’un ton faussement enjoué : « Oh, ne vous inquiétez pas, ce n’est rien ». Dans mon for intérieur, je savais que c’était plus complexe que ça.
L’appel de mes origines avait émergé subrepticement en moi, faisant resurgir de mes lectures anciennes, une citation d’Otto Von Bismarck : « qui ne sait pas d’où il vient, ne peut savoir où il va.En ce sens, le passé est la rampe de lancement vers l’avenir».
Jusque-là, je ne m’étais pas penché sur mon identité. J’étais accaparé par des préoccupations de vie quotidienne. Je devais me tenir prêt à saisir toutes opportunités, pour me faire une place dans cette société devenue rude, intransigeante, rationnelle.
Au cours de l’histoire et des civilisations, les songes ont toujours représenté une façon de s’affranchir du temps et de l’espace ordinaires. Tel un archéologue averti, spécialiste des choses anciennes, étudiant sans relâche les traces laissées par l’homme depuis la préhistoire, à partir d’objets trouvés, je recherchais dans ma mémoire, les moindres signes de ma présence au Monde, quitte à remonter le fil de mes réincarnations, jusqu’à accéder aux phénomènes quine s’expliquent pas, aux ancêtres, au divin, à la Connaissance.
La nuit qui suivit, j’entrai dans une résurgence ayant pour décor une place typique de village méditerranéen, ombragée par des platanes à feuilles d’érable. En zoomant l’image, j’apercevais à travers de hautes grilles, une vieille bâtisse aux murs jaunâtres, fissurés, abîmés par l’humidité : Je suis petit comme un Papou de Nouvelle-Guinée. Je franchis les grilles de l’entrée, contraint et forcé. J’ai la respiration saccadée, bruyante. Je tiens d’une main maladroite, mon cartable vert bouteille. Mon autre main s’agrippe désespérément à la jupe écarlate de ma mère, assortie à son rouge à lèvres, carmin. La cloche retentit. Je suis emporté par une marée humaine. Et ça criaille, et ça piaille, et ça chiale de toutes parts. Je me retourne. Je ne vois plus ma mère. Je suis perdu. Je ne veux pas aller à l’école. Je veux rester libre. Libre comme l’air. Libre comme la déraison. Libre comme le vent berbère qui pousse l’horizon.
Nous raisonnons par émotions, par croyances, sous le joug de nos perceptions sensées ou erronées. Comment se prépare-t-on à rester lucide dans ces zones où le temps n’existe pas, à évoluer dans des lieux inattendus, des époques datées, futuristes ou imaginaires ?
Retour sur terre. Dureté de contact avec le Monde.Mes rapports avec monsieur Martinez se limitaient aux formules de politesse entre la prise d’instructions et le rendu de mon travail de la journée.
Chaque individu a ses failles, ses fragilités. Monsieur Martinez quittait son bureau par une porte dérobée, les jeudis à 15 heures précises, pour rejoindre sa maîtresse au « Royal Monceau », un palace de la capitale. C’était su de tous parce qu’il ne pouvait s’empêcher de rapporter le lendemain des détails croustillants sur ses aventures extra-conjugales. Il se vantait de posséder le registre complet de toutes les positions sexuelles pour vivre à fond l’orgasme, surtout lorsque, affirmait-il, les yeux mi-clos, la bouche baveuse, il la prenait en levrette puis la pénétrait tandis qu’elle se balançait en position du guépard, le ventre arrondi, les avant-bras à peine soulevés et les genoux bien pliés, sur la couche.