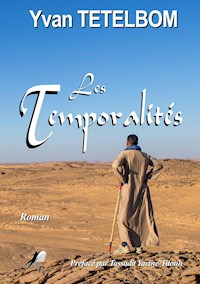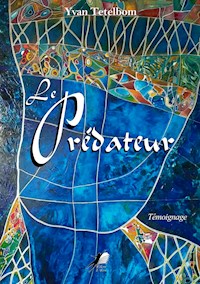Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Französisch
Yvan Tetelbom partage son expérience de l’antisémitisme. Il évoque les situations difficiles qu’il a rencontrées en raison de son identité juive, tant dans sa vie personnelle que professionnelle. Les allusions et insinuations antisémites auxquelles il a été confronté l’ont profondément affecté, l’amenant à réfléchir sur cette haine persistante dans la société, malgré les horreurs de la Shoah pendant la Seconde Guerre mondiale. Après avoir émigré d’Algérie à l’âge de quinze ans, il s’est intégré à la société française, mais au fil du temps, il a réalisé que la haine envers les Juifs persistait. Cette réalité le pousse à se demander pourquoi l’antisémitisme perdure malgré les leçons de l’Histoire.
À PROPOS DE L'AUTEUR
D’origine ashkénaze avec des liens familiaux en Biélorussie et en Ukraine, ainsi que d’une famille juive algérienne établie depuis des générations,
Yvan Tetelbom a vécu l’exil en France après la guerre d’Algérie. Il est auteur à la SACEM et a également suivi des cours de comédie au cours René Simon à Paris pour interpréter ses propres poèmes. Parallèlement, il s’est impliqué dans la création culturelle en Arts vivants et a été spécialiste de la poétique du langage, intervenant dans divers contextes éducatifs et sociaux.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 149
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Yvan Tetelbom
Une inquiétude juive
Essai
© Lys Bleu Éditions – Yvan Tetelbom
ISBN : 979-10-422-1186-8
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
À la mémoire de Serge
Ne composez jamais avec l’extrémisme, le racisme, l’antisémitisme ou le rejet de l’autre. Dans notre histoire, l’extrémisme a déjà failli nous conduire à l’abîme. C’est un poison. Il divise. Il pervertit.
Jean-Paul Sartre
Quand vous entendez dire du mal des Juifs, dressez l’oreille, on parle de vous.
Franz Fanon
I
Préambule
J’arrive à un âge où je peux voir défiler ma vie, sur toute sa longueur. Ça tombait bien, car en octobre 2022, je fus approché par une organisation juive, le « Bn’ai B’Brith », loge René Cassin d’Antibes-Juans-Les pins, située dans le département des Alpes-Maritimes. Au cours de cette réunion informelle, je leur proposai de tenir une conférence autour du sentiment d’inquiétude que ressent aujourd’hui, la communauté juive, en France, et dans le monde, en tenant compte de la période où les Juifs vécurent en Algérie avant et pendant la colonisation française.
Je voulais surtout aborder le thème de l’antisémitisme, en comprendre intellectuellement le mécanisme et ses ressorts depuis les origines. J’avais besoin de retrouver mon âme juive, léguée par mes ascendants. Il y avait trop longtemps que je m’en étais éloigné, tant ses pratiques m’apparaissaient au fil du temps, vieillottes et pour le moins dogmatiques.
Le B’nai B’rith, expression hébraïque signifiant les « Fils de l’Alliance », est la plus ancienne et la plus importante organisation humanitaire juive au monde. Fondée en 1843, à New York aux États-Unis, par douze personnes, dont Henry Jones, et deux frères, Juifs émigrés d’Allemagne, qui voulaient mettre à jour, un système d’entraide pour les Juifs arrivant aux États-Unis et devant faire face à des conditions de vie difficiles. C’est à partir de cette base, d’aide humanitaire et de services, qu’un système de loges et chapitres fraternels grandit puis s’étendit dans le monde entier. Elle est calquée sur les organisations maçonniques. Cette structure est aujourd’hui présente dans plus de 50 pays.
L’Amour fraternel, la Bienfaisance et l’Harmonie sont à la fois la devise et les valeurs fondamentales de cet ordre indépendant. La défense des droits de l’homme, la lutte contre les haines, et l’antisémitisme sous toutes ses formes, la défense des valeurs de la République, la promotion des cultures juives, le travail de mémoire, la solidarité et le soutien à l’État d’Israël représentent les missions essentielles de cette association, le dialogue interreligieux tenant une place centrale.
Je l’avoue, je pris peur devant l’immensité de la tâche. Mais j’avais accepté. Il était trop tard pour renoncer. Ce fut une grande première. Je tentai, non sans quelques bafouillages de débutant, de capter l’auditoire, en extirpant de ma mémoire, des faits tangibles auxquels j’avais été confronté au cours de mon existence. Les retracer dans un ouvrage devenait une nécessité.
En effet, il me paraissait intéressant de tenter de saisir l’ampleur du problème.
Car la grande question qui nous occupe, nous préoccupe aujourd’hui est la suivante :
Quand on est Juif,
Doit-on avoir peur ?
Ou juste être inquiet ?
Ou peut-on encore rester dans le déni de la réalité ?
Jusqu’à être INDIFFÉRENTS,
Face à la menace antisémite, laquelle court depuis des siècles. Et ne s’essouffle pas. Bien au contraire…
II
Mon histoire personnelle
Je suis né à Port-Gueydon, en Kabylie. C’est un village abritant un port de pêche, situé dans la wilaya de Tizi-Ouzou, dont le nom vient de l’Amiral Gueydon, qui le créa par décret, le 25 janvier 1885. Il fut rebaptisé Azeffoun (en berbère : Azfun), après l’indépendance, en 1962.
J’y ai vécu jusqu’à ma quinzième année. La Kabylie était un havre de paix, malgré la guerre et ses atrocités. Je garde le souvenir d’une région magnifique aux paysages montagneux, surplombant la Méditerranée, berceau des civilisations.
Mes grands-parents paternels vivaient dans la maison familiale. Leur écoute, leur tendresse, leur bienveillance, leur complicité nous sécurisaient, en ces temps troublés. Mon grand-père, que je n’ai hélas pas trop connu, était un personnage atypique, généreux, bienveillant. Né en 1868, à Brest-Litovsk, aujourd’hui Brest, en Biélorussie, il avait dû fuir les pogroms qui sévissaient dans ce pays comme dans toute l’Europe centrale, vers la fin du XXe siècle. Il se retrouva en Kabylie, avec sa jeune épouse, née Saïger Aya Malka, devenue ma grand-mère, native de Kiev, capitale aujourd’hui de l’Ukraine. Il aurait pu, à l’instar des membres de sa famille, s’exiler en Argentine ou aux États-Unis, notamment à New York, plus précisément dans le quartier de Brooklyn, où on retrouve la trace d’une grande communauté de Juifs, dont le chef de file était le Grand-Rabbinhongrois Teitelbaum (mon vrai nom d’origine), né en 1887, fondateur de la dynastie hassidique de Satmar(en hébreu : חסידות סאטמאר).
Ce sont les Juifs de cette cité maritime, perchée sur une colline grimpant à 465 m d’altitude, et dont la renommée dépassait les frontières de l’Algérie par ses sites archéologiques et ses vestiges, qui l’avaient localisé et fait venir afin d’assurer les offices de prières, car il avait étudié le Talmud (loi orale) dans sa jeunesse, ce qui lui conférait la légalité religieuse pour officier en tant que Rabbin.
Comme il était en errance, ne sachant où fuir, il prit le chemin de cette terre lointaine, aux antipodes de son milieu familier. Pour vivre, il commença à vendre du fil et des aiguilles, puis monta un bazar. Nul doute qu’il pensait déjà, à transmettre son patrimoine à ses futurs enfants. On l’appelait le cheikhr, eu égard à son rang religieux. C’est une marque de considération. Les chefs religieux, toutes religions confondues, étaient respectés en Kabylie.
Les étrangers persécutés dans leurs pays étaient accueillis en Kabylie les bras ouverts, quelles que soient leur race, leur nationalité, leur foi religieuse ou leur idéologie.
Mon père allait naître dans cette localité en 1915, et ma mère, qu’il épousa en 1946, le suivit. Née en 1923, elle portait le patronyme arabe de Bensaïd, qui devait s’écrire à l’origine en deux syllabes constituées de Ben (fils de) et Saïd (bienheureux). Elle était issue d’une famille juive autochtone implantée dans ce pays, depuis des générations, lesquelles remontaient probablement aux années d’avant la conquête de l’Algérie par la France.
Mes ancêtres maternels, Juifs algériens
Mon père parlait couramment la langue berbère, ou Amazigh, laquelle signifie « homme noble, homme libre ». De toute façon, pour commercer, c’était indispensable. Ma mère la mixait à l’arabe, tandis que mes grands-parents s’exprimaient toujours en yiddish. Mais tous arrivaient plus ou moins, à communiquer en français, cette langue de l’occupant, ce qui me plaçait au carrefour de multiples influences.
Mes grands-parents maternels vivaient à Orléansville (anciennement Castellum Tingitanum à l’époque romaine), rebaptisée El Asnam, puis Chlef après l’indépendance. Ils m’avaient accueilli en pension, à ma douzième année, pour y recevoir un enseignement secondaire, car il n’y avait pas de collège dans le village. Ils respectaient à la lettre, les rites et traditions religieuses, mais tous semblaient inquiets face à la menace antisémite, et pour cause, mes tantes répétaient à chaque réunion familiale, qu’elles avaient été interdites de scolarité et commençaient à porter l’étoile jaune, durant la Seconde Guerre mondiale.
En excluant les Juifs, le gouvernement du Maréchal Pétainavait envoyé un message clair aux Allemands, pour prouver son entière collaboration. L’Algérie, écrivait le journaliste Michel Ansky, est « un pays vivant sous un régime plus pétainiste que celui du Maréchal Pétain en France ».
III
Les Juifs en Algérie
L’histoire des Juifs en Afrique du Nord remonte à l’Antiquité, sans qu’il soit possible de retracer avec certitude l’époque et les circonstances de leur arrivée sur le territoire de l’actuelle Algérie. Selon les historiens, ils avaient été judaïsés à partir du Ier et IIe siècle, après J.C, par des Juifs arrivés via la Libye, après la destruction du temple de Jérusalem.
Cet immense territoire, qui allait devenir un pays défini par le Maghreb central, aura subi les occupations romaines, byzantines, puis vandales, lesquelles étaient composées de petites tribus germaniques qui vivaient, si l’on en croit les premières sources écrites, dans une partie de l’actuelle Pologne avant d’émigrer vers le sud, envahissant la péninsule ibérique, puis l’Afrique du Nord-Ouest.
La conquête musulmane de l’Afrique du Nord s’achèvera en Algérie au VIIIe siècle. Elle s’inscrivait dans la continuité des premières occupations de territoires, qui suivaient la disparition du prophète Mahomet, en 632.
Cet envahissement du Maghreb qui avait débuté avec la bataille de Séfétula (actuelle Sbeïtla, en Tunisie) en 647 avait trouvé son épilogue avec la perte, par l’Empire byzantin, de ses dernières forteresses, au profit du califat omeyyade, fondé en 709. Cette ultime bataille fit entrer l’Afrique du Nord dans l’ère des civilisations arabo-islamiques, marquant ainsi durablement l’identité des communautés juives locales.
L’avènement de l’Islam, vit ensuite se succéder: la dynastie Rostomide, puis la dynastie Fatimide, les Zirides, les Hammadites, les Almoravides, les Almohades, la dynastie des Zianide, puis en 1518, pour lutter contre la menace d’occupation espagnole, Alger fut placée sous la protection du sultan ottoman d’Istanbul par Barberousse. Ensuite, ce fut le règne des « Beylerbeys », puis celui des « Pachas » (quarante d’entre eux environ, se succédèrent). Survint alors le règne des « Aghas », puis cet immense territoire fut placé sous l’autorité des Deys-pachas (onze deys se succédèrent). Après quoi, Alger résista aux offensives anglaises et françaises (1678, 1680, 1682, 1688) puis de 1710-1830, dix-huit Dey se succédèrent, le dernier étant le dey Hocine.
L’arrivée en masse des Juifs espagnols, dans des circonstances tragiques, allait gonfler le contingent de ceux vivant déjà sur cette terre algérienne. Tout cela, à cause de la folle décision prise par Isabelle 1re de Castille, dite la catholique, de les chasser d’Espagne, sur les conseils de son confesseur, l’ecclésiastique Tomás de Torquemada, le 29 avril 1492, par « décret de l’Alhambra » qui stipulait : « Nous avons décidé d’ordonner à tous les Juifs, hommes, femmes, enfants, de quitter nos royaumes et de ne jamais y retourner, à la date du 31 juillet de cette même année, sous peine de mort et de confiscation de leurs biens. »
Il faut savoir que depuis le XIIe siècle déjà, des tensions entre Juifs et chrétiens d’Espagne, avaient pourri les relations entre ces deux communautés.
Mais cette fois, le pic de détestation était arrivé à son paroxysme. La reine avait misé sur une conversion massive de Juifs profondément attachés à leur patrie. Pari perdu, puisque la majeure partie d’entre eux refusèrent ce marchandage obscène !
Je rapporte le témoignage poignant du curé de Los Palacios, Andres Bernaldez, qui a assisté à cet exode des Juifs espagnols, et en parle comme le « déplacement d’une marée humaine, dans la détresse et la confusion : « Ils quittèrent leur pays natal, petits et grands, vieillards et enfants, à pied ou juchés sur des ânes et autres montures, en charrettes, en direction du port. Ils marchaient le long des routes et à travers les champs, dans des conditions extrêmes, les uns tombant, les autres se relevant, certains mourant, certains naissant, certains devenant malades, de sorte qu’il n’y avait pas de chrétien qui eut pitié d’eux, et où ils allaient, on les invitait à se faire baptiser ».
Quelques-uns se convertirent, la mort dans l’âme, à cause de leur âge, ou de situations particulières, tels le rabbin octogénaire Abraham Senior et autres notables. C’étaient des cas isolés, car la majorité d’entre eux n’obéirent pas à cette injonction. Ils émigrèrent en terre arabe, et c’est de là que vient l’appellation sépharade, ou Sefardim (en hébreu : סְפָרַדִּים), dont ils furent affublés.
Entre les Juifs abêtis par la domination musulmane et les Juifs émigrés espagnols, plus riches, plus cultivés, plus intelligents, on assista à un choc des cultures. Ils n’avaient rien de commun, à part la religion.
Ils avaient eu cependant le choix cornélien entre deux destinations principales : le Maghreb (surtout le Maroc et Oran), et l’Empire ottoman, dans ses parties européenne et asiatique.
Mais dans l’ensemble, les Juifs persécutés de par le monde avaient trouvé refuge, en Algérie, ce qui les mettait à l’abri d’une mort certaine. Mais à quel prix ? En effet, la gouvernance musulmane avait conceptualisé le statut de la dhimma, qui organisait leur exclusion de la vie civile. Ceux-ci étaient nommés les dimmhi.
Il faut noter qu’échappaient à cette obligation, les Juifs colporteurs. Les livres d’histoire sont avares d’informations sur ce sujet. En effet, malgré leur mépris du commerce ambulant, les autorités au pouvoir permirent aux Juifs de devenir camelots, selon les normes culturelles de la société dominante. En tant que dhimmi, le Juif était considéré comme sexuellement non dangereux, sorte d’humiliation déguisée. Dès lors, il était le seul marchand autorisé à faire des affaires, de manière itinérante parmi les tribus. En effet, même lorsqu’il n’y avait que des femmes sous la tente à l’arrivée du colporteur, celles-ci pouvaient sans problème marchander avec le Juif, ce qui était impensable avec un camelot musulman qui, en aucun cas, ne pouvait entrer en contact avec une inconnue.
Ce statut protecteur, concernait en premier lieu, les gens du Livre (ahl al-kitab), et donc principalement les Juifs, mais aussi les chrétiens et autres non musulmans. Cette appellation signifiait pacte, engagement, obligation, contrat. Dans ce cadre, les Juifs étaient « protégés », tout en subissant des interdits discriminatoires.
Mais protégés de quoi, de qui ? Évidemment, ce pacte, garanti par les autorités, ne les protégeait pas des abus fiscaux, leurs impôts allant du simple au double par rapport à ce que versaient les autres. Quand une loi régit de faire payer des personnes pour les protéger, cela s’apparente à un racket institué. De ce fait, on leur imposait une infériorité sociale, politique et pas seulement religieuse, ce dernier point étant acquis d’avance, c’est-à-dire que l’islam était censé être supérieur à toute autre religion. Et comble d’affront, les personnes concernées devaient remettre leur créance appelée la djizîa, au calife dont elles dépendaient, en s’agenouillant, signe de soumission.
Pire encore, les Juifs devaient se vêtir d’un costume reconnaissable, porter des habits sombres, aux manches démesurées. Il leur était interdit de s’accoutrer de vêtements de couleur verte, réservée aux descendants du prophète ou rouge, représentant l’étendard turc. La chechia, le turban et le burnous blanc leur étaient également défendus. Ils ne pouvaient chausser que des savates, qui devaient être beaucoup plus courtes que le pied, afin que le talon frotte continuellement le pavé. Et lorsqu’ils marchaient dans les rues, ils devaient impérativement laisser le passage aux musulmans, qu’ils soient adultes ou enfants. Après 18 h, ils n’avaient plus le droit de circuler sauf s’ils possédaient une autorisation de l’autorité supérieure. De plus, ils étaient exclus de tout lieu public fréquenté par les musulmans, excepté les bazars. Ils vivaient dans des quartiers séparés. Les contestations entre Juifs et musulmans étaient du ressort du cadi (juge) dont ils devaient baiser la main. La parole du Juif était réputée nulle lorsqu’un musulman niait sa véracité. Cette ségrégation s’appliquait également aux minorités chrétiennes d’orient.
William Shaler, consul américain en poste à Alger, dans les années 1800, a laissé un témoignage saisissant. Je cite : « Les Juifs ont à souffrir d’une affreuse oppression. Il leur est défendu d’opposer la moindre résistance quand ils sont maltraités par un musulman, quelle que soit la nature de la violence. Ils n’ont pas le droit de porter une arme quelconque, pas même de canne. Les mercredis et samedis seulement, ils sont autorisés à sortir de la ville sans demander la permission. Lorsqu’il y a des travaux pénibles et inattendus à exécuter, c’est sur les Juifs qu’ils retombent. »
Les Juifs, au nombre de vingt-cinq mille environ, étaient très pauvres, et contrairement aux idées reçues, vivaient dans des conditions exécrables, principalement à l’intérieur des grandes villes, à Alger, Oran, Constantine. Ils se regroupaient dans des ghettos, sorte de « mellah » où ils travaillaient comme bijoutiers, cordonniers, orfèvre. Mais ils pouvaient en sortir, et fréquenter librement d’autres quartiers alentour.
Toutefois, ils n’étaient jamais tranquilles. Ils vivaient en permanence sous la menace d’oppressions diverses. Parfois le pire survenait comme en 1815, lorsque le grand-rabbin d’Alger, Isaac Aboulker, fut décapité lors d’une émeute.
Il faut toutefois noter une grande diversité de situations dans l’espace et dans le temps. Des relations de bon voisinage, voire d’amitié, pouvaient se nouer, notamment à l’occasion de la célébration des fêtes juives. La pratique des « protections », – tel ou tel individu se mettant sous la protection d’un notable musulman, d’un haut fonctionnaire ou du Dey ou bien des consuls européens –, ne concernait pas seulement quelques riches marchands, mais s’étendait parfois à des gens modestes. Dans les campagnes, de nombreuses tribus juives vivaient en complémentarité avec leurs voisines musulmanes. Car il existait aussi une ruralité juive. Dans le bled profond, des familles juives, entièrement arabisées, disséminées sur tout le territoire, pratiquaient leur religion de façon syncrétique avec l’islam. Elles vivaient de l’élevage, du tissage, de la culture des céréales, à tel point qu’il était difficile de les distinguer des musulmans.
Mais vivre en permanence dans une inquiétude quasi constante était éprouvant. Heureusement, la conquête de l’Algérie, par la France, le 14 juin 1830,