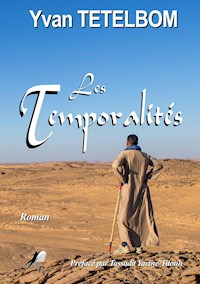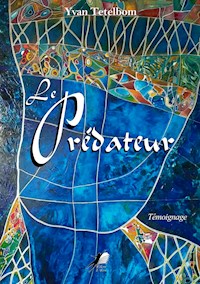
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Libre2Lire
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Yvan Tetelbom nous raconte son errance dans un monde trop violent, mais aussi sa reconstruction rendue possible grâce à la poésie.
Un enfant insouciant, émerveillé par la vie, est soudain figé dans son élan par la destruction de son innocence, dont la déflagration le projette dans un monde trop dur pour lui. Un chemin d’errance et de solitude au cours duquel il est confronté à la violence de la guerre d’Algérie, à la douleur de l’exil, à la brutalité de l’antisémitisme, au piège de l’illusion, à l’âpreté du monde politique et carcéral, à la mort, au sexe, à l’amour, à la culpabilité. Un chemin de croix éclairé par une passion qui le métamorphose : la poésie. Elle lui permettra de survivre et de devenir VIVANT !…
Ce témoignage émouvant nous transporte dans les souvenirs d'Yvan Tetelbom : poète, interprète et magicien des mots. C'est par l'écriture qu'il arrive à exiger la vérité et à briser la voix du silence.
EXTRAIT
Mon village, c’est mon pays. C’est mon enfance. C’est mon langage. C’est mon identité. C’est mon ancrage. C’est mon histoire personnelle. Je suis kabyle et fier de l’être. Mon enfance est constituée de ce sable cristallin brûlé par le soleil, dont les grains soulevés par le sirocco, s’échappent vers le ciel en nuées naturellement chorégraphiées. Mon enfance, ce sont ces heures folles à courir avec Arezki sur la plage des caroubiers. Mon enfance, ce sont des états hérétiques de liberté à faire l’enfant-oiseau sur les toits des maisons recouvertes de tuiles en terre cuite, au risque de poser malencontreusement un pied sur l’une d’entre elles plus branlante que les autres. Mon enfance, ce sont ces moments d’extase à me rassasier de pain bourré de mie imbibée d’huile d’olive, à me délecter de corail d’oursins saupoudrés de beurre, de citron, à m’empiffrer de sardines argentées, à me régaler de zlabias, de makroud pataugeant dans leur miel, à m’enivrer de halwa en pâte de sésame. Mon enfance, ce sont des furiosités à dévaler en patin à roulettes, à la vitesse d’un champion, la rue principale en forte inclinaison, au risque de ne pouvoir stopper mon élan. Sinon, c’est l’accident comme ce jour où je tape frontalement dans un muret et me retrouve, groggy, la tête en sang, avec probablement un traumatisme crânien. Dans ce village du bout du monde, il n’y a pas de médecine des radiographies, des analyses. C’est la loi des hommes sauvages. L’on meurt vite en cas d’accident et si l’on ne meurt pas tout de suite, l’organisme se renforce et ça immunise contre toutes sortes de maladies.
À PROPOS DE L'AUTEUR
"
J’avais un rêve : vivre de ma poésie… Objectif atteint !" Ainsi s’exprime
Yvan Tetelbom. Né en Kabylie, il écrit des poèmes et les interprète sur scène, en France et à l’étranger. Spécialiste en poétique du langage, il intervient régulièrement dans des écoles jusqu’à des universités, mais aussi dans des lieux de souffrance tels que les prisons, les hôpitaux psychiatriques, les centres d’accueil et au cœur des cités dites «sensibles». Il livre son premier récit, issu de ses blessures et de ses succès, comme un témoignage dédié à toute l’Humanité.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 230
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Yvan TETELBOM
Le Prédateur
Témoignage
Cet ouvrage a été composé en France par Libre 2 Lire
www.libre2lire.fr – [email protected], Rue du Calvaire – 11600 ARAGON
Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction intégrale ou partielle réservés pour tous pays.
ISBN papier : 978-2-490522-29-3ISBN Numérique : 978-2-490522-30-9Dépôt légal : Septembre 2019
© Libre2Lire, 2019
Illustration de couverture : NEMES – Tableau par Gérard Curci "Toussaint"www.toussaintcurci.com
La souffrance enfante les songes,
Comme une ruche ses abeilles,
L’homme crie où son fer le ronge,
Et sa plaie engendre un soleil,
Plus beau que les anciens mensonges.
Je ne sais ce qui me possède,
Et me pousse à dire à voix haute,
Ni pour la pitié ni pour l’aide,
Ni comme on avouerait ses fautes,
Ce qui m’habite et qui m’obsède.
Aragon
À Marie
À Sarah, Tao.
Un prédateur est une personne qui abuse d’une autre, plus vulnérable qu’elle.
DÉFLAGRATION INTIME
Après la déflagration générale et le renouvellement des choses, les âmes retourneront dans les corps qu’elles ont animés.
Diderot
C’était un jour ordinaire comme tous les jours qui se lèvent à la même heure.
Aucune agitation ne montait de la rue : ni les klaxons des voitures ni les conversations bruyantes qui habituellement attaquaient les tympans.
Orléansville, ancienne cité romaine, située entre Alger et Oran, baignait dans un climat chaud et humide, annonçant l’été, alors que nous étions à peine à mi-printemps.
Je faisais la sieste, un jour où il n’y avait pas école. Rien ne laissait supposer qu’une ombre prédatrice dissimulée dans le noir, allait surgir.
L’arme du crime était un poignard en forme de sexe. La plaie avait répandu en moi du sperme à la place du sang.
J’avais 12 ans.
Et je me vis assis sur une portion de chaise, apeuré, prostré, dévasté, en état de sidération, tête basse, les épaules lourdes, le regard saisi par l’effroi.
Je savais que lorsque l’âme et le corps se séparent, c’est le moment où l’on meurt. Donc j’étais mort. J’eus à peine le temps, d’apercevoir mon corps inerte, recroquevillé dans son détritus de chair glacée, dégoulinant de sperme, puis tout se fragmenta à la Picassienne dans l’extrême lenteur des situations post-traumatiques.
Je fus aspiré par le vide.
Le cri ne vint jamais.
PREMIERS TROUBLES
Le monde m’échappe et je ne le retiens pas
Anne Goscinny
Je suis en terre inconnue. J’évolue dans un monde étrange. Mon esprit rôde autour de ce corps sans vie, mais qui respire encore. Je ne sais plus qui je suis, où je vais, si j’existe. Je marche, je dors, je mange, je bois, je me lave. J’exécute des gestes mécaniques. Je vais au collège, j’écoute mes professeurs poliment, je ne prête pas attention à ce qui m’entoure. Je ne comprends pas toujours ce que l’on me dit. Lorsque l’on m’appelle, je ne réagis pas. Parce que je pense que ce n’est pas moi que l’on appelle. Je ne ressens rien, comme anesthésié au point d’être absent de toute empathie vis-à-vis des autres. Je suis un automate. Je n’ai pas la réflexion immédiate. Je suis obsédé par des pensées négatives. Je souffre, mais je ne sais pas de quoi je souffre. Il y avait un avant, il n’y a plus d’après.
Je me fiche de savoir s’il pleut, s’il fait soleil. Je ne suis ni réceptif au froid ni à la chaleur. Mon cerveau s’est probablement déconnecté du monde réel. J’habite le ciel des oiseaux. Je me perds dans le silence des nuages.
Je sais juste que je suis élève en sixième au collège Lallemand à Orléansville. Ainsi en a décidé le conseil de famille qui m’a exfiltré précipitamment de mon milieu familial en Kabylie, car l’on juge que je ne peux évoluer que dans un milieu éduqué, mon grand-père étant greffier au tribunal d’instance de la ville. D’ailleurs, l’on ne me demande pas mon avis.
Orléansville, anciennement Castellum Tingitanum est le site d’une cité romaine. Elle abrite des vestiges archéologiques précieux. Elle est fondée en 1843 par le général Bugeaud sur le lieu-dit El Asnam. Elle prendra le nom d’Orléansville, qui vient de Ferdinand, duc d’Orléans et fils du roi deFrance tué dans un accident de voiture sur la route de Paris à Neuilly le 13 juillet 1842. Le décret du 31 décembre 1856 crée la commune de plein exercice. L’atmosphère de la ville y est brûlante, irrespirable dès les premiers jours du printemps. Le Colonel de Saint-Arnaud dit même au début de la présence française, que c’est « un grand désert ». L’on y parle la langue arabe, ce qui me change radicalement de la langue kabyle ou aqbaylit, si douce et poétique à mon oreille dont l’alphabet est composé principalement de lettres latines avec quelques-unes inspirées du grec auxquels s’agrègent le touareg au sud, le chleuh au Maroc, puis le mzab, le chaoui, le rifia et le chenoui.
Je me sens misérable, minable, fragile, inutile, indésirable. Je ne sais même pas si je pense et à fortiori à quoi je pense. Il n’y a aucune épaisseur entre ce que je représente et le néant. Je suis une vague morte, un tracé, une esquisse de vie baignant dans sa rêverie, une substance hybride, une espèce d’évanescence, un être indéfini en voie de décomposition morale et physique.
Lorsque je fais pipi au lit la nuit, ma grand-mère Esther hurle comme une folle, en me frappant avec sa sandale. Elle me dit que je suis la honte de la famille, que je salis ses draps, que je lui donne du travail supplémentaire. Elle menace, si je continue, de lâcher son berger allemand sur moi. Je me sens diminué, humilié. Je suis tétanisé. Elle a un visage émacié, les cheveux déjà gris ramenés derrière sa nuque. Ses petits yeux austères palpitent dans le vide et sa voix haute-perchée piaffe nerveusement en émettant des sons galactiques. Elle est méchante. Je la crains.
J’ai peur. J’ai peur de tout. J’ai peur des autres, j’ai peur du noir. J’ai du mal à trouver le sommeil, car je vois des ombres foncer sur moi, et quand je dors, je fais des cauchemars, alors je me réveille en sursaut, j’allume la lumière. Je reste vigilant jusqu’à ce que le sommeil m’endorme à nouveau.
Lors des repas, si ma chaise grince, si je lèche bruyamment ma cuillère à soupe, si je renverse mon verre d’eau sur la table ou s’il me prend un éclat de rire nerveux, tant l’atmosphère est pesante, elle s’agace. Je connais la sanction. Je suis immanquablement puni les soirs où sont retransmis les matchs de football. Elle m’arrache sauvagement le transistor de l’oreille. C’est le pire des sévices auxquels je suis confronté, car ce sport que m’a fait découvrir mon oncle Georges en m’amenant avec lui au stade Jacques Robert du nom d’un ancien Maire de la ville, tué dans un duel en 1910, situé au lieu-dit « la Ferme », possède des vertus thérapeutiques. Il m’aide à sortir de ma vie monacale, de mon état mutique où je me confine pour oublier mon désarroi intérieur sur lequel je suis incapable de plaquer une explication.
Mon grand-père Eugène, heureusement, représente mon seul ilot de tendresse dans ce monde hostile, mais il n’élève pas la voix pour me protéger, par faiblesse ou par stratégie. Chaque jour que Dieu fait, immuablement, à 5 heures du matin, à l’heure où chantent les coqs, il entonne d’une voix de stentor, des chants en arabe et en hébreu, réveillant toute la famille qui rouspète. Je présume qu’il me venge. Bien calé au fond de mon lit, je jubile.
C’est un homme de petite taille, de forte corpulence, cheveux courts coiffés en brosse, le front large, le menton volontaire, l’air malicieux derrière ses lunettes blanches, faisant ressortir un nez busqué. Il attache une grande importance à sa présentation soignée à 4 épingles, avec sa chemise blanche sans faux plis, sa cravate au nœud impeccable, sa veste grise à carreaux tombant sur un pantalon à bretelles. Il arbore une superbe montre à gousset en argent massif avec sa chaînette argentée qu’il tire de sa main sûre, pour la faire émerger de la poche de son gilet. Quelle élégance dans l’attitude ! C’est une personnalité que l’on respecte en ville. Lorsque les gens le saluent, il ôte son chapeau comme dans les films d’époque. Je suis fier de me tenir auprès de lui. Nous avons coutume d’aller à pied à la synagogue pour y célébrer le shabbat qui commence le vendredi soir après le coucher du soleil, et se termine le samedi soir, après l’apparition de trois étoiles dans le ciel. Nos places y sont réservées.
En chemin, tandis que je lui confiai mes difficultés à assimiler les conjugaisons, à partir d’un ensemble ordonné des formes que le verbe peut prendre en fonction du mode, du temps, de l’aspect et de la personne, il me rassura :
Mon oncle Georges est le fils de ma famille d’accueil. Comme c’est leur dernier enfant et de surcroit l’unique garçon, il a le statut d’enfant unique et donc de chouchou. Il polarise de fait toutes les attentions. Il en profite pour affirmer sa toute-puissance. Moi, je ne compte pas. Il est grand, svelte, mince, actif, d’apparence longiligne. Je ne le vois qu’aux repas, où, pris par ses pensées, sa parole est rare. Et quand il parle, ses phrases sont tranchantes comme des machettes qui tuent sur le coup. Je ne me risque pas à donner mon avis sur tel ou tel sujet. Encore faut-il que j’aie une opinion. Il est sérieux, distant. Il ne sourit jamais. Son visage ne montre aucune expression. À sa façon de se saisir de ses couverts et de s’en servir, je sais s’il est énervé, mécontent ou satisfait. L’écart d’âge entre nous, qui va du simple au double, est trop important. Je suis un adolescent timide, en proie au doute. Lui est un homme mûr, qui est déjà dans sa vie. Nous ne communiquons pas. Chacun est dans sa bulle. Heureusement il aime le football. Ce sera notre seul lien.
J’observe. Je suis donc plus réceptif aux êtres qui m’entourent. Je perce plus aisément leurs secrets à partir de mots ou bribes de phrases qu’ils expriment, grâce à mon aptitude à deviner les sentiments profonds qui s’y cachent. Cette impression se manifeste surtout auprès de personnes que j’aime et j’aime mon grand-père. Il me rassure. Lorsqu’il évoque les Dardanelles où il a fait la guerre, sans donner plus de détails, j’imagine alors ses conditions d’existence dans cette bataille appelée aussi la bataille de Gallipoli, du nom du passage obligé entre la mer Égée et la mer de Marmara lors de la Première Guerre mondiale qui opposa l’Empire ottoman aux Anglais. Je sens bien que ses pensées le ramènent comme le mot à la page blanche, à cette période où la mort était omniprésente, mais aussi aux scènes obscènes d’exécutions capitales auxquelles il était contraint d’assister en tant qu’officier public ministériel dans l’enceinte de la prison d’Orléansville dans les années 1957 afin de surveiller le bon déroulement de la procédure puis de l’enregistrer sur procès-verbal officiel.
Je ne retiens rien. Je manque de concentration. Les choses que j’ai faites la veille s’effacent au moment où je cherche à m’en souvenir. J’oublie même les tâches que je dois faire, l’instant d’après. Alors je les note sur un bout de papier que je ne retrouve presque jamais. J’ai peine à saisir le sens de ma vie, ma perception sensorielle s’emballe, zigzague entre tristesse et détresse, laisser-aller et rejet de tout. Il s’ensuit une perte de repères qui se traduit par une défaillance sur le plan de mon équilibre psychique et corporel. Je n’arrive plus à m’orienter dans l’espace.
Je suis un pantin désarticulé venant de nulle part. Je suis absent, mou, léthargique, passif. Tout se mélange dans ma tête, tout se confond. Seule ma mère, pour l’heure, me relie à ma vie d’avant. Je l’implore chaque nuit pour qu’elle vienne à mon secours, me protège, ressente mon désespoir. Poser ma joue sur son sein. Je veux qu’elle caresse ma nuque, qu’elle me serre fort dans ses bras, qu’elle m’étouffe de son amour. Je connais cette douceur maternelle ou ce sont juste des réminiscences d’une vie que j’invente peut-être. Je pleure, mais je ne sais pas pourquoi je pleure.
Je n’ai plus le goût de vivre. Je ne m’intéresse à rien. J’habite le vide. J’évolue dans un espace éthéré, mystérieux, qui amortit les bruits, les paroles. Je n’ai pas l’impression d’avoir une existence humaine. J’usurpe une vie qui n’est plus d’origine. J’entends des sons, je perçois des intonations, mais c’est du bruitage, je distingue des silhouettes à l’heure où le jour se perd dans la nuit. Elles vont, viennent, passent devant moi sans me voir. Je construis un récit qui se nourrit d’abstractions.
Je ne supporte pas que l’on m’approche. Je ne veux pas que l’on me touche. J’ai une certaine hantise du contact avec le masculin. Ce genre humain me tétanise. Il dégage de grosses voix qui me déstabilisent, m’inspirent de la crainte, du danger.
Je me tiens toujours dans des zones de moindre éclairement possible, à l’extrême limite du noir total, là où les objets sont indistincts. Je recherche les réserves discrètes, les alcôves secrètes, les réduits obscurs.
J’ai trois centres d’intérêt : le football, la poésie et l’actualité politique à travers la révolution algérienne. Cette guerre de décolonisation est un sujet si sensible, que le gouvernement français en a minimisé le terme, pour n’en faire qu’un simple problème de maintien de l’ordre. Ils disent que ce sont des « événements », alors qu’il s’agit bien d’une guerre. Un événement c’est un fait qui survient inopinément tandis que la guerre, ce sont des morts, des blessés à vie, des espoirs brisés, des amours qui tournent à vide. Moi, je n’ai pas peur. Je n’imagine pas ma propre mort puisque je ne sais pas si je suis vivant.
L’on me répète inlassablement qu’il faut rester prudent sur le chemin qui va de l’appartement au collège et retour. C’est dangereux à cause des risques d’attentats. Aux premières teintes martiennes du crépuscule, j’aperçois par la fenêtre, à travers le voilage, des ombres se glisser à pas de sioux, entre les habitations. Elles ouvrent le bal des explosions au plastic. Je fais alors le pari que ça peut arriver dans notre immeuble, parce que c’est déjà arrivé : ce soir-là, à peine avais-je reculé de quelques pas, que la déflagration avait soufflé les vitres de l’appartement, lesquelles s’étaient éparpillées en mille copeaux dans un fracas assourdissant qui sont autant d’armes qui peuvent blesser, tuer.
Je suis un élève appliqué, sérieux, sage, discret en classe. Les résultats suivent. Je figure même au tableau d’honneur à l’issue de mon premier trimestre, mais mes grands-parents font la moue. Alors que j’attends des encouragements, ils me sermonnent :
En fait, si j’aime de plus en plus apprendre, comprendre, c’est parce que je cherche instinctivement dans mes manuels scolaires, des réponses aux interrogations que mon subconscient me transmet.
Les jours se succèdent et le temps est long et lent. Je suis triste. Infiniment triste. Ma grand-mère Esther me dit qu’elle s’inquiète de me voir si solitaire :
J’élude son questionnement. Je n’ai pas de réponse. Sous mes apparences, gangrène un mal profond dont je ne sais définir la cause. Curieusement, j’aime ma souffrance. Je m’en nourris. Elle est mon amie. J’ignore l’origine de ce tourment qui m’étreint. Je suis bien trop jeune pour tout analyser.
Parfois j’ai des réactions bizarres qui échappent à mon contrôle. J’imite « moumoune », la chatte de la maison. Je m’agrippe aux armoires de l’appartement au-dessus desquelles je me tapis en boule. Et je reste là, tel un poète maudit, durant des « éternités ». Je veux que l’on m’oublie définitivement. Je me cache pour mourir, à l’instar de ces oiseaux qu’évoquera dans son roman, Colleen Mc Cullough en 1977, dans « Les oiseaux se cachent pour mourir ».
Je suis sujet à des crises d’automutilation. Ce sont des réactions impulsives. Je m’inflige des blessures comme ce soir-là où, pris d’un accès de démence, je boxe la fenêtre de la cuisine. Le sang gicle de mon poignet droit. Mon état nécessite d’urgence un traitement des plaies par la suture. Personne ne cherche la raison de ce geste. Personne ne se doute que je souffre.
Je me retrouve souvent seul à la maison lorsque je reviens du collège. Je suis traversé par des phobies irrationnelles : je crois entendre des bruits suspects de pas. Je crois ressentir une compression dans ma poitrine suite à une fuite de gaz, fictive. Alors, je m’échappe, je cours, je cours à travers la ville, terrifié, la respiration haletante.
Des cris caractéristiques aux mouvements de foule me signalent qu’il y a des émeutes alentour, opposant les partisans de l’Algérie algérienne à ceux défendant une Algérie française. Je me précipite sur les lieux. La police s’interpose pour éviter les affrontements au corps à corps. Les pierres volent à l’aveugle d’un camp à l’autre, occasionnant de graves blessures chez les manifestants. Des plaies ouvertes entaillent les visages, laissent échapper des coulées de sang. Les blessés se comptent par dizaines, sont extirpés d’urgence de la manifestation par des secouristes pour être acheminés vers les ambulances dans le hurlement des gyrophares.
Cette guerre, au fond, m’attire. Elle vient à ma rescousse pour me libérer d’un poids trop lourd à porter. Elle répond à mes propres pulsions morbides. Je transfère par la pensée, ma violence sur les émeutiers. Je les encourage intérieurement à porter la terreur dans le camp adverse, sans distinction de conviction.
Je prends goût à ces escapades. Ce jour-là, la place de la préfecture est noire de monde. Les gens applaudissent à tout rompre ou hurlent leur dépit à chaque parole prononcée par le Général de Gaulle dont la voix ample, caverneuse, tragique, solennelle emploie les mots : paix, Algérie algérienne, autodétermination. Ma conscience politique s’éveille.
La vie a ses rythmes, entre tensions et relâchements, ralentis et accélérations ponctuées par des lignes droites, des rotations, des courants s’agitant dans tous les sens. La guerre d’Algérie veut son épilogue.
J’ai l’âge de décoder les informations qui passent en boucle à la radio. L’une d’entre-elles est déjà dans toutes les oreilles. Des putschistes représentés par les généraux, Salan, Challe, Jouhaud, Zeller, décrètent que l’Algérie restera française. L’espoir renaît chez les pieds-noirs. Vent de panique chez les musulmans. Le ciel est bas. Les rues sont désertes. Impression de fin du monde. Les magasins ont baissé leurs rideaux métalliques doublés de grilles. Les services publics sont fermés. Personne ne s’aventure dans les rues. Au bas des immeubles les militaires pointent leurs armes sur les gens agglutinés sur les terrasses, en les sommant de rentrer chez eux : allez, déguerpissez,fissa, fissa !
S’ajoutent ponctuellement les rugissements gutturaux qui montent des abîmes. Le tremblement de terre meurtrier du 16 septembre 1954 est encore dans toutes les mémoires. C’est une année que l’on ne peut oublier, car elle correspond au début de la guerre d’Algérie. La ville fut détruite à 90 % faisant près de 15 000 morts et des milliers de blessés. Il se raconte encore que la terre s’était ouverte sous les pas des passants, les avaient gobés vivants puis s’était refermée sur eux, provoquant des scènes de panique dignes des plus grandes Apocalypses. Mon oncle René avait heureusement trouvé un passage au milieu des décombres. Tout le monde suffoquait à cause de la poussière des pierres. Finalement tous l’avaient emprunté comme ils pouvaient. Il restait une dernière étape : descendre du 1er étage par une fenêtre restée ouverte à l’aide d’une échelle-escabeau. Mon grand-père Eugène était si lourd qu’arrivé à mi-échelle, il chuta. Heureusement un pic de boucher le rattrapa par son pyjama. Ce fut un miracle que tous aient eu la vie sauve.
Mon année scolaire en 4ème est déjà bien engagée lorsque je quitte subitement la plaine du Chélif parce que mes parents me pressent de les retrouver en Kabylie. Ils me disent qu’il se passe des choses graves dans le pays. J’envisage tous les cas de figure. Je n’imagine pas cependant l’extrême gravité de la situation.
Le trajet est périlleux. Les trains sautent par intermittence sur des bombes. Ce jour-là, celui dans lequel j’avais pris place s’était immobilisé durant des heures et l’on avait attendu patiemment que la voie se dégage, car celui qui nous précédait venait d’exploser, finissant sa course dans un ravin en contrebas. Je distinguais nettement des corps abîmés, encastrés dans la ferraille calcinée, des têtes arrachées encore sanguinolentes, des moignons de membres éparpillés à la ronde. C’était un spectacle banal. J’y étais habitué. De toute façon, j’avais une idée abstraite de la mort. Pour moi c’était le passage d’un monde à l’autre et j’étais déjà dans cet autre monde.
Puis l’express Oran-Alger avait repris progressivement de la vitesse. La tête penchée hors-la fenêtre, laissant l’air s’engouffrer dans mes poumons, je regardais les oueds anémiques, les paysages asséchés, les sols arides. J’apercevais dans les champs, des fellahs, le corps courbé par la fatigue. J’étais aimanté par l’étrangeté poétique des stations : lieux d’itinérance servant d’un décor de théâtre absurde à l’exil, aux rencontres silencieuses, licencieuses, aux séparations définitives, aux adieux qui font mourir, pages de retour aussi vers la nostalgie qui fait du bien ou fait souffrir.
Ma grand-mère Esther est surprenante. Elle peut être dure, autoritaire, ignoble, détestable, mais elle peut aussi avoir des élans de tendresse auxquels je ne m’attends pas, lorsqu’elle pose ses mains sur mon ventre, pour calmer mon angoisse qu’elle devine sous mon air absent, durant les trajets ferroviaires.
Après une nuit passée à Alger chez des oncles, des tantes, l’on me raccompagne à la gare centrale où je prends seul, la micheline en direction de Tizi Ouzou. Cette ville tient son appellation de Tizi ou col de montagne et Ouzou, genêts. C’est la porte d’entrée de la Kabylie. À l’époque ottomane, la ville n’était qu’un simple village limité au nord par le massif de Sidi Belloua et au sud par un fort (ou bordj) qui abritait une garnison de janissaires ou soldats d’élite de l’infanterie. Il prit son essor à l’arrivée des Français et devint ville coloniale après l’installation de quelques services publics, hôtels, écoles, bureaux de poste, lieux de culte tels l’église Saint-Eustache et les mosquées traditionnelles, Lalla D’Mamiya et Lalla Saida. L’explosion démographique postindépendance atteignit des proportions gigantesques.
Là, mon père m’attend. Nous déambulons dans la cité aux chemins de terre poussiéreuse, le temps que nous soit communiqué l’horaire officieux du convoi militaire dans lequel sera positionné le car « l’oiseau blanc » qui nous ramènera à notre village. En principe, il y a un convoi par jour. Parfois nous apprenons au tout dernier moment que la date est reportée. L’on se doute alors que l’armée française dispose de renseignements fiables quant à d’éventuels préparatifs d’embuscades des fellaghas.
Les nuages se sont agrégés en bandes orageuses. Il règne une atmosphère singulière dans la cité berbère. Les cigognes, ces échassiers aux pattes longues et effilées, aux becs orangés, aux ailes déployées, ont fait leur apparition plus tôt que d’habitude, sur les minarets des mosquées, sur le toit des immeubles, sur les pylônes, signe qu’il y a de l’étrangeté dans l’air. À la gare routière, les voyageurs ont l’air soucieux. L’autobus est enfin affrété. Le convoi s’enfonce dans la montagne, se perd dans les innombrables lacets. J’ai des nausées. Je m’étais renseigné : il paraît que c’est à cause du manque de synchronisation entre l’oreille interne et les yeux qui envoient des signaux contradictoires au cerveau. Je reste persuadé que c’est plutôt à cause de toutes ces odeurs mélangées de produits épicés qui montent de couffins des voyageurs. Des tirs sporadiques des maquisards postés sur les hauteurs nous prennent pour cible. C’est habituel. Nous longeons à présent le front de mer, signe que nous sommes presque arrivés. C’est le dernier virage. Nous dépassons la pépinière, abordons les derniers mètres avant de remonter la rue principale. Je suis assailli par une meute de copains venus m’accueillir. Dans l’effusion des retrouvailles, ils me posent toujours ces mêmes questions à propos de cette région du Chélif dont le nom vient du fleuve long de 733 kilomètres situé au nord-ouest du pays, qui prend sa source dans l’Atlas saharien et a son embouchure dans la mer méditerranée près de Mostaganem :
Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je suis devenu amnésique. Mon cerveau a tiré un trait sur ces trois années qui viennent de s’écouler. Je sais juste que je reviens de l’enfer.
La mémoire est espiègle. À notre insu, elle enregistre, conserve, encode des faits, des paroles, des situations auxquelles l’on a été confronté en tant que témoin ou acteur. Il est possible aussi que certains souvenirs se perdent, s’ils n’ont pas été sollicités depuis longtemps ou sous l’effet d’un choc qui les enterre définitivement. Ils peuvent cependant refaire surface, en totalité ou par fragments à des moments inattendus.
Port-Gueydon. J’habite depuis ma naissance dans cette agglomération côtière située à 70 km au nord-est de Tizi Ouzou. Du temps des romains, cette région kabyle s’appelait Ruzasus. C’était une base militaire très stratégique en raison de sa situation géographique, bordée au nord par la Méditerranée, au sud par des montagnes s’élevant à 500 m d’altitude et à l’est par la région de Bejaïa, qui fut au temps de la dynastie des Hammadides, une capitale qui marque son passage dans l’histoire de l’Algérie. La ville fut confiée vers le IIe siècle à un chef local, Aurelius Rulasen ex prefectura. L’origine de son nom, car ce n’est ni amazigh ni français, ni turc, ni arabe dialectale (darija) vient de l’arabe classique. Ce n’est autre que le mot en arabe « Azziffoune » qui veut dire « Musiciens » ou « qui joue d’un instrument musical ». En 1492 des Mauresques arrivèrent dans cette région après la chute de Grenade en Andalousie, la plupart étaient musiciens, chanteurs, hommes de lettres. Leurs maisons étaient peintes en blanc. Les Amazighs de la région furent très hospitaliers avec eux. Ils les aidèrent à s’installer. Ils les appelèrent « Athundlouss ». Leurs descendants sont restés.
Port-Gueydon en tant que village n’existait pas encore officiellement. Il n’y avait rien, juste des montagnes avec des villages nichés au fond des vallées ou juchés au sommet des collines. Un jour en 1807, un homme y débarqua. Il était de type européen. Il était juif. Il s’appelait Joseph Hadjadj. La légende dit qu’il venait de Dellys, longeait la côte sur un radeau de fortune qui s’échoua à cause de la tempête sur une plage sauvage. Des Kabyles alertés par la nouvelle, inquiets de voir arriver un étranger, vinrent à sa rencontre pour l’empêcher de mettre pied à terre. L’étranger leur donna un peu de sel, une certaine quantité de sucre roux, du savon qu’il gardait en réserves sur son embarcation.
Les Kabyles sont un peuple de l’accueil et de l’hospitalité. C’est dans leur culture. Après les premiers mots échangés, ils l’invitèrent chez eux pour se réchauffer, se restaurer. Ils lui proposèrent même de rester vivre auprès d’eux. Joseph se sentit si bien qu’il eut envie de s’y installer. Il construisit une maison. Ce fut la première maison jamais construite en cet endroit isolé entre mer et montagne. Puis d’autres habitations s’érigèrent. Joseph donna naissance à plusieurs enfants parmi lesquels Alexandre et David qui devinrent boulangers.
En 1830 les troupes françaises débarquèrent en Algérie. L’amiral Louis Henri comte de Gueydon, premier gouverneur d’Algérie sous la IIIème république donna son nom à ces quelques maisons disséminées çà et là. Suite à une grave insurrection, il mit en état de siège la plus grande partie des communes de la colonie et travailla énergiquement à la répression de la révolte. Assimilant les Kabyles aux insurgés de la commune de Paris, il donna comme consigne : «