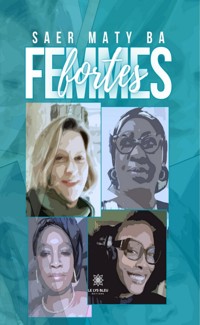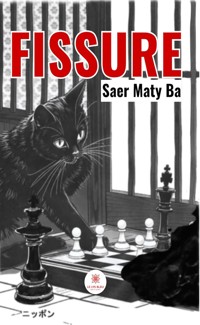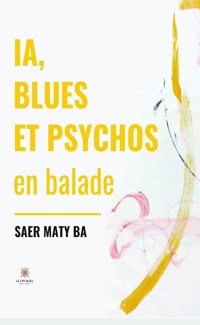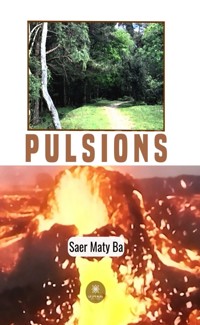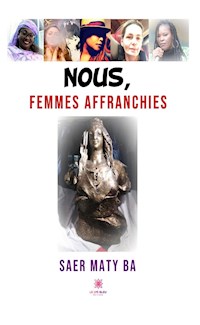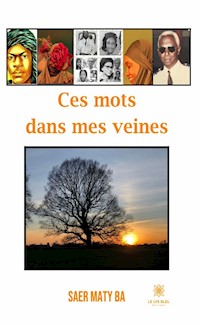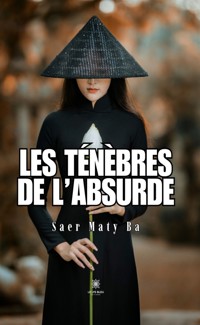
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Présumée orpheline, adoptée en Asie puis élevée en Europe, Marie Madeleine grandit dans le bonheur… jusqu’à ce que l’adolescence et l’amour d’Omar l’Africain fassent vaciller ses certitudes. Tous deux, aux origines fissurées, partagent la même faille : une identité éclatée. Devenue diplomate, enceinte, elle entreprend un voyage intime dans trois pays, dont le Viêt-nam, à la recherche de ses racines et d’un sens à leur histoire.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Après vingt-sept ans d’enseignement universitaire en littérature, cinéma et études culturelles au Royaume-Uni, Saer Maty Ba poursuit avec finesse sa réflexion à travers ce quatrième roman. "Les Ténèbres de l’absurde" explore l’absurdité de la quête de sens, entre fractures identitaires et dilemmes existentiels.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 214
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Saer Maty Ba
Les ténèbres de l’absurde
Roman
© Lys Bleu Éditions – Saer Maty Ba
ISBN : 979-10-422-8293-6
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Il y a deux manières de se perdre : par ségrégation murée dans le particulier ou par la dilution dans l’universel.
V. Y. Mudimbe
Pour moi, l’avenir est quelque part derrière, loin derrière.
Bao Ninh
C’est la quête elle-même qui est notre but.
Jòn Kalman Stefànsson
Dans toute parole et dans tout acte, fût-il criminel, gît la promesse d’une valeur qu’il nous faut chercher et mettre au jour.
Albert Camus
Préface
Vous êtes sur le point de découvrir le second livre édité par ma petite maison indépendante, BANJO Éditions, dont le premier projet, un recueil de nouvelles intitulé IA, Blues et psychos en balade (2024), s’interrogeait sur les rapports de l’humanité aux intelligences artificielles. Tout d’abord, quelques informations sur moi : j’ai toujours préféré l’édition à l’écriture stricto sensu. En revanche, j’ai toujours aimé lire et relire les travaux d’autrui. Le choix de « BANJO » comme nom de ma maison émane des racines lointaines du banjo, un instrument à cordes originaire d’Afrique occidentale. Ce nom est aussi lié au grand auteur noir jamaïcain Claude Mackay, plus particulièrement à son roman humaniste Banjo, dont mes parents étaient épris ; McKay y mettait en scène un personnage principal, Lincoln Agrippa Daily, surnommé « Banjo », dans le Marseille portuaire des années 1920 ; d’où mon prénom musical à moi, homme francophile et francophone aux origines caribéennes, doublées d’une appartenance écossaise contemporaine. J’ai quitté l’enseignement et la traduction pour me consacrer à ma passion, au sein de laquelle des auteur.e.s indépendant.e.s, porteurs.euses d’une autre voix, en quête de nouvelles voies et d’autres moyens d’appréhender, d’exercer leur créativité, ces auteur.e.s-là m’encouragent à poursuivre mon bonhomme de chemin.
Ainsi, pour son deuxième projet, BANJO Éditions a réitéré sa confiance en Saer Maty Ba, contributeur de deux nouvelles percutantes et originales à IA, blues et psychos enbalade. En l’incluant dans ce premier projet, j’avais vu juste quant à la précision de son écriture et à l’agitation de son intellect. En effet, dès ma toute première lecture du tapuscrit Les ténèbres de l’absurde, qu’il disait penser pouvoir mieux terminer, je fus convaincu que Saer savait extraire de ses propres tripes une combinaison infinie de lettres écarlates. Cependant, si j’ai décidé de republier cet auteur – en solo cette fois-ci – c’est que, par le truchement de corps frivoles, son roman parvient à s’imprégner de sujets graves. Entre autres exemples probants, je dirais que du Maghreb à l’Europe occidentale, ou encore de Hanoï à Saint-Louis du Sénégal, il fait voyager sujets et personnages sur l’aile d’une conscience insouciante, au cœur d’abysses noircis d’héritages ténébreux et provenant d’aïeuls fautifs. De plus, cerise sur le gâteau, Saer le fait en mêlant humour et humeurs changeantes, tout en balançant un tas d’incertitudes, de silences, voire d’absences contre un mur de quiétude fissuré, fragile : fantastique ! En même temps, Les ténèbres de l’absurde m’est paru publiable, non pas parce qu’il m’a mis une grosse claque (je n’ai rien vu venir !) mais plutôt du fait que je l’ai trouvé : (1) aussi économe et constamment lové dans le cœur des choses et des êtres qu’une histoire d’Edgar A. Poe (« La Barique d’amontillado » ou « Le Chat noir », par exemple), (2) aussi débordant d’adrénaline nourricière qu’un texte de Fatou Diome ou Virginie Despentes (fiction et non-fiction) et (3) pas moins dense, condensé, riche ou complexe qu’un roman de F. Scott-Fitzgerald, notamment Gatsby le magnifique.
C’est ainsi que le second projet francophone de BANJO Éditions est venu au monde, une entreprise transparente aux origines et sources retraçables – voir par exemple les incises, des semis pour de futures récoltes éditoriales, qui parsèment Les ténèbres de l’absurde et où l’auteur répond sans détour à mes questions sur l’écriture et le métier d’écrivain, mais aussi la sélection de sources citées qui clôt le roman. En effet, à BANJO Éditions, nous nous efforçons de sortir des sentiers conventionnels, en encourageant des styles d’écriture et, par ricochet, des approches à la lecture qui soient variés, raison pour laquelle Les ténèbres de l’absurde est un roman non conventionnel, à plus d’un titre, et je prie pour qu’il soit à la hauteur de vos attentes. Sinon, soyez assuré.e.s que BANJO Éditions s’efforcera de faire mieux la prochaine fois.
Merci.
Lance Lincoln Banjo McKay, éditeur indépendant
Fait accompli ?
Il était une fois quatre pays, trois guerres et neuf anges qui s’égaraient silencieusement, en filigrane, tel un fil quelconque, dans les ténèbres de l’existence…
En fait, non, reculons d’une phrase : ce qui suit n’est ni poème ni conte de fées.
Trouvons les mots justes…
Abandonnons le cocktail diplomatique pour aller larguer la bombe du sens sur le non-sens.
Le colon lambda a longtemps anticipé sur un slogan ânonné partout dans le monde, de nos jours, principalement par les chefs d’État et de gouvernement de tout acabit : « menaces existentielles ». On découvre ce phénomène assez facilement, c’est-à-dire dès que l’on commence à se pencher sur les guerres coloniales, notamment les trois qui nous ont interpellés – Indochine (que je nommerai première guerre du Viêt-nam), Viêt-nam (deuxième guerre du Viêt-nam, avec les USA comme agresseur principal) et Algérie (guerre d’indépendance/guerre d’Algérie, qui m’intéresse par le biais de mon’Om, que je présenterai plus tard).
En effet, en Indochine, au Viêt-nam, ou encore en Algérie, la France, non contente de menacer et mettre en danger la collectivité, notion constituée, selon un philosophe et journaliste lu quelque part, de quatre éléments – institution, peuple, nation et humanité –, compromit la survie de cette même collectivité. Il va de soi que, face à cette tentative de meurtre multiforme, une réponse collective ne se fit pas trop attendre (évidente question de vie ou de mort, de sécurité). Dans ce contexte, le sens et le but de mon présent récit s’intéressent à ce qui avait déclenché la nécessité d’une telle réponse. Autrement dit, aux ressources culturelles, éthiques, politiques, etc., qui exposaient une menace coloniale française au visage de violent destructeur d’existences. Ne nous y méprenons pas, ces ressources étaient fondamentales à la collectivité, qui, en retour, était prête à mourir pour leur défense. Elle savait que la France pillait d’autres de ses ressources, sur et sous son territoire, mais c’étaient les ressources humaines qui lui incombait le plus, à savoir, le droit de ladite collectivité à disposer d’elle-même face à une envahisseuse n’ayant absolument rien à fiche chez elle. Et, hier comme aujourd’hui, quand bien même sa permanence comme agrégat d’êtres humains se défendant contre la chosification coloniale reste non-négligeable, ce n’est pas seulement pour elle que l’on s’insurge. Car l’on va plus loin, vers un existentiel qui, conçu par un philosophe lu quelque part, « emporte une idée de la vie bonne ». Une vie que la France était venue chercher chez les Vietnamien.ne.s et les Algérien.ne.s, tout en niant à ces dernièr.e.s la leur dans le champ des possibles français.
Certains d’entre ces humains, vietnamiens ou algériens, souvent pour des raisons personnelles (famille, parfois idéologie), se rangèrent du côté français – et ce sont ce type de gens-là qui nous ont enfantés, mon’Om et moi. Toutefois, la majorité des Vietnamien.ne.s et des Algérien.ne.s choisirent la voix/voie qui barrait la route aux vautours colons et, en fin de compte, parvinrent à les éconduire des territoires et de l’âme qu’ils auront envahis. Pour un temps. Long. Il s’ensuit qu’à mon avis toute victime de menaces et ou de guerres existentielles, même après les faits, surtout au niveau individuel, se doit d’être maîtresse de son destin, de sa vie. Elle ne doit pas se laisser aller. Parce que la vie n’est pas un fait accompli. La vie n’est pas acquise ou donnée. Qui plus est, chose cruciale, l’individu doit éviter de se voir imposer la signification à donner à sa propre vie. Cette signification ne peut venir que de l’intérieur de soi. De son intérieur vers l’extérieur, à la rigueur, mais non de l’Autre, ou de l’extérieur, vers soi. S’il existe des choix, c’est dans cette tranche nommée vie, cernée par les deux non-choix que sont la naissance et la mort, qu’il faut les faire, fraction d’existence, cette vie qui, si elle n’est pas conçue et pratiquée comme suggéré ici, résulterait en un renforcement de menaces, existentielles, invasives et criminelles, telles que la colonisation et les guerres mentionnées plus haut. Ces dernières se plaisent à imiter le phœnix ; elles tendent à renaître de leurs cendres pour continuer de menacer, sous de nouvelles formes, l’existence des naguère-colonisé.e.s d’Indochine, du Viêt-nam et d’Algérie. Mais, sans surprise, j’entends ces affranchi.e.s dire : nous ne nous tairons pas, même si absent.e.s ; du fond des ténèbres, nous répondons et répondrons présent.e.s ; face à et dans l’absurde, l’écho lointain de nos voix opaques déchire et déchirera le non-sens du présumé sens de ces guerres, surtout celle qui m’avait mise sur le chemin de nulle part et ou d’ailleurs…
Elle sait qui l’a remportée. Elle l’a étudiée au lycée – ou, était-ce au collège ? Elle ne saurait dire clairement, encore moins avec certitude, car l’ombre des années vécues très loin de son pays natal, belles dans l’ensemble, se console-t-elle, cette ombre-là tend à voiler la face, mais aussi les plus fines particules de ses leçons d’histoire, de ses lectures personnelles. Cela dit, il arrive qu’une partie de ses souvenirs, ayant pris forme vers ses six ans, émerge et transperce le voile du temps. Elle le dit souvent à son entourage curieux. C’est ainsi qu’aujourd’hui, assise au balcon du sixième étage d’un immeuble cossu, caressant son ventre enceint, d’avance réjouie d’accoucher prochainement, elle se sait chanceuse. D’être maman en devenir. De pouvoir élever son bébé dans un pays en paix. Sans stress ni risque de le voir enlevé, violé, tué, pense-t-elle sincèrement. Fortunée également, se considère-t-elle – pourtant – d’avoir eu des parents inconnus (d’elle). Du moins, tel est le cas chaque fois qu’elle songe à son arrivée dans un orphelinat de La Providence, où débuta le voyage existentiel qui allait créer et nourrir la personne qu’elle est devenue.
D’après ses observations et tout ce qu’elle sait aujourd’hui sur une bonne Sœur nommée Maryvonne – suite à une récente rencontre avec les ex-collègues de cette dernière dans son pays natal –, visage fin, taille moyenne, maigrichonne, pleine d’énergie, la nonne, qui lui semblait être parfaite, l’aurait sûrement beaucoup marquée naguère, un peu plus que les autres bonnes Sœurs s’entend. À La Providence régnaient l’amour, la bienveillance et l’envie de voir les pensionnaires voler de leurs propres ailes, même si une seule et unique voie leur était ouverte : l’adoption. Une vie d’orphelinat n’en est pas une, bien sûr, pense-t-elle, mais Sœur Maryvonne n’avait pas de défauts. Enfin, elle en avait un seul, ou deux, ou trois. Bref. Son défaut majeur était d’ordre philanthropique. Je parle de cette bonté aveugle vis-à-vis des défauts de ses pensionnaires. Patiente lorsqu’ils pétaient un câble, ou un plomb, bienveillante quand ils en voulaient au monde entier sans savoir pourquoi, Sœur Maryvonne savait conseiller ; elle ne ratait aucun anniversaire. As en catéchisme, elle savait faire aimer Jésus, la Bible et surtout l’image de la femme dans ce livre, saint pour des millions d’âmes à travers le monde : ses cours sur Marie Madeleine sont restés gravés sur la mémoire de plus d’une pensionnaire. Encore une fois, Sœur Maryvonne n’était pas la seule bonne-bonne Sœur, mais, selon le staff actuel de l’orphelinat, elle était de loin la meilleure : toujours plus fort, plus haut et plus loin y allait-elle, comme une olympienne, dans ma tête d’adulte je l’ai surnommée Olympe, tellement elle avait dû être, par le passé, courageuse, travailleuse et dynamique !
Officiellement retraitée mais vivant à l’orphelinat, où elle prêtait (une) main (plus si) forte à la Mère Supérieure et à ses jeunes nonnes locales, Sœur Maryvonne m’apprit qu’en fait je n’avais pas été orpheline. Elle me révéla que mes géniteurs – ils avaient vraiment existé et pouvaient être identifiés, à ma grande surprise d’alors ! – m’avaient sciemment offerte à La Providence, afin de m’assurer une chance de survie, puis de vie meilleure que les leurs, dans un pays apparemment préférable au leur, ce dernier sujet à une deuxième guerre en cinquante ans, contre des nations que ces géniteurs-là avaient dû voir/percevoir comme des messies, des sauveuses, des porteuses d’espoir pour leur propre patrie en proie aux communistes. Je n’avais aucun doute sur la magnanimité ou la générosité de ces géniteurs inconnus. De plus, être pris au piège de cette guerre-là (contre les USA et leurs alliés australiens, néo-zélandais et thaïlandais) ne pouvait être drôle ou pris à la légère ; selon les Sœurs Battersea (Maryvonne) et Véronique (Marie), en présence de la Mère Supérieure Bonnette (Marie Madeleine), mes géniteurs avaient fait pour leur enfant ce que tout bon couple chrétien aurait fait : bien, pensai-je, un jour je creuserai pour essayer d’en savoir davantage sur mes géniteurs, y compris leurs origines géoculturelles (région, village et j’en passe).
Elle explora une, deux, plusieurs fois. Et elle découvrit des choses, même si ses moments d’excitation se terminaient toujours en boule au ventre, en amertume, en regrets, qu’elle devait savoir gérer pour aller de l’avant…
Fractures de sens
Elle fit une pause pour réfléchir aux raisons et aux chances de réussite de sa quête familiale, approfondie par le biais d’objectifs clairs à atteindre. En tant qu’enfant adoptive des Darracq, se dit-elle, je me lance dans une quête familiale différente, afin de comprendre comment j’en suis arrivée à vivre ici, dans ce présent peu indicatif. Pourtant, présentement, en plus ou en dépit du fait que les Darracq et leur pote Bénou avaient manqué de satisfaire ma curiosité presque obsessive vis-à-vis de mon passé et, par là même, de m’ouvrir les portes d’un futur identitaire stable, je sais comment identifier les contours de la trajectoire qui mène à ce passé, même si, je dois me le rappeler, elle peut être porteuse d’éléments aptes à stopper net ma recherche intime. Je me considère effectivement comme l’un de ces êtres humains dont Amine Maalouf dit à juste titre qu’ils portent en eux « des appartenances qui, aujourd’hui, s’affrontent violemment ; des êtres frontaliers, en quelque sorte, traversés par des lignes de fracture ethniques, religieuses ou autres. » Et c’est précisément à cause de cet enchevêtrement de confrontations, d’affronts violents, que j’ai manqué (perdu ?) toute direction qui avait pu/aurait pu m’être donné. Parce que je ne pense, pas une seconde, la situation ci-dessus capable d’engendrer en moi, automatiquement ou par processus, une vocation d’unioniste, de quelqu’une qui unit, de constructrice de passerelles, ou de médiatrice communautaire et culturelle. Au contraire du Libano-Français Maalouf, je ne crois pas en une vocation à faire valoir, ni en un rôle à jouer, tout simplement parce que je serais un être frontalier. D’ailleurs, à mes yeux, tout le monde est frontalier. Qui plus est, si, en vertu d’une constitution frontalière toujours déjà donnée, cette vocation ou ce rôle pouvait « tisser des liens, dissiper des malentendus, raisonner les uns, tempérer les autres, aplanir, raccommoder », le monde aurait été un bien meilleur lieu de vie. De même, la deuxième guerre qui a ravagé mon pays natal, conflit déclencheur du voyage existentiel ayant abouti à ma récente végétation au sein d’un nulle part identitaire, n’aurait pas eu lieu. En somme, je me lance dans mon enquête familiale parce que, malgré mon identité, mes loisirs, en dépit/à cause de l’Église, des Darracq, d’Omar Aït Assad (mon’Om), de Bénou de Ré, etc., – tout un monde à découvrir –, je me sens perdue, je suis dépourvue de sens : c’est ce que je crois…
C’était effectivement un village. Le nom ne lui disait rien, mais l’emplacement géographique lui faisait appréhender ce qui avait pu motiver ses parents à la donner aux catholiques français, plutôt qu’aux Bouddhistes, Confucianistes ou autres Évangélistes américains… Ses parents s’étaient convertis au Catholicisme un peu avant la fin de la première guerre du Viêt-nam, celle d’Indochine s’entend, qui avait fait particulièrement rage dans la tristement célèbre cuvette de Diên Biên Phu, entourée de collines hautes de plus de 400 mètres, située près de la frontière avec le Laos. En effet, entre Mars et mai 1954, le Viêt-Minh, inférieur en nombre et sophistication d’armement, vint à bout du corps expéditionnaire français d’Extrême-Orient (CEFEO), chassant par là même la France d’une grande partie de l’Indochine. Puis, en juillet 1954, reconnaissant le gouvernement démocratique du Viêt-nam, les accords de Genève mirent officiellement fin à la guerre d’Indochine. Elle se dit : cela ne m’explique pas tout ! mais, dois-je blâmer quiconque m’aura mis à l’oreille la puce du questionnement jusqu’auboutisme ?
Oui.
Chez la Marianne noire, malgré les écoles privées, catholiques et strictes, où j’étais élève, l’esprit critique de la tradition intellectuelle française laïque s’installait progressivement et confortablement en moi. Au point qu’aujourd’hui je peux me demander : comment se fait-il que mes géniteurs, dont j’ai récemment découvert l’existence, m’aient donné précipitamment, malgré la tournure que prenait la deuxième guerre du Viêt-nam ? (En effet, à tout observateur averti, à tout acteur impliqué dans les deux guerres au niveau des renseignements généraux, ou encore, à quiconque sachant lire entre les lignes, très tôt, la chute du régime répressif et corrompu de Jean-Baptiste Diêm, 1955-1963, ainsi que celle du statu quo imposé par une France et une Amérique néo-colonisatrices, avaient été évidentes.) Pourquoi m’offrir à la France, maintenant qu’elle était vaincue, terminée au Viêt-nam ?
Son père biologique trafiquait des produits illicites. De temps en temps, il faisait de l’abattage clandestin de porcs et de volailles aux yeux et à la barbe d’autorités traditionnelles et administratives coloniales, incompétentes. De la sorte, du temps de la guerre d’Indochine c’est par la terreur et par l’intimidation, suivie d’une promesse de lendemains meilleurs pour sa famille, le tout combiné à un petit pécule pour toute information de valeur fournie, qu’il s’était fait recruter par la France. Jeune, sans instruction apparente mais ambitieux – il voulait partir à Sài-Gòn, puis à l’étranger : en France surtout – il avait finalement cédé aux pressions des services du renseignement du pays de la Marianne noire. Sa propre autorité et les pouvoirs de persuasion qu’il avait sur sa femme, timide, obéissante et « achetée » à coup de dot significatif, femme ayant eu fait trois fausses couches à l’époque de l’Indochine avant d’avoir eu son bébé, fille et unique, à l’aube de la seconde guerre du Viêt-nam, cette femme-là ne se fit pas prier lorsqu’il lui révéla ce qu’il avait fait pour la cause française. En utilisant des techniques similaires à celles de ses recruteurs, il embarqua cette dernière dans son aventure ténébreuse et la pressa sous le sceau de son secret traître.
Seulement voilà : les soupçons commencèrent à être éveillés au fur et à mesure que le couple se montrait confiant quant à l’issue de chacune des deux guerres, la seconde plus que la première, en même temps qu’il minimisait les avancées et victoires du Viêt-Minh, pourtant palpables dans des contrées aussi reculées que leur village. En outre, ce couple avait sous-estimé les compétences des services du renseignement de Hô Chi Minh (né Nguyen Sinh Cung) et de ses alliés. À ses risques et périls car, de manière inattendue, quatre individus frappèrent nuitamment à sa porte : munis d’une arme blanche et d’un pistolet. L’un d’eux, nouveau dans le village, à la fois voisin de maisons et de rizières, était en fait un Can Bo ou cadre d’État-major de Hô Chi Minh. Par intuition, ou après un tuyau, le couple avait pu s’en aller avant, fuir in extremis en n’emportant que le strict minimum, principalement de quoi se nourrir, leur fille tour à tour sur le dos de sa mère ou en kangourou sur la poitrine de son père, négociant un paysage dangereux de deux points de vue, au moins : des forêts luxuriantes bien connues d’eux, mais également la présence de Viêt-Minhs qui maîtriseraient encore mieux la topographie de la jungle vietnamienne. Et n’oublions pas que ces connards de GI peuvent nous flinguer ; nous n’avons pas intérêt à oublier nos codes ; ils prennent tous les Vietnamiens pour des Viêt-Cong, ces demeurés d’Américains ! Hé ho, ferme-la pour une fois, les Yankees ont été plus réglos avec nous que les Français, tu l’as dit toi-même ! lui rétorqua sa femme, d’habitude très silencieuse et d’apparence docile. Ils avaient du pain sur la planche, en tout cas, il leur fallait atteindre une zone sûre, que seul le mari semblait connaître, zone donnée par son agent responsable, pour des cas comme celui-ci où il devait fuir ses compatriotes ennemis. Sans oublier, enfin, les défoliants, l’agent orange, que les Américains déversaient sur le paysage pour détruire les récoltes mais par là même, causant de sérieux dommages à la santé des êtres humains.
Logis incendié, village ameuté. Quelques amis du couple intimidés, interrogés, torturés, puis abattus. Le Can Bo et ses acolytes Viêt-Minh se lancèrent vraisemblablement à leur trousse. Peut-être pas tous les quatre, probablement pas du tout, vu qu’à ce moment de la guerre, les hommes de Hô Chi Minh étaient équipés flambant neufs pour communiquer avec d’autres unités postées ailleurs, sans se déplacer ? Toutefois, pensant que ses traqueurs et leurs collègues communistes, éparpillés stratégiquement dans le pays en vue de la victoire finale, se trouvaient en terrain bien connu et n’avaient aucune pitié pour les traîtres, le couple se sentait poursuivi. À cela s’ajoutaient les aléas liés aux paysages traversés, principalement, les montagnes luxuriantes, la jungle et sa faune s’apparentant plus souvent Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad et son avatar filmique Apocalypse Now qu’à l’idéaliste Le livre de la jungle – même pour des Vietnamiens de leur trempe. La maman redoutait spécialement que des reptiles ne lui suffoquassent son bébé, pleureur au moins toutes les heures pour cause de grosse faim, si ce n’était pour que maman ne lui fasse une toilette sommaire près d’un cours d’eau. Et puis, il y avait la boue, les pluies à verse, souvent très violentes et apparemment interminables, les chemins escarpés, les ravins, les collines d’herbes folles et d’autres types de végétation inhospitalière, sans compter les piqûres d’insectes et de scorpions.
Mari et femme avaient des contacts dans des villages traversés, mais il fallait qu’ils se pressassent pour sortir de la zone hostile et regagner la liberté, rejoindre une base, un front, sans être trop sûrs d’y parvenir, après presqu’une semaine de cavale jalonnée de faim, de privation volontaire de sommeil et de stress. Il n’était surtout pas question de se faire prendre, car les yeux crevés à coups de crosse et le visage ensanglanté auraient été les moindres châtiments subis. Et puis, le couple se souciait de plus en plus de son bébé. Sa santé chancelait. Et il ne pouvait la laisser à leurs familles respectives nulle part. Car ces derniers auraient été interrogés. Pire, vu la situation de guerre et ses corollaires de manque de nourriture doublé de paranoïa ambiante, d’avoir eu une autre bouche à nourrir serait devenu problématique pour lesdites familles et, si elles n’étaient pas en mesure de répondre de la légitimité du nourrisson, suite par exemple, à une dénonciation aux communistes du Viêt-Minh, le risque de se faire arrêter ou tuer n’en devenait que plus grand. De plus, dans l’esprit du couple renégat en fuite, les Viêt-Minh étaient déjà conscients qu’ils avaient un bébé de moins de douze mois dans les bras. En même temps, dans leur village, une rumeur circulait selon laquelle le même couple n’avait pas eu de fausses couches mais que, durant la première guerre du Viêt-nam, la femme avait joué les mères porteuses d’une autre sorte pour des couples d’Américains en mal d’exotisme. Pacifistes et anti-guerre du Viêt-nam pour la plupart, ces Américains-là étaient particulièrement avides d’enfants vietnamiens à adopter : qu’y avait-il, à la fois de plus anti-communisme et anti-impérialisme américain que l’adoption d’un petit Vietnamien quelconque ? Allez chercher l’erreur…
En tout cas, aux yeux de l’enfant qui allait être adoptée en France, y grandir et narrer ce récit en cours, si ces histoires de mère porteuse étaient avérées, la complicité du mari devait être évidente, l’argent reçu certainement dérisoire et au-delà du pécunier, la motivation du couple incertaine pour ne pas dire inconnue. Néanmoins, la narratrice a toujours été surprise qu’un tel trafic d’êtres humains, du Viêt-nam aux différentes destinations sur le sol américain, ait pu se produire au sein de l’armée américaine. Elle était également intriguée par le succès de ce type d’opération, de cette arnaque – même si elle n’a jamais pu prouver que des militaires adoptaient les bébés en question, ce qui n’était souvent pas le cas, d’ailleurs.