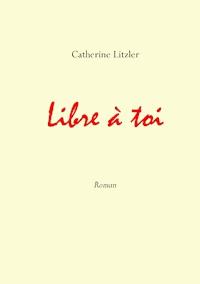
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Pour Catherine Litzler, le bien le plus précieux est la liberté. Dans son premier livre, elle a voulu rendre un hommage vibrant aux insurgés de la Commune et plus particulièrement à un de ses ancêtres dont l'histoire s'est perdue aux confins de la Nouvelle Calédonie. Entre chronique intimiste, récit historique et roman d'aventures, "Libre à toi" entraîne le lecteur dans un voyage spatio-temporel entre le Gers d'aujourd'hui, la Commune de Paris et le bagne de Nouméa durant les derniers soubresauts d'un XIXème siècle tonitruant. Un récit flamboyant duquel s'échappe à chaque page un vent de liberté ébouriffant.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 407
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Toute reproduction, même partielle, de cet ouvrage est formellement interdite sans l’accord de l’auteur.
Tous droits réservés pour tous pays. Dépôt légal : décembre 2015
Merci à Claude
pour son exigence, ses encouragements et sa confiance
Avec tout mon amour
À Marie et Bader
En hommage à mon mystérieux aïeul
« On ne fera pas un monde différent
avec des gens indifférents »
Arundhati ROY
Sommaire
Le carnet rouge
Liberté
Le 18 Mars 1871
La semaine sanglante
Satory
L'exil
La Nouvelle
La manigance
La vie de forçat
La belle
Quand enfin les rêves se réalisent
La grande traversée
Epilogue
« Il faut que tu viennes. Vite ! Ce week-end ! » avait crié Ludivine au téléphone. Clément avait senti son cœur battre comme aux premiers jours, soulevé par un fol espoir, prêt à y croire encore. Il n’avait posé aucune question, il lui suffisait de savoir qu’elle le réclamait.
En un tour de main il avait bouclé la dernière scène de sa pièce, délégué la charge de la première lecture à son assistante et annulé tous ses rendez-vous. Sans le moindre scrupule. Avec une jubilation qui accélérait les battements de son pouls, il avait extirpé de sous le lit son vieux sac tout avachi et avait ouvert les portes de sa penderie. Il avait hésité, choisi deux chemises, un jean, son pull préféré, un cachemire couleur anthracite, deux tee-shirts, avait ajouté une chemise élégante et un pantalon assorti. Puis il avait bourré chaussettes et caleçons dans les poches de côtés et son sac avait enfin retrouvé sa ronde bonhomie. Avant de l’endosser, il avait encore glissé dans la poche frontale la dernière BD de Duffaux, un livre d’Onfray, le Libé du jour. Dans l’ascenseur, il avait adressé un sourire satisfait à l’image que lui renvoyait le miroir : il s’était toujours senti plus jeune et plus beau avec ce sac sur le dos. Des ailes aux talons, il avait sauté dans le 93 et pu apprécier, en esthète qu’il était, la beauté de Paris tout en remerciant le printemps de raccourcir les jupes et de rendre les robes plus légères.
Gare Montparnasse, il avait joué des coudes pour monter in extremis dans le TGV de quatorze heures dix.
Clément loucha sur le poignet de son voisin assoupi. Seize heures. Deux heures encore ! se lamenta-t-il en bâillant. Le glissement monotone du train et la touffeur des moquettes l’anesthésiaient. La prochaine fois, je ne prendrai pas un e. zen, décida-t-il avant de s’enfoncer dans son fauteuil et de piquer un petit somme.
Un coup de sac sur la tête le réveilla. Sans s’excuser, son jeune voisin fila vers la sortie. Le train entrait au ralenti en gare de Bordeaux. Les passagers qui montaient à bord ignorèrent la place libérée à ses côtés, Clément étendit ses longues jambes engourdies en poussant un soupir d’aise. Quand le train repartit enfin, son cœur s’emballa et une vague d’euphorie accrocha un sourire à ses lèvres. Plus qu’une heure et je suis avec elle ! pensa-t-il. Il déplia nerveusement son journal, tenta de lire les nouvelles. Les grands titres sonnaient creux, les articles ne lui révélaient rien de nouveau. La tête ailleurs, il laissa tomber le journal sur ses genoux et regarda à travers la vitre.
Le train roulait lentement maintenant, trop lentement, il lui rappelait ce petit tortillard colombien qui les avait conduits en Guajira et qui était si lent qu’un cycliste les avait doublés, si lent qu’il avait pu lui cueillir des fleurs le long du fossé. Il y avait si longtemps… La vie passe aussi inexorablement que le paysage aperçu de cette fenêtre, songea-t-il. Il lutta contre la nostalgie d’un passé révolu. Il refusa de se projeter dans un avenir incertain. Il ne voulait penser qu’au présent, au bonheur de la retrouver, bientôt, bientôt. Les vergers, les maisons coquettes et les gares endormies défilaient sans qu’il y prête attention. Il avait beau essayer de régler son rythme cardiaque à celui, régulier et lent des boggies, les pulsations de son pouls restaient chaotiques. Ils se connaissaient depuis toujours, mais il savait qu’il faudrait un peu de temps, comme à chaque fois qu’ils se retrouvaient, pour abolir cette imperceptible et pourtant insupportable distance que la séparation physique créait fatalement entre eux.
Maintes fois, n’y tenant plus, il avait tout plaqué pour la rejoindre. Elle lui donnait rendez-vous sur un quai de gare, comme aujourd’hui. Elle apparaissait au milieu de la foule, ses grands yeux noirs se posaient sur lui, il retrouvait une insatiable soif de vivre. Mais tôt ou tard, leurs chemins se séparaient à nouveau et il rentrait à Paris. Seul. Le public, curieux de découvrir ses nouvelles frasques, l’attendait. Il écrivait dans l’urgence un scénario, une pièce de théâtre, quelques chansons. Il renouait avec la jet-set que son insolence divertissait. Il creusait son trou, se faisait une place dans la société. Il avait la reconnaissance des autres quand seule celle de Ludivine lui importait. Mais elle était ailleurs, loin, elle le privait de son soutien, de son approbation, de son sourire, de ses caresses, de ses baisers et il lui fallait bien s’accommoder de son absence, tenter de vivre sans savoir où elle était, ni avec qui. Le sentiment d’injustice qui alimentait son amertume, se transformait en rancune, voire en colère car Ludivine elle, ne semblait nullement souffrir de la situation. Elle partait le sourire aux lèvres, la jupe légère. Elle disparaissait pendant des mois, se contentant de lui envoyer de temps en temps une carte postale laconique :
« Ce monde n’est pas fait pour les assis, il est trop beau ! Nourris ta cervelle de beauté, tu verras, elle t’en sera reconnaissante et ne te fera plus souffrir ! Bises de Phnom Penh. »
Ou bien : « La meilleure mesure de la richesse, c’est de ne pas trop s’éloigner de la pauvreté ! Bisous tendres de Yogyakarta. »
Ou encore : « Nietzsche disait qu’être adulte c’est retrouver le sérieux que l’on mettait dans ses jeux, enfant. Es-tu vraiment sérieux cousin chéri ? Bisous de St Louis. »
Parfois c’était une grosse enveloppe, des photos d’elle, toujours souriante et il souffrait encore plus.
Une lettre reçue deux ans plus tôt avait bien failli changer leur destin. Un télégramme le fit.
La lettre venait de Mexico, elle était aussi longue que le télégramme fut bref.
Mon cousin préféré,
J’espère que tu vas bien. Moi, je jubile ! J’ai trouvé mon paradis au Mexique, je me pose ! Je construis quelques bungalows, j’ouvre une bonne table d’hôtes et je fais du tourisme vert ! Génial, non ? J’aurai sans doute besoin de toi…
J’ai déjà le terrain : deux hectares de prairie au cœur d’une petite vallée boisée, bordés à l’ouest par la rivière qui décrit un large coude (jolie plage de sable blond à l’ombre des grands arbres). J’avais vu un magnifique terrain près des chutes d’Agua Azul mais quand j’y suis retournée après les pluies, il avait disparu sous l’eau jusqu’à mi cocotier ! (Parait que c’est normal) Les bungalows devaient être perchés sur des pilotis de deux mètres cinquante de haut et pour accéder au terrain, il fallait traverser la rivière dans une caisse en bois suspendue à un câble tracté à la main. Pas idéal. J’ai renoncé.
Celui-ci est moins spectaculaire mais plein de charme. Je l’ai découvert au retour de ma visite des ruines de Tonina. Le passeur du rio avait vraiment une sale gueule. Son rire obscène m’aurait fichu les chocottes s’il n’avait pas eu au moins cent cinquante ans ! Sur la porte de sa cabane délabrée une chouette était clouée, les ailes grandes ouvertes. Ici la magie fait partie de la vie. J’ai filé et me suis retrouvée dans un bois étrange : on y avait planté en lignes des arbres aux troncs très droits, couronnés d’une cime légère qui filtrait les rayons du soleil. La lumière était diaphane, évanescente, un décor surréaliste ! J’avais fait à peine quelques pas que je me suis retrouvée coincée. Entre chaque arbre, à hauteur d’homme et barrant tout passage, de gauche comme de droite, devant comme derrière, des toiles d’araignées géantes ! Toutes habitées par des monstres poilus, gros comme mon poing ! (J’avoue que je n’en menais pas large.) Je me suis mise humblement à quatre pattes et j’ai rampé sous l’obstacle, tout en gardant le nez en l’air au cas où l’une d’entre elles aurait la mauvaise idée de me tomber dessus. Du coup, je n’ai pas vu où j’allais ! J’ai tourné en rond, je me suis complètement paumée, les araignées m’avaient prise à leur piège ! Je me voyais déjà engluée dans la soie, ficelée comme un saucisson, stockée dans leur garde-manger, attendant avec angoisse d’être bouffée par des milliers d’arachnides velus ! Et pour comble d’horreur, le rire obscène du vieux sorcier qui se rapprochait ! Soudain toutes les toiles se sont mises à vibrer frénétiquement comme si les bestioles m’envoyaient un dernier avertissement avant de fondre sur moi ! Du coup, j’ai pris mon courage à deux mains, j’ai respiré à fond et aléa jacta est, ventre à terre, j’ai foncé ! (Tu aurais certainement apprécié ma course en levrette !)
Je m’en suis sortie, tu t’en doutes. Couverte de boue et avec quelques égratignures sur les mains et les genoux mais je m’en suis sortie. Bon, tout ça pour te dire à quel point j’étais heureuse de me retrouver soudain au jardin d’Éden ! Je n’en revenais pas ! Exactement ce qu’il me fallait ! (On peut contourner le bois aux araignées pour y accéder, rassure-toi, je ne suis pas complètement folle !) J’espère qu’il te plaira. Je revois le propriétaire demain matin, il semble intéressé par mon offre. (Il s’appelle Oropesa : « pesant d’or », tu le crois pas !)
Pour les autorisations, visa etc., j’ai Juan-Carlos, un ami très fiable, il arrangera tout ça. S’il le faut, nous ferons un mariage blanc.
Clément avait bondi. Jusque-là, le romantisme de Ludivine l’avait fait gentiment sourire, tout juste grincer des dents mais là, elle dépassait les bornes ! Ça devenait ridicule ! Ridicule et dangereux. Elle était tombée sous la coupe d’un zocalo boy, un faiseur de charme, un soi-disant fils de prince maya, un séducteur d’aventurière esseulée, un gigolo, un manipulateur, un usurpateur, un voleur ! Et elle voulait s’établir là-bas ! Elle voulait se marier ! L’abandonner !
Malgré sa colère, il avait fait preuve d’une grande maîtrise pour lui écrire ceci :
« Ma chère cousine, ton inconscience et ton ignorance des réalités sont effrayantes ! Ne fais surtout rien, RIEN, tu m’entends, absolument rien, j’arrive ! En attendant, médite sur cette parole de l’anthropologue Toño Garcia de Leon : « Le sous-sol du Chiapas regorge d’Indiens assassinés, de bois pétrifiés, de villes abandonnées et d’océans de pétrole. »
Une fois de plus, il se retenait de lui dire qu’il l’aimait, qu’il était jaloux et qu’il ne pouvait supporter une telle séparation. Sous des oripeaux cartésiens, il dissimulait la véritable nature de ses sentiments.
Sa banquière s’était fait prier juste assez pour se faire mousser et Clément avait obtenu une rallonge à son découvert. Il avait acheté un billet et s’était envolé pour Mexico. De là, il avait pris un vol intérieur pour San Cristobal de las Casas puis un bus pour Palenque qui l’avait déposé à Ocosingo. De là, il avait marché jusqu’à la posada Agua Azul. « La seule du pueblo, tu ne peux pas te tromper, avait dit Ludivine au téléphone, c’est un véritable zoo ! Les Indiens capturent des animaux dans la forêt Lacandona et ce fumier de Pablo (le fils de la casa) les achète pour quelques pesos ou une bouteille de Tequila ! C’est révoltant ! Il faut faire quelque chose ! »
Le jaguarondi décharné avait feulé avec dédain, les perroquets déplumés avaient péroré, les buses éperdues poussé des cris pointus, les caméléons hallucinés viré de couleur et les atèles avaient fait un tel barouf dans leur cage que l’arrivée de Clément avait été annoncée bien avant qu’il n’atteigne l’étage. Pourtant, Ludivine n’était pas à l’accueil. Il avait donc dû enjamber l’affreux crocodile allongé devant sa porte, gueule ouverte, odeur fétide, œil fixe et glauque, hostile, avant que Ludivine apparaisse enfin. Bien que fort gironde dans sa petite robe blanche, elle avait mauvaise mine. Il se rappelait leur conversation d’alors, sans préambule, sans comment tu vas, ça fait longtemps, tu m’as manqué…, rien de tout cela avec elle.
– Oropesa n’en finit pas de tergiverser. Il prétexte la découverte d’un filon de pétrole dans le coin pour augmenter encore son prix ! Je crois qu’il me mène en bateau. Je commence à en avoir marre… Tu l’aurais vu se gratter le dos contre un arbre pendant que je lui parlais ! C’est un ours ! Un sale macho ! D’ailleurs, ils sont tous machos ici ! J’ai l’impression de retourner cinquante ans en arrière, de trahir mes aînées qui ont lutté pour la libération de la femme ! Je ne supporte plus ! Le plus terrible, c’est qu’il y a vraiment du pétrole ! Ce matin, sur le zocalo, j’ai vu une demi-douzaine de gros durs avec des casquettes de la Pemex. Ils sont venus s’asseoir à la terrasse du café, juste à côté de moi. Ils n’ont pas arrêté de me reluquer en échangeant des propos salaces. Ils avaient tous la pistola à la ceinture… Si le coin regorge de pétrole, je suis foutue ! Adieu veau, vache, cochon, couvée !
Clément avait à peine caché son sourire de satisfaction. Elle flanchait, il fallait porter l’estocade :
– Sais-tu ce qu’ils écrivent dans la Jornada ? Que la réforme agraire n’est jamais arrivée jusqu’au Chiapas, que des communautés entières ont été chassées de leurs terres par les grands propriétaires, comme ton Oropesa et que ces dix dernières années, plus de quinze mille indigènes sont morts de faim, de maladies, ou purement assassinés ! Mais les insurrections du XVII° et du XIX° siècle restent vives dans la mémoire des Indiens. Selon la rumeur…
– Ah ! La rumeur… Il est vrai qu’au Mexique la rumeur est beaucoup plus fiable que la presse, censurée ou en cheville avec le PRI. Soixante-quatorze longues années d’élections truquées, tu te rends compte ! La plus vieille dictature du monde !
– En tout cas la rumeur dit que Zapata est de retour.
– Mais Zapata n’est jamais parti ! « Regard liquide sous son grand sombrero, il va por los montes, el caballero fantasma, Emiliano Zapata ! » Et derrière les sabots de son cheval, il traîne les indigènes ! Armés de fourches, de piques ou de bâtons, prêts à tenir tête à la police et à l’armée, et ce malgré les appels à la prudence du chef de l’opposition Cuauthémoc Cardénas ! Tu vois, je ne suis pas si ignorante…
– Ocosingo est considéré comme un nid de zapatistes. Leur chef, le sub-comandante Marcos, se cacherait dans les environs. Tu es tombée en plein panier de crabes ma pobrecita ! Et ne me dis pas que la cause des Indios est juste et que tu es prête à la soutenir, parce que tu ne comprends rien à ce foutu pays et tu n’imagines pas dans quel pétrin tu vas te mettre ! Crois-moi, la seule chose à faire c’est de déguerpir en vitesse !
Il avait tout fait pour l’éloigner d’Ocosingo, de la guérilla, et surtout de Juan-Carlos, trop beau, trop malin, trop dangereux. Il lui avait suggéré de prendre du recul « pour mieux réfléchir » et avait aussitôt acheté deux billets de bus pour le Yucatan. Ils s’étaient posés sur une plage à Tulum et avaient vécu une semaine idyllique. Dans ses bras, Ludivine avait semblé oublier ses rêves insensés.
De retour en France, Clément était resté sans nouvelles d’elle pendant des semaines. Inquiet, il avait guetté la moindre information provenant du Mexique. Il ne savait que craindre le plus : une révolte indienne ou le zocalo boy ? Il avait passé l’été à se ronger les ongles. Rien ni personne, pas même la belle Barbara avec qui il avait eu une aventure torride, n’avait pu lui faire oublier Ludivine.
Début septembre, alors que son moral était aussi gris que le ciel de la rentrée, il avait enfin reçu une lettre provenant de Mexico D.F
Quérido Primo
J’ai reçu un télégramme hier. Juste deux mots, assassins : « Parents décédés »
C’est drôle, je n’arrive pas à pleurer.
Je suis chez l’ami Benjamin. Il est minuit, dehors la ville gronde. Il fait chaud, je n’ai pas sommeil, j’ai envie de te parler.
Depuis que tu es parti, j’ai pas mal bourlingué, au Bélize, au Guatémala. Et puis j’ai eu envie de revoir encore une fois Ocosingo.
Je ne suis pas triste non plus.
Je vais tout te raconter. Tu as le temps ? Prends-le si tu m’aimes un peu.
Au commencement, était Hanuman.
Tu sais combien j’avais le cœur fendu chaque fois que je traversais le zoo de l’infâme Pablo ?
Ce jour-là, Pablo avait une nouvelle victime : un bébé singe hurleur qu’il avait attaché au bout d’une courte corde tout en haut d’un arbre, avec juste quelques tortillas à manger et un carton pour dormir. Un si mignon bébé singe !
Cette fois, c’était too much. Il fallait sauver le singe Hanuman ! (C’est le nom que je lui ai donné.)
J’ai décidé de l’enlever.
Le télégramme a précipité les événements.
Voilà ce qui s’est passé.
L’heure de la siesta. Ocosingo est écrasé de chaleur. Calme plat dans la maison. Un répit pour les animaux.
Je suis dans notre petite chambre (la rose et jaune), le ventilateur ronfle au plafond (il est toujours aussi inefficace !) Je suis nue dans mon hamac, en proie au coma des tropiques. Je balance entre rêves lourds et élucubrations fantaisistes quand soudain j’entends la voix de fausset de Pablo. Il hurle mon nom. Apeurés, les animaux reprennent leur barouf infernal. Je finis par me lever, de toute façon la sieste est foutue. Encore vaseuse, j’ouvre la porte, (mais oui, je me suis habillée), j’enjambe Chicot (tu n’as pas oublié ce cher vieux croco !) toujours fidèle au poste, sa belle gueule grande ouverte sur ses innombrables dents pourries, je me penche, Pablo vocifère sous mon balcon. Plutôt que de se fatiguer à monter un étage, ce cabron me tend une longue perche. Piquée à un clou, une enveloppe bleue : le télégramme susdit.
Je l’ouvre, lis : « parents décédés », le chiffonne et le mets dans ma poche.
Rien. Aucun effet.
Je le reprends, le défroisse, le relis, toujours rien ! Pas une larme, pas un sanglot, rien, je le remets dans ma poche.
Et là j’éclate de rire !
Tu crois que c’est normal ?
Je décide de partir. Le soir même. Avec Hanuman.
Je le confierai à mon amie Pilar, il sera bien dans la réserve de Tuxtla.
Je prépare mon sac et j’attends que les derniers borrachos ronflent dans le caniveau.
Je descends, mon sac sur le dos et mon coupe-ongles à la main. Déterminée, je vandalise les cages ! J’arrive à faire des trous assez gros pour laisser passer les oiseaux et tu sais quoi ? Pas un ne moufte ! Étonnant non ? C’est une buse qui s’envole la première ! Depuis, je lève la tête quand j’entends un cri pointu. Tu imagines ma joie ! J’espère que les autres ont suivi.
Après ça, je grimpe à l’arbre, je surprends le bébé endormi, il a à peine le temps d’ouvrir les yeux que je l’enfourne déjà dans mon sac ! (J’avais prévu son couffin) Le tour est joué !
Ne me reste plus qu’à filer au terminal.
Le premier bus part à cinq heures. J’attends, avec quelques Indiens quand au bout de la rue se pointe un cavalier sur son cheval. Oropésa ! Je fais mine de ne pas le voir, il met pied à terre et m’accoste :
– Vous partez señorita ? Pourquoi ? Les zapatistes ? Faut pas avoir peur de ces sales indiens, notre armée est forte, un beau trou dans leur tête de sauvage et tout sera réglé !
Puis d’un air mielleux :
– Je vous trouve très sympathique señorita et muy muy bonita. Pour vous, je peux baisser mon prix. Je suis sûr que nous allons trouver un accord, dit-il en posant sa grosse main moite sur mon épaule.
Le salaud ! J’avais envie de le gifler, de lui cracher à la figure, de lui sauter à la gorge, de… Hanuman a fait mieux.
Le bus se pointe, tout brinquebalant et pétaradant, un bruit infernal. Je sens bouger dans mon dos, Hanuman panique, moi aussi : ils vont m’arrêter pour vol ! Me jeter dans leur prison infâme où ils m’oublieront ! Je vais croupir là des années, sans que personne ne le sache ! Sans jamais revoir mon cousin préféré !
C’est alors qu’Hanuman bondit hors du sac comme un diable de sa boîte ! Oropésa ouvre de grands yeux et reçoit une énorme giclée de diarrhée verdâtre sur sa sale gueule ! Sa belle chemise blanche change de couleur ! Un vrai bonheur !
Il a hurlé comme un putois ! Moi, j’ai vite remballé Hanuman et j’ai sauté dans le bus. On est parti aussitôt. Ce singe est l’esprit des Mayas, je l’adore !
Le soir, on fait escale à San Cristobal. Je prends une chambre dans un hôtel bon marché et installe confortablement mon bébé dans le tiroir de la commode. Il s’y trouve bien. On bavarde un peu (je sais parler singe hurleur, je te montrerai, il faut gonfler le cou, un peu comme un pigeon, ouvrir la bouche en cul-de-poule et émettre des sons de la gorge en tâchant d’impressionner beaucoup).
Hanuman finit par s’endormir, moi aussi.
Le jour se lève. Hanuman aussi. Je le vois de mon lit qui sort de son tiroir, saute par terre et se dirige vers le coin toilette ! Il patine bien un peu sur le carrelage mais réussit à grimper sur le lavabo et… se met à pisser dedans !
Je lui ai acheté trois belles bananes bien mûres.
Pilar prend soin de lui.
J’ai pleuré en le quittant.
Tu trouves ça normal toi ? Je pleure pour un singe et pas pour mes parents.
Voilà, j’arrête de te faire perdre ton temps. Prends bien soin de toi cousin chéri. Carpe diem.
Ah, j’oubliais : je rentre. Je serai à Paris le 17 à 20 heures.
Baisers.
P.-S. : Seras-tu à l’aéroport ?
Clément avait attendu Ludivine à Orly. Il aurait voulu que le monde soit plus beau, que la nuit soit plus douce, que Paris brille davantage. Il aurait voulu couvrir le sol de pétales de roses pour elle. Il l’attendait le cœur battant, un petit bouquet de fleurs à la main.
Ils s’étaient rendus à Aubervilliers dès le lendemain pour apprendre que la mère de Ludivine avait eu un cancer généralisé, qu’elle était condamnée et que son mari avait choisi de partir avec elle. Il l’avait débranchée et s’était mis une balle dans la tête.
Tante Bibiane avait remis à Ludivine l’urne contenant les cendres de ses parents et la clé de leur appartement, rue Montorgueil.
Au grand dam de Clément, Ludivine s’était empressée de vendre l’appartement parisien et d’acheter une vieille bicoque à la campagne. Ils y fêtaient le nouvel an avec des amis lorsque Benjamin téléphona de Mexico pour annoncer que les zapatistes avaient pris possession de la ville de San Cristobal de las Casas, à l’aube, sans un coup de feu !
Le visage cagoulé de Marcos fit la une des journaux. Les représailles commencèrent à Ocosingo, place du marché. Deux cents Indiens furent tués. Nombre d’entre eux, d’une balle dans la nuque.
Ludivine vivait seule, loin du fracas des villes, au milieu de nulle part. Aussi paumée qu’au Chiapas.
Quand Clément venait la voir, le temps d’un week-end, il donnait un sérieux coup de main, coupait du bois, débroussaillait les abords de la source, retournait le potager, tondait la prairie. Il était plutôt bien dans sa peau, la vie lui paraissait plus facile, il avait plaisir à cueillir les fleurs des fossés. Mais, comme toujours, le lundi matin, il repartait seul.
« Paris t’attend, tu as besoin de ta ville » lui disait-elle moqueuse en le poussant dans le train.
Il lui faisait signe derrière la vitre, la regardait disparaître, avalée par l’escalier tandis qu’il s’éloignait lentement, persuadé qu’il n’était pour elle qu’une parenthèse sympathique.
Le train venait de prendre de la vitesse. La dernière ligne droite, se dit-il en rassemblant fébrilement ses affaires.
– Agein, Agein, 3 minut-tes d’arré !
L’accent chantant du chef de gare sema un rayon de soleil sur le quai. Devançant la foule, Clément dévala l’escalier, traversa le tunnel à grandes enjambées et gravit les dernières marches au ralenti. En haut, Ludivine l’attendait.
– Hum ! Tu sens bon ! dit-elle le nez dans son cou.
Les voyageurs contournèrent le couple enlacé sans faire de bruit. Ludivine entraîna Clément vers la sortie. Ébloui, il mit une main en visière devant ses yeux. Le ciel m’a toujours paru plus lumineux ici, plus haut, plus grand, pensa-t-il.
– Tu as toujours ta vieille Citroën ?
– Et toi, toujours ton vieux sac à dos ?
– On s’attache, que veux-tu. Tu as l’air en forme…
– Ça va. Et toi ?
– Ça va.
– Je suis contente que tu sois là.
Sourire de Clément. Tout à son bonheur intact, il admirait le spectacle qui s’ouvrait devant lui. Le soleil avait entamé sa course lente. Un vent léger s’amusait à effilocher les rubans roses et rouges qu’il laissait flotter au ponant.
Ils étaient vite sortis de la ville pour passer au vert. Vert tendre des prairies, vert émeraude des blés en herbe, vert chrome des buissons, vert jaunissant des colzas, vert rosissant des fruitiers. Toute en rondeurs et en courbes lascives, la campagne s’étirait à perte de vue, sans rien qui vienne heurter le regard. De-ci de-là, une ferme en pierre blanche, comme une perle sur son écrin de verdure. De la terre chaude montaient des parfums de fleurs. Clément sentit une douce ivresse ouvrir en grand son cœur. Il se tourna vers Ludivine concentrée sur sa conduite. Il prit plaisir à contempler ce visage qu’il connaissait par cœur, suivit des yeux la courbe du nez, long et sensuel, le dessin des lèvres couleur de figue, l’arc du sourcil noir, semblable à l’aile d’un oiseau en vol, la pommette haute, tachée de rouge, l’empreinte d’une larme brûlante.
– Ne me regarde pas comme ça, c’est mon mauvais profil !
– Tu m’as manqué.
– Ça fait combien de temps ?
– Deux mois. La dernière fois, c’était le 15 février, à Paris. Tu es partie aussitôt après la représentation. J’ai pensé que je t’avais déçue…
– Pas du tout ! Ta pièce était super ! “To be two or not to be two ?” Excellente question… et très bon titre !
– C’est déjà ça.
– J’ai ri mais…
– Mais ?…
– Mais j’ai aussi grincé des dents.
– Aïe !
– Quel cynisme aussi ! Ça ne te va pas ! Tu as bien trop d’orgueil pour être cynique.
– Si j’étais si orgueilleux, crois-tu que je m’exposerais ainsi ? Je ferais comme toi, je m’isolerais comme un ermite.
Ludivine se réjouit en son for intérieur de constater que Clément tenait la forme. Le week-end allait être animé.
– N’empêche, affirma-t-elle, la vie à deux ce n’est pas du tout ce que tu décris !
– Ah ! Je reconnais en toi la grande spécialiste du couple !
– J’ai quand même une petite expérience. Avec toi notamment…
Clément détesta ce « notamment ». Ludivine poursuivit :
– Tu prétends dans ta pièce que chacun, inévitablement, veut rendre l’autre conforme à ses désirs, qu’on passe son temps à vouloir le faire plier, à le casser, et tu appelles ça de l’amour ! Dépendance, pouvoir, soumission, tout ce que tu voudras mais pas amour ! Tu veux que je te dise : ton couple manque de démocratie ! Venant d’un anarchiste comme toi, ça me déçoit un peu…
– J’ai esquissé une sorte de caricature du couple pour mieux dénoncer ses travers, se défendit-il.
– Alors disons que la caricature n’est pas ma forme d’art préférée. J’ai quand même bien ri.
Clément se tut. Il n’aurait pas cru que la critique de Ludivine lui ferait aussi mal. Moi qui ai écrit cette pièce pour elle, pensait-il, je me suis bien planté.
Dans sa fuite, le soleil avait emporté les couleurs. Le ciel était gris maintenant, chargé de gros nuages noirs que le vent poussait vers eux.
– Il va pleuvoir, dit-il radouci.
– C’est embêtant, mes essuie-glaces ne sont plus très efficaces. En plus j’ai des fuites au toit ouvrant.
Clément lorgna d’un air suspect le plafond et força sur la poignée pour bloquer l’ouverture.
– Pas la peine de mascagner, c’est le caoutchouc qui est poreux. Je vais prendre un raccourci. Avec un peu de chance, on arrivera avant la pluie.
Ludivine coupa aussitôt la nationale et s’engagea sur une piste étroite, mangée par les herbes folles et constellée de nids-de-poule.
– Tu vas trop vite ! se plaignit Clément.
– Tu te souviens de notre safari en forêt Lacandona ? Même scénario qu’aujourd’hui. L’orage nous pousse au cul, il faut forcer l’allure pour arriver à bon port avant qu’il nous tombe dessus ! dit-elle en écrasant le champignon.
Clément serra les dents et se cramponna de la main droite à la poignée de plafond.
– T’es sûre que c’est un raccourci ?
– Sûre. Ceci dit, j’ai bien peur qu’il soit trop tard, le ciel va nous tomber sur la tête.
Un fracas assourdissant vint aussitôt confirmer ses craintes : des trombes d’eau s’abattirent violemment sur eux, martelèrent sauvagement la tôle de la vieille Citroën. En quelques minutes la piste devint un trou aqueux, à peine visible dans les phares. Les essuie-glaces qui rayaient le pare-brise en un va-et-vient douloureux, ne parvenaient qu’à faire grincer des dents. Penchée en avant, Ludivine répétait bêtement qu’elle n’y voyait plus rien ce qui n’était pas fait pour rassurer Clément.
– Eh merde ! Manquait plus que ça !
– Quoi ?
– Ça goutte.
– Aïe, c’était sûr. Je suis désolée… Tu n’as qu’à reculer ton siège.
Clément obtempéra mais n’obtint qu’une délocalisation du problème. Avec la régularité exaspérante d’un métronome, la fuite d’eau vint inonder sa cuisse gauche. Croisant rageusement les jambes, il se tordit vers la droite, se colla à la vitre, puis, perdant patience :
– C’est un véritable hammam là-dedans ! Tu n’as pas de désembuage ? Non, bien sûr. Une peau de chamois ? Faut pas rêver ! Ah ! Un kleenex ! Génial ! Maintenant y a des pluches partout !
– Tais-toi, tu augmentes l’effet de serre.
– Saloperie de toit ouvrant ! Il me pleut sur le crâne maintenant ! Je te préviens, je ne supporterai pas ce traitement longtemps. C’est quoi ? Un test d’endurance pour citadin ? Faut payer de sa personne pour être admis dans ta cambrousse ? !
– Arrête de râler ! Tu me distrais et je ne sais plus où je suis !
Ah si, ça doit être là, à gauche… Tout va bien, j’ai retrouvé le chemin vicinal.
– Le bonheur !
– Allons, réjouis-toi, y a un bon petit confit de canard qui t’attend à la maison ! Dans un quart d’heure on y est ! Promis.
Ludivine avait beau être bonne cuisinière et lui mourir de faim, il commençait déjà à regretter Paris, ses lumières et ses avenues bien tracées. Il en serait même venu à regretter les taxis de la capitale s’il ne s’était souvenu de la muflerie de la plupart des chauffeurs.
Quand Ludivine pila, il se sentit à deux doigts de l’infarctus.
Raide sous la pluie battante, Clément serrait les dents. À ses côtés, Ludivine sanglotait, le visage dans ses mains. Sur le bitume, au milieu d’une flaque de sang que diluait déjà la pluie, un lapin éventré vomissait lentement ses boyaux.
– Quelle horreur ! C’est la première fois que ça m’arrive ! Même les grenouilles, même les souris, j’ai toujours su les éviter ! Pourquoi ? Mais pourquoi justement ce soir ! Quel massacre !
– N’exagère pas, ce n’est qu’un lapin. Et il n’avait même pas d’éclairage !
– Tu trouves ça drôle ?
– Bon. Et y a quoi au programme maintenant ?
Ludivine contempla hébétée la voiture immobilisée, le nez dans le fossé.
– Il y a une ferme un peu plus haut, renifla-t-elle, on va aller demander de l’aide. Viens.
Elle fonça tête baissée. Clément la suivit sans broncher dans la pénombre, au milieu d’un no man’s land coassant. La pluie coupante lui collait la chemise à la peau et lui glaçait les sangs. Le chemin de terre montait dur. Il trimballait un kilo de terre sous ses chaussures de cuir qui, à chaque pas, menaçaient de rester engluées. Heureusement, là-haut, comme la promesse d’une rédemption, une petite lueur brillait à un carreau de fenêtre. Déjà à l’abri sous le porche de la ferme, Ludivine attendait qu’il la rejoigne pour soulever le heurtoir et frapper trois coups à la porte.
« C’est ouvert ! » leur cria-t-on de l’intérieur.
Elle poussa la lourde porte et un gros chat tigré fila dans la pénombre du couloir. Une odeur de cendre froide vint piquer leurs narines. « Entrez donc ! Par ici ! » La voix, dont l’accent roulait comme une pierre moussue sur le dos d’une prairie, était caverneuse, celle d’un vieux fumeur. Ludivine précéda Clément dans la vaste cuisine. Une lampe pendue au plafond éclairait faiblement la nappe blanche d’une table ronde. Deux hommes se tordirent sur leur chaise pour dévisager les intrus. L’un, d’âge canonique, un béret noir vissé sur la tête, avait la trogne d’une pomme blette. L’autre, plus jeune, la pipe au bec et le regard vif dans une figure bien faite, s’exclama joyeusement :
– Ah mais c’est la petite demoiselle d’Ous Paradies ! Entrez, entrez donc ! C’est pas un temps à se promener dehors ça ! Assoyez-vous et racontez-nous : qu’est-ce qui vous arrive ?
– Excusez-nous de vous déranger, commença Ludivine, toujours debout.
– Mais vous dérangez pas ! Assoyez-vous donc ! Vous connaissez votre voisin Maurice Davas ? Il est de la Pradiasse, la ferme qui est juste avant la vôtre, à dix minutes de marche !
L’homme souleva brièvement son béret.
– Ah oui, bien sûr, répondit sans conviction Ludivine. Voici mon cousin Clément, il arrive tout juste de Paris.
Clément serra les deux mains tendues. Bien que dissimulés par les moustaches, les sourires des deux hommes lui semblèrent pour le moins goguenards.
Un pas alerte résonna sur les tomettes du couloir. Tout le monde tourna la tête vers la porte, une sexagénaire de belle allure fit son entrée.
– Ah ! Achi lou gouverroment ! Vengnes nous espiouna ? (1) demanda l’homme à la pipe.
La femme haussa les épaules puis, avec un grand sourire :
– Ah bonsoir Ludivine ! Bonsoir… c’est ton cousin ? Il est trempé comme une soupe ! Et bien Roland, qu’est-ce que t’attends pour allumer le feu ? Tu vois pas qu’ils sont transis ?
(1) Voilà le gouvernement ! Tu viens nous espionner ?
– Bouto lus beyres aou loc de rouspeta ! Arré coumo un petit Floc eri de resaouhura lou guisé ! (1) affirma Roland en se frottant les mains. Puis se levant, il alla déposer un petit fagot dans l’âtre, tira un zippo de la poche de son pantalon, le fit claquer sur sa cuisse, enflamma un papier journal et le fourra sous le bois. Le feu prit aussitôt. Avec un soupir d’aise, Clément offrit son dos à la chaleur de la flamme.
– Nous venons d’avoir un petit accident, annonça Ludivine. Oh, rien de grave mais nous allons avoir besoin de votre aide pour sortir la voiture du fossé, ajouta-t-elle avec un minois qui se voulait irrésistible.
Les deux hommes se regardèrent mutuellement sans réagir. La femme posa cinq petits verres à pieds sur la table, les remplit d’une liqueur dorée et s’assit :
– Santat !
Le Floc était une douce caresse pour les gosiers, les petits verres se vidèrent d’un trait. La femme les remplit aussitôt, puis, s’adressant à Maurice :
– Alors ? Tu l’as retrouvée ?
– Toujours pas Michèle. Aro hétres jours d’ambé. Aquet tems va este bero coumo aquet parisien té ! (2)
Les rires fusèrent franchement. Clément interrogea Ludivine du regard. Avec un sourire indulgent, elle haussa les épaules et s’envoya une lampée, petit doigt en l’air.
– Bah ! C’est une coriace ! Et pis trois jours, c’est rien qu’une petite fugue, ça peut arriver hein ?
Michèle s’était adressée à Clément. Il répondit, énigmatique :
Sors les verres au lieu de rouspéter ! Rien de tel qu’un bon petit Floc pour vous réchauffer le gosier !
Ça fait trois jours maintenant ! Et par ce temps, elle va être dans un état ! Comme ce Parisien tiens !
– Trois jours c’est rien, j’en connais qui partent bien plus longtemps que ça…
– Ah bon ? Parce que vous aussi à Paris, vous avez des blondes ? s’étonna Maurice.
– Heu… Des blondes… des brunes aussi.
– C’est toutes les mêmes ! constata Maurice en secouant le chef. Ah ! Ces femelles !... L’aura sans doute trouvé plus couillu ailleurs…
Clément fronça le sourcil. Il avait comme l’impression que quelque chose lui échappait. Michèle lui versa un troisième verre, il l’accepta avec reconnaissance.
– Et votre affaire, elle s’est passée où ? demanda Roland.
– Juste en bas de chez vous, répondit Ludivine. J’ai freiné, la voiture a glissé et s’est mise dans le fossé.
– On verra ce qu’on peut faire quand il fera sec.
Clément ouvrit de grands yeux effarés.
– Va falloir rester là ? Attendre des plombes ? Sans rien manger ? souffla-t-il à l’oreille de Ludivine. Mais le petit doigt toujours en l’air, elle sirotait son Floc et l’ignorait royalement. Je suis tombé dans un guet-apens ! se dit-il intérieurement en vidant son verre d’un trait.
– Vous inquiétez pas, ça va pas durer, le rassura Michèle tout en le resservant, ça ramollit déjà. Puis s’adressant à son mari :
– Et pourquoi tu sors pas le pendule toi ?
– J’ai pas attendu les ordres du gouvernement pour savoir ce que j’ai à faire ! répondit Roland en allumant sa pipe. Elle est repérée, du côté d’Espeyrous.
– Il ne pleut plus ! J’vous avais bien dit que ça durerait pas !
– Boun, y ban suy pressat d’ana à Espeyrous (1), dit le vieux en se levant de sa chaise. J’la ramènerai en lui bottant le cul. Ça lui passera l’envie de recommencer à la blonde !
(1) Bon, allons-y, j’suis pressé de filer à l’Espeyrous
Clément sentit qu’il déraillait. Son cerveau, trop longtemps mis à rude épreuve et passablement embrumé par l’alcool, lui envoyait des images gores où un drame de la jalousie en milieu rural tournait au massacre à la tronçonneuse, décapitation à la hache, déchiquetage à la broyeuse pour s’achever dans une mare de sang où barbotaient des canards aux dents longues. Paniqué, il tenta de se raccrocher à Ludivine qui l’observait d’un air désolé :
– D’Aquitaine, daigna-t-elle enfin préciser. La blonde d’Aquitaine. Une vache quoi !
Maurice fronça le sourcil, qu’il avait fort dru et en bataille, Roland, la pipe entre les dents, se fendit d’un sourire narquois et Michèle, la main devant la bouche, pouffa de rire. Clément lui, se tassa sur sa chaise.
– J’prends une lampe et je vous accompagne, dit Michèle, en fouillant dans un tiroir de la table, encore secouée par le fou rire.
Visiblement satisfait de l’effet produit par la gasconnade sur un Parisien fraîchement débarqué, Roland prit son temps, tira longuement sur sa pipe avant de se lever, secoua patiemment sa braise dans la cheminée puis, d’une voix posée, accorda enfin le feu vert.
Tout le monde lui emboîta le pas. Ils descendirent le chemin à la queue leu leu. Clément retrouva la boue avec résignation et suivit tant bien que mal. Sur la route, les phares de la vieille Citroën éclairaient crûment le cadavre du lapin éventré.
– Ben vous l’avez pas raté celui-là !
– Je suis désolée.
Les deux hommes descendirent dans le fossé.
– Il nous manque le troisième homme ! dit Roland avec cet accent chantant qui donnait de la légèreté à ses injonctions et avait le don d’agacer Clément. Il descendit à son tour, dérapa, se ramassa sur le cul, constata le sourire sous les moustaches, se redressa sans broncher, releva courageusement les manches, cracha dans ses mains et s’arc-bouta pour soulever le bas de caisse.
– Oh hisse ! crièrent les autres.
– Oh hisse ! reprirent les femmes là-haut.
Dans un bel élan la voiture rebondit sur le bitume, le nez dans l’axe de la route et Ludivine reprit sa place au volant. Clément s’assit à ses côtés, sur le siège mouillé, regarda ses mains, ses vêtements, se demanda où il était et ce qui s’était passé depuis ce matin lumineux où Paris brillait sous le soleil printanier, il y avait un siècle, sur une autre planète.
D’un coup de botte, le lapin, du moins ce qu’il en restait, rejoignit le talus.
– Pouvez y aller !
– Merci ! Adishatz !
Un renard gris, museau pointu, queue à l’horizontale, leur coupa bien encore la route mais Ludivine assura parfaitement : son coup de frein efficace permit au renard de passer son chemin et à Clément de s’en tirer avec une petite bosse au front. La lune souriante faisait miroiter le macadam détrempé d’où s’échappaient des brumes joyeuses comme des feux follets. Au détour d’un chemin blanc, la maison apparut.
Debout devant la porte, Clément n’avait qu’une hâte : se changer. Se laver et se changer. Mais avant cela, il lui fallut encore attendre, raide et digne, que Ludivine trouve la clé au fond de son fourre-tout. Pour masquer son impatience, il leva le nez et contempla la façade éclairée de lune. Avec ses deux petits faîtages relevés comme des sourcils, la maison tricentenaire avait un air de jeune fille facétieuse.
– Finalement tu l’as trouvée.
– Non pas encore, dit Ludivine en continuant à explorer son sac.
– Je parle de ta maison. Elle te ressemble.
– Ah bon ?... Ah, ça y est, je l’ai !
Un crapaud les accueillit sur le seuil de pierre et un chat noir se faufila comme une anguille entre leurs jambes. Clément reconnut le parfum familier de l’encens préféré de sa cousine. Son cœur s’emballa. Il marqua un temps d’arrêt avant d’entrer dans le monde de Ludivine.
– Bienvenue mon cousin chéri ! dit-elle. Pendant que tu te changes, je prépare un ti-punch, ça te réchauffera !
Clément fila à la salle de bains, enleva avec soulagement ses vêtements maculés de boue et s’octroya une douche très chaude. Puis il alla dans sa chambre et se jeta sur le lit, s’étira de tout son long, testa le matelas, se souvint qu’il avait toujours bien dormi ici, poussa un long soupir de bien être et laissa son regard errer dans la vaste pièce. Le mobilier était sommaire : une table en bois clair, une chaise cannée, une lampe avec une nasse en roseau de Lombok en guise d’abat-jour, un panneau de photos sur le mur blanc près d’un planisphère obsolète, un kilim usé au sol, un sari bleu turquoise camouflant une penderie bricolée avec un bambou suspendu à la poutre par des bracelets brésiliens. Ludivine avait toujours eu un faible pour les structures légères, constata-t-il avec amusement. « Je ne suis qu’une passante dans la longue vie de cette maison, elle m’abrite momentanément, je lui appartiens plus qu’elle ne m’appartient » aimait-elle répéter.
Je la soupçonne d’arrière-pensées plus pragmatiques. À mon avis, la précarité la rassure. C’est une nomade, elle se veut libre de partir à tout moment et ne tolère un fil à la patte qu’à la condition que ce fil cède facilement ! pensa-t-il amèrement en croisant les mains sous sa tête.
D’un bond, il se leva, sortit ses vêtements du sac à dos, choisit un pantalon, opta pour une chemise noire et commença à s’habiller devant le panneau de photos. Je suis sur chacune d’elles, remarqua-t-il avec un plaisir mal dissimulé. Tout en boutonnant sa chemise, il se remémora les Tarahumaras aux semelles de vent devant leur grotte noircie par la fumée, le chasseur nu croisé sur le sentier du sanctuaire des Ifugaos, sa joie à conduire, en le grattant avec ses orteils derrière les oreilles, ce bel éléphant indien. Et ce fameux match de foot où les gringos l’emportèrent trente à vingt-neuf contre les Indiens Colorados ! Sur cette photo en contre-jour, il partageait une pipe d’opium avec deux Karens, là c’était un chilum avec le sadou de Varanasi, là encore un tarpé avec l’ami Benjamin. L’envie de fumer le démangea soudain, il se hâta, enfila une chaussette en dansant sur une jambe, regarda de plus près cette photo un peu floue prise dans les llanos où il décampait fissa devant plusieurs caïmans sortant d’un trou d’eau. Sur celle-là, sa tête ébouriffée émergeait du hamac et affichait un sourire complètement idiot. Ah, là, au bord du Mékong, il se trouvait plutôt beau. Satisfait, il laça ses baskets. Tout en haut du panneau, leur devise en belles lettres roses : « carpe diem ». Près de la porte un petit portrait du Che portant l’inscription : « Ici, territoire libéré ». Clément sourit et sortit de la chambre en chantonnant « la mauvaise herbe » de Brassens.
– Tu veux nous mettre une musique ? lui cria Ludivine depuis la cuisine.
Il passa au salon. Une minette aux yeux bleus, l’y suivit, griffa au passage le cuir du vieux fauteuil club puis sauta sans vergogne sur la table basse et de là, le surveilla en agitant nerveusement sa queue en panache. Clément se pencha devant les colonnes de disques pour en faire l’inventaire : entre Miles Davis, Billy Holliday et James Cotton, il choisit ce dernier. La musique envahit l’espace. Il alluma avec soulagement une cigarette et fureta le long des étagères encombrées de livres. Il ouvrit un atlas, fit défiler les photos des îles du Pacifique, reposa le livre du bleu plein les yeux. Le sourire bienheureux d’un petit Ganesh l’attira. Il lui frotta le ventre, respira le parfum de santal qui s’en échappa et une foule d’images colorées l’assaillit. Emu, il continua son tour d’horizon, caressa le bois lisse du boomerang, sortit de son fourreau de cuir serti de turquoises et de corail le couteau népalais qu’il avait troqué contre son sac de couchage puis se saisit du sifflet brésilien, en fit sortir trois sons stridents et se revit à Salvador de Bahia, dansant sur le Pelourinho, avec Ludivine. Elle fit son entrée à ce moment-là, se déhanchant, un plateau dans la main. Elle posa les mojitos sur la table basse, chassa d’une petite tape la minette et vint tourbillonner autour de Clément :
– C’est chouette que tu sois là ce soir ! Tu sais que nous sommes le premier avril ?
– Ah c’est pour ça !...
Elle lui sourit, se laissa tomber dans un fauteuil :
– Ça fait tout juste deux ans que je suis ici ! Trinquons à la maison ! Et à toi bien sûr, se reprit-elle.
– À nous deux ! rectifia-t-il, en s’asseyant en face d’elle, avant d’ajouter : tu ne t’ennuies pas trop, toute seule dans ce coin perdu ?
– Je ne suis pas vraiment seule, répondit-elle avec un petit rictus malicieux… Et puis je suis très occupée, ajouta-t-elle. Tu sais, ce n’est pas évident d’organiser son temps quand aucune force extérieure n’intervient ! Ça demande un gros travail sur soi-même. Ça n’a pas l’air, mais je suis sans cesse en danger ! Des tas de pièges me guettent : la paresse, l’inertie, l’apathie… Si je m’y laisse prendre, aucun projet n’aboutit, la tristesse me gagne et je suis bonne pour la déprime ! Entre ordre et chaos, l’équilibre est très, très fragile…
Clément l’observa mi-amusé, mi-inquiet. Après tant d’années de bougeotte, il se demandait si l’immobilisme soudain de sa cousine était un rééquilibrage salutaire ou une forme de renoncement. Il opta pour les deux à la fois.
– Mais rassure-toi, je m’en sors plutôt bien. La vie est belle !
Clément avala un peu de rhum.
– J’avais cru, commença-t-il, du moins j’avais espéré que ton retour en France signifierait ton retour avec moi. Au lieu de ça, tu as mis 800 bornes entre nous et tu me laisses sans nouvelles pendant des mois ! Qu’est-ce qui ne va pas ? Qu’est-ce que je t’ai fait ? demanda-t-il en haussant le ton malgré lui.
Ludivine piqua une olive et la croqua en baissant le nez.
– Je veux comprendre, insista Clément.
Elle le dévisagea, se mordit la lèvre, finit par déclarer :
– Je ne veux plus te partager. Je préfère renoncer à toi.
Il la regarda éberlué. Ce n’est pas possible, se dit-il, elle triche, elle se dérobe.
– Tu te souviens de ce que tu m’as dit à seize ans ? « Je préfère te le dire tout de suite, je ne pourrais pas me contenter d’un seul homme. » Tu t’en souviens, n’est-ce pas ? J’étais un pauvre adolescent romantique, je l’ai reçu en pleine poire ! Mais je me suis rendu à ta raison : il faut bien que le corps exulte !
– Tu ne t’es pas fait prier, non plus…
– J’étais réfractaire à la morale, à la religion, au conformisme, la transgression était une pure jouissance et ça me plaisait énormément de fréquenter le septième ciel avec toi !…
– La luxueuse décadence, comme tu disais. « J’ai connu le paradis, se mit-elle à déclamer : ce n’était que culs, bites et seins ! De la chair, rose, brune, tendre à croquer. Des guiboles emmêlées, des mains tripoteuses, des langues enroulées ! Et tous ces parfums affriolants ! Ah !!! Le paradis, vous dis-je ! » C’était ta toute première pièce ! Tu as fait un tabac ! On était jeune, on s’est bien éclaté. Aujourd’hui, je sais que la relation aux autres n’est rien comparée à ce que je ressens avec toi. La sincérité, la complicité, la confiance, tout cela n’existe qu’avec toi. Il n’y a que dans tes bras que je peux m’abandonner totalement. En fait, il n’y a que toi qui m’intéresses. Seulement voilà, je voudrais t’avoir pour moi toute seule et je sais que ce n’est pas possible, tu ne sais pas résister à la tentation.
– La meilleure façon de résister à la tentation, c’est d’y céder.
– Ce n’est même pas de toi.
– Non, d’Oscar Wilde. En une phrase courte, et drôle, il renverse toute la culture judéo-chrétienne. Tu ferais bien d’en faire autant ! Quand on est gaulée comme toi, on est faite pour l’amour ! S’en priver est un sacrilège !
Il avait haussé le ton. Les sourcils froncés, elle le regarda droit dans les yeux :
– Mais qui te dit que je m’en prive ?
Clément sentit le sang affluer à ses tempes.





























