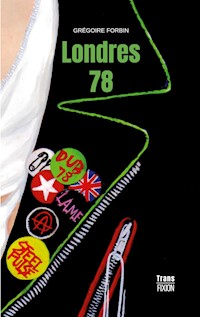
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Quatre garçons et une fille se retrouvent à Londres au printemps 1978, alors que la déflagration punk crache ses derniers décibels. Les voyages forment ou déforment la jeunesse. En tout cas, après celui-ci, rien ne sera plus jamais pareil entre ces cinq-là. Une histoire d'amour et d'amitiés sur plusieurs décennies, portrait en creux d'une génération sous influence sexe, drogue et rock'n'roll, mais aussi éloge de l'adolescence éternelle.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 102
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Du même auteur
Le cancer publicitaire
Car rien n’a d’importance, 1993
D’autre chose que d’amour
La Bartavelle, 1994
Triste en attendant Y
La Main Courante, 1994
Le Poulpe/Zombi la mouche
Baleine, 1997
Au milieu des méduses
Transfixion, 2016
L’adolescence est le seul temps où l’on ait appris quelque chose.
Marcel Proust
A teenage dream’s so hard to beat.
John O'Neill (The Undertones)
Table
Pirate love
Sorrow tears and blood
Carry on
Walk on the wild side
Gypsy eyes
Pirate love
Ben
Londres en avril 1978, c’est un peu comme un parc Disneyland pour les punks. Les badges pullulent aux revers des vestes étriquées. Les cheveux se dressent sur les têtes, laqués à la bière. Les vêtements se portent déchirés et les épingles à nourrice plantées dans les joues. Tout le monde semble sortir d’un défilé de Vivian Westwood. Mais on sent bien que l’explosion a fait long feu. L’enthousiasme, l’arrogance et l’énergie initiale ont fait place au nihilisme, à la pose et au business. Les Sex Pistols ont splitté après leur tournée catastrophe aux États-Unis, et les Damned ont donné leur dernier concert le 8 avril au Roxy. À peine formée, la déferlante punk a tout ravagé sur son passage, puis s’est autodétruite et délégitimée. Mais on s’en fiche un peu.
On est arrivés hier après-midi à Douvres (eh oui, j’ai fini par gerber en vue du port et à deux minutes du débarquement, fuck !), puis on a pris le train jus-qu’à Waterloo Station. Et ce soir, on est au Speakeasy, pour assister au concert d’un groupe improbable : une moitié de Sex Pistols, un quart de Heart-breakers et un quart d’inconnu. Autrement dit : Steve Jones à la guitare, Paul Cook à la batterie, Johnny Thunders en leader charismatique et déjanté, et Henry Paul, un obscur froggy à la basse. Depuis son arrivée à Londres, les musiciens se disputent l’honneur de jouer avec Thunders, légende vivante du rock new-yorkais, ancien New York Dolls et ex-Heart-beakers. Il a été par exemple accompagné par la rythmique d’Eddy and the Hot Rods, puis par les Only Ones. Ici même, au Speakeasy. Je le sais, je l’ai lu dans Best. Je lis tout dans Best et je sais tout grâce à Best. Ça me fait marrer, car Nico et Momo se fichaient toujours de moi avec mon Best et les articles intellos d’Hervé Picard sur le rock progressif : Genesis, King Crimson, Hawkind, l’école de Canterbury et tout ça. Mais aujourd’hui, grâce à Bruno Blum, correspondant permanent à Londres, et sa rubrique « In the City », et Patrick Eudeline qui collabore aussi au journal, Best a enterré Rock & Folk (cet abruti de Philippe Manœuvre n’a rien compris aux punks, il est resté scotché à Aerosmith et s’est permis de descendre en flammes le dernier Ramones).
Depuis que Thunders a immigré à Londres, on dit que l’ambiance a changé. Il a ramené avec lui une passagère indésirable. Comme Steve Jones de retour de Rio, comme Thoper Headon, le nouveau batteur de Clash, comme Sid Vicious (il est question qu’il enregistre une version de My Way, sans déconner !), comme tant d’autres punks, il a l’héroïne comme petite copine. No future. Ça prend tout son sens. Alors que le punk oscillait entre bière et speed, ces cons-là, après avoir tant critiqué les babas, sont en train de faire exactement la même chose : à chaque shoot, à chaque sniff, ils jouent à la roulette russe avec la mort et flinguent ce qui leur reste d’énergie — l’âme du mouvement punk.
C’est pour ça que Laurence est fascinée. Dire qu’on n’a rien vu ni rien compris pendant des mois, des années, même ! Avec Jissé, on a commencé à l’attendre à la sortie du collège, à la suivre, à rêver d’elle et à lui écrire des poèmes, bref à fantasmer comme des malades sur elle, en troisième. Et on ne lui a parlé qu’en fin de seconde. Depuis, on ne se quitte plus, et c’est un peu comme un rêve qui se réalise à chaque fois qu’on la retrouve. Mais pendant tout ce temps passé avec elle, jamais on n’a pensé qu’elle se shootait. Best ne peut pas tout. Il y a des choses dans la vie qui, tant que l’on ne les a pas expérimentées, restent inimaginables.
Évidemment, maintenant qu’on sait, ça semble évident. Son mystère. Son charme lysergique et vénéneux. La noirceur de ses cheveux et de ses yeux. Sa peau tellement pâle, presque bleue. Sa démarche comme si elle flottait au-dessus de la chaussée, ses jambes fines, ses attaches fragiles. Ses silences. Sa façon de parler, souvent énigmatique, entrecoupée de rires graves. Ses dents blanches, ses lèvres pulpeuses… Je sais, je mélange tout. Tout ce que j’ai essayé d’écrire sur elle et sur ce qu’elle m’inspire est parti à la poubelle. Pareil pour Jissé. Pendant un moment, on allait au café tous les jours après les cours, son café, où elle recevait tour à tour les admirateurs et les prétendants qui se pressaient à sa table telle une courtisane du XVIIIe siècle, et on s’asseyait en face d’elle. On sortait nos cahiers et on commençait à griffonner, à parler fort et à dire n’importe quoi. L’idée était qu’elle comprenne bien qu’on était en train d’écrire un livre (peut-être même un livre sur elle), qu’on était super intéressants à défaut d’être super tout court, et qu’elle ferait bien de nous adresser la parole parce que nous, on était incapables de le faire. Bizarrement, ça a fini par marcher.
Le Speakeasy est un petit club en sous-sol, au coin de Margaret Street, près d’Oxford Circus. Ce n’était pas une boîte punk à l’origine. Tout l’opposé même, vu que le patron était le manager de Yes et que des groupes comme Pink Floyd et King Crimson y ont essuyé les plâtres. Mais la mode est passée par là. La salle est longue, étroite et bondée, et il faut être patient pour parvenir à la scène. Les murs sont peints en noir, l’éclairage est famélique. Le seul coin un peu sympa est le bar central et les banquettes en enfilade qui sont disposées devant. Chaque table est coiffée par une suspension qui crée une ambiance tripot pendant la prohibition, Speakeasy oblige.
Avant le set, on s’y installe pour boire un coup. Laurence s’assoit en face de moi, avec Jissé à côté d’elle. Momo a déjà l’air bourré et fait les cent pas devant nous, une bière à la main. Nico mate partout autour de lui. Laurence regarde Jissé, puis me regarde. Depuis qu’on est arrivés, je sens l’embrouille venir. Combien de temps peut tenir notre trio ?
On a découvert que Laurence se shootait au Palace, il y a un mois à peine. « Le Palace n’est pas une boîte comme les autres : il rassemble dans un lieu original des plaisirs ordinairement dispersés : celui du théâtre comme édifice amoureusement préservé, jouissance de la vue ; l’excitation du Moderne, l’exploration de sensations visuelles neuves, dues à des techniques nouvelles ; la joie de la danse, le charme des rencontres possibles. Tout cela réuni fait quelque chose de très ancien, qu’on appelle la Fête, et qui est bien différent de la Distraction : tout un dispositif de sensations destiné à rendre les gens heureux, le temps d’une nuit. Le nouveau, c’est cette impression de synthèse, de totalité, de complexité : je suis dans un lieu qui se suffit à lui-même. » C’est pas moi qui le dis, c’est Roland Barthes. Ce qu’il oublie de préciser, c’est que tout le monde est défoncé. Il suffit de lire les articles d’Alain Pacadis, journaliste à Libération et junkie notoire, pour s’en convaincre.
Laurence, on l’a retrouvée dans les chiottes en train de se piquer. Elle avait disparu et on s’inquiétait, car on avait déjà pas mal picolé et fumé. Et puis, on était là pour elle ; pour la désirer ; pour la voir bouger, danser et sourire ; pour sentir son regard noir et lumineux dégoulinant de khôl se poser sur nous, ses chevaliers servants, à défaut d’autre chose. Il y avait une foule énorme, ce soir-là, et on a eu un mal fou à parvenir aux toilettes. Le long couloir rouge desservant l’antre bondé et surchauffé n’en finissait pas. Des lasers et des stroboscopes fendaient l’obscurité, des créatures au sexe indéterminé s’agitaient autour de nous, les confettis pleuvaient, la sono hurlait — Ring my bell, Do you think I’m sexy, You make me feel.
Dans l’escalier qui conduisait à l’entresol, c’était la cohue. Ça sentait le popers à plein nez et l’odeur d’ammoniaque nous tétanisait. Les corps luisaient et se télescopaient, les paillettes brillaient, les regards chaviraient et le vieux théâtre lifté tanguait et vibrait à l’unisson. Un flot incessant montait et descendait sous l’éclairage cru des ampoules halogènes. Arrivés devant les portes des WC, on a poussé celle des dames et commencé à appeler Laurence. Côté lavabo, des filles sacrifiaient au rituel du miroir et quelques actrices célèbres se repoudraient le nez. Quand on a découvert Laurence dans une des chiottes, une aiguille à la main et l’avant-bras pendant le long de ses jambes, elle s’est contentée de dire : « Il fallait bien que vous l’appreniez un jour ». Son sourire était mortel, comme toujours. Tendre et moqueur à la fois, genre on ne me l’a fait pas. Avec un soupçon de morgue et de vulgarité. Un sourire à la Jagger.
Nico me tire par le bras :
— Eh, c’est pas Thunders, là ?
Je me retourne et je regarde derrière nous. Je vois un petit rital en costume noir cintré en train de manger des spaghettis, les yeux dans le vague, perdu dans ses pensées ou beaucoup plus loin dans la galaxie, difficile à dire. Une fille en robe lamée rose bonbon boit à côté de lui, et plein de gens vont et viennent autour de sa table. C’est bien Johnny Thunders, le beautiful looser himself. Nos regards se croisent. Il me sourit. Je me tourne tout excité vers Jissé, mais il est occupé à chuchoter à l’oreille de Laurence. Il a son rire carnassier et elle hoche la tête en tripotant ses cheveux. Bah, Thunders est plus intéressant. Je le regarde à nouveau, en essayant d’être discret (Nico veut prendre des photos, mais je lui déconseille). Je pense à Al Pacino dans Le Parrain. Je pense à son look de pin-up à platform-boots sur la pochette du premier New York Dolls. Je pense à Lou Reed et aux paroles d’Heroin :
« When the smack begins to flow
Then I really don’t care anymore ».
Je pense à tout ce qu’il a dû s’enfiler dans les veines pour en arriver là. J’ai fumé de l’héro une fois à la pipe, et ça ne m’a rien fait. Mais c’était peut-être du sucre. En tout cas, je n’y toucherai plus. Je me contente du pétard pour planer. Même si Laurence déteste ça. Elle dit que les babas se passent le joint, mais qu’il n’y a rien d’autre qui passe entre eux. Qu’ils sont juste bons à remuer la tête après. Elle a horreur des « bougeurs de tête ». Moi aussi. Mais ce n’est pas une raison suffisante pour se piquer, à mon avis.
Je me demande si la blonde en robe lamée à côté de lui n’est pas Sable Starr, groupie number one de Thunders devenue sa girl friend attitrée. Il paraît qu’elle était prête à tout pour coucher avec lui, allant jusqu’à se teindre le pubis en vert et à jouer la morte dans une piscine pour qu’il s’intéresse à elle. On raconte qu’ils voulaient se marier, qu’elle est tombée enceinte, mais qu’elle a avorté, ayant trop peur de la jalousie de Thunders, ainsi que de ses diverses addictions. Quoi qu’il en soit, c’est elle aussi une légende. Dans les années 70 à Los Angeles, elle a « fréquenté » Robert Plant, Mick Jagger, Rod Stewart, Alice Cooper, David Bowie et Marc Bolan. On lui prête également des aventures avec Iggy Pop et Richard Hell, le premier bassiste des Heartbreakers, qui a fondé après son propre groupe, Richard Hell and the Voidoids. Sable Staar, la vache !





























