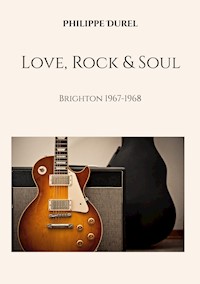
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Love, Rock & Soul Brighton 1967-1968 Si vous êtes fan des sixties... Si vous êtes un inconditionnel du Rock and roll, du Rythm and blues... Si vous appréciez la « mode d'avant »... Si vous êtes quelque peu nostalgique des années 60... Si vous désirez découvrir et vivre par procuration dans une ville balnéaire au sud de Londres... Alors ce récit est pour vous ! Suivez pas à pas l'auteur, il avait une vingtaine d'années à l'époque, vous ne le lâcherez plus, vous connaîtrez ses sentiments, ses émotions, ses rencontres, ses passions. Il saura par un sens de l'observation hors du commun vous faire découvrir ou redécouvrir le quotidien d'une jeunesse qu'on croirait à tort simplement insouciante et joyeuse. Au fil du récit cette jeunesse se révélera soucieuse de son avenir, préoccupée par l'actualité, touchée par l'angoisse et le drame. Une belle aventure dans le passé.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 252
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Au bon temps du Rock and Roll …
Sommaire
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Play Liste
1
« All you need is love » chantaient les Beatles à la radio. Tu n’as besoin que d’amour, oui, pourquoi pas, mais au dernier jour des vacances ce samedi 29 juillet 67, assis sur mon lit dans ma chambre de Gardner Street, billet du car-ferry pour le Havre en main, je n’avais aucune envie d’un retour en France. Je me sentais chez moi dans ce Brighton du sud de l’Angleterre. J’étais bien dans cette cité excentrique et décontractée. Le quartier branché de North Laine où je séjournais m’enchantait. Dès la porte de la maison de ville franchie, j’appréciais les boutiques colorées où l’on trouvait les dernières tendances de la mode, des vêtements d’occasion, des instruments de musique, de la bijouterie de pacotille. J’aimais l’atmosphère de ces petites rues où se côtoyaient des gens de tout style, vieux, jeunes, sans aucun a priori. J’aimais cette ville balnéaire animée tous les soirs d’été, son ambiance musicale qui courait le long des rues de la ville, sa diversité des endroits où sortir. Des caves du « Starlight » ou du « Pop-Inn », à l’immense club « Top Rank » aux soirées à thèmes, en passant par la mini discothèque « The Box », je sortais chaque soir dans un univers différent.
Bachelier depuis un mois, je devais convaincre les parents de me laisser revenir pour une bonne cause, perfectionner mon anglais me semblait être la solution. Trouver un emploi serait indispensable, serveur dans un pub ou travailler dans un commerce me satisferait. Prêt pour la restitution des clés, avec une bonne heure d’avance, je pouvais tester les commerçants du quartier. Comme toujours avant de sortir, contrôle du look face au grand miroir accroché sur la porte de la chambre. Miroir bien pratique, à la différence de celui placé au-dessus du lavabo où je devais plier mon mètre quatre-vingt-cinq pour me raser. Satisfait du pull noir colle V sur la peau, du pantalon gris clair et des boots noirs, coup de peigne sur mes cheveux mi-longs, je descendis plein d’espoirs. Dès ma troisième entrevue, je compris que la morosité ambiante de l’économie et la réglementation pour les permis de travail ne faciliteraient pas l’embauche d’un étranger.
Le moral au plus bas, de retour vers Gardner Street par North Road, j’aperçus au loin ma propriétaire. Assez grande, brune, cheveux souples avec une coupe courte qui encadrait bien son visage, elle était très élégante dans sa tenue et son maintien. Robe d’été rouge à pois blancs, avec une large ceinture du même tissu que la robe, escarpins également de couleur rouge, sac bandoulière en cuir fauve, le bas ample de sa robe ondulait légèrement au gré de sa démarche. Elle me subjuguait au fur et à mesure qu’elle s’approchait. A son arrivée, ses yeux gris-vert, son sourire éclatant, me laissèrent sans voix. Bloqué, c’est avec un temps de retard que je répondis à son bonjour. Elle me laissa passer le premier pour monter l’escalier. Sur le palier, toujours impressionné, c’est après deux tentatives que j’ouvris la porte. Je m’effaçai pour la laisser entrer. Son sac posé sur la table, après un regard sur l’ensemble de la cuisine, elle se dirigea vers la fenêtre à guillotine pour en vérifier la fermeture. Dure à coulisser elle la ferait réparer. Vérification également de la robinetterie de l’évier et de la gazinière. Après un coup d’œil par la porte de la chambre de l’autre côté du palier, satisfaite, elle se tourna vers moi pour me demander si j’avais passé un bon séjour. Son anglais, sans accent marqué, facilitait la conversation. Je repris un peu d’assurance, lui répondis que j’étais enchanté de ces trois semaines passées. Je lui fis part de ma volonté de passer une année à Brighton pour améliorer mon anglais tout en travaillant. Après la description de mes entrevues négatives du matin, les mains appuyées derrière elle sur le plan de travail de la cuisine, elle me demanda si un autre job que serveur me conviendrait.
J’acquiesçai aussitôt, l’espoir était de retour. Elle m’écrirait pour m’informer d’une éventuelle possibilité, ou non, me souhaita un bon retour en France. Je la remerciai, la saluai, pris mon sac et sourire aux lèvres, descendis l’escalier quatre à quatre.
Dans la rue, je me dirigeai vers la gare machinalement, j’étais sur un nuage, abasourdi par la bonne nouvelle d’un éventuel retour, mais aussi complètement conquis par la jolie madame Collins. Son parfum floral qui m’avait tant troublé était encore en moi. Elle connaissait son pouvoir de séduction, s’amusait sans doute de mon émoi, mais j’étais fasciné.
Dix minutes plus tard j’entrai dans la gare de Brighton. Du dix-neuvième siècle, avec un magnifique toit de verre et d’acier, elle était très fréquentée le week-end par les londoniens. A une bonne heure de train, ils profitaient de la plage et de l’ambiance festive de la ville.
Je pris mon billet pour Southampton port de départ du carferry reliant Le Havre. En attente sur le quai, je redescendis sur terre me demandant si mon souhait de retour se réaliserait. Convaincre les parents et avoir un emploi officiel me paraissaient de plus en plus difficile.
Le train était à l’heure, pas toujours le cas en Angleterre. Je montai, arpentai les couloirs pour trouver un compartiment avec peu de passagers, espérant être au calme pour digérer et mon vague à l’âme de partir et mes espoirs de retour. Au quatrième wagon, l’un des compartiments était occupé par deux personnes assises chacune en bout de la même banquette. Je fis coulisser la porte, saluai mes compagnons de voyage et m’installai en face, à contresens du train. J’aurais préféré être moi aussi à une extrémité pour profiter d’un angle du compartiment et de la vue sur le paysage ou le passage du couloir. Une banquette de quatre places pour moi seul, ce n’était déjà pas si mal, en espérant que le compartiment ne se remplisse pas.
J’étais bien embarrassé, pas de livre, ni de magazine ou un journal à lire, je regardais la place vide en face de moi, le haut du wagon, le plancher, restais dans mes pensées de futur. A la dérobée j’observais mon entourage. Sur ma droite une jeune femme, cheveux longs, châtain, habillée sobrement d’un pull noir sur une courte jupe bleue, regardait ostensiblement par la fenêtre. Côté gauche, un journal déplié, tenu par des mains minces et soignées, au poignet une montre de prix. Sous le journal, un pantalon bleu marine sur des jambes croisées, aux pieds des chaussures noires parfaitement cirées. J’imaginais un gentleman, un dandy, je m’étonnais de sa présence dans un wagon de seconde classe. Il replia son journal, The Guardian, quotidien de référence. M’apparut alors un homme aux cheveux blancs coupés très courts, avec moustache et petit bouc, visage émacié, quelques rougeurs qui dénotaient peut-être un penchant pour le whisky. Après un regard, il me demanda si j’étais français. Mon affirmation le conforta et là, avec un grand sourire, il m’interpella sur De Gaulle et son allocution au balcon de la mairie de Montréal du début de la semaine. Il faut dire que notre Général, les bras levés, avait lancé de sa voix de stentor « Vive le Québec libre ! », sous les acclamations d’une foule de quinze-mille personnes. L’image avait fait le tour du Monde. Cela avait déplu ou amusé selon les contrées. Je lui répondis que j’avais vu les gros titres et les photos sur les journaux affichés en kiosque, les Anglais avaient moqué De Gaulle, j’en avais souri. La conversation continua sur De Gaulle et son véto à l’entrée de la Grande-Bretagne dans la Communauté européenne en 1963. Mon interlocuteur s’inquiétait de la réponse du président français sur la nouvelle demande des anglais du début de l’année, toujours en étude en cette fin juillet. Par bonheur, l’arrivée à Chichester me libéra de l’envahissant gentleman. Dès sa sortie du compartiment, nous échangions la passagère et moi un sourire entendu. Je me glissais du milieu de ma banquette au côté couloir, chacun pouvait enfin s’adonner à ses propres réflexions.
Je me remémorais la fête d’hier soir, Lyydia, finlandaise tout juste rencontrée, qui balança une chaise par la fenêtre du cinquième étage d’un appartement où avait lieu une soirée. Je l’avais laissée seule trop longtemps, lors d’un aller-retour pour prévenir deux français de l’endroit de la fête. J’avais récupéré Lyydia en pleurs sur le palier, virée manu militari. C’était aussi son dernier jour de vacances, elle avait un peu picolé, on s’était consolé sur la plage. J’aurais bien aimé la rencontrer avant. Avant c’était Eva, une suédoise, on était sorti ensemble une douzaine de jours. Elle aussi était repartie. Mes deux scandinaves étaient brunes aux cheveux longs, un comble avec le nombre de leurs consœurs blondes en vacances à Brighton. La station balnéaire était à la mode. Des jeunes venaient particulièrement de Londres mais aussi d’Allemagne, de Scandinavie, d’Italie. Les Italiens étaient de redoutables concurrents de drague pour nous les Français, côté anglais on était tranquille, ils aimaient passer la soirée au bar. Cette ambiance aux multiples rencontres me convenait parfaitement, j’appréciais ces amourettes de quelques jours, parfois d’un soir.
Aux abords de Portsmouth, ma compagne de voyage se prépara à descendre, franchit la porte du compartiment en m’accordant un sourire et un « by » qui m’enchanta.
A Southampton, comme à chaque voyage, vingt minutes de marche pour rejoindre le quai du car-ferry. Les voitures commençaient à embarquer sur le bateau orange de la compagnie norvégienne Thoresen Ferries. Tous ses bateaux, dénommés Viking et différenciés par un chiffre, étaient identiques. Avec mon nombre de voyages à bord j’y étais chez moi. Beaucoup de monde en cette période, il ne fallait pas tarder à la cafétéria et récupérer un fauteuil rapidement, sous peine de dormir sur le pont. Là c’était peut-être dans une chaise longue avec une couverture, ou sans la couverture ou sans la chaise longue et à même le sol, la tête sur le sac de voyage. Prévoyant, je passais la nuit dans un fauteuil à l’intérieur sur un côté du bateau, bien calé avec l’angle de la paroi.
Le lendemain matin, je rentrais par le bus à la maison des parents, rue Sully, dans la partie ancienne du Havre, quartier épargné par les bombardements de l’aviation anglaise, les cinq et six septembre 1944. Petit déjeuner avec maman très contente de me revoir en bonne santé. Papa était à sa boucherie chevaline dans le quartier de l’Eure près des docks. Dernier de la fratrie, je côtoyais peu mes frères Pierre et René, et ma sœur Geneviève, tous trois étaient mariés et avaient des enfants
Après un descriptif succinct à maman de mes activités anglaises, je retrouvais ma chambre et ma collection de disques vinyles. Petit électrophone mais bonne puissance, je balançais à la suite « Baby please don’t go » et « Gloria » du groupe Them, irlandais de Belfast. Et là, la formidable voix de Van Morrison inondait la pièce, déclenchait des frissons. Echauffement sur le premier titre et puis tu danses et tu joues de l’air-guitare en reprenant « Gloria » à l’unisson. Quelques bons accords, le tempo qui va bien, un formidable chanteur, succès assuré de l’époque. L’éphémère groupe Them est peu connu en France mais toute une génération pop-rock identifie les premières notes de « Gloria ».
A la suite, allongé sur mon lit, quelques titres des Stones et des Kinks en sourdine, j’étudiais la façon de présenter mon projet aux parents.
Titulaire d’un bac « Technique et Economie », durement acquis avec tout juste dix et deux dixième de moyenne, je n’avais aucun véritable projet d’avenir. En 1967, nous avions le choix entre cinq sections pour le baccalauréat : mathématiques élémentaires ; sciences expérimentales ; philosophie ; mathématiques et techniques ; technique et économie. Bien que redoutant l’aspect technique, à juste titre, j’optais pour la cinquième série qui me paraissait plus adaptée à mon niveau. Malgré ma petite moyenne, mes parents étaient fiers de moi. Seulement vingt pour cent de ma génération étaient bacheliers, le taux de réussite au baccalauréat était d’à peine soixante pour cent pour cent-trente-trois-mille candidats. Nous étions beaucoup plus nombreux que les premier trente-et-un candidats de 1809, et beaucoup moins que les sept-cent-soixante-cinq-mille de 2017.
Mon bac me permettait d’aller à l’université ou de trouver un travail. Ce seul diplôme facilitait l’entrée dans nombre d’entreprises qui vous formait suivant leur spécialité. La maitrise de l’anglais étant rare en France, en avoir un excellent niveau m’ouvrirait des horizons plus numérateurs. Fort de mon succès au bac, ma proposition, de passer un an à Brighton avec un emploi sur place pourrait satisfaire les parents. J’étais confiant pour un appui de papa. En complément de son métier de boucher, il importait d’Irlande des chevaux de boucherie, ce qui le rendait dépendant d’un interprète lors de ses contacts avec les vendeurs irlandais. Côté maman, m’imaginer, pourquoi pas, prof d’anglais ne lui déplairait pas, elle aurait aimé être institutrice. Le soir même, mon projet était accepté sans difficulté. Restait à espérer un courrier positif.
En attendant, l’indispensable était de trouver un travail temporaire pour assurer les frais de sortie et une cagnotte de départ pour l’Angleterre. Dans les petites annonces du journal local, je trouvai rapidement une proposition pour repeindre un garage de vente de voitures d’occasion.
Il se situait près du Rond-point dans une rue derrière le Cours de la République, à un quart d’heure de la maison. Le garage était divisé en deux parties. Au rez-de-chaussée, une petite surface pour la remise en état des véhicules, avec sur le côté une rampe d’accès au grand hall d’exposition du premier étage. Là se situait le bureau de vente. Bien accueilli à l’ouverture par le propriétaire, embauché dans la foulée pour un travail non déclaré, il me présenta mon collègue, peintre d’occasion lui aussi. C’était un navigateur en vacances qui se faisait un peu d’argent lors de ses périodes de repos. Dès l’après-midi j’étais juché avec lui sur un petit échafaudage, le rouleau à la main, pour repeindre les murs en blanc.
Le week-end, je sortais avec mon copain Alain, coiffeur pour dames dans un salon près de la plage, « Serge Coiffure ». J’avais connu Alain par l’intermédiaire d’un autre coiffeur, Richard, qui me coupait les cheveux quand nous habitions au quartier des Neiges. Bien que deux ans plus âgés que moi nous avions sympathisés. Il m’avait proposé de les accompagner en vacances en Angleterre, lui et son collègue Alain. C’est ainsi que nous nous étions retrouvés à Brighton pour trois formidables semaines de vacances en juillet 66.
Samedi soir reprise des bonnes habitudes. Alain me récupérait à la maison à neuf heures, avec sa Ford Cortina de 62, pour aller prendre un verre au « Week-End » à Saint Adresse. Situé près de la plage, café-tabac avec de la restauration, il était fréquenté par une jeunesse un peu branchée. C’était un lieu de rendez-vous du samedi soir, avant de rejoindre Etretat ou Yport, petites stations balnéaires de la côte normande.
Passé dix heures on partait pour Etretat, direction « La Frégate », une des premières discothèques créées en France. A l’entrée, coucou à Carol, préposée aux platines, Alain la connaissait. L’endroit était petit, une piste de danse restreinte, mais une super ambiance. Musique anglo-américaine, parfois un titre français comme « Love me please love me » de Polnareff. Enchainé avec « These arms of mine » d’Otis Redding, le moment des slows de drague était arrivé. Parfois on faisait un saut au Casino voir s’il y avait des filles que l’on pourrait charmer. L’ambiance était différente, l’orchestre très bon. Au retour d’Etretat, accompagnés ou non, on prenait un verre à « L’étable » au centre-ville du Havre. Un peu avant l’aube on pouvait trouver de la place au Morny’s, la mini discothèque du premier étage. Encore seuls le dimanche après-midi, sortie à la discothèque « Les Champs Elysées » quartier Sainte Cécile, ou parfois à la gare-maritime lors de bals très prisés par la jeunesse havraise. Pendant mes vacances de lycéen, le lundi, jour de repos des coiffeurs, on pouvait jouer au Yam à la terrasse du Marignan, à l’angle de la rue Lesueur et du Boulevard de Strasbourg, quartier animé proche de la gare. Parfois Richard était de la partie. Cet été-là, il le passait en Allemagne, seize mois de service militaire obligatoire. Il avait bien essayé de se faire réformer, mais les toubibs de l’armée n’étaient pas naïfs.
*
Un matin, maman me donna une lettre timbrée à l’effigie de la reine d’Angleterre Elisabeth II. Assis sur mon lit, le dos appuyé contre le mur, j’ouvrais délicatement l’enveloppe, la peur au ventre d’avoir une réponse négative. Je dépliais la lettre. Ouf ! Il y avait une possibilité, mais sous condition. L’emploi proposé : plongeur dans un petit restaurant de Brighton. Le hic était qu’en raison des grandes difficultés économiques de la Grande-Bretagne, il serait très difficile d’obtenir un permis de travail. La seule option était un engagement dans un cadre universitaire. Je devais faire en sorte d’avoir un cursus nécessitant l’apprentissage de l’anglais, en collaboration avec un organisme d’enseignement.
La solution était de préparer une licence d’anglais avec le Centre National d’Enseignement par Correspondance, structure officielle. Les parents acceptèrent sachant qu’un diplôme en était l’aboutissement. Après avoir dans un premier temps informé madame Collins de mon projet, je pus deux semaines plus tard, lui envoyer mes documents officiels d’inscription au CNEC pour une licence d’anglais. Nouveau courrier d’Angleterre et une réponse positive avec restriction. Considéré comme étudiant, je ne travaillerai pas à plein temps et toucherai un salaire en conséquence. Mon contrat courrait d’octobre à juin. Je pourrai louer mon deux-pièces à North Laine au prix mensuel d’une location classique. Trop content, j’acceptais sans hésiter. Les soucis financiers à venir se régleraient en partie avec les parents et sur place selon les opportunités. Après trois semaines comme peintre en bâtiment j’avais touché une somme que je considérais rondelette et pour compléter je revendis ma guitare basse avec son ampli. Je m’en étais peu servie, le résultat d’une formation avortée d’un groupe de rock. Ma basse avait la particularité d’être de la même forme et de couleur identique à la légendaire quatre cordes de Paul McCartney. La différence était que la mienne n’était pas une Höfner 500/1 Violin. Je gardais mon autre guitare pour l’emmener avec moi, une acoustique Folk Framus sur laquelle j’avais appris et progressé pour être capable de jouer quelques titres.
Au mois de septembre je réussis à me faire embaucher pour deux semaines dans une entreprise d’embouteillage de vin de Porto, je conditionnais les bouteilles dans les cartons. Le pécule augmenta.
Le 29 septembre, grand jour du départ, après avoir préparé sac et guitare le matin j’étais resté l’après-midi dans ma chambre à lire, à écouter le dernier single des Rolling Stones. Single qui m’avait un peu déçu en s’éloignant du blues et du rock avec les titres « I love you » et « Dandelion ». Les Stones avaient sacrifié à la tendance « Peace and Love » du moment pour entrer dans le top ten. Heureusement je balançais Stevie Wonder, « I was made to love her » et chantais « The letter » avec « The Box Tops », titre de l’année vendu à plus de quatre millions d’exemplaires. Le chanteur du groupe Alex Shilton n’était âgé que de seize ans, mais sa voix rauque donnait le cachet soul. Les paroles de la chanson étaient en rapport avec la guerre du Vietnam, on pouvait imaginer un G.I. souhaitant rentrer après avoir reçu une lettre de sa petite amie. Le succès fût immédiat chez les combattants. Je bissais le titre, la sono couvrait ma voix et c’était préférable pour tous.
Au moment du départ, maman me donna l’argent de la nourriture pour un bon mois et le loyer pour deux mois. Papa me compléta largement le pactole quand il me déposa à l’embarquement au quai de Southampton. Avec ma cagnotte personnelle l’ensemble représentait une belle somme. Je n’avais jamais eu autant d’argent sur moi. Au bureau de change sur le car-ferry le taux de la Livre Sterling diminua le montant, mais loyer payé, je pourrais vivre deux mois sans problème et ensuite compléter l’aide des parents avec mon nouveau job. Je cachais l’argent des premiers loyers dans le sac au milieu des vêtements. Une seconde liasse disparaissait dans une poche intérieure du magnifique blouson en cuir acheté chez Sigrand Covett, le spécialiste de l’homme élégant, avenue René Coty au Havre. Également dans la boutique de qualité, l’achat d’un non moins bel imperméable de couleur mastic. Ce jour béni j’avais aussi eu droit à une nouvelle paire de boots noirs de chez André « le chausseur sachant chausser » Place de l’Hôtel de ville. Le magasin haut de gamme Caron à l’entrée de la rue de Paris avait ma préférence mais n’entrait pas dans le budget familial. J’avais profité des largesses de maman qui souhaitait que je sois correctement habillé même si elle avait dû s’adapter à mes goûts. Pour la troisième liasse de billets, j’en laissai une partie dans mon portefeuille et une autre pliée dans ma poche de chemise sous mon pull. Optimisme au plus haut après ma transaction en monnaie anglaise, j’achetais des cigarettes au magasin hors taxes. Je fumais très peu, et pouvais me permettre de m’offrir ma marque préférée, la Senior Service, une des plus chères du Royaume Uni, un tabac blond de Californie. Je l’appréciais également pour son emballage. Le paquet blanc rectangulaire avait pour emblème un splendide voilier blanc, entouré de deux branches d’olivier, surmonté d’une couronne. La partie haute du paquet était traversée par une bande horizontale dorée, bordée de deux bandes bleu marine. Une ligne également dorée, au milieu de l’enveloppe de cellophane, permettait d’ouvrir la protection. Je trouvais ce paquet chic en comparaison aux marques françaises. Il devait l’être car James Bond fumait des Senior Service entre autres dans le film Goldfinger. En tirant délicatement la languette pour ouvrir le paquet, loin de ressembler à l’agent secret britannique, je pouvais m’imaginer, portant mon imperméable avec le col relevé et une cigarette aux lèvres, en truand comme Belmondo dans « Le Doulos » ou en détective privé comme Humphrey Bogart dans « Le grand Sommeil ». Le chapeau mou passé de mode n’était pas obligatoire. C’était sans doute influencé par les espions et les polars que j’avais séparé les livres sterling. Je fumais ma Senior Service, puis bien calé dans mon fauteuil, avec mon sac entre moi et l’encoignure de la cloison du bateau je pouvais m’endormir et rêver aux « James Bond Girls ».
Au petit matin, à l’approche de l’île de Wight, je profitais du peu de monde dans les toilettes pour me rafraichir, et me raser. Petit tour sans histoire au bureau de la police des frontières. Je venais pour deux mois à Brighton perfectionner mon anglais. Je donnai l’adresse de mon logement, montrai que je préparais un diplôme avec des cours par correspondance et lorsque que l’on me demanda si j’avais des connaissances sur place, j’affirmai que j’étais plus ou moins fiancé avec une anglaise prénommée Fiona habitant Hove, ville jouxtant Brighton. Quand, à la demande habituelle du policier sur mes moyens financiers, j’annonçais la somme d’argent que j’avais pour deux mois, mon autorisation d’entrer sur le territoire anglais fut signé sans problème. Je n’eus pas à justifier le montant en montrant mes billets. Cela m’était arrivé une fois. J’avais retenu de bons enseignements de mes passages dans ce bureau lors de mes précédents voyages. Bonne présentation, très poli, réponses rapides, précisions si nécessaires, j’avais bien préparé l’entrevue.
Lors d’un voyage avec mon ami Alain, en février, j’avais quelque-peu fanfaronné en présentant pour le logement trois adresses de copines au choix. Nous avions dû attendre l’entrée du ferry dans le port de Southampton, pour obtenir l’autorisation de descendre du bateau, après avoir précisé la bonne adresse vérifiable, sinon c’était le retour direct au Havre.
Petit déjeuner britannique à la cafétéria, en compagnie d’une forte majorité de routiers. Débarquement à Southampton à huit heures, de nouveau un peu de marche à pied jusqu’à la gare et enfin un train peu rempli pour Brighton. Connaître le parcours par cœur me semblait diminuer la durée du trajet.
2
A la sortie de la gare, je posai mon sac sur le parvis, m’allumai une cigarette, un regard sur Queen’s Road qui descendait vers la plage, j’étais chez moi.
Je marchai jusqu’au Wimpy situé sur le trottoir de droite où nous allions parfois manger, Richard, Alain et moi, lors de notre séjour l’année d’avant. C’était plus fréquent la première semaine. Par la suite, le financier nous obligea à nous restreindre sérieusement sur la nourriture pour profiter de nos soirées.
Je m’installai sur une banquette à une table pour deux, à l’entrée face à la cuisine ouverte. Quelques tables plus loin on accédait à une grande salle. Ma place me permettait de profiter de l’animation de ce restaurant ancêtre du fast-food où le service se faisait à table. Je commandai deux œufs au plat avec des frites et un coca. La clientèle était uniquement jeune, souvent par petits groupes, mixte ou pas. Vacances terminées, exit les scandinaves et les continentaux européens. J’étais le seul hors Royaume-Uni. Une large majorité de filles avaient opté pour les mini-jupes ou les minirobes, le plus souvent avec des bottes, parfois blanches plastifiées. Tenue peut être influencée par la chanson « These boots are made for walkin’ », immense succès de Nancy Sinatra en 1966. C’était en tout cas mon impression à la vue du défilé de ces paires de jambes bottées. En raison de la météo froide et humide, temps nuageux sans soleil, les filles portaient des manteaux aux gros boutons, ou des cirés plastifiés de couleur vive, les gars des impers ou parfois des parkas. Je prolongeais l’attente de mon rendez-vous de quinze heures avec la séduisante madame Collins en buvant un insipide café anglais qui ne risquait pas d’augmenter mon rythme cardiaque. Enfin le moment tant attendu arriva, je quittais le Wimpy, passais par Church Street, pour rejoindre mon deux pièces Gardner Street. Pile à l’heure, la porte d’entrée sur la rue était ouverte, je montai l’escalier et toquai à la porte entrebâillée de la cuisine. La charmante voix du « entrez » de ma propriétaire me perturba quelque peu. Quand elle se retourna de la fenêtre pour m’accueillir, elle me fit une nouvelle fois sensation par son élégance. Elle portait un costume joliment coupé, de couleur beige, sur des bottines noires qui la grandissait. Nous étions pratiquement à la même hauteur. J’étais en lévitation. Je m’imaginai que son mari devait être grand, beau, élégant, la classe lui aussi. Ce pouvait ne pas être le cas, certains ont des atouts cachés qui font la différence. Personnellement, pas de joker dans mes manches, un physique sans plus. J’avais pour habitude de suivre les conseils d’un copain, lors de mon unique colonie de vacances, à l’âge de quatorze ans : « Regarde-toi dans un miroir et drague en fonction de ton niveau ». C’était facile pour lui, beau gosse, il flirtait avec la plus jolie fille de la colonie. Malgré tout, son conseil m’était resté et je l’appliquais le plus souvent. Le « bonjour Philippe, vous avez fait bon voyage » me reposa au sol.
- Oui très bien merci
- Excusez-moi Philippe mais je suis un peu pressée…J’ai un autre rendez-vous…Donc, je vous ai apporté le contrat de location, lisez-le tranquillement. Plus tard, vous m'enverrez l'original signé.
- Entendu madame Collins.
- Voici également la carte de visite du restaurant pour le poste de plongeur. Ce sont des gens charmants, et leur cuisine est excellente. Vous devriez vous y plaire.
- Merci, c’est très aimable à vous de m’avoir trouvé ce job.
- Vous savez, j’ai fait aussi des petits boulots pendant mes études, je connais la situation. Bien…Au revoir Philippe, bon séjour, travaillez bien.
- Au revoir Madame Collins.
Et là, ma troublante propriétaire franchit la porte. J’attendis qu’elle soit en bas de l’escalier pour fermer et récupérer le contrat sur la table. Je m’installais dans l’unique et vieux fauteuil en tissus vert près de la fenêtre. L’entrevue très courte m’avait déçu. J’avais quelques difficultés à comprendre la raison de son aide. C’était la cinquième fois que l’on se rencontrait. Les deux premières fois avec mes copains, en juillet 66, pour la location d’une chambre dans une maison située près de la gare. Grande maison qu’elle louait l’été pour des jeunes en séjour linguistique. Ce n’était pas notre cas mais celui des autres locataires, cinq françaises et un allemand. Deux fois cet été pour mon mini deux pièces qu’elle me louait à nouveau. Je partis du principe qu’elle avait une location assurée jusqu’à l’été prochain, mais l’Université du Sussex étant située à Brighton, elle aurait pu tout aussi bien avoir un étudiant anglais. Son élégance, sa façon d’être m’avait subjugué. Elle portait des vêtements coûteux, donnait l’impression d’être à l’aise financièrement, pourtant elle gérait elle-même ses locations. La lecture du contrat me confirma que le montant du loyer était trois fois moindre que celui de l’été jusqu’à la date de mon départ fin juin. Attachée sur le contrat avec un trombone, la carte de visite du restaurant avec la date et l’heure à laquelle je devais m’y présenter : mercredi 4 octobre à quinze heures.
*
Cet été, j’avais vécu trois semaines dans le deux-pièces, mon installation fût rapide. Je rangeai quelques vêtements d’hiver dans l’armoire, peu de différences entre les deux saisons, j’étais en Angleterre. Approvisionnement au petit supermarché de la rue où j’avais mes habitudes. Le choix était limité, j’étais toujours en Angleterre. A se demander la cause de mon retour. On était samedi soir, je savais pourquoi j’étais là, j’allais retrouver l’ambiance musicale et de fête que j’appréciais tant, totalement différente du Havre très limité dans ce domaine.
J’aurais aimé être avec mes compères de l’an passé. Malheureusement, Richard sous les drapeaux depuis mars, Alain le serait dès le mois prochain. J’étais plus jeune de pratiquement deux ans, j’avais la possibilité de repousser l’incorporation en raison de mes études, je ne m’en souciais guère pour l’instant. Sortir sans copains était beaucoup moins fun, mais habitué à être souvent seul dans mon enfance, je m’adaptais assez facilement.





























