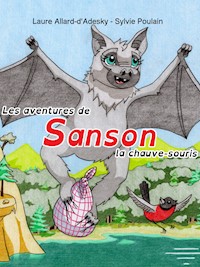Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Art en Mots Éditions
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Zélie a la trentaine quand elle meurt soudainement. Après avoir rendu son dernier souffle elle découvre qu’elle est une « entre-deux », le sort que l’on réserve aux personnes qui n’ont pas accompli assez de bonnes actions pour aller au paradis mais ne méritent pas non plus l’enfer. On lui propose un choix : se réincarner en amie imaginaire d’un enfant et par des bonnes actions mériter sa place au Paradis ou aller en Enfer où on porte des sandales chaussettes en écoutant l’intégrale de Dave.
Zélie choisit donc de devenir l’amie imaginaire de Clara, son ancienne voisine, mais va vite découvrir que ce ne sera pas de tout repos, surtout quand des « entre-deux » commencent à disparaître étrangement et qu’un certain Pierre vient troubler son quotidien déjà bien mouvementé.
Une histoire originale où se mêlent comédie et fable fantastique.
À PROPOS DE L'AUTEURE
Laure Allard-d'Adesky écrit depuis sa plus tendre enfance. Après la naissance de son fils, elle décide de consacrer une grande partie de son temps libre à l'écriture de livres pour enfants. Elle publie en 2014 Le bal du solstice aux Editions Jets d'encre puis des contes pour le site internet Whisperies.com. En 2015, dans le temps libre que lui laisse son engagement de réserviste au service de l'armée de Terre, elle s'essaye aux histoires pour adultes. Elle publie une nouvelle intitulée Altiya, la déesse du feu aux Editions secrètes. En 2016, elle se lance dans les comédies romantiques et publie Juste une histoire de chance chez Anyway Éditions et Burger Royal aux Editions secrètes. En 2017, elle a publié la suite de la saga Burger Royal ainsi que 4 albums pour enfants.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 225
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ma deuxième VIE
après la mort
Laure Allard-d’adesky
Roman Fantastique
Illustration graphique : Graph’L
Images : Adobe Stock
Éditions Art en Mots
Prologue
J’ai toujours su que je mourrai jeune. Sans aucun narcissisme, je me disais qu’ainsi il y aurait plus de monde pour me pleurer le jour de mon enterrement et peut-être même pour se lamenter sur ma tombe pendant des heures. Je rêvais d’une mort spectaculaire. Après tout, la vie est une grande pièce de théâtre en plusieurs actes : au moment de quitter la scène, autant le faire de manière grandiose.
J’avais vu une série télé où l’héroïne meurt percutée par la lunette des toilettes de la station MIR (Dead Like me), et j’avais trouvé cela génial, digne d’un bel encart dans la rubrique des faits divers. Il n’y avait que la partie « cuvette des toilettes » qui me gênait un peu : pas assez glamour, et puis je ne voulais pas mourir avec de la matière fécale sur le visage. C’est pourquoi je me disais qu’il serait sympa de faire un tour de grande roue, place de la Concorde par exemple, et que ma nacelle se décroche pour tomber sur un éminent membre de l’Assemblée Nationale passant par-là, nous tuant tous deux sur le coup. Je pouvais aussi me noyer en sauvant le chien du président de la République, sous les yeux horrifiés de la première Dame qui déclarerait le jour de ma mort deuil national. J’envisageais aussi un effroyable accident de parapente sur Buckingham Palace (alors que je ne fais pas de parapente), qui interromprait le thé de Sa Majesté la reine : so shocking ! En résumé, je voulais d’une mort dont on se souvienne.
Si je voulais mourir jeune, je ne voulais pas non plus partir trop tôt. Il me fallait avoir le temps d’accomplir de grandes choses, au moins suffisamment pour qu’on me pleure à chaudes larmes : il fallait qu’on puisse dire de moi « Zélie était une femme formidable : sans elle, je ne serais pas devenue ce que je suis aujourd’hui. » Ou encore « Il y aura toujours un avant et un après Zélie Louvier ». Pour devenir une femme digne d’être regrettée et pleurée pendant quelques jours, je m’étais dit qu’il fallait quand même atteindre la petite cinquantaine. Ainsi, je serais encore une belle femme avec une carrière extraordinaire, mais ne vieillirais pas assez pour finir dans une maison de vieux, harnachée dans un fauteuil et méprisant mes voisins de table en train d’avaler une bouillie prémâchée devant une énième rediffusion de Plus Belle la vie. J’avais un plan, une carrière toute tracée et je serais sans doute arrivée à mes fins si la Grande Faucheuse n’avait pas décidé de se débarrasser de moi de la manière la plus ridicule qui soit, à l’aube de mes trente ans.
Chapitre 1 : Le dernier jour de ma vie
À l’aube de mes trente ans, j’étais loin d’avoir suivi mon plan de carrière à la lettre. Je rêvais d’une grande notoriété en tant que directrice de la création dans une prestigieuse agence de pub, mais à la sortie de mes études, je n’avais trouvé qu’un petit boulot de vendeuse d’encarts publicitaires dans un journal gratuit. Celui qui, au mieux, vous sert à laver vos vitres et, au pire, à ramasser les crottes du scottish-terrier de votre grand-mère. Qu’importe, cela ne me dérangeait pas, j’avais mis un pied dans le milieu de la pub et j’avais encore une vingtaine d’années devant moi pour devenir une Grande Dame. Il fallait juste que je ne perde pas trop de temps en route et que je ne croupisse pas ad vitam dans le trou à rats qu’était mon bureau actuel.
Mes collègues étaient sympas, mais ils étaient loin de passer leurs week-ends sur des yachts au large de Monaco, comme j’aspirais à le faire dans quelques années. Geneviève par exemple, celle qui partageait mon semblant de bureau, travaillait pour ce magazine miteux depuis trente ans ; elle était fière à chaque fois qu’elle vendait un encart publicitaire pour la dernière crème dépilatoire ou une nouvelle alèse révolutionnaire pour lutter contre les fuites urinaires. Elle paraissait vraiment heureuse. Elle faisait le job de ses rêves et cela me dépassait totalement. Je ne me voyais vraiment pas, à son âge avancé (près de soixante ans), dans un bureau sans fenêtre situé dans l’arrière-cour d’un supermarché vendant du poulet aux hormones et de la viande hachée avariée.
Yves, un de mes autres collègues, arrivait chaque jour au travail avec une pêche d’enfer. Il essayait de nous remonter le moral quand la grisaille parisienne nous donnait envie de nous pendre. Il avait toujours des petites intentions pour les uns et les autres. Il racontait à qui voulait l’entendre qu’il avait toujours adoré ce magazine, que c’était en déchiffrant ses petites annonces qu’il avait appris à lire. C’était le genre d’homme qui a toujours le sourire aux lèvres et une pensée positive. Il arrivait le matin en sifflotant, alors que moi je me traînais vers mon fauteuil de bureau à reculons. De toute manière, j’aurais eu du mal à faire comme lui puisque je ne sais pas siffler. Mais je faisais mon boulot, je restais pro et je pense que je n’étais pas mauvaise quand il s’agissait de proposer à l’organisateur de la foire à la saucisse de Trifouillis-les-Oies ou de Perpète-la-Galette, une pleine page pour annoncer le programme de leurs événements si glamours !
Pour l’instant, j’étais mademoiselle Tout Le Monde et j’insiste sur le « mademoiselle ». Je fréquentais depuis quelques mois Benjamin – dit Ben le musicien – pourtant j’avais du mal à savoir s’il tenait réellement à moi. C’était un de ces artistes incompris qui gratte sa guitare avec des airs inspirés, joue sur de petites scènes pour une poignée de spectateurs, tout en étant persuadé qu’il finira par être remarqué par une grande maison de disques. Il était parfois froid et distant, mais ce n’était pas un mauvais bougre. Ce qui m’attachait à lui, c’était qu’il avait de l’ambition. Comme moi, il avait un plan et il ne se moquait pas quand je lui exposais le mien. Souvent nous dégustions en tête à tête, à même le sol, des plats préparés par le chinois du coin de ma rue et il ne cessait de me dire : « Tout ça, c’est temporaire Zélie, bientôt la grande vie : les fringues de couturiers et les magnums de champagne. Tu verras, bientôt on tutoiera les plus grands et ceux qui n’ont pas cru en nous se mordront les doigts. » Bien naturellement, j’acquiesçais dans un grand éclat de rire et nous trinquions avec une bière chaude, nos pensées nous projetant chacun dans nos rêves les plus fous.
La plupart de mes amies, si elles n’étaient pas encore passées devant monsieur le maire, rêvaient de se faire mettre la bague au doigt, mais moi, j’étais heureuse de mon statut. Si je voulais vraiment devenir une publicitaire reconnue, je ne pouvais pas m’embarrasser d’un mari qui voudrait absolument me voir élever une joyeuse marmaille digne d’une pub pour l’ami Ricoré. Ben n’avait jamais parlé d’enfants et j’étais certaine que jamais cette idée ne lui avait traversé l’esprit.J’avais de la chance : mes parents divorcés depuis mes deux ans ne croyaient pas du tout à l’idée du mariage, et ma mère, accro aux injections de Botox, aurait assassiné quiconque aurait osé aborder le fait qu’elle était en âge d’être grand-mère.
Je vivais dans un petit studio parisien. On était loin du loft dont je rêvais, pourtant il était fonctionnel, propre et pratique. Ben y squattait régulièrement. J’imagine qu’il devait le trouver plus confortable que le futon du garage de ses parents à Antony. Nous partagions notre petit espace avec Bertha, ma tortue d’Hermann. Certaines personnes rêvent d’un chat, d’un chien, ou encore d’un hamster, mais moi, j’avais toujours rêvé d’une tortue : l’animal de compagnie du pauvre, réputé quasi increvable. Cette petite bête n’avait besoin de rien d’autre qu’une feuille de salade et un coin pour vivre. Je pouvais facilement la confier sans craindre qu’on lui donne trop de croquettes et que je la récupère souffrant de terribles flatulences pendant des jours. J’adorais observer Bertha, car je me disais que ma vie n’était pas si pourrie. Au moins, moi, je pouvais sortir de mon studio, je ne devais pas me balader avec ma maison miteuse sur le dos jusqu’à la fin de mes jours. J’étais fascinée par les tortues depuis l’époque où je passais mes mercredis après-midi à regarder des épisodes de Tortues Ninja et à me demander quand est-ce qu’elles finiraient par souffrir des séquelles de leur curieux mode de vie. On ne peut pas passer sa journée dans des égouts à bouffer de la pizza et à discuter avec un rat sans finir en thérapie ou suivi par un diététicien.
En partant travailler, chaque matin, je croisais ma petite voisine de palier, qui devait avoir entre sept et huit ans. Je l’avais rencontrée le jour où elle était venue m’emprunter du sucre. Elle était mignonne dans son genre : un mini sosie de Mercredi Addams, sans cesse vêtue de noir avec deux tresses parfaitement symétriques qui entouraient son visage à l’air sévère. Elle s’appelait Clara et son école était située à côté de ma station de métro. Nous cheminions côte à côte sans jamais nous parler, pour autant, si j’avais le malheur d’avoir quelques minutes de retard, je regrettais sa présence à mes côtés pour effectuer ce court trajet. C’était une petite routine familière qui me mettait en joie. Allez savoir pourquoi. Je savais qu’elle m’attendait aussi longtemps qu’elle le pouvait. Je l’entendais claquer sa porte d’entrée et attendre sur le palier quelques minutes, malheureusement, je n’étais pas toujours en mesure de la rejoindre. Elle dégageait quelque chose qui m’était devenu indispensable pour passer une bonne journée, sans que je puisse l’expliquer. Pourtant, Dieu sait que je me méfie des enfants. Pour moi ce sont des petits nids à microbes qui, sous leurs visages d’ange, sont souvent le mal incarné. J’avais été le bouc émissaire des autres élèves depuis mon entrée à l’école primaire. Mes parents ne m’avaient pas facilité la tâche en m’appelant Zélie. Cela m’avait valu des piques aussi tendres que : « Zélie n’est pas zolie », « Zélie n’est pas très zentille » ou pire « Zélie a un zizi ». C’est ainsi que, même en ayant grandi, je continuais à garder de la distance avec les humains de moins de quinze ans.
Telle était ma vie : j’étais loin des strass et des paillettes, mais c’était passager — du moins c’est ce que je croyais…
Ce jour-là, j’avais cinq minutes de retard quand j’ai quitté précipitamment mon appartement. J’étais énervée de m’être presque électrocutée en essayant de récupérer ma tartine dans le grille-pain avec un couteau en métal. J’avais rigolé nerveusement lorsque les plombs avaient sauté. Je m’étais dit « Quelle mort bête tout de même ». J’étais loin de m’imaginer que la mienne le serait encore plus. Quand j’ai réalisé l’heure qu’il était, mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. J’étais déçue de rater Clara, mais également particulièrement stressée, car depuis quelques semaines nous avions un nouveau patron qui ne tolérait pas les retards et nous faisait pointer à notre arrivée, comme à l’usine.
Au début, j’avais été ravie de voir arriver une nouvelle tête, surtout en apprenant qu’il avait la trentaine et faisait drastiquement baisser la moyenne d’âge de l’entreprise. Nous étions une petite boîte et ce n’est pas parce qu’il allait être le patron qu’on ne pouvait pas bien s’entendre. Comme je me trompais ! Roméo (car c’était son prénom, et il voulait donner à l’extérieur l’illusion d’une ambiance décontractée en nous obligeant à ne pas l’appeler Monsieur Morel) avait tout de suite instauré les distances de rigueur en nous imposant une discipline digne du règne soviétique. Fini les pauses café à rallonge au cours desquelles Geneviève me racontait les dernières aventures de Truc, son chat obèse et maladroit, et où Yves tentait de me faire rire avec une énième blague de Toto.
Il régnait désormais une ambiance glaciale au bureau, et même Yves le bienheureux avait de plus en plus de mal à débarquer au travail avec le sourire. Roméo pouvait se mettre dans des colères terribles, moi, j’avais adopté une politique de l’autruche pour ne pas me faire remarquer. Plus il criait, plus je me faisais toute petite derrière l’écran de mon ordinateur, prenant bien soin de ne pas croiser son regard. Je n’aimais pas mon boulot, malheureusement, je ne pouvais pas prendre le risque de me faire virer, cela ferait tache dans mon dossier et me suivrait pendant longtemps.
En sortant du métro, j’adoptai cette démarche typique des Parisiens : mi-marche mi-course pour essayer de diminuer un peu mon retard, mais pour ne pas arriver non plus à bout de souffle, au bord de la crise cardiaque avec des auréoles sous les bras. Je croyais me souvenir que Roméo avait un rendez-vous à l’extérieur ce matin-là. Il ne regarderait son logiciel de pointage qu’après sa pause déjeuner. Cela m’offrait un peu de répit pour réfléchir à une bonne excuse crédible qui ne m’attirerait pas son courroux. Malheureusement pour moi, au moment même où j’allais entrer dans l’immeuble de la boîte, je percutai un torse masculin de plein fouet. Comme dans un ralenti télévisuel, je levai les yeux vers l’homme pour m’excuser et réalisai avec effroi que ce n’était personne d’autre que mon patron. Il me lança un regard plein de dédain et de mépris (le genre de regard qui donne autant envie de faire pipi dans sa culotte que de disparaître de la surface de la Terre) et me demanda :
— Est-ce une heure pour arriver au travail, Zélie ? Vous avez posé votre matinée ?
Toujours ce sens de l’emphase ! Je n’avais que quinze minutes de retard, pardi ! Je m’attendais à bégayer tellement il me faisait peur, alors je pris une profonde inspiration avant de lui répondre :
— Je suis désolée Roméo, j’ai eu un souci à la maison avec mon grille-pain et…
— Vous pensez vraiment que votre misérable vie privée m’intéresse ?
— Je… je suis navrée, cela ne se reproduira plus.
— C’est évident, sachez que je vous ai à l’œil. C’est un premier avertissement. Il n’y en aura pas deux.
Il me contourna d’un geste brusque, manquant de me renverser au passage. J’ai oublié de préciser qu’il avait une carrure d’armoire à glace. Il aurait pu tout aussi bien être déménageur ou joueur de rugby professionnel, face à moi qui mesure à peine 1m60 en me mettant sur la pointe des pieds. Je me précipitai alors au bureau et c’est seulement en fermant le logiciel de pointage que je pus reprendre une respiration normale.
— Café ? proposa Geneviève, profitant de l’absence de notre boss.
J’acceptai avec grand-plaisir, j’avais besoin de me changer les idées et le récit du dernier souci de Truc serait idéal pour cela. Je ne parlais jamais de ma vie privée avec mes collègues. Non pas que je n’avais rien à dire, c’était plutôt que je préférais écouter, qui sait : ces informations me seraient peut-être un jour utiles, même si j’en doutais en entendant le récit détaillé de la cœlioscopie du père d’Yves. Et mon intérêt semblait convenir à mes collègues, d’autant plus que mon excellente mémoire me permettait de feindre l’intérêt. Au moment où Geneviève me tendit une tasse fumante de cappuccino, je lui demandai :
— Truc apprécie-t-il ses nouvelles croquettes ?
— Oh oui, je savais bien qu’il ne digérait pas le saumon alors qu’avec la volaille il n’a aucun problème, il a un sommeil beaucoup moins agité, plus du tout de gaz.
Je fronçai le nez (trop d’information tue l’information), mais répondis néanmoins en souriant :
— Tu m’en vois ravie, c’est important qu’il dorme bien.
— Cela me permet aussi de me reposer, c’était un peu compliqué ces derniers temps. Tu n’as pas croisé Roméo, ce matin ? Il est sorti à peine quelques minutes avant que tu n’arrives, tu as eu chaud.
— Tu parles, je l’ai percuté de plein fouet. Je me demande comment un type aussi détestable peut avoir le prénom du héros le plus romantique de tous les temps.
Une voix masculine répondit derrière moi :
— Peut-être simplement parce que sa mère était persuadée qu’elle attendait une fille et rêvait de l’appeler Juliette.
Mon sang ne fit qu’un tour. Je me retournai pour faire face à mon boss, qui tenait un dossier entre les mains avec une mine patibulaire.
— J’avais des papiers à récupérer, estimez-vous heureuse que je n’aie pas envie de perdre du temps à vous réprimander, car je suis suffisamment en retard comme ça. Retournez au boulot !
Comme deux gamines prises en faute, nous fûmes en un instant de retour à notre poste de travail, sans demander notre reste. Quelques instants plus tard, la porte d’entrée claqua, nous pûmes éclater d’un rire nerveux, ce qui fit venir Yves. Il nous demanda ce qu’il y avait de si drôle.
J’ai passé la matinée plongée dans mon boulot. Il fallait absolument que je regagne des points auprès de mon patron, j’étais sur une pente glissante et dangereuse alors qu’il était peut-être l’ascenseur qui me ferait gravir les échelons.
À la pause déjeuner, Geneviève se leva et me demanda si je voulais les accompagner, Yves et elle, dans une brasserie qui venait d’ouvrir. Déjà qu’en temps normal cette perspective ne m’aurait pas fait rêver… je répondis par la négative. J’aimais être au calme pour déjeuner. Cela me permettait de faire le point sur ma vie, même si le bilan n’était pas toujours positif. En plus, rester à mon bureau donnait l’illusion que j’étais une employée modèle et consciencieuse. J’ai décidé de descendre seulement m’acheter une salade en bas de la rue. Je vous ai déjà situé le supermarché le plus proche, que j’évitais soigneusement, alors il me fallait rajouter cinq minutes de plus à ma sortie pour être sûre de ne pas finir l’après-midi assise sur la cuvette des toilettes, terrassée par une gastro foudroyante. Au moment où je m’apprêtais à sortir, je croisai le regard de Roméo qui était revenu entre temps.
— Excusez-moi, demandai-je. Je vais descendre m’acheter de quoi manger, voulez-vous que je vous rapporte quelque chose ?
Il parut surpris par ma proposition, je m’étonnais moi-même. Est-ce que je n’en faisais pas un peu trop ?
— C’est gentil de votre part.
Il eut une mine de dégoût comme si ça lui coûtait de l’admettre.
— Voilà cinq euros, si vous voulez bien me rapporter un sandwich parisien et un Perrier, de la Boulangerie à l’ancienne.
Je pris sa monnaie avec un sourire, le maudissant intérieurement. La boulangerie à l’ancienne était la plus chère du quartier. Le moindre sandwich, même un simple jambon beurre, valait une dizaine d’euros, car, dans ses recettes, le boulanger rajoutait des fragments de truffe ou du caviar pour donner une touche plus luxueuse à votre repas. Je n’étais pas près de mes sous, mais ça me faisait mal au cœur de prêter de l’argent à cette peau de vache, même si c’était mon patron. Je fis donc mes propres courses au supermarché et, sur le chemin du retour, m’arrêtai à la Boulangerie à l’ancienne. Dix minutes de queue, et le repas de Roméo me coûta la modique somme de douze euros cinquante. Je pris soigneusement la facture et, en rentrant, tendis le tout à mon patron tout en guettant sa réaction.
— Ah, les prix ont augmenté, dit-il. Je n’ai pas de monnaie, je vous rembourserai sur votre paye du mois prochain si ça ne vous dérange pas.
J’avais envie de répondre :
— Bien sûr que si ça me dérange ! C’est une question de principe : les bons comptes font les bons amis.
Naturellement, je restai silencieuse. Je n’avais aucune envie d’en faire mon ami, mais d’autre part je pensais à mes rêves de grandeur. Bientôt, c’est moi qui mangerais des sandwichs au beurre de truffe ou aux œufs de caille, et je ne serais plus à sept euros cinquante près. Je quittai donc son bureau pour m’installer dans le mien et y engloutir ma salade sans saveur. Il me restait une demi-heure de pause. Je la passai à surfer sur les profils Instagram de femmes d’influence à qui j’aurais aimé ressembler. Comme moi, elles étaient parties de rien et vivaient maintenant des vies palpitantes, dormant dans des hôtels de luxe et ne mangeant que dans des restaurants étoilés. Elles avaient un physique de star, ce qui serait aussi mon cas si j’avais un coiffeur, un chef et un coach sportif à domicile.
— Un jour ce sera moi, murmurai-je, pensant être seule.
Mais c’était sans compter sur Roméo qui, pour la deuxième fois de la journée, apparut derrière moi sans que je l’aie entendu venir. Je me demande encore s’il n’avait pas le don de se mouvoir en silence ou de se téléporter où bon lui semblait. Il pouffa :
— Vous n’êtes pas sérieuse ?
Piquée au vif, j’essayai de maîtriser mes émotions. Il n’avait pas le droit. Personne ne pouvait briser mes rêves ni surtout laisser entendre que mes aspirations n’étaient que chimères. Je lui répondis en tentant de maîtriser les trémolos dans ma voix.
— Si parfaitement, pourquoi ?
— Ces femmes s’inventent le passé de madame Tout Le Monde pour renforcer leur gloire éphémère, mais elles ont fait de grandes études, ont commencé leurs carrières à bosser dans des boîtes cotées au CAC 40 alors que vous…
— Alors que moi quoi, Roméo ? Moi, je travaille dans un magazine minable, dirigé par un patron tout aussi minable qui s’imagine que rabaisser ses collaborateurs lui fera oublier qu’il a une vie de merde ?
C’est en prononçant cette dernière phrase que je pris conscience de mon erreur. Je portai la main à ma bouche. Avais-je encore le temps de m’excuser ? Pouvais-je inventer un syndrome semblable à celui de la Tourette, qui m’aurait forcée à dire des choses que je ne pensais pas ? Je me demandai si éclater en sanglots permettrait de me sortir de ce mauvais pas. Puis, un instant après, je pensai à toutes ces grandes femmes que j’enviais. Jamais elles ne se seraient laissé faire, alors je soutins le regard de mon boss qui était devenu rouge pivoine. C’est alors que, sans un mot, il sortit. J’aurais pu en être soulagée, mais je le connaissais maintenant suffisamment bien pour savoir qu’il cherchait juste à retrouver une contenance avant de se venger de cet affront. La seule chose qui pouvait un tant soit peu me sauver, c’était qu’il n’y avait pas eu de témoin. Je ne l’avais donc pas humilié, enfin, seulement à moitié.
Je ne m’étais pas totalement remise de mes émotions quand Geneviève réapparut, quelques minutes plus tard.
— Tout va bien ? Tu es pâle comme un linge.
Je mourais d’envie de lui raconter ce qui venait de se passer, mais je ne pouvais ignorer le don qu’avait mon patron d’apparaître là où on ne l’attendait pas, et je ne voulais pas prendre un nouveau risque inutile.
— Juste une petite migraine, rien de grave.
Ma collègue me tendit une aspirine et un verre d’eau, le tout avec un grand sourire. Sa gentillesse et sa sollicitude ne cessaient de me surprendre. Elle était toujours adorable, presque comme si nous étions amies alors que pour moi, elle ne serait jamais plus qu’une collègue de travail : aussitôt après avoir quitté ce boulot, j’étais sûre d’oublier tout de mon environnement minable, y compris le prénom des gens qui bossaient à mes côtés.
Le reste de la journée, je me plongeai dans mon boulot, démarchant des dizaines d’entreprises d’Île-de-France afin de leur proposer une mise en avant peu coûteuse dans notre magazine dont – cela faisait partie de mon argumentaire – le grand tirage était assurément un atout incontournable. J’étais fière de moi pour avoir vendu un encart à une entreprise de pompes funèbres et un autre à une boîte qui avait élaboré une pilule censée vous faire rajeunir et prolonger votre vie de vingt ans. Il fallait juste que je discute avec le graphiste pour qu’il ne mette pas les deux annonces côte à côte. J’avais presque oublié ma dispute avec Roméo quand je l’entendis m’appeler dans son bureau. Au son de sa voix, je savais que j’allais passer un mauvais quart d’heure. Je me levai, chantant l’air de la marche funèbre de Chopin dans ma tête. Je ne savais pas encore à quel point c’était un funeste présage.
— Asseyez-vous, je vous en prie, déclara mon patron d’une voix blanche.
Je m’exécutai, tentant tant bien que mal de maîtriser mon corps qui s’était mis à trembler.
— Vous êtes calmée ?
— Roméo, je suis désolée, je me suis laissé emporter. Mes mots ont dépassé ma pensée.
— Non, vous aviez tout à fait raison. Vous n’avez fait que dire ce que la plupart de vos collègues pensent tout bas et votre franchise est tout à votre honneur. C’est une qualité très rare de nos jours.
Il fit une pause. Ses yeux semblaient sonder le plus profond de mon être. Il me donnait l’impression d’être le diable en personne, qui aurait voulu me voler mon âme. Je ne comprenais pas où il voulait en venir. C’est alors qu’il éclata de rire. Son rire fit presque trembler les murs. Il ressemblait à ces psychopathes des séries policières qui s’apprêtent à découper leurs victimes en petits morceaux pour les donner ensuite à manger à leurs Yorkshires affamés. Il semblait attendre une réaction de ma part, mais tétanisée par la peur, je ne disais rien.
— Néanmoins, vous comprenez que je ne peux tolérer dans cette entreprise une employée dénigrant à ce point son emploi. Vous n’êtes pas sans savoir que notre magazine demande un budget conséquent, que nos encarts publicitaires ont de plus en plus de mal à couvrir. C’est pourquoi je suis au regret de vous informer que nous nous passerons de vos services dès le mois prochain.
— Comment ? Ce n’est pas possible. Vous ne pouvez pas me licencier comme ça !
— Eh bien si ! Justement. Comme vous l’avez si bien dit, je suis le minable patron d’une boîte tout aussi minable. Ma décision ne devrait donc pas vous surprendre.
— Je ne me laisserai pas faire, je vous traînerai aux prud’hommes pour licenciement abusif.
— Faites, faites, je vous en prie, mais n’oubliez pas : ce genre de procédure coûte cher et entache la réputation d’un employé. Vous pouvez partir pour des raisons économiques, ou je peux gâcher à jamais vos puérils rêves de grandeur en révélant aux grands de la pub à quel point vous êtes une employée médiocre.
Il me montra la porte. Sa sentence prononcée, il ne voulait plus de ma petite personne dans son bureau. Je quittai la pièce avec des envies de meurtre et des larmes aux yeux. Geneviève n’était plus là quand je gagnai mon bureau, et j’en étais heureuse, car je n’aurais pas supporté son écœurante gentillesse et ses mots bidon censés m’encourager et me remonter le moral. Je ne savais pas comment trouver le courage de revenir travailler jusqu’à la fin du mois et surtout de ne pas avoir envie d’arracher les globes oculaires de Roméo pour les lui faire bouffer par les narines.