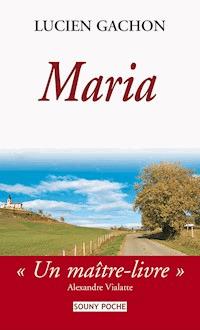
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Lucien Souny
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Lucien Gachon a labouré la terre. Il la porte en lui, en connaît les parlers et les rites : il en sait l’âme.
Maria nous mène au cœur de la vie de nos campagnes, au lendemain de la guerre de 1914-1918. Le paysan vit encore en symbiose avec les lois contraignantes de la nature, qu’il accepte avec une sagesse teintée de lassitude. Son pessimisme foncier, un brin fataliste, s’allie à l’ardeur de la tâche. Il se livre peu : la besogne quotidienne le révèle plus que les petites joies et les grandes peines. Son univers se limite aux frontières du village, ce solide rempart contre une civilisation qui veut le bousculer. Isolé des bruits du monde, son terroir est son royaume.
Maria peint avec fidélité cette vie de paysan. L’héroïne a entr’aperçu les fièvres citadines et l’amour romancé. Mais, très vite, dès son arrivée dans sa belle-famille, s’engage une lutte sans merci pour la maîtrise de la terre. L’histoire, affrontement impitoyable des jeunes et des vieux, peut sembler bien sombre. Pourtant, habités par des forces souterraines, ces êtres taillés dans le roc emportent notre sympathie : une vitalité touchante se cache au tréfonds de leur campagne rugueuse.
Loin du roman rural qui se contente de chanter la douceur des collines, le rythme des saisons et les caprices du ciel, Maria est un joyau ciselé par l'âpreté du labeur et des jours.
EXTRAIT
Maria était une grande et belle fille de vingt-deux ans, sortie, on le voyait, d’un bon moule, et moulée, elle aussi, pour fabriquer des grenadiers ; toute blonde et rose sur les joues avec un peu la peau brûlée, malgré le grand chapeau de paille qu’elle avait posé sur un genêt. Un corsage clair et un tablier grand comme un mouchoir collaient sur le corset qui lui faisait la taille fine, les hanches larges, tandis que sa jupe tailleur, tendue par ses jambes écartées, se creusait entre ses cuisses sous la tête sommeillante de Médor.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
Un « maître-livre ». -
Alexandre Vialatte
À PROPOS DE L'AUTEUR
Avant d’être romancier,
Lucien Gachon (1894-1984) est géographe. Issu d'une famille paysanne modeste installée dans le Puy-de-Dôme, il est d’abord instituteur pendant dix-sept années (1915-1931), puis, professeur à la Faculté des lettres de Besançon (1937-1952), et il termine sa carrière à l’université de Clermont-Ferrand en tant que professeur de géographie (1952-1964). Ses débuts littéraires seront patronnés par Henri Pourrat, son maître et ami. Lucien Gachon s'impose comme l'un des meilleurs romanciers auvergnats ayant pour sujet l'univers paysan.
Maria a frôlé le prix Goncourt en 1925, attribué à Maurice Genevoix pour
Raboliot.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 236
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Préface
Quel intérêt, demanderont certains, à rééditer ce livre écrit il y a près d’un siècle, en 1925 ? D’abord parce que c’est un magnifique témoignage. Les personnages décrits par Lucien Gachon sont si vrais qu’on les imagine aussitôt, peinant à la tâche derrière leurs bêtes ou aux champs, on entend leur accent, leurs intonations dans la brièveté de leur parler, on voit même leur gestuelle au travers de leurs mots ou de leurs silences. Tout est pris sur le vif. Qui est entré un jour dans une ferme des montagnes auvergnates n’aura aucun mal à imaginer le lourd huis clos qui se joue entre les deux générations, les jeunes et les vieux. Car ce livre est aussi un roman, avec son histoire, ses conflits, ses intérêts. Il montre un jeune couple qui s’installe à la ferme et tient à en devenir maître. Dans une lutte âpre et sans merci où la jeune femme, Maria (toute famille avait sa « Maria »), tient le premier rôle.
Le livre a connu le succès dans les années de sa parution, entre les deux guerres, quand la vie à la campagne paraissait dure à beaucoup et que l’exode rural battait son plein. Maria a manqué de peu le prix Goncourt (remporté cette année-là par Maurice Genevoix), et certains passages étaient choisis pour servir de dictées aux enfants des écoles, tant la réalité décrite leur était facile à comprendre.
Rééditer Maria est donc faire revivre un passé, une tradition. Mais nous croyons aussi que c’est encore « un maître livre » (selon l’expression d’Alexandre Vialatte) pour notre époque. Préserver la nature est maintenant une nécessité, un besoin urgent de nos sociétés. On ne parle pas d’écologie dans Maria, elle se vit au quotidien, parfois durement, âprement, dans l’auto-restriction transmise par les générations. Dans ce couple de la campagne, si loin des élites dominantes, combien aujourd’hui pourraient se reconnaître ? Notre vie change, les populations se déplacent, de nouveaux foyers s’implantent à l’écart des villes (ne parle-t-on pas de « rurbains » ?), trop souvent victimes du chômage ou du manque de logements. Beaucoup savent ce qu’il en va que de n’être pas du pays, connaissent des fins de mois difficiles ou même le surendettement. Ils comprennent la lutte que le couple doit mener pour rembourser ses dettes, et ce à une époque où il n’y avait guère de subventions d’État ni prêts bancaires. Et « compter ses sous » leur paraîtrait trivial ? Si parler d’argent crûment, attendre l’héritage des parents, travailler du matin au soir en se privant n’est guère élégant ni romanesque, c’est pour nombre d’entre eux la réalité de la vie. Maria n’a rien d’une féministe, mais elle défend son droit à être maîtresse chez elle, avec un courage et une détermination qui forcent l’admiration. Gachon n’a rien voulu enjoliver, il a voulu transcrire. Et loin de lui l’ambition de se poser en moraliste. On sent la force du vouloir-vivre de ses personnages et, à travers eux, l’ancrage profondément humain, terrien de l’auteur, en même temps que la densité de son style. Henri Pourrat ne s’y était pas trompé qui avait immédiatement décelé la valeur du jeune écrivain et de son livre. Cela demeure.
Catherine Gachon-Brémeau, 2015
À mon ami Paul Vernois
PREMIÈRE PARTIE
Ce dimanche soir de fin juillet, entre fenaisons et moissons, durait dans le repos. Personne par les prés où le regain vert, blondi de lumière, pointait. Personne derrière les seigles mûrs, entamés en diagonale, où les gerbes, étalées sur le chaume, séchaient. Les insectes vibraient, les papillons voletaient, la brise mollissait à travers les arbres, dans l’air. Vers cinq heures, la chaleur baissa, des troupeaux de vaches montèrent vers les landes. Quand elle les vit, la grande Françoise dit à sa fille :
– Maria, faudra lâcher. Prépare-toi.
Médor connaissait ce signal. Il s’éveilla, sortit, aboya devant la porte entrouverte de l’étable où les vaches une à une soulevèrent leur tête et leur panse, puis, lourdement, se levèrent.
Les six vaches et les deux chèvres de la ferme des Brunel, au Buisson de Saint-Côme, parurent à leur tour dans la crove. La Blanche prit la tête et le troupeau blanc et rouge s’étira en procession pour monter aux landes par le sentier bordé de genêts et de fougères, que leurs sabots avaient dégazonné.
Arrivée aux buges, la file se rompit, les vaches s’éparpillèrent, le nez dans les fougères, tandis que les deux chèvres et Médor restèrent près de Maria qui chercha pour s’asseoir un bon point d’observation.
Elle monta sur le sommet large et rond de la colline, dressa sa silhouette, parcourut des yeux l’horizon familier où elle reconnut chaque bergère et chaque troupeau, vit que ses bêtes étaient bien tranquilles à manger en contrebas et, n’apercevant rien de nouveau, s’assit à l’ombre ronde d’un grand genêt sur la mousse traversée de caille-lait blanc.
Elle desserra le cordonnet de son sac à ouvrage sur lequel elle avait brodé un iris violet et en tira un roman d’amour et d’aventures : Femme et Maîtresse.
Elle lut et fut seule.
Maria était une grande et belle fille de vingt-deux ans, sortie, on le voyait, d’un bon moule, et moulée, elle aussi, pour fabriquer des grenadiers ; toute blonde et rose sur les joues avec un peu la peau brûlée, malgré le grand chapeau de paille qu’elle avait posé sur un genêt. Un corsage clair et un tablier grand comme un mouchoir collaient sur le corset qui lui faisait la taille fine, les hanches larges, tandis que sa jupe tailleur, tendue par ses jambes écartées, se creusait entre ses cuisses sous la tête sommeillante de Médor.
Vraiment, Maria avait de quoi faire caresser et manier aux garçons !
On disait d’elle : c’est une gente fille, mais pas commode.
Les drôles qui veulent la chatouiller, qu’ils se méfient ! Elle les veut dégourdis et bien plantés et qu’ils sachent lui parler. Plus d’un a eu son « va-t’en » qui croyait bien la tenir. Sans la guerre, elle serait déjà mariée dix fois si elle avait voulu et avec quelque richard encore ! Et la bourgeoise aurait eu beau biais !
Maria en lisant s’imprégnait vaguement d’amour sans songer à ses bêtes et au soir, à la brise qui ondulait sur les collines et à la lente descente du soleil.
Les vaches disparaissaient dans les genêts. On ne voyait plus, par instants, que leur queue qui cinglait de coups de fouet les taons, les mouches, dorés par les rayons du couchant.
Partout, très loin, c’était la lande et la paix.
Une traînée de fougères trembla comme si une faux les coupait et un roquet jaunâtre émergea du vert, fureteur. Tiens ! le chien de Victorine, ses vaches ne doivent pas être loin.
– Eh, Victorine ! Viens ici.
Et en rien de temps, Victorine fut là avec son chien et sa chèvre qui agitait son « couvre-cul » comme les écrevisses leur queue.
– Bonsoir, Victorine. Tu vas bien ? Mais tu es gente ce soir ! Tu attends peut-être ton amoureux ?
– Penses-tu ! Je me moque pas mal des amoureux. Un homme, c’est embarrassant ; c’est toi qui te maries, à ce qu’on m’a dit ?
– Penses-tu ! Qui t’a dit ça ?
– Ce matin, à la messe, on en parlait et en venant de Grandval, la vieille Marotte m’a dit : « La Maria t’a pas parlé de son galant ? Il paraît qu’un jeune du Forestier la fréquente. »
Maria rit bruyamment et, ardente à répondre, opposa :
– Eh bien ! on t’en a dit une belle !
– Pourquoi pas ? Allons, dis-le-moi ! Je le redirai pas. Qu’est-ce que ça peut te faire ? Ça se saura toujours quand même…
Pour couper court à ces questions, Maria s’empara du livre que Victorine avait sous le bras avec son bâton de bergère.
– Fais voir ce que tu lis de beau. C’est joli ?
– Je te crois. Je pleurais tout à l’heure, comme une simple en le lisant. Je te le prêterai.
– Et le tien ?
– C’est un peu triste : « ils » se tuent à la fin. J’aurais mieux aimé qu’« ils » se marient. Mais tout ça c’est des contes.
– Ça désennuie… Té ! mes vaches qui partent. Hé ! Friquet, arrête-les, arrête-les ! C’est leur heure. Je vais les descendre au regain.
Et, imperceptiblement moqueuse, Victorine lança, loin déjà :
– Bonsoir, Maria ! T’ennuie pas ce soir.
Victorine ne devait pas encore être arrivée vers ses narses herbeuses, quand Jules Pradier de chez les Pelien, l’amoureux de Maria, vint à elle, rasé de frais, moustaches en crocs, parfumé, les yeux pleins d’ombre et prometteurs sous le chapeau mou baissé en avant. Il est en veston et ses souliers de confection, bien cirés, glissent sur le gazon. Tiré à quatre épingles, il soigne son apparition. Il vient de la ville. Il travaille chez Michelin : c’est un titre. Il ne fait que huit heures par jour. Il s’y est dégourdi, danse, chante aux noces, et les paysannes disent de lui :
– Se secoue-t-il, ce Pradier ! Il amuserait un régiment.
Maria s’est levée et laissé embrasser sans façons. Lui l’a prise avec science, une main à plat derrière la taille, l’autre protectrice sur son épaule, et ses yeux langoureux disent un amour subtil, un amour qui apporte un monde de félicités mystérieuses ; tandis que Médor aboie furieusement à cet inconnu qui semble vouloir attaquer sa maîtresse.
Ils s’assirent, pressés l’un contre l’autre ; les genêts les dérobèrent au monde ; Médor se tut ; et, de nouveau, on n’aperçut plus que la queue et le dos lisse des vaches égaillées parmi la toison verte de la lande.
Mais tout se sait ou se devine.
Secoués de rires étouffés, trois garçons et Victorine, dissimulés à quelque cent mètres, épiaient les amoureux. La mère de Maria, la grande Françoise, avait vu, de la ferme, arriver vers sa fille le garçon qu’elle détestait.
Maria ramena ses vaches, un peu inquiète. Depuis deux mois que le Jules venait la voir ou lui écrivait, sa mère, une forte et grosse paysanne, riche en sang, était contre elle, une furie déchaînée. La Maria était la cadette de ses trois filles. Ses deux aînées – une lingère mariée à un jardinier du bourg voisin de Saint-Vert ; l’autre « par le pays » du côté de Thizy, mariée à un chiffonnier –étaient comme perdues pour elle. Elle en avait fait le sacrifice. Quand elle partirait de sa ferme du Buisson, ce ne serait pas pour aller les voir, mais pour se laisser mettre dans un creux, au cimetière, sous six pieds de terre. Ainsi, la Maria représentait son seul espoir d’une vieillesse non abandonnée. Elle ne l’avait pas « poussée » à dessein au-delà du certificat d’études pour qu’elle restât une paysanne, épousât un paysan qui viendrait au Buisson comme gendre. Tous deux porteraient secours à ses vieux jours, la soigneraient dans la maladie et l’assisteraient à l’heure de la mort si son homme venait à partir avant elle. En récompense, elle servait des gages à sa cadette depuis l’âge de quinze ans, ce qu’elle n’avait pas fait aux autres, lui achetait un beau trousseau et toute la toilette qu’elle désirait.
Et voilà que tout s’écroulait ! Et du fait de qui ? Pour qui ? Pour un freluquet, un petit bourgeois de ville, un crevé, pour le neveu du Gouri contre qui la famille plaidait depuis vingt ans ! Aussi, tous les jours, la grande Françoise répétait à son Vieux, avec une rage hallucinée :
– J’en eus un malheur quand je la laissai aller à la fête du Forestier ! Il dut l’ensorceler ! Il n’a rien, rien qui plaise : un nez comme la pointe d’un sabot, des yeux noirs de jaloux qui brillent, la peau des joues collée sur les os ; un nain, attaqué de la poitrine et blessé au-dedans du corps avec je ne sais combien de blessures ; il est « laide », « laide », « laide » !
Maria rentra. Elle aperçut, en posant son livre sur la fenêtre, une sorte d’écriteau suspendu bien en évidence, où sa mère avait tracé en grosses lettres maladroites :
Laide,
Caïn,
Judas,
Traître.
La mère et la fille s’affrontèrent. La tempête éclata une fois de plus.
– Tu l’as revu ton nez de carotte ! Qu’il ne passe pas par ici ou je le sors à coups de balai ! Ah ! garce ! je pouvais bien t’acheter six douzaines de draps, au printemps dernier. Il aura beau se rouler dedans !
– Tu as bien laissé les autres se marier à leur gré. Qui doit jouir doit choisir. C’est pas toi qui le prends. Laisse-moi tranquille ou je te plante là !
– Après ce que je t’ai fait ? Tu devrais en avoir honte ! Une famille de pendus, de voleurs, de brigands ! Pends-toi tous les Gouris à ton derrière et que je te voie plus !
Maria trépignait de rage ; sa mère écumait, les yeux hors de la tête, pitoyable dans sa détresse qui transparaissait, redoutable cependant par sa colère et sa force massive.
Puis, soudain maternelle :
– Marie-toi avec qui tu voudras des environs : de Saint-Vert, de Saint-Côme, ou de Grandval ; va-t’en gendresse, mais n’apporte pas le déshonneur dans la famille. Que deviendras-tu à Clermont, en ville ? Il s’y saoulera, te fera quatre ou cinq petits, et te laissera pour une de ces poupées qui se mettent tout ce qu’elles gagnent sur leur cul. Demeure avec moi, je te ferai tout ce que tu voudras.
– J’en ai assez de ton chiendent et de ton bien. Toutes s’en vont. Regarde la Louise, la Toinette. Elles reviennent avec des toilettes de dames, des colliers en or et des mains doucettes qui font honte aux miennes. La Jeanne Ducros, à Paris, gagne cent francs par mois, se fait des étrennes et n’y lave même pas la vaisselle. Sa sœur le contait ici dimanche passé encore.
Le père Brunel qui n’aimait pas les disputes parvint enfin à les calmer.
La nuit, amollies par des souvenirs et des visions d’avenir, la mère et la fille pleuraient l’une et l’autre dans leur lit.
Maria, la semaine suivante, calcula. Sa mère tenait à la maison les cordons de la bourse avec l’autorité ; elle dispensait les faveurs ; elle favoriserait à son gré l’une ou l’autre de ses filles le jour du partage.
D’ailleurs, il n’y avait pas à y mordre ; depuis deux mois, elle ne lui avait rien acheté : ni chapeau, ni souliers, ni robe. Pas un sou ! lui avait-elle dit, tant qu’elle n’aurait pas expédié à moissons cet intrigant. Et Jules allait repartir chez Michelin, son congé expirant, dans quinze jours. Elle le reverrait pour la dernière fois le dimanche en huit, à la fête patronale de Grandval. Que lui dirait-elle ? L’aimait-elle beaucoup ? Elle le voyait parlant mal et dégagé. Elle avait éprouvé pour la première fois avec lui un peu de cette ivresse qu’on savoure en fermant les yeux et qui est l’amour. Son sang riche et sa jeunesse lui faisaient désirer le mariage, mais ce désir n’allait pas jusqu’à la tourmenter la nuit. Elle conservait une certaine liberté d’esprit et un sens pratique que les difficultés à venir, soudain évaluées, aiguisaient bien davantage que son expérience passée…
Au vrai, jusqu’à vingt-deux ans, elle avait poussé dru, dans l’abondance et sans trop de soucis. Les hivers, elle brodait des chemises ou des draps, confectionnait d’interminables dentelles au crochet pour des combinaisons ou des pantalons, taillait les pièces de son trousseau, dans la somnolence vide mais tranquille des courtes journées étreintes de neige. Les dimanches, elle allait voir ses amies ou ses amies venaient la voir. Elle leur étalait, flattée, les pièces de son trousseau bien alignées dans son armoire de frêne. On consultait les journaux de mode, on feuilletait l’album de cartes postales. On bavardait. Et à la veillée, les garçons de Courteserre ou du Chapieu venaient avec un accordéon boire, danser, rire avec elles.
L’été était coupé par des semaines de rude labeur, aux fenaisons, aux moissons, à l’arrachage des pommes de terre. Pourtant, dans les intervalles, on se reposait et on allait aux fêtes ou au marché porter les provisions. Mais toujours il y avait les vaches, le fumier, un peu d’ennui et l’exemple des autres, le besoin d’une vie plus brillante, plus agitée même. Elle disait fréquemment :
« Ici, ils sont bêtes, bêtes, bêtes à payer patente ! »
Jules, c’était la ville, la libération de la campagne. Maria pensait : « Je ferai mon ménage et du travail de couture à domicile ; j’irai au cinéma ; je me promènerai le soir dans les rues emplies de monde et inondées de lumière ; j’aurai des bas à jours et les mains blanches. »
Mais, insistantes et importunes, les réflexions de sa mère ensuite l’assaillaient :
« Il a vendu sa part de bien six mille francs. Que ferait-elle avec six mille francs ? Il les lui faudrait pour monter son ménage. Et la situation de Jules chez Michelin n’était ni précise, ni définitive. Il a été blessé dans la poitrine. Sait-on jamais ? Deux de ses oncles sont morts jeunes de fluxion de poitrine, laissant leurs veuves chacune avec trois enfants en bas âge. Si pareil malheur m’arrivait ? »
« On ne pouvait pas dire, certes, qu’il était beau – et intimement son orgueil de belle fille souffrait de ce que les gens diraient quand on la verrait avec ce nabot – ; mais enfin, il avait une expression agréable, quelque chose qui plaisait. Quand ses sœurs venaient avec leurs maris pour la fête patronale et qu’on allait en famille se promener de-ci de-là, maris et femmes se soufflaient des choses dans le tuyau de l’oreille, complotaient, riaient, faisaient bande à deux alors que Maria, souvent, était seule à penser qu’un mari ça donne du poids, de l’autorité et comme une certaine importance. »
Ainsi, Maria pesait le pour et le contre, prête peut-être à dire oui.
Le dimanche après la dispute, le père Brunel prit sa chemise blanche empesée, un ruban de soie noire étroit et doublé que sa femme lui noua au cou en faisant deux boucles bien égales de chaque côté du nœud, un large chapeau de feutre rond, et partit vers le haut pays du Forestier s’informer de ce qu’on disait et pensait de Jules Pelien.
Il y connaissait deux ou trois vieux de sa classe qui avaient fait, comme lui, leur service dans les Alpins à Chambéry, ainsi que deux jeunes ménages, anciens voisins, que les hasards des mariages ou des arrangements de famille avaient déportés là-haut.
Après trois heures de marche, il arriva à Malpertuis, village de la commune du Forestier, et frappa, vers neuf heures, chez le Loye – le Louis –, son vieux camarade d’escouade :
– Té ! Voilà mon vieux Tuéno – Antoine. Qu’est-ce qui t’amène ? Y avait-il longtemps que je ne t’avais plus vu ! Assieds-toi donc. Je suis tout seul. La femme et la fille sont à la messe. Mais nous serons que mieux pour parler.
Et le Loye sortit du placard saucisson, fromage, jambon, une demi-tourte de pain bis en quartier de lune, alla à la cave tirer un litre et s’installa face à son ancien camarade de régiment.
– Je suis venu faire un tour, me promener, voir les Anciens, acheter – si ça me dit –, pour changer les poutres de mon étable, cinq ou six sapins au Damien de Loubèze, commença Brunel. Rien de nouveau par ici ? On s’y marie aussi ?
– Le curé en a sonné cinq l’autre dimanche. La jeunesse est revenue. Tout ça se secoue. Assez de garçons ont été tués et cependant presque toutes les filles trouvent chaussures à leur pointure. Ça ne fait rien, les vieux comme nous seraient bons maintenant !
– Le dimanche seulement. La semaine, nous laisserions faire le service aux jeunes. La bête est morte ! Elle ne se réveille qu’après un verre ou une bonne pause, mon pauvre vieux. À ta santé !
– À ta santé ! Buvons un coup en attendant. Vois-tu, tous les jeunes ne seront pas très bons aussi pour les filles, beaucoup sont abîmés comme le Jules de chez le Pelien. À propos de lui, on dit justement qu’il fréquente une fille de chez toi, mais on ne m’a pas dit le nom. Tu ne l’as pas su ?
– Non, ça s’est pas dit. Sa tante de Courteserre ne nous en a pas parlé et nous sommes brouillés avec son oncle, le Gouri.
Alors, sans être sollicité, le Loye émit son jugement.
– Nous ne le connaissons pas bien, ne l’ayant vu que tout gamin. Il paraît que c’est un sournois. Son frère qui a gardé le bien, c’est un travailleur, mais le Jules a trouvé la terre trop basse. Maintenant, il fait le fier et ne parle pas à tout le monde. On sait bien pourtant d’où il sort. Sa mère a de temps en temps des coups de marteau. Il avait un oncle fou et un autre, le Duan – le Jean –, avait la tare de voler. Maintenant le Jules a vendu sa part, il la goule peut-être à Clermont avec les putes, enfin ça me regarde pas… Mon pauvre Tuéno, la jeunesse d’aujourd’hui ne veut plus voir la terre. Ils ne sortiront de la ville que quand ils n’auront plus de pain à manger. Ici, dans le village, on faisait vingt mille gerbes par an, maintenant quatre ou cinq mille… Té ! les voilà qui arrivent de la messe. Joséphine, reconnais-tu le Tuéno Brunel, mon conscrit du Buisson ? Donne des verres, trinquerons tous.
On s’assit, on trinqua. Après force compliments et demandes de nouvelles, le Loye, loquace, reprit, s’adressant à sa fille :
– Nous parlions du Jules Pelien.
– Ah ! parlez-en ! On m’a dit justement ce matin à la messe qu’il fréquentait votre fille, père Brunel, que le mariage allait même se faire…
Et avec un dépit jaloux, elle ajouta :
– Il était bien venu me voir, il y a deux ans. Mais il est trop méchant ; et capable d’un sale coup quand il a bu.
La fille ne disait pas que c’était le Jules qui ne l’avait pas prisée pour le mariage.
Brunel, confus d’être découvert, s’avoua enfin, dans un accès de confiance comme pour se réhabiliter :
– Je ne te l’ai pas dit tout à l’heure, mais je venais justement pour savoir des nouvelles de lui. Ma femme ne veut pas le mariage. C’est elle qui m’envoie. Je suis bien content de ce que tu me dis : il y a tant de « riens qui vaillent » aujourd’hui…
Le père Brunel remercia, invita à son tour, alla voir les bêtes, l’installation, et prit congé après que ses hôtes l’eurent supplié de ne pas dévoiler les secrets qu’ils lui avaient confiés :
– Te l’ai dit à toi, vois-tu ; mais fais attention ; ça mène toujours des ennuis avec du monde malin.
Les renseignements qu’il recueillit ensuite à droite, à gauche, en causant et surtout en faisant causer, toujours sans avoir l’air de rien, furent contradictoires, mais, en général, peu favorables.
Il évita le Forestier et arriva chez lui, la nuit tombée.
Françoise le guettait au détour du chemin creux, la mine épanouie, ses poings sur les hanches.
– Pauvre bougre ! Il en est venu un autre ce soir vers la Maria. Il chassait. J’ai entendu, vers six heures, deux petées coup sur coup du côté de l’Alisier. Je l’ai bien vu. Par la colline, il est allé tout droit vers elle. Ils ont rentré les vaches ensemble. Je lui ai fait prendre un verre et il a demandé s’il pouvait revenir dimanche prochain. Que va faire la Maria ? J’ai connu qu’elle lui parlait assez bien.
Les deux Vieux rentrèrent. Maria lisait. La lampe familiale les réunit tous trois apaisés, et déjà presque tendres.
Maria, redevenue rieuse et légère, demanda la première :
– Alors, qu’as-tu appris ?
– Rien de bon, pauvre Maria. C’est une sale famille, de vers sa mère comme de vers son père. Et lui, c’est un sournois, un malin. Il n’a pas la place qu’il dit avoir chez Michelin ; c’est pourquoi il est resté par là à traîner les jambes, si longtemps. Si tu l’écoutais, tu te casserais le cou aussi vrai que deux et deux font quatre.
La grande Françoise triomphait :
– Te le disais-je ? Tous les Pelien ensemble valent pas ton petit doigt. Ce nabot pour une si belle fille ! Qu’aurait dit le monde ? On en aurait fait une risée ! Laisse-le que et je te promets que tu n’y perdras pas. En ville, vois-tu, tous sont des crève-faim, des œufs mollets, des « riens qui vaillent » et des coureurs.
Le père Brunel, qui conservait presque toujours sa clairvoyance, était tout surpris, devant sa fille consentant, par son silence attentif, à ce triomphe.
Maria n’alla pas à la fête de Grandval comme elle l’avait promis au Jules. Cependant, elle en avait bien envie. Manquer cette fête patronale, ça ne lui était pas arrivé depuis qu’elle était fille, c’est-à-dire depuis l’âge où elle avait allongé ses robes, marqué sa taille par un corset, remplacé sa natte par un chignon et lu des romans d’amour. Mais elle ne pouvait pas résoudre cette difficulté : rencontrer au bal deux galants à la fois. Elle resta à la maison : Pierre Poulenoire, le dimanche précédent, s’était déclaré et lui avait sagement et pratiquement parlé.
Elle le connaissait depuis le printemps, ce Pierre Poulenoire, de Chanteloube, un village de Saint-Vert distant d’une heure de marche de Buisson. Un voisin. Mais il avait fait toute la guerre et il était de la classe 14. Avant qu’il parte, elle n’était encore qu’une gamine et depuis un an seulement il était revenu. Elle avait dansé pour la première fois avec lui à Saint-Vert un soir de marché et sa santé de robuste gaillarde avait conquis le rescapé.
Depuis, deux ou trois rencontres les avaient rendus familiers. Ils se tutoyaient, ce qui est tout naturel entre filles et garçons du pays. Peut-être même s’embrassaient-ils sans que leurs baisers soient d’amour.
Comme le hasard est grand ! Voici maintenant qu’au Clovel, derrière le jardin de la ferme, adossés à une haie de noisetiers, Maria Brunel et Pierre Poulenoire se parlaient, assis, les jambes un peu écartées, à un mètre l’un de l’autre, symétriquement.
Il était en veste de chasse, en molletières et en gros souliers du régiment. Il fumait, égrenait des paroles en regardant devant lui, tandis que Maria lui répondait, le nez sur son crochet.
La nuit venue, ils rentrèrent derrière les bêtes, comme deux promeneurs, et l’on soupa.
On les avait placés l’un à côté de l’autre au haut de la table et du côté du placard, les Vieux face à eux du côté de la porte. Les rideaux bien refermés, un bouquet sur l’appui de la fenêtre, où rien ne traînait, indiquaient un souci d’ordre et d’intimité. La maison était vaste, propre, parée, sans relents et sans vieillesse.
On mangea la soupe, du jambon, du fromage ; on parla des récoltes, des mariages ; on échangea des nouvelles ; et, la table débarrassée du fricot, quand il ne resta plus que quatre verres remplis de vin et la bouteille, Pierre, par petites phrases posées et méditées, exposa sa situation, l’avenir qui les attendrait, lui et sa femme.
« Nous étions quatre enfants à la maison, mais deux sont morts, un à trois mois, l’autre à quatre ans, tous deux d’une fièvre qui passa par le pays et fit périr tant de monde il y a une dizaine d’années ; maintenant nous restons que deux : moi et ma sœur plus vieille que moi de deux ans. Deux mois avant la déclaration de guerre, elle s’est, comme vous savez, mariée à un chiffonnier, le Benoît, des Prades. Ils sont installés à Mâcon et il paraît que l’an dernier ils gagnèrent, le commerce de la peille allant bien, autant d’argent qu’ils voulurent. Le Benoît, mon beau-frère, se vante aujourd’hui d’être riche à cent mille francs ; un peu moins, un peu plus : cent mille, c’est aussi vite dit que cinquante. Mais il paraît bien qu’ils en ont.
Quand je suis revenu de la guerre et comme j’étais pour rester à la maison, j’ai dit à mes vieux : Maintenant, je veux pas me crever ici à travailler pour ma sœur, faut faire le partage ou je m’en vais. D’autant plus que le Vieux se saoule et nous fait ensuite une vie enragée. Il jeta bien, un jour, avant la guerre, ma sœur à la porte ; et ma mère y a passé plus d’une fois. Faut le laisser faire : ça lui passe avec le vin.
Nous fîmes donc notre partage au printemps chez Jacquet à Saint-Vert. Ce fut décidé en huit jours. Le Vieux signa étant saoul et, quand il l’eut fait, il resta trois semaines sans manger à cause du chagrin qu’il eut d’avoir donné son bien.
Je dois payer à ma sœur trente mille francs : vingt-cinq mille dans un an et demi, pas au printemps qui vient mais à l’autre, et les cinq mille restant, après la mort du dernier mourant. Le bien vaut, au bas mot, soixante-cinq mille francs ; nous tenons neuf bêtes, voyez-vous, et il nous reste encore du foin pour un mulet. Le jour du partage, mes Vieux furent de mon côté, à cause que je gardais le bien et qu’ils restaient avec moi.





























