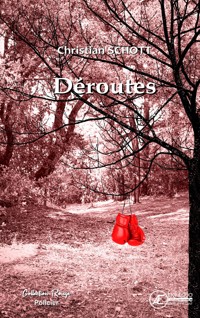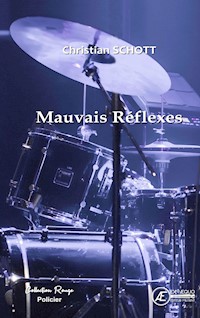
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ex Aequo
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Au lendemain d’un concert de jazz, les organisateurs trouvent le corps sans vie de l’un des techniciens aux abords de la scène.
Pourtant la victime aurait quitté les lieux à l’issue de la soirée, pourtant l’alarme de la salle aurait été enclenchée à l’arrivée des gens de l’association, pourtant, pourtant…
Pour quelle raison le sonorisateur se trouvait à cet endroit, à cette heure ? Quelles sont les causes de sa mort ?
Des questions qui en amènent d’autres, des doutes, des certitudes, des erreurs, le parcours sinueux d’une enquête qui mène à la vérité. Des rencontres avec des femmes, des hommes, avec tout simplement des êtres humains, qui parfois le sont si peu.
C’est l’inspecteur principal Bolitch qui mène cette nouvelle enquête. Il a abandonné sa Ford rouge pour une Peugeot, il est aujourd’hui accompagné de son collègue Maggioli, mais reste fidèle à son personnage de « L’orage ».
Bolitch explore les vies des autres, livre un peu de la sienne.
Il évolue cette fois dans le monde de la musique qu’il affectionne, le jazz, mais y rencontre quelques fausses notes. https://www.calameo.com/read/000084266f21e5a32b24c
À PROPOS DE L'AUTEUR
Né en Lorraine, Christian Schott est heureux grand père et militant associatif. Passionné de musique il organise, avec des copains, le JazzPote festival de Thionville.
Après avoir publié « L’Orage » aux éditions Ex Æquo, il revient pour une nouvelle enquête de Bolitch … dans le milieu du jazz !
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 203
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christian Schott
Mauvais réflexes
Roman policier
ISBN : 979-10-388-423-4
Collection Rouge
ISSN : 2108-6273
Dépôt légal : septembre 2022
© couverture Ex Æquo
© 2022 Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction intégrale ou partielle, réservés pour tous pays. Toute modification interdite.
Éditions Ex Æquo
Un soleil coquin s’amuse à éblouir les deux amis attablés à la terrasse du QG Café de Florenville. D’un ricochet sur les verres de Leffe, ses rayons viennent chatouiller tantôt l’un tantôt l’autre, qui aussitôt plisse les yeux, penche la tête. Puis l’étoile joueuse visite une autre table, fait fi d’un parasol mal orienté, agace d’autres clients
Lionel et Antoine se sont connus au lycée, en première, où ils étaient voisins de table.
Leur projet, leur premier projet en pointillés, deviendra bientôt ligne pleine.
Dans six mois ou peut-être même plus tôt.
« Marcel, tu remets deux demis ! »
Huit heures du matin, d’un matin avec le sale air d’un lundi matin.
Pourtant c’est jeudi, un jeudi du tout début de l’été.
Avec déjà un soleil prometteur.
Avec encore quelques notes de piano qui s’étirent dans la tête de l’inspecteur depuis le concert de la veille.
Mais voilà, la fête est finie pour Bolitch, installé dans la salle d’attente, en compagnie d’un jeune couple qui glousse, leurs quatre yeux rivés sur un smartphone, et d’un vieillard noueux qui suit avec peine les pages tremblotantes du quotidien local.
Sur la table basse, les éternelles revues aux couvertures glacées. Au mur, des photos de montagne, passion du médecin ; quelques jouets sur une étagère. Sur la porte, des affiches médicales avec les informations, conseils et injonctions qui rappellent l’éventail des maladies auxquelles on peut prétendre.
Le mois dernier, Bolitch avait passé près de deux heures à attendre son tour. Cette fois, il est arrivé dès l’ouverture. Pour sûr qu’il serait le premier.
Mais l’ancien est déjà dans la pièce, le journal déployé. L’inspecteur salue d’un sourire celui qu’il considère comme un resquilleur. Il a maudit le réveil trop matinal, insulté le journaliste de radio trop complaisant avec le ministre des Finances, avalé un café trop chaud, pesté contre le livreur trop lent qui encombrait la rue, et le voilà arrivé trop tard.
Pis que tout, il y a cette feuille qu’il a imprimée et pliée avec soin au fond de sa poche. Elle émane du laboratoire thonvillois.
Fébrilement, il a lu et relu le compte-rendu de sa prise de sang. On a enquêté à l’intérieur de son corps, et il a maintenant la solution, mais il ne parvient pas à la déchiffrer.
Ce ne sont qu’hypothèses, mais teintées d’un pessimisme des plus foncés.
Une liste infinie ; hématocrite, monocytes, CS-Tf calculé, albumine sérique, plusieurs lignes consacrées à des cholestérols variés, des termes incompréhensibles pour la plupart, effrayants. Des menaces.
Des unités diverses, g/L, mg/L, mol/L, des pourcentages.
Et ces nombres qui refusent si souvent de s’inscrire dans la norme, dans la colonne qui aligne la fourchette parfaite, celle de l’être en bonne santé.
Mais surtout, il y a tous ces résultats surlignés en jaune, qui font écho à l’encre rouge du maître d’école, cette couleur de l’opprobre soulignant la faute.
On repère l’erreur qui souhaitait l’anonymat, et on l’habille d’éclat pour mieux l’étaler au grand jour, pour mieux stigmatiser le délinquant.
Et, comme naguère il ratait sa dictée, aujourd’hui il a raté sa prise de sang.
Il l’a pressenti, il en est sûr.
L’autre jour, le silence du médecin au moment de l’examen était éloquent. Ses mimiques lourdes de sens. Son empressement à lui ordonner un bilan sanguin.
Et ses reproches travestis en remarques, ses suppositions sur son hygiène de vie.
Son sourire éclatant quand la balance « balance » avait dénoncé le poids de l’inspecteur.
— Vous avez pris, monsieur Bolitch, vous avez pris !
— C’est sûr que j’ai pris, je faisais trois kilos à la naissance, n’avait pu s’empêcher de lâcher un Bolitch aussi déconfit que vexé.
Un nouveau rendez-vous avait été fixé quinze jours plus tard. On y était.
Bolitch se met à transpirer, malgré la température très supportable. L’angoisse. Il a mal dormi. Envisagé mille perspectives allant du gris foncé au vantablack.
Le diagnostic tant redouté suffira à le tuer, c’est devenu une certitude. Un funeste chapelet de termes assassins a pris possession de son cerveau : cancer, métastase, pancréas, chimio, crémation…
Pour un peu, le mécréant trouverait la foi à l’aube d’une punition divine. Pour un peu, il irait exhumer quelques prières qu’il a gravées dans sa mémoire sans jamais s’en rendre compte.
Comme des fantômes lui reviennent les souvenirs de son enfance. Il les retrouve chauds et lumineux comme ces matins de Pâques où le soleil caressait les vitraux de la petite église du village. À l’époque où il croyait plus à Dieu qu’à diable, où il aimait à lire la vie des saints, où il feuilletait la vieille bible de sa mère.
Il avait songé à devenir missionnaire, à partir en Afrique pour s’occuper de ces petits enfants qu’il voyait sourire sur les images offertes par le vieux prêtre qui enseignait le catéchisme.
Il y croyait, aussi fort qu’il croyait au père Noël, ce bonhomme si généreux.
Jusqu’au jour où…
Jusqu’au jour où…
Il était en vacances chez ses grands-parents. Une petite semaine au début du printemps. Ils habitaient la campagne qu’ils n’avaient jamais quittée à l’exception de Grand-père qui, comme on le disait alors, avait fait son régiment à Metz. Jamais de vacances, ni montagne ni mer, la campagne suffisait à leur bonheur. Une maisonnette entretenue avec soin, un potager aux légumes bien alignés qui, victoire de Grand-mère, avait dû céder un peu de terrain à un hortensia majestueux et quelques pivoines.
Deux rangées de clapiers abritaient les lapins au regard si doux, un poulailler où s’agitaient sans cesse une demi-douzaine de poules entourées d’un haut grillage. Un coq qui roulait des ailes en arborant une crête d’un rouge vif. On le disait menaçant. Il effrayait l’enfant d’alors qui se tenait éloigné de la basse-cour, seule enclave hostile en ce monde de quiétude.
Il aimait ces matins au pâle soleil où il arrosait les fleurs et les laitues pendant que le grand-père binait, sarclait, piochait. Il aimait les repas de midi où la grand-mère lui préparait toujours ses plats préférés, les après-midi où dans la pénombre de la petite cuisine seule la grande horloge découpait le silence, les soirées où on déployait avec soin le plateau antique du jeu des petits chevaux, la nuit où on lui expliquait les étoiles assis sur les marches d’escalier.
Et le poids de l’édredon d’hiver, la fraîcheur des draps d’été.
Toutes ces pièces d’une enfance qui étaient autant de morceaux de bonheur.
Jusqu’au jour où.
Des grands-parents en larmes, des mots poignards, la mer, un petit bateau qui a coulé.
Ses parents.
Des souvenirs glacés qui vrillent une vie.
Le vieux est entré en consultation depuis près d’une demi-heure. Bolitch s’impatiente, maudit l’ancêtre. Se dit qu’à son âge il aurait dû s’orienter vers un médecin légiste.
Regarde sa montre. Sonde pour la énième fois le fond de sa poche. Tâte la feuille balafrée de jaune.
Regarde à nouveau sa montre qui semble freiner.
Enfin le bruit d’une porte qui s’ouvre, des salutations à voix haute.
Le moment est venu. Il va arriver, l’inviter à le suivre.
Et voilà que son téléphone vibre. S’arrête. Recommence.
Bolitch consulte l’historique. C’est le troisième appel de son collègue Maggioli. Sans doute une urgence. L’inspecteur active la touche de rappel et colle l’appareil contre son visage avant de chuchoter.
Il se lève au moment où le médecin pénètre dans la salle d’attente. Il bredouille deux mots d’excuses et quitte la pièce.
Il rejoint sa voiture garée à proximité et démarre.
On vient de découvrir le cadavre d’un homme dans la salle Cavanna de Bazange. Ce serait un technicien du spectacle.
Bazange… Les notes de piano qui trottaient encore dans sa tête viennent de là. Elles y étaient la veille. Le festival de jazz !
***
Après avoir essuyé un chapelet de ronds-points qui lui donne l’impression de conduire une centrifugeuse, le policier franchit un passage à niveau pas très à niveau et rejoint la longue avenue qui départage les beaux quartiers de Thonville. De ce côté de la chaussée, les maisons de maître alignent leurs façades cossues. Des grilles de fer tourmenté, des vitraux, des pignons qui s’avancent, des balcons, de larges portes peu accueillantes, parfois une gargouille, témoignent du luxe, de la richesse des résidents. Le long des portes, des plaques. La plupart noires, avec des écritures dorées, en creux, en relief, comme sur les tombes. Des architectes, notaires, dentistes, médecins spécialistes, rarement des généralistes.
Les bâtiments lancent vers le ciel des mansardes, minuscules excroissances au bord des toits d’ardoise. Les murs sont d’une couleur uniforme, indéfinissable, un terne qui hésite entre le gris et le beige. Comme pour ne pas attirer l’attention, comme pour masquer le luxe qu’on devine pourtant.
Tout respire le solide, l’établi, pas le fragile.
Au bout, à l’angle, la plus ancienne pharmacie de la ville affiche une large vitrine. Elle révèle un intérieur spacieux, lumineux, un long comptoir de bois blanc, des présentoirs rutilants. Le feu passe au vert et libère l’antique Peugeot qui s’élance vers le centre de la ville. Les rues sont étroites, encombrées de camionnettes de livraison, de voitures garées pêle-mêle, le temps d’une course, car l’après-midi les véhicules sont proscrits et le piéton devient maître des lieux.
Ici les maisons sont plus basses. Les boutiques donnent sur la rue, mangent régulièrement un bout de trottoir pour y proposer des produits bon marché. Il y a, la plupart du temps, un seul étage. Le grisâtre d’en haut, sali à maints endroits, contraste avec les devantures colorées de neuf. Les volets, souvent fermés, ajoutent une touche de tristesse. On imagine des logements exigus, au plancher qui grince, aux fenêtres qui laissent passer le vent d’hiver, l’odeur âcre des gaz d’échappement l’été.
Quelques feux se mettent au rouge pour arrêter l’inspecteur, partagé entre l’exaspération face à ces étapes trop longues, trop fréquentes, et l’envie de retarder une nouvelle rencontre avec un mort.
Cette fois, il traverse les quartiers populaires. Les constructions y sont encore plus élevées. Les balcons ne méritent pas le nom de terrasses. Çà et là quelques plantes tentent d’égayer cette géométrie sordide, mais la plupart du temps il n’y a rien derrière les balcons grillagés. Certains immeubles ont été réhabilités. On les a repeints de triangles aux couleurs vives pour rompre la monotonie des alignements. Donner de jolis tons à la misère la rend plus supportable, surtout au regard de ceux qui ne la vivent pas.
Au bas des tours, on a coincé des bancs entre des containers qui vomissent des sacs plastique vandalisés par les chats et chiens errants, les rats sédentarisés.
Parfois un arbre anémique cerné d’un grillage gondolé par les tirs des petits footballeurs.
La supérette a baissé son rideau tagué depuis bien longtemps. Il y avait aussi une boulangerie, un pressing, une agence postale. Il y avait.
Le dernier à s’en être allé a été le bureau de tabac, ultime point de rendez-vous du quartier. Les générations s’y succédaient au cours de la journée. On y parlait plus qu’on y achetait. Parfois le ton s’élevait et l’un ou l’autre jubilait, un carton numéroté à la main. Ici, le seul espoir était à gratter.
Le chanceux exhibait alors la preuve de sa victoire aux yeux d’un cercle de spectateurs, envieux ou heureux pour lui. Pour un peu, il aurait convoqué la presse. Il avait enfoncé ainsi un coin de soleil dans sa misère, soulevé aussi un nouvel espoir pour ceux qui aspiraient à la réussite.
Et fait le bonheur du marchand qui s’apprêtait à augmenter ses ventes pendant quelques semaines.
Mais un soir la vitrine s’est éteinte, pour ne plus jamais se rallumer. Seule la carotte est restée plantée au-dessus de la porte définitivement fermée. Le buraliste a pris sa retraite, qui a sonné celle de l’échoppe. Il s’est, paraît-il, retiré quelque part en Dordogne où vit sa fille. A rejoint son grand fils en Bretagne, est retourné dans le Nord de son enfance.
Paraît-il.
La Peugeot quitte la ville pour une route rectiligne qui coupe les friches industrielles. Quelques bâtiments en ruine subsistent au milieu d’une végétation qui a colonisé le territoire. Il y a cinquante ans — il y a si peu —, des centaines d’ouvriers s’affairaient à dominer le fer. Les autobus se relayaient aux portiers de la grande usine pour y déverser ou reprendre des flots de travailleurs.
Les nombreux cafés, pièges posés alentour, vivaient en trois-huit et méritaient le nom d’assommoirs. Ils ont aspiré bien des salaires, et les rares augmentations s’y voyaient transformées en ardoises.
Un économiste des plus éclairés qui menace de dispenser sa leçon quotidienne sur France Inter se voit clouer le bec par Bolitch qui enclenche la touche CD. C’est alors Coltrane, Sims et Mobley, réunis en 1956 pour un conclave de saxophonistes, accompagnés par le piano de Red Garland et une rythmique de métronome avec le duo Paul Chambers et Art Taylor, qui emplissent l’habitacle de notes envoûtantes.
Le jazz emporte l’inspecteur pour le déposer aussitôt dans le jazz. Celui du festival, de la salle, du technicien décédé.
Il ne décroche pas quand son téléphone résonne. Sans doute Maggio. Il doit piaffer à la salle. L’Italien que personne ne considère comme un modèle de ponctualité se révèle à l’occasion d’une impatience rare.
Après quelques sonneries, l’autre répond au répondeur.
Les morceaux se succèdent, et la voiture se met au tempo de la musique. Un chorus qui s’éternise lui vaut un hurlement d’avertisseur furieux, lui intimant l’ordre de démarrer au vert.
Après avoir traversé une zone commerciale copie conforme de toutes les zones commerciales, puis dépassé le panneau d’entrée de Bazange, il arrive en vue de la salle.
De construction récente, l’édifice aux reflets métallisés ressemble à un tatou ramassé avec ses écailles qui miroitent au soleil tout frais du matin. Une succession de portes de verre façade sur presque tout le mur frontal. Un lacis de métal dessine le visage si reconnaissable de François Cavanna au-dessus de l’entrée.
Le policier gare sa voiture juste à côté de la Fiat de Maggio, coupe à regret Trane, et franchit le seuil du bâtiment.
Il y a quelques heures, c’était fête ici. Aux abords de la scène où s’époumonait le saxophoniste, un petit groupe entoure le corps d’un homme.
Quand l’inspecteur Maggioli aperçoit Bolitch, il quitte le cercle pour venir à sa rencontre. Le grand gaillard à la carrure de déménageur broie la main de Bolitch ; ce dernier retient un juron qui ferait tant plaisir au Rital. Comme à son habitude, celui-là est vêtu avec goût, enfin le sien. Avec sa chemise colorée qui oscille entre le rose foncé et l’orange pastel, son costume jaune clair et ses éternelles chaussures noires à bouts carrés, il ressemble à une rue de Burano.
—Sacré spectacle ! lâche l’Italien. Le toubib vient d’arriver.
— Raconte.
— Ce matin, les deux responsables du festival se sont pointés…
— Au fait, coupe Bolitch, j’ai pas écouté ton message.
— Quel message ? Je ne t’ai rien envoyé.
— Ah bon ? Deux secondes.
Bolitch s’écarte un peu et extrait le téléphone de sa poche. Il consulte la messagerie vocale.
Il blêmit.
Une voix doucereuse, inhabituelle.
Son médecin…
***
Les deux flics se sont réfugiés dans les vestiaires de la salle Cavanna transformés en bureau de police éphémère.
Rabroué par Bolitch, Maggioli ralentit le débit, et reprend son exposé.
— Voilà, ce matin, juste avant neuf heures, deux des organisateurs ont ouvert la salle, comme tous les jours du festival. Ils se sont installés dans leur petit local pour faire les comptes de la veille, préparer la journée en attendant le reste de l’équipe. L’un des deux allait ouvrir les loges quand il a trouvé le corps à côté de la scène. Il a tout de suite reconnu le technicien.
— Et…
— Il s’est approché, a vu une mare de sang, il a paniqué, hurlé. Son pote est venu, ils ont appelé les pompiers, et le commissariat, et c’est tout.
— Ils sont où ?
— Derrière le bâtiment, du côté de l’entrée des artistes. C’est par là aussi qu’arrive le reste des bénévoles de l’association, je leur ai demandé de ne pas quitter les lieux.
—
Oui, je veux leur parler. Et le mort ? Parce qu’il est mort !
— Sauf à pouvoir hériter d’un crâne de rechange, c’est fini pour lui. Même à Lourdes, ils ne peuvent plus réparer. Il s’appelle Boris. Les deux hommes ne savent même pas son nom, ou alors ils l’ont oublié. Ils le connaissent depuis plus de quinze ans, il travaille chaque année avec eux depuis la première édition. Il était là hier encore.
— Bon, tu les envoies, j’attends ici. Et puis, va te tuyauter auprès du toubib. C’est… ?
— Oui… C’est Bouillard.
— Pfff… Toujours pas en retraite, celui-là ?
— Ben, je crois qu’il est plus jeune que toi, mon gaillard !
— Ah bon ?
— Oui, il a une longueur d’avance sur son âge.
Maggioli quitte le bureau improvisé. Bolitch en profite pour s’aérer et échapper quelques instants à l’exiguïté de l’endroit.
À peine a-t-il franchi le seuil de la pièce qu’il tombe nez à nez avec le journaliste de L’Écho Public.
Les deux hommes se toisent avant d’esquisser un sourire.
Leur rencontre date de plusieurs années. Le reporter onctueux comme un évêque — Bolitch avait emprunté la tournure à son grand-père — avait, depuis la première minute, exaspéré le policier. Si cette profession était pour lui utile, respectable, voire essentielle, elle comportait aussi, comme toute corporation, ses brebis galeuses. Et ce Soumer en était une, qui à coup sûr ferait podium aux jeux Olympiques de la nuisance. Celui-là n’avait jamais eu l’ombre d’un début de compassion pour une famille de victime, l’embryon d’une attitude humaine pour un délinquant. Ses piètres écrits, vides de réflexion et pauvres de forme, étaient nourriture pour tout public en mal de clichés, pour tout agitateur en manque de neurones.
Maggioli, qui savait à l’occasion être lapidaire, avait dit un jour que si Soumer se faisait incinérer, son urne serait déclarée Seveso.
Après un bref et aigre échange où le policier invite l’autre à quitter les lieux avec la délicatesse de celui qui chasse une mouche verte préparant un atterrissage sur une tartelette aux fraises surmontée d’une épaisse crème Chantilly, il s’en retourne au vestiaire où l’attendent les deux témoins conduits par Maggioli.
***
Visiblement accablés, les deux hommes s’asseyent lourdement face à Bolitch. Les traits tirés, ils se présentent sans attendre. Il y a là le directeur du festival, Patrick Muller, que Bolitch reconnaît car c’est ce dernier qui a annoncé les concerts de la veille, et le trésorier de l’association. Un dénommé Paul Deleux. Le premier semble plutôt disert, habitué des micros et des réunions. L’autre est le comptable qu’on imagine. Plus chiffres que lettres. Discret, sérieux, l’intraitable intendant, l’économe économe, une caricature.
Voisins du village d’à côté, ils arrivent souvent dans la même voiture, vers neuf heures et repartent alors ensemble bien après le dernier concert. Et ce matin particulier est décrit par le directeur comme l’a relaté Maggioli.
— La porte d’entrée était ouverte à votre arrivée ? interroge le policier.
— Ben non. Fermée, et j’ai désactivé l’alarme comme tous les matins.
— L’alarme était mise ?
Le directeur, grand bonhomme d’au moins un mètre quatre-vingt-dix aux cheveux rares, abaisse la tête et fixe son acolyte qui, lui, frise le mètre cinquante, sans rien friser d’autre car il est tout aussi chauve.
— Hein, t’es d’accord ? Tu m’as bien vu débrancher…
Comme si l’autre sentait le besoin de le secourir, il vient conforter ses dires.
— Oui ! Oui, comme d’habitude.
Le duo se rend compte alors de l’ambiguïté de la situation, ce que ne manque pas de relever le policier.
— Vous découvrez donc le cadavre du technicien à l’intérieur d’une salle close.
Les deux acquiescent d’un mouvement synchronisé.
— Et hier soir, ou plutôt, tôt ce matin, qui a fermé ?
— Moi ! Enfin nous, répond le directeur en se penchant vers son partenaire comme pour lui demander de le certifier à son tour.
Mais l‘autre reste muet.
Le grand reprend alors. Il décrit la parfaite organisation, que l’on perçoit un peu comme sienne, qui régit le festival. Il se fait un point d’honneur, et ce depuis l’origine de la manifestation, d’avoir toujours été, sauf à une exception près due un jour à une crevaison, le premier sur le site. Et, il grandit encore de quelques centimètres avant d’ajouter :
— Et le dernier à le quitter.
Fier de la tâche accomplie, le bénévole à l’ancienne se met à rêver, loin du sol, quand il est frappé en plein vol par une nouvelle question.
— Vous avez donc enclenché l’alarme en partant, et ce matin vous l’avez désactivée. Avant de fermer, vous vous êtes assuré que tout le monde était parti ?
Le plus petit prend alors la parole et coupe ainsi l’autre qui bredouille.
— On ne fait qu’un petit tour, c’est tout, juste comme ça. On range un peu le coin du catering, parce qu’il faut dire que souvent les musiciens laissent tout traîner, on remet la charcuterie et les fromages au frigo, récupère les bouteilles vides, remplit une poubelle et voilà, mais c’est tout. On ne fait pas de ronde avant de fermer.
Le second acquiesce et baisse la tête. Pour la première fois, il sent une faille dans l’organisation, son organisation. Un défaut, un vice, une faute. Un échec.
Son cou devient cric. Il descend encore d’un cran, le menton appuyé sur le col de sa chemise et il murmure plus qu’il ne parle.
— Vous comprenez, nous ne sommes plus tout jeunes — il appuie sur le « nous », histoire de partager le fardeau
— et les journées sont longues. Dès que les musiciens ont quitté les loges, on s’empresse de partir, pour profiter de quelques heures d’un sommeil qui parfois même se refuse…
Son binôme l’interrompt d’une voix forte.
— Mais Boris… Boris c’est… le technicien… enfin le mort…
Il s’arrête un instant. Le chagrin perle au coin des yeux, et il continue, mais avec une voix rabotée par la peine.
— Il est parti en même temps que le dernier groupe, il discutait avec un musicien, il me semble que c’était le bassiste, il le connaissait de longue date, et il a enfourché sa moto et s’en est allé.
Bolitch s’interroge plus qu’il n’interroge.
— Il serait donc revenu plus tard ?
—Certainement ! ponctue le directeur, qui reprend son statut de directeur en remettant sa grande carcasse à la verticale.
— Et l’alarme ? reprend le policier.
Le grand rétrécit à nouveau. Les deux responsables partagent un silence lourd d’interrogations.
— Vous êtes repartis aussitôt après le technicien ?
— Oui ! claque Patrick Muller.
— Non ! corrige le trésorier.
Après un silence embarrassant, le directeur, une nouvelle fois voûté sous le poids de ce qu’il qualifie d’affront public commis par celui qu’il considère comme un subalterne, se reprend.
— Mais oui, nous sommes d’abord repassés par les loges. On le fait tous les soirs, on vous l’a déjà dit !
— Donc, vous n’êtes pas repartis immédiatement après le technicien, comme vous venez de le prétendre ! rétorque Bolitch, un sourire aux lèvres.
— Ben non…, lâche l’autre, attaqué de toutes parts. Le temps de ranger un peu, nous avons démarré une petite demi-heure plus tard.
— Et, pendant ce temps, Boris aurait donc très bien pu revenir pour se laisser enfermer.
Le directeur, qui maintenant ne dirige plus rien, se met à transpirer à grosses gouttes. Étourdi, il semble avoir pris au passage une dizaine d’années. Fringant il y a encore quelques heures, cabot sur la scène où il semblait affectionner les longs discours, il est accablé, muet.
Il reprend alors :
— Eh oui ! Il a pu revenir, laisser sa moto je ne sais où, pas loin, et revenir…
***
Bolitch arrive en vue de l’Hôtel Pissarro, coince la Peugeot entre deux camionnettes et consulte son téléphone. Pas de nouveau message, aucun appel en absence.
Dans moins d’une heure, le groupe de musiciens s’en ira à la gare. Ils doivent être au petit déjeuner.
Avant de se rendre au commissariat pour y rédiger son rapport, Maggio lui a fait part des quelques constatations du docteur Bouillard, aussi laconique que désagréable, comme à son habitude.
Le technicien serait décédé à la suite d’une chute. De plus, il était muni d’une lampe frontale, qui lui a tailladé le front en se brisant. Les circonstances n’étaient pas des plus limpides à déterminer, il y avait donc là obstacle médico-légal, et seule l’autopsie diligentée par le procureur devrait apporter un éclairage sur ce cas.
Voilà pour l’essentiel l’exposé du médecin. « Éclairage avec lampe frontale brisée » pourrait résumer ses déclarations.