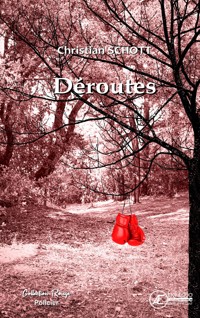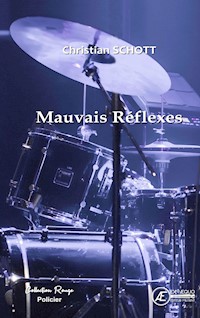Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ex Aequo
- Kategorie: Krimi
- Serie: Les enquêtes de l'inspecteur Bolitch
- Sprache: Französisch
C’est l’effervescence au commissariat de Thonville... Les décès se succèdent à un rythme effréné.
Qui est l’assassin, ou qui sont les assassins ? Quel est le mobile de ces meurtres où les victimes ne semblent avoir aucun lien, où le mode opératoire diffère.
La traque commence. S’agit-il un tueur en série, ou est-ce une série de crimes ?
Les investigations donnent le tournis à l’inspecteur principal Bolitch et font perdre son latin à son inséparable adjoint Maggioli. Les rares témoignages éclairent peu quand ils ne brouillent pas les pistes.
Une nouvelle enquête qui nous ramène dans l’univers habituel de nos deux policiers. On y partage leur quotidien, leurs souvenirs, leurs états d’âme. On retrouve Marlène et Yolanda, leurs compagnes, Sélim le patron du petit café, le déplaisant commissaire Petitfeu, Marcel et Robert les fidèles du comptoir, et on fait la rencontre d’un procureur qui ne manque pas de caractère...
À PROPOS DE L'AUTEUR
Né en Lorraine, Christian Schott est heureux grand-père et militant associatif. Passionné de musique, particulièrement de jazz, comme son héros, il aime à suivre ses pas depuis « "L’orage" » paru en 2021 aux éditions Ex Aequo.
« "Dessein Funest"e » est la quatrième enquête de l’inspecteur principal Bolitch.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christian SCHOTT
Dessein funeste
Les enquêtes de l’inspecteur Bolitch
Roman policier
ISBN : 979-10-388-1044-0
Collection : Rouge
ISSN : 2108-6273
Dépôt légal : septembre 2025
© couverture Ex Æquo
© 2025 Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction intégrale ou partielle, réservés pour tous pays.
Toute modification interdite.
Editions Ex Æquo
6 rue des Sybilles
88370 Plombières Les Bains
www.editions-exaequo.com
Ils sont tous là ou presque. Presque, parce qu’il faut bien assurer une permanence au commissariat. C’est Richard qui s’en charge. Il est secondé par le jeune Sylvain.
La veille, Bolitch et son inséparable adjoint, le grand Maggioli, ont été appelés. Un pêcheur avait retrouvé le corps d’un gamin dans un étang, au moment où sa ligne s’était empêtrée dans un entrelacs de racines.
— Un débutant, ou un maladroit, a cru bon de souligner Maggioli, même pas foutu de lancer !
— Ta gueule ! a cru juste de lui répondre Bolitch.
L’habitude de l’Italien de s’attarder sur le moindre détail, et parfois sans aucun lien avec le propos, a une fois de plus irrité l’inspecteur principal. L’essentiel était la mort d’un enfant. Avait-il glissé ? Avait-il été poussé ? Par jeu ? Volontairement ? L’enquête débutait…
Mais pour l’heure, le personnel du commissariat, hormis les deux réquisitionnés, est réuni dans une petite salle communale pour un hommage à Trojan Thill, maintenant ancien collègue. Son corps est parti la veille pour un cimetière à Saint-Pierre-d’Oléron, petite bourgade où il était né, et où il avait dit vouloir finir ses jours. Mais voilà, TT, comme on le surnommait, avait perdu ses rêves. Peu à peu, il s’était enfoncé dans les sables mouvants du malheur, sans jamais crier à l’aide, sans jamais réclamer une main secourable. On avait beaucoup parlé depuis son décès. On avait fouillé sa vie avec délicatesse, sans rien y trouver. Ni peine de cœur ni maladie incurable.
Rien. Rien qui l’aurait poussé un soir à utiliser son arme contre lui-même. Rien. À bien y réfléchir, rien non plus qui l’élevait vers le bonheur. Jamais, dans les souvenirs des uns et des autres, il n’avait fait état d’une envie, d’un désir, d’un plaisir à venir, d’un projet quelconque loin d’Oléron. Rien d’autre que son île. Pourtant Sélim avait remarqué que Thill s’était soudain mis à boire plus que de raison. Depuis quelque temps, la fréquence de ses navettes entre le commissariat et le bistrot Au Bon Beur s’était intensifiée. On pouvait l’y croiser dès l’ouverture et, à plus d’une reprise, il faisait la fermeture. Le patron, inquiet, s’en était ouvert à son ami Bolitch qui, avec Maggioli, avait promis de veiller sur TT. Mais voilà, une enquête en cours qui ne les lâchait pas, une ambiance délétère au commissariat depuis l’arrivée de Petitfeu, nouveau patron qui donnait envie de fuir le bâtiment à chaque occasion…Et les plaisirs ou soucis de la vie des deux policiers avaient installé des priorités qui leur paraissent bien futiles aujourd’hui. TT est parti. Sans que ni l’un ni l’autre, malgré l’insistance de leur ami cafetier, malgré la promesse qu’ils lui avaient faite, tente d’empêcher son départ. Leur tribunal les a condamnés sans appel pour non-assistance à collègue en danger. Et dans la petite pièce vitrée, surchauffée par un soleil qui les jette en enfer, se tient le témoin à charge, Sélim, raide dans un costume qu’on ne lui connaissait pas, les traits crispés par les larmes retenues. Darui, l’ancien commissaire qui vit sa retraite le long de la Loire, est revenu pour la cérémonie, son épouse accrochée à son bras. Lors de son départ, il avait annoncé quelques résolutions, comme celle de perdre du poids, car il dépassait déjà allègrement le quintal. Manifestement, ce projet n’a pas été mis en œuvre. Un aléa aura sans aucun doute bousculé les plans du bonhomme. Buatois, Seiler et Furgaut, les plus anciens compagnons du défunt, échangent quelques mots à voix basse, quand Mouse, fidèle secrétaire du commissariat, épuise un deuxième paquet de mouchoirs. Ternier a le visage de Ternier : impassible, fermé, comme insensible à tout ce qui l’entoure. On a disposé une rangée de chaises le long d’un mur, et les plus anciens s’y ratatinent, écrasés par le chagrin. On pense reconnaître parmi ceux-là la mère, le père, un oncle, une tante ou un cousin. Mais personne n’en a la certitude. On savait si peu de lui. Il s’agit pourtant de proches, car parfois un sanglot mal contenu s’échappe. Un appareil diffuse en sourdine une cantate de Bach. Sur un guéridon habillé de crêpe noir repose le portait de Thill. Une grande photo en noir et blanc où il esquisse le sourire un peu emprunté de celui qui fuit les objectifs. Il semble avoir la trentaine. Plus, peut-être. Difficile d’évaluer son âge. Toujours délicat de prononcer un jugement définitif sur TT. On savait si peu de lui. Il est vrai qu’il paraissait un peu plus terne depuis plusieurs semaines, mais ce n’est là qu’impression, fondée sur le drame qui a suivi. Il est aisé de déceler des signaux annonciateurs quand l’événement a eu lieu. C’est prévoir la météo de la veille. Thill n’avait jamais été des plus en vue. Il parlait fort peu, n’était pas exubérant. C’était un taiseux. Il était silhouette dans le brouillard, murmure dans le brouhaha. Décoloré, passé…Il s’exprimait en de rares occasions lors des réunions d’équipe, mais toujours avec concision, précision. Comme tous ceux à la parole rare, il était écouté avec attention. Ses dires devenaient précieux. Il était très apprécié, et il avait pour immense qualité, aux yeux de certains, de ne pas faire d’ombre. Il n’avait jamais brigué une promotion, quand d’autres étouffaient d’envie de gravir un échelon dans la hiérarchie. Une fois par an, et une fois seulement, il était à l’honneur. Il se chargeait d’une commande groupée d’huîtres pour le personnel. Une fois par an, il se montrait volubile. Il faisait le tour des bureaux, distribuait un tableau qui détaillait produits et tarifs, conseillait, distillait nombre de commentaires, vantait les mérites de son Oléron, et de son cousin producteur à Dolus. Quelques jours plus tard, il s’en allait prendre livraison sur une plateforme d’arrivage, et organisait la distribution dans la cour du commissariat.
Venaient alors les fêtes de fin d’année et, du même coup, le retour à l’anonymat pour Trojan Thill.
Alban Petitfeu, qui a remplacé Darui depuis quelques mois, lit un court résumé de la carrière de Thill d’un ton monocorde. Il y ajoute deux ou trois anecdotes glanées auprès des collègues. Mais discourir dans ces circonstances est exercice difficile, et le nouveau commissaire est à la hauteur de la tâche, malheureusement à sa hauteur, et il ne déçoit personne, car il frise le degré zéro. Un austère préposé clôt alors la cérémonie sur un dernier air de Bach.
Les uns et les autres se dispersent après avoir échangé un rapide au revoir, souvent teinté d’émotion ; et une demi-heure plus tard, Bolitch et Maggioli se retrouvent installés au fond du petit café de Sélim.
***
Le patron a déjà repris sa tenue habituelle et regagné sa place derrière le comptoir. L’antique juke-box joue Avec le temps, histoire de rester dans une ambiance mélancolique. Deux bières belges arrivent sans avoir été commandées, et les policiers lèvent leur verre dans une synchronie parfaite, sans échanger une parole. Sélim, resté auprès d’eux, croise les bras et déclare alors :
— Plus rien à dire ou à faire. Mektoub ! On n’aura pas le cœur à manger des huîtres cette année, et puis le temps va effacer la douleur… Et alors, on boira ce petit blanc d’Oléron qu’il aimait tant, pour ne jamais effacer TT de notre vie.
Le cafetier termine ainsi l’oraison funèbre au moment où Ferré se tait. Il sait ce que ressentent les inspecteurs. Si pour leur collègue décédé il est maintenant trop tard, il éprouve le besoin d’apaiser ses amis. Le ton et les mots de Sélim sont un baume sur leur douleur. L’ombre d’un sourire apparaît sur leur visage quand le patron retourne vers le zinc.
Dans le silence du petit café, seuls les verres se mettent à chanter dans les aigus, frottés par le torchon du bistrotier.
Les policiers sirotent leur Leffe. Tous deux hésitent à lancer une conversation. Tout sujet leur semble futile, presque sacrilège, irrespectueux vis-à-vis d’un mort auquel on vient de consacrer un hommage.
Bolitch se souvient des rires gras de l’un de ses oncles lourdauds lors du repas qui a suivi les funérailles de ses parents. Il n’avait pas huit ans, c’est si loin, mais ils résonnent encore comme autant d’insultes à leur mémoire. Il n’a jamais voulu revoir l’imbécile. Il a appris sa mort il y a deux ou trois ans. Cancer de la gorge. Le destin lui aura coupé le son.
C’est le métier qui leur vient en aide. Une enquête à ses débuts, la mort du gamin retrouvé noyé.
— On doit avoir le retour des premières conclusions de la scientifique, entame alors Bolitch.
— Oui, je pense, répond Maggioli, immédiatement de retour dans l’investigation en cours, ça nous donnera du grain.
— À moudre, du grain à moudre Maggio.
— À moudre ! Pourquoi à moudre, on fait ce qu’on veut avec le grain, on n’est pas obligé…
— C’est une expression, c’est tout !
— Et alors, Monsieur le professeur, c’est peut-être une expression, mais c’est pas mon expression, c’est…
Comme à chaque fois que Bolitch reprend son collègue, celui-là s’emporte, invente un vocabulaire, établit de nouvelles règles de grammaire. Se vexe.
— C’est bon ! Je vais appeler Dugelay.
Au même moment, la porte s’ouvre et M et Mme Darui pénètrent dans la salle. Ils se précipitent vers Sélim qu’ils embrassent chaleureusement.
— On s’est aperçus tout à l’heure, mais nous tenions à te saluer plus longuement avant de repartir. On n’avait pas l’intention de se sauver comme ça ! Sans avoir échangé quelques mots avec ces deux-là !
Et il se retourne vers ses anciens collègues.
— Je savais vous trouver ici.
— Belle déduction, Monsieur le Commissaire honoraire ! ironise Bolitch.
Les deux inspecteurs se lèvent et c’est le moment des effusions. Angèle Darui est très émue. La douce femme ne peut retenir quelques larmes.
— Cela ne fait pas si longtemps que nous avons quitté la région, mais je suis très heureuse de vous retrouver, malgré les circonstances.
— Oui, malgré les circonstances, insiste Darui, qui s’installe lourdement face à Bolitch.
Comme par le passé, il réclame un blanc sec. Il en oublie son épouse, qui, timidement, demande un Perrier.
Le gros commissaire, plus honni qu’adulé, si souvent maltraité par le personnel, et en particulier par l’inspecteur Bolitch, a gagné le statut d’ami en quittant la sphère professionnelle. Il était naguère le patron, il est maintenant l’égal.
Craintif avec la hiérarchie, relais servile des décisions même imbéciles, cassant à l’occasion avec les agents, enserré dans son costume camisole, il a déposé l’habit qui déguisait l’être humain.
Si Bolitch n’a rien oublié du comportement de l’ancien commissaire, il se sent maintenant proche de lui. Après tout, l’homme s’est montré si peu différent de tant de ses contemporains. Ni lâche ni héros, capable d’actes d’héroïsme, coupable de lâchetés.
Maggioli, qui comme les autres n’avait jamais porté l’ancien patron dans son cœur, a effacé toute rancœur, du jour où il a vu Darui se déchaîner sur une batterie. Le musicien a alors suppléé le policier pour l’éternité dans l’esprit du Vénitien.
Il faut ajouter, et ce n’est pas négligeable, que son successeur, le triste Alban Petitfeu — Ducon pour Ternier —, a tout mis en œuvre pour le faire regretter.
Darui se met alors à décrire sa nouvelle vie de retraité, rythmée d’aucun rythme. Comme il l’avait souhaitée, comme l’avait aussi voulu son épouse. Tous deux avaient redécouvert les plaisirs simples. Insouciants, ils menaient une existence sans contrainte.
Angèle possédait enfin la serre dont elle avait rêvé. Elle y faisait grandir plusieurs variétés de tomates, elle soignait quantité de fleurs. Lui s’était offert un attirail complet de pêcheur, et des boules de pétanque neuves, qu’il lui tardait d’essayer au bord de la Loire.
Maggioli évoque sa chère Yolanda. Bolitch, interrogé par Mme Darui, donne quelques nouvelles évasives de Marlène.
Personne n’a abordé celui qui les avait réunis, car tous ont le sentiment d’avoir failli.
***
— L’enfant ne s’est pas noyé accidentellement ! assène Bolitch en prenant place dans la voiture de Maggioli.
Les deux hommes quittent à l’instant l’institut médico-légal de Thonville. Le vieux médecin légiste, Jules Dieter, vient de procéder à l’autopsie d’Émilien Labourdette, neuf ans, retrouvé dans l’étang de Bassempoutre.
La noyade ne fait aucun doute. Le corps ne porte aucun stigmate de coup. Les relevés de la police scientifique et technique ne font état d’aucune trace de lutte alentour.
Sur la rive, le sol durci par la chaleur de l’été n’avait gardé aucune empreinte. Le vent avait fait voler la poussière.
— Comment peux-tu affirmer une chose pareille ? interroge l’Italien, qui actionne au même instant le lecteur de CD.
Et Le printemps de Vivaldi s’installe, comme toujours. Bolitch grogne de déplaisir, usé par l’amour excessif de son collègue pour une partie seulement de l’œuvre du compositeur vénitien.
Il s’enferme dans une réflexion profonde, et ne répond pas.
Un peu plus de dix minutes plus tard, la Fiat est rangée sur le parking du commissariat.
Le duo d’inspecteurs salue Sylvain qui assure l’accueil.
— Bonjour, les inspecteurs !
Le jeune homme, toujours enjoué, s’avance vers eux. Sa timidité l’empêche sans cesse d’aller au-devant des autres, sa gentillesse les attire auprès de lui.
Cette fois, il se met à remuer les bras tel un moulin sous une tempête, et lui, qui d’habitude n’use les mots qu’avec parcimonie, se met à mitrailler :
— Vous savez ? Vous êtes au courant ? Vous savez ? Le mois prochain…
— Août ! rétorque Bolitch. Question suivante ?
Désarçonné, Sylvain ne poursuit pas. Il est muet, et muet d’un rouge écarlate.
— Continue, l’encourage Maggioli d’un ton amical. Bolitch est un vieux farceur, tu le sais… Vas-y ! Il se passe quoi, le mois prochain ?
— Eh bien… Eh bien… Je peux me présenter aux qualifications de brigadier ! Si je réussis, je serai…
— Tu seras ! ponctue Bolitch. Tu seras !
Et il accompagne ces paroles apaisantes d’une belle claque dans le dos du jeune.
Cramoisi d’émotion, Sylvain prépare un remerciement qu’il n’a pas le temps d’exprimer.
Bolitch emprunte déjà l’escalier qui mène à l’étage, suivi d’un Maggioli qui lâche :
— Ce qui est rassurant avec toi, c’est que parfois, pas très souvent, mais parfois, tu sais te rattraper. J’ai l’impression dans ces rares instants de côtoyer un être humain… ou au moins approchant.
— Bon ! Arrête de phraser sans cesse, on a du boulot !
— Alors je vais te dire une chose.
Le Vénitien se redresse et déclame :
— Ce n’est pas toujours ceux qui parlent le moins qui en font le plus.
— Oh, ça va ! Viens avec moi ! marmonne l’inspecteur principal.
Tous deux s’installent dans le bureau de Bolitch. Celui-ci allume l’ordinateur, imprime le dossier de la police scientifique et consulte ses notes prises lors de l’autopsie, notes consignées dans son éternel carnet noir.
— L’enfant a disparu après le centre aéré qui finit à seize heures. OK ?
— Oui, c’est…
— Dieter a fixé l’heure de sa mort avec une fourchette précise… entre seize heures quinze et seize heures trente ?
— Ben oui… C’est ce qu’il a dit.
— Or, mon cher Watson, l’étang est distant de trois kilomètres deux cent du village… Le malheureux gamin n’a donc pas pu s’y rendre à pied en moins d’une demi-heure, amplitude la plus large à condition de s’en aller dès seize heures.
— Oui, mais il aurait pu emprunter un vélo, en voler un…
— Pour quelle raison ? Et dans ce cas, où est-il ? On n’a absolument rien trouvé au bord de l’eau.
— Oui… Oui, mon cher Lock, c’est vrai…
— Donc, on l’a emmené !
***
La Peugeot 208 de Bolitch sinue dans un lotissement biscornu de Malange. Le plan d’implantation a sans doute été réalisé par un géomètre dépressif. Des pavillons qui tentent de jouer l’originalité sont émiettés le long de ruelles qui s’entrecoupent dans tous les sens. De hautes haies de thuyas masquent le croisement, et l’inspecteur principal conduit avec une prudence qui lui est peu coutumière. De temps à autre naît un trottoir, qui s’interrompt au bout d’une dizaine de mètres. Au centre d’une place, un massif de fleurs et d’arbustes entretenu cache en partie une sculpture qui tente de représenter la volupté si on se fie au panonceau fiché à son pied. Le conducteur a coupé le sifflet au GPS qui s’évertuait à le guider dans le labyrinthe.
Par chance, le vélo jaune d’un jeune facteur apparaît dans le rétroviseur, et Bolitch s’arrête pour interroger le cycliste :
— Bonjour, vous pouvez m’indiquer la rue des Myosotis ?
— Deux fois à droite ! C’est tout près, mais faites attention, la numérotation est un peu fantaisiste, il y a des maisons planquées dans des impasses. On passe à côté sans les voir. Vous cherchez qui ?
— Numéro 12. Le nom, c’est Labourdette…
L’homme, enjoué il y a quelques secondes, reprend d’un ton las :
— Ah… Le gamin… C’est terrible. Terrible… Vous verrez, c’est une maison jaune, ils ont rénové la façade le mois dernier. Elle fait un angle.
Il repart sans entendre les remerciements de Bolitch. Courbé sur sa bicyclette, il semble attaquer une montée. Pourtant la rue est plate. Mais voilà, le porte-bagages est lesté par la peine.
La Peugeot s’arrête le long d’une haie de troènes qui borde le 12, rue des Myosotis. Un prunus, asséché par la canicule de juillet, a déjà laissé tomber une belle partie de ses feuilles pourpres bien avant l’automne. La pelouse, jaunie, est envahie de plantes qui adorent la sécheresse. De minuscules roses trémières ballottent au bout de leurs hautes tiges. Les volets sont clos : est-ce pour se protéger du soleil, ou pour enfermer un chagrin qu’on ne veut pas étaler ?
Une fois de plus, les policiers vont devoir surmonter l’insurmontable : la confrontation avec les proches d’une victime, d’une toute jeune victime, d’un gamin. Annoncer à ce couple détruit par la mort de leur enfant qu’il a perdu la vie dans ces circonstances, qu’on lui a volé cette vie, ajouter encore à l’insupportable…
Car il est certain qu’il n’était pas seul au bord de l’étang… Alors, accident ? Meurtre ? C’est là le début d’une affaire qui va émouvoir la population, qui va faire la une des médias. C’est aussi le premier dossier de la toute nouvelle procureure, Olgane de la Figurcie.
***
La magistrate a pris ses fonctions au début de l’été, quelques semaines avant le « mercato » de septembre pour succéder à l’acariâtre Pierre Ferrant, contraint de cesser ses fonctions à cause de gros problèmes de santé.
Ceux que l’on appelle bruits de couloirs et leurs amies mauvaises langues affirment qu’on l’a poussé vers la sortie. Les mêmes prétendent qu’il pourrait reparaître bientôt au tribunal, mais cette fois, sur le banc des accusés, pour une sombre histoire de prise illégale d’intérêts dans une compagnie d’assurances…
Pour l’heure, sa remplaçante est en place et, comme tous ses prédécesseurs, elle s’est engagée à rencontrer « les gens de terrain ». Au programme : la visite du commissariat de Thonville.
Elle y gagne le surnom de « La tornade » après moins d’un quart d’heure de présence. Contrairement à maître Pierre, dit « Le prélat », onctueux, précieux, au ton monocorde, le sourire ironique niché entre ses bajoues, la dame est tout en angles et en énergie. Petitfeu, qui a rajouté une bonne dose de sucre et de miel à son comportement habituel, s’apprête à la recevoir dans l’intimité de son bureau. Dès l’annonce de sa venue, il a peaufiné un discours d’accueil, travaillé sur une présentation du commissariat de Thonville, un peu éloignée de la réalité, pour s’attribuer tous les mérites.
Mais ce qui intéresse Olgane de la Figurcie, ce ne sont pas les propos de Petitfeu, car elle a quelque expérience de ces rencontres stériles avec les filtres à vérité ; elle veut voir et discuter avec le personnel. Le commissaire reste donc comme deux ronds de flan face à cette étrange créature qui, après un salut éclair, entreprend le tour de l’étage, suivie par un Petitfeu soufflé et essoufflé.
La plupart des policiers restent circonspects, bousculés par le volcan figurcien. Ici elle rectifie d’une claque sonore un dos qu’elle trouve trop voûté, là elle interroge sur la décoration, sur une photo qui trône à côté d’un ordinateur, ailleurs elle fulmine, car une plante est asséchée, et s’en va derechef chercher un gobelet d’eau à la fontaine.
Elle demande à réunir l’ensemble du personnel dans la salle de réunion, où elle détaille rapidement son parcours professionnel. Puis, elle fixe quelques grands principes qu’il est impératif d’observer, mais assure qu’elle n’a aucune intention d’interférer sur les méthodes utilisées, si elles s’inscrivent bien sûr dans l’éthique de cette profession décriée.
Derrière elle, Petitfeu caniche en opinant du sous-chef à chaque parole prononcée.
Quand elle ouvre la foire aux questions, seul Bolitch intervient. Elle a plutôt laissé une bonne impression auprès de celui qui aime les gens faisant preuve de caractère. Il est vrai qu’elle peut impressionner. Un physique à la Rossy de Palma, vêtue d’un tailleur qui ne doit rien au prêt-à-porter, des bijoux discrets, mais de prix, cette caricature d’aristocrate fait peu de cas de l’horrible Petitfeu, ce qui dès lors lui attire la sympathie de l’inspecteur principal.
— Madame la procureure…
— « Le », s’il vous plaît, Bolitch ! dit celle qui a retenu son nom. « Le » !
Le policier, habitué aux remontrances de Marlène, toujours vigilante et explosive dans le domaine de l’égalité des sexes, bafouille.
— Oui, « le » ! reprend-elle. J’aime bien surprendre, nous sommes très peu nombreuses à avoir accès à ce type de responsabilités ; aussi, comme les hommes s’attendent toujours à y trouver un homme… Dissimulée derrière ce « le », je leur fais alors une bonne, ou surtout mauvaise, surprise, mais ça ne dure qu’un temps, les nouvelles vont vite. Donc, c’est « le ».
— Oui… Oui… Alors, Madame le Procureur, je souhaitais connaître votre position vis-à-vis de l’utilisation de statistiques de résultats, des tableaux brandis tous les jours, sauf le dimanche, qui semblent devenir une fin en soi, puisque d’une part nous passons de plus en plus de temps à les alimenter, et d’autre part de plus en plus de temps à subir les conséquences des analyses qui en sont faites. Tous ces rapports devaient venir en appui à notre travail, mais j’ai le sentiment que nous devenons des appuis aux rapports. Il jette au passage un regarde ironique à Petitfeu, qui a compris que les mots de l’inspecteur étaient pierres dans son jardin.
— Eh bien, inspecteur Bolitch, vous vous doutez bien que vous ne m’apprenez rien. Mais, j’ai lu plus souvent ce genre de propos que je ne les ai entendus. Comme tous les responsables, j’évolue dans un monde peu critique, où parfois la servilité tient lieu de compétence. Non, les chiffres ne seront pas mes maîtres ! Je l’affirme.
Quelques sourires se dessinent dans l’assemblée.
— Mais ! Mais ! Je serai intraitable avec l’éthique, avec la qualité de votre travail. Vous vous devez d’être exemplaires ! Et maintenant, au boulot !
Toutes et tous se précipitent alors dans le couloir, et les commentaires vont bon train. Les avis sont partagés entre adhésion et hostilité avec un nuancier d’opinions assez large. Ainsi, dans le bureau de Bolitch, un débat se fait jour. Ternier, reconverti au service administratif depuis une grave blessure à la jambe, et qui s’exprime de façon toujours concise, donne son point de vue en deux mots : « La chieuse ». Le verdict est clair, sans appel. Il a une aversion particulière pour l’ensemble de ses supérieurs, Petitfeu sera « Ducon » pour l’éternité, comme Darui renommé pour toujours « Baudruche ». Seul Bolitch trouve grâce à ses yeux. Avant le drame qui a fait d’un homme d’action un rond-de-cuir, il a fait équipe avec lui pendant plusieurs années. Ils ont vécu en bonne entente tous ces moments, difficiles comme joyeux, qui, pour Ternier, faisaient le sel du métier qu’il avait choisi. Il était déjà un taiseux, mais un taiseux heureux. De ceux qui se passent volontiers de mots, que si souvent ils trouvent inutiles, agaçants, dans la bouche des autres. Depuis, il est taciturne, presque muet, quand il n’est pas cinglant. Alors, sa façon de témoigner une forme d’affection pour Bolitch est de toujours accéder à ses demandes, et d’éviter de lui décocher toute saillie dont il est coutumier avec les autres.
Maggioli est plus modéré.
— Je suis partagé…
— Ah oui ! Partagé… C’est souvent utilisé par ceux qui ne se mouillent pas, tacle Bolitch.
— Oui, mais on peut quand même…
— C’est sûr on peut, on devrait, on pourrait… Vas-y, développe toute la panoplie couillemollesque !
— Mais merde ! On vient de la rencontrer ! Et puis d’ailleurs, si tu veux tout savoir, elle me plaît pas, mais pas du tout. Cette espèce de bourgeoise qui se la joue sincère, directe ! Elle se donne des airs de camionneur, mais son bahut c’est une Rolls ! Toi, t’es qu’un gros niais ! Tu la crois quand elle te dit qu’elle a pas l’intention de nous pourrir avec les chiffres. Mais elle fera comme les autres ! Je te pensais plus intelligent que ça, plus clairvoyant. Mais Monsieur Bolitch est en extase devant la, le, la procureure parce qu’elle snobe l’autre Petitfeu. Ça suffit pas, et si ça se trouve, c’est un jeu de drôles !
Bolitch, qui adore reprendre les maladresses de son adjoint, y renonce. Maggioli continue à éructer, et pour clore, il déclare avec solennité :
— Si elle est parvenue là où elle est, c’est pas un hasard, elle a su prendre le bon chemin ! C’est le patron du MEDEF avec un gilet CGT.
Bolitch ne bronche pas. Il connaît les éruptions de l’Italien, fréquentes, puissantes. Mal fondées ou décalées parfois, elles peuvent cependant être lourdes de sens et d’enseignement. Mais à l’instar de son collègue, car tous deux pratiquent avec brio la mauvaise foi, l’inspecteur principal ne reconnaîtra pas son tort, même parfaitement convaincu de sa fausse route. Il y va de ce semblant d’honneur qui ne frôle pas le ridicule, puisqu’il l’illustre à la perfection, puisqu’il l’est.
Ternier, quant à lui, rareté, sourit du bout des yeux.
Un silence s’installe, rompu au bout de quelques instants par Maggioli :
— Bon ! Tu fais la gueule ?
— Non… Non… Je réfléchissais.
— Dans ce cas, réfléchissons ensemble ! lance Maggioli.
Tous les trois reprennent alors les dossiers jusque tard dans la soirée…
***
Dès le coup de sonnette, la porte s’ouvre. Une femme apparaît, leur adresse un « bonjour » presque inaudible, les laisse se présenter.
— Police judiciaire, nous venons…
— Pour Émilien ! coupe-t-elle, et elle les invite à la suivre.
Ils pénètrent dans un petit salon où plusieurs bougies trouent l’obscurité d’autant de petites lueurs. Seules ces petites flammes qui se recroquevillent ou s’allongent dansent dans la pièce où tout est figé. La dame qui a accueilli les inspecteurs a rejoint un couple de silhouettes serrées sur un canapé. Sur la table basse qui leur fait face est posé un cadre qu’on devine être la photo du petit. L’homme se lève, toujours sans un mot, et allume un lustre imposant qui dévoile toute la scène. Des meubles sombres, des tapis, un crucifix au-dessus d’une porte avec un Jésus comme empalé par une branche de buis. Un grand tableau occupe le mur du fond. C’est une scène de chasse, où un magnifique cerf n’a pas eu de chance. Un vaisselier, avec une rangée de tasses aux couleurs vives, des assiettes décorées. En équilibre sur un guéridon dans un angle, une vierge d’albâtre, que pas un miracle n’a pu changer en marbre, veille.
Tout est silencieux, sombre, oppressant. La mort a posé une chape de malheur dans un endroit où déjà ne régnait pas la gaieté. L’austérité semblait avoir conquis la place depuis bien avant le drame.
Bolitch entame :
— Nous sommes désolés… Nous ne pouvons qu’effleurer votre chagrin…
Une quinte de toux saisit Maggioli, qui s’excuse.
L’inspecteur principal poursuit d’une voix caverneuse :
— Nous avons entamé une enquête sur le décès de votre fils.
Et il regarde la femme qui leur a ouvert la porte.
— Je suis la sœur de Bernadette… La tante du petit. Jean-Joseph et Bernadette sont les parents.
Et elle tend le bras vers les deux autres comme pour les inviter à parler.
L’homme ouvre la bouche et, d’un ton rogue, interroge :
— On va bientôt avoir notre fils chez nous ? Une enquête ?
— L’autopsie est terminée. Vous pourrez récupérer le corps d’Émilien. Oui, une enquête, parce que les éléments dont nous disposons nous laissent penser que sa mort n’est pas un accident.
— Ce n’est pas un suicide ! rétorque le père dans un cri.
— Je comprends votre désarroi, mais les investigations viennent de débuter, nous ne pouvons éliminer aucune hypothèse…
— Mais il ne s’agit pas d’un suicide ! Ce n’est pas possible.
— Nous aurions quelques questions à vous poser, nous avons besoin d’éléments… Vous comprenez… Il peut s’agir d’un crime.
La mère, enfermée dans un profond silence, le visage jusqu’alors figé dans une forme de béatitude, réagit par un couinement.
Son mari se crispe. Il perd pied. La haine a fait un nid dans son chagrin. Il s’emporte, hurle. Bernadette Labourdette tente de le retenir. De sa main frêle, elle lui prend le bras, mais ne parvient pas à le calmer. Il se lève, jette un regard menaçant à Bolitch. Ses paroles sont violentes, il accuse, il condamne. Dans un magma de mots qu’il est difficile d’identifier, on repère peine de mort, ordre, immigré.
Il se rassied, éclate en sanglots, vaincu par la douleur.
Une longue parenthèse de silence s’installe.
— Un si bel enfant… ose timidement la tante du petit. Qui donc pouvait lui vouloir tant de mal ? Qui ? Quel monstre ?
— C’est justement pour faire la lumière sur le décès d’Émilien que nous avons besoin de vous entendre…
L’interrogatoire dure plus d’une heure. La tante est précise, concise, elle veut visiblement apporter tout ce qui peut être utile à l’enquête. Le père, cassant, est agressif. Il se maîtrise mal, hausse le ton, puis s’effondre. La mère est effacée, elle s’exprime peu, étire chaque phrase. Elle est sans doute sous tranquillisants. Elle n’est que douleur ; pour ne pas sombrer, elle s’accroche au Ciel plutôt qu’aux vivants.
Quand les policiers quittent la maison, ils n’ont que peu d’éléments. Bolitch saisit son portable qu’il vient de sentir vibrer au fond de sa poche. Il a reçu un appel du commissariat, suivi d’un message d’une quarantaine de secondes.
Il s’adresse d’un ton sec à Maggioli.
— On file ! Un mec vient de se faire buter devant la Société Générale, celle de la rue aux Ours.
Après quelques circonvolutions dans les rues du lotissement tarabiscoté, la Peugeot rejoint l’avenue Jaurès qui conduit au centre-ville. La circulation est dense, mais la sirène et le gyrophare creusent un couloir dans le flot de véhicules, et interdisent aux piétons de traverser la chaussée.
Maggioli se cramponne tant bien que mal. Il n’a confiance ni dans la solidité des points d’arrimage ni dans la conduite de son collègue.
— Si le mec est mort, c’est peut-être moins urgent, non ? ose l’Italien.
Le visage fermé, les yeux rivés sur la route, Bolitch ne répond pas, si ce n’est par un nouveau coup d’accélérateur.
Moins de cinq minutes plus tard, ils arrivent sur les lieux. Maggioli s’extrait avec bonheur de la voiture, tout secoué encore par la vitesse et par la chaussée pavée qui mène à la banque. La petite antenne de l’établissement, l’une des seules qui subsistent, est au centre-ville dans le lacis des ruelles où l’on trouve de rares échoppes et un restaurant, si bien caché, qu’on a l’impression qu’il ne veut pas être dérangé aux heures des repas. Une équipe est déjà sur place. Une rubalise encadre le périmètre de la scène de crime. Un médecin procède à l’examen du corps allongé sur le trottoir devant le distributeur de billets. Bolitch salue d’un signe Pierre Dugelay, le chef de la police scientifique. De l’autre côté de la rue, trois badauds viennent glaner quelques émotions qui viendront alimenter leurs prochaines conversations, parfois pimenter leur vie ternie par l’ennui.
Un peu plus loin, Furgaut interroge une femme, effondrée.
Bolitch et Maggioli s’approchent, franchissent la rubalise.
Dugelay les met au parfum :
— L’affaire est claire : le mec retirait de l’argent, et il s’est pris un genre de coup de massue sur la tête. Le crâne explosé…
— Mais, c’est… hoquette Bolitch. On l’a buté pour…
— Quarante balles ! C’est le montant du retrait. Quarante balles.
— Et il n’a rien vu venir ? Personne…
Furgaut rejoint le groupe :
— Salut ! Pas beau à voir, hein ?
— Oui, ça ! répond Bolitch, agacé.
L’inspecteur principal, flegmatique en cas d’épuisement total, irritable, comme nombre de ses confrères lorsqu’il mène une enquête, éprouve des sentiments mêlés vis-à-vis de ce collègue. Si celui-là est un policier redoutable, disponible, et qui possède par ailleurs un réseau d’indics des plus large, et dans tous les milieux, il a aussi le don d’exaspérer Bolitch.
« Furgaut : fin limier », mais « tendance limier » aime-t-il à le décrire. Et ce n’est pas dû au tour de taille du collègue, qui pourtant le fait ressembler plus à une boule de bowling qu’à une quille. Mais ce Furgaut possède l’art, car à son niveau de pratique, c’est un art, d’aligner les évidences, les histoires drôles éculées, les détails inutiles, les questions sans pertinence.
Ses interventions lors des réunions d’équipe, trop nombreuses à partir d’une, tirent une série de bâillements aux plus assidus. Mais, comme certaines rares moules d’eau douce, enfouies en partie dans la vase, ternes au sortir de la rivière, il peut révéler à l’occasion une perle. Ce que personne n’avait remarqué, envisagé. L’élément qui va permettre d’accélérer l’enquête.
— Alors ? demande Bolitch, sur un ton qu’il veut adouci.
— Pas grand-chose. Une femme qui venait retirer de l’argent a découvert le mec. Il n’y avait personne d’autre dans la rue, enfin elle n’a aperçu personne.
— À l’heure-là, c’est plutôt calme ici, je connais, j’habite pas loin, ajoute Dugelay. Avec le soleil qui se reflète sur l’écran, il a dû se concentrer sur l’appareil, et n’a rien vu…
— Ni entendu, lâche Maggioli.
— De toute façon, l’autre a été discret. Rien alentour, un coup sur la tête, et parti avec les billets.
— Quarante balles, répète l’inspecteur principal. Il a des papiers sur lui ?
— Oui, tiens, voilà son portefeuille, lui dit alors le responsable de la police scientifique en lui tendant l’objet. Il y avait aussi un trousseau de clefs, sûrement de son logement. C’est tout ce qu’on a trouvé.