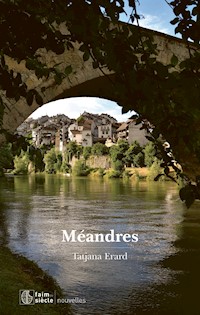
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Faim de siècle
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Dans la droite ligne d’
Une Rose et un balai de Michel Simonet,
Méandres propose un beau portrait de la ville de Fribourg. La Basse-Ville et ses méandres sont au cœur de ces nouvelles. Les personnages qui donnent son atmosphère unique à la patrie des Bolzes illuminent ces nouvelles de leur présence. Boubi, Kiki, la moniale, le vieil homme assis sur un banc, le bâtisseur de pont, le cantonnier… autant de visages qui façonnent ces textes pleins de poésie.
À PROPOS DE L'AUTEURE
Fille de la Basse-Ville de Fribourg,
Tatjana Erard a publié
Méandres aux éditions Faim de siècle en 2016. Auparavant, elle avait également publié
Hubert Audriaz, l’enfant libre aux éditions de l’Hèbe, en 2010. Son troisième ouvrage
Inspirations est encore une fois consacré à un personnage emblématique de Fribourg, Emmanuel Schmutz, décédé l’année dernière. L’ouvrage est, comme
Méandres profondément ancré dans la ville de Fribourg.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 128
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Table des matières
I. Ma Basse-Ville
II. De sa fenêtre
III. Les rues
IV. Le cantonnier
V. Bouh Rababou !
VI. Le livreur
VII. Dans mon église
VIII. La course d’école
IX. Sur mon banc
X. Le bâtisseur
XI. La moniale
XII. Du funiculaire
XIII. La passante
XIV. A la Fête-Dieu
XV. Au bistrot
XVI. « Coup d’sac »
XVII. Les méandres
Méandres
Tatjana Erard
Nouvelles
Editions Faim de Siècle
Ce livre a bénéficié du soutien de: Service de la culture du canton de Fribourg
Service de la culture de la ville de Fribourg
Remerciements :
À Sylvain et à Christine Gonzalez pour leur inestimable relecture
À Charly Veuthey et aux Éditions Faim de Siècle pour leur regard bienveillant, leur humour et leur confiance
À Blaise Hoffmann, instigateur du texte Ma Basse-Ville, étincelle de tout le reste
Aux habitants de Fribourg
À Enzo et à son papa
« L’instant s’enfuit, à moins qu’on ne le retienne d’une phrase. »
Jean-Dominique Humbert (né à Fribourg en 1956)
I. Ma Basse-Ville
En écoutant One de U2 ou Angie des Rolling Stones
Ma Basse-Ville est un méandre. L’eau embrasse la terre. La réalité se noie dans les souvenirs, glisse lentement le long des ponts, s’entortille autour de ces géants figés. Noms mélodieux promettant de belles histoires. Pont de Saint-Jean, pont du Milieu, pont de Bois, pont de Zaehringen. Les pieds dans l’eau, la tête dans les étoiles. Enfoncés profondément dans la Sarine, ils ressurgissent au détour du regard. On pourrait ne plus les voir, les oublier. Mais non. Ils enjambent nos vies.
Ma Basse-Ville, bel endroit pour planter ses racines.
Ma Basse-Ville est une prairie. Les maisons aux toits de briques s’y repaissent paisiblement. La cathédrale veille. Du haut de sa ville, elle observe amoureusement son troupeau de briques. Elle sent la chaleur qui s’en dégage. Les fenêtres éclairées réchauffent son cœur de pierre. Serrées les unes contre les autres, elles n’ont pas besoin de parler. Nées dans un même lieu, elles se comprennent. Les lampadaires encerclent les habitations. Parlant de la pluie et du beau temps, ne baissant jamais la garde, ils illuminent nos vies.
Ma Basse-Ville est chaleureuse, il fait bon y passer son enfance.
Ma Basse-Ville est une âme. Fière. Ses « Bolzes » jadis fauchés ont pris leur revanche. Aussitôt arrivés à Fribourg, les curieux descendent en premier lieu saluer les vieilles pierres. Les fontaines de Hans Gieng jalonnent le parcours du visiteur. Elles l’accompagnent à travers le dédale des rues. Rue d’Or, rue des Bouchers, des Forgerons, Grandes-Rames. On s’interroge. Quels secrets peuvent-elles bien renfermer ? Les habitants, eux, savent. Mais aiment cultiver une part de mystère.
Ma Basse-Ville me hante et m’enchante. De la fenêtre de ma chambre, on voit la chapelle de Lorette. Promenades dominicales à Bourguillon. Surtout ne pas oublier de mettre une bougie. Les heures s’envolent, les souvenirs restent. Mon ancienne école me sourit. Je n’ai qu’à tendre les bras pour la toucher. Premiers livres, premiers poèmes, premières amours.
Ma Basse-Ville est toute ma vie. Des moments forts, des moments durs mais tous profondément vécus. Chaque ruelle contient son étincelle de beauté.
Ma Basse-Ville est réconfort, elle arrondit les angles de mes souvenirs.
II. De sa fenêtre
En écoutant Diva Casta, extrait de La Norma de Vincenzo Bellini
De sa fenêtre, il voit la neige tomber. Les flocons se révoltent. Retardent le moment fatidique de leur contact avec le sol. Certains hésitent, prennent leur temps, tourbillonnent encore un peu. Ils attirent son attention en toquant à sa fenêtre. Ô Neige, suspends ton vol ! Les contours du monde deviennent flous. Les reliefs se métamorphosent. Les marronniers, fantômes effrayant la Sarine, agitent leurs longs bras fins. Ils se susurrent des secrets, épiés par la rangée de vieilles bicoques qui, sous leur air absent, n’en perdent pas une miette.
De l’autre côté de la Sarine, le petit chemin si sage d’habitude prend de la hauteur pour se mettre au niveau des bancs. Cette soudaine complicité n’échappe pas au pont du Milieu. De la rivière, de la Basse. Il aime être recouvert de blanc. Déguisé avant l’heure, il se mire dans l’eau, satisfait de son nouvel aspect. C’est décidé, il enfilera ce costume-là cette année pour le Carnaval des Bolzes.
Lui, il ne me déguisera pas. Mais, de sa fenêtre il verra passer les chars en carton et papier mâché. Il verra les confettis, joie des enfants, les guggens jouer de tout leur souffle. Il entendra leurs notes rebondir contre les falaises, il en rattrapera quelques-unes au vol. Il les relâchera vite. Ce n’est pas une musique que l’on garde longtemps. Comme la neige, elle doit être éphémère. Il observera les masques, les costumes. Il repensera à ceux dont lui parlait souvent mon grand-père. Faits de cartons et de vieilles fripes. Parce que les images parlent parfois davantage que les mots, il lui montrait des photos de gamins de l’Auge, masqués. Elles lui plaisent. J’aime non seulement celles des carnavals d’antan, mais les autres aussi. Avant tout, c’est voir la ville en noir et blanc qu’il aime.
Après le cortège, il entendra le Rababou se faire huer par la foule sur la place du Petit-Saint-Jean. Bouh, Rababou ! Bouh ! Qui brûlera en emportant avec lui les malheurs de l’année, les frimas de l’hiver. Plus vite les flammes les auront engloutis, plus doux sera le printemps, c’est bien connu.
Tiens, il se rend compte que la Sarine est la seule qui avale les flocons instantanément. Elle ne leur laisse pas le temps de réaliser ce qui leur arrive. Partout ailleurs, ils se posent au moins quelques secondes. Pas là. Leur destin s’accélère. Ils vont mourir sans avoir réellement vécu.
La cathédrale semble elle aussi observer le spectacle. Il la contemple souvent de sa fenêtre. Altière, majestueuse. Elle règne sur sa rangée de maisons au garde-à-vous. Soldats de béton à la fidélité sans bornes. Fiers dans leur uniforme brun, gris, blanc. Bonne joueuse, la Sarine leur renvoie leur reflet. Clic. La reine et sa garde sont la cible, une fois encore, d’un appareil photographique qui tente de les emprisonner dans un minuscule cliché. On ne peut pas leur en vouloir d’essayer de capturer une petite parcelle de beauté. Même si l’image rendue n’est jamais aussi belle que l’image réelle. Lui, il n’a pas besoin de clichés. Les bords de ma fenêtre encadrent cette vue devenue son tableau préféré. Une main invisible l’agite comme une boule-qui-neige et tout se met en mouvement. Les éléments du tableau se déplacent, s’entrechoquent, glissent les uns sur les autres. Soudain, tout le paysage s’en trouve changé.
Il tourne la tête et se heurte violemment au contraste de la pièce. Rien ne bouge. Jamais. La boîte à bijoux sur la coiffeuse, le miroir derrière la boîte à bijoux, la commode en face de la coiffeuse, le fauteuil à côté de la commode, la vieille table en bois massif au milieu de la pièce, la nappe blanche crochetée sur la table. Tout est à sa place. Même les fleurs ne baissent jamais la tête. Figées dans leur vase sans eau. Le plastique de leur chair est juste un peu plus pâle à cause des rayons du soleil. Le chandelier en verre de Murano domine ce pauvre royaume. Même le cristal a perdu sa vocation d’étinceler. La poussière qui le recouvre empêche les éclats de lumière de circuler.
La salle à manger est son antre. La vue est la plus belle de la maison. Son royaume. Même si le seul élément qui semble vivant est la bibliothèque. Livres mal rangés, souvent déplacés. Films visionnés, encore et encore. La poussière n’a pas eu le temps de s’y poser.
Vite il tourne la tête et il cligne des yeux. Il transforme encore la vue. Son regard devient kaléidoscope. Il aime ce mot. Sa sonorité, son étymologie aussi. Série de belles (kalos) images (eidos) que l’on regarde (skopein). Merci, vieilles connaissances de grec ancien ! Selon le clignement de sa paupière, le paysage change. La hauteur de la cathédrale, le mouvement de la Sarine, l’alignement des bâtisses, les couleurs, la luminosité. Prendre les éléments dont on dispose, les retourner encore et encore jusqu’à ce que l’on trouve l’arrangement parfait. Et comme il n’existe pas, on continue de les manipuler. Son plaisir réside dans l’essai, non dans l’aboutissement. Un élément n’est pas à ma convenance, il l’éclipse d’un coup de paupière. C’est facile. Attention à ne pas fermer complètement les yeux. L’obscurité totale détruit le kaléidoscope. Il ne veut pas s’endormir. Quelques millimètres suffisent à changer complètement sa vision du monde. Il faut être prêt à bouleverser l’ordre des choses. On prend un risque. Que l’assemblage soit moins réussi que le précédent. Regret d’avoir bougé de deux millimètres. Heureusement, rien n’est définitif. Si on abaisse encore un peu les paupières, tout change à nouveau. Il ne reste qu’à garder en tête la version que l’on préfère. Les autres sont des repentirs. On les recouvre de nos pensées. On a ainsi l’illusion de repartir à zéro. On laisse la couche de neige agir. Même si, au fond, on sait que rien ne s’efface jamais complètement.
Parfois, il y a des éléments qui ne sont pas prévus pour entrer dans notre vie et qui, pourtant, y surgissent. Qui s’accrochent aux clous de nos souvenirs. Comme certaines pensées. Sans crier gare. Heureusement, on ne sait pas à l’avance ce qui va se passer. C’est comme lorsque l’on cadre une photo. On se concentre sur ce que l’on veut avoir dans notre viseur et, au moment où l’on veut appuyer sur le déclencheur, un élément hors champ surgit. C’est ça qui forme les plus belles images. Un après-midi, lors d’une balade, il regardait les gens passer, comme souvent, assis sur le rebord du mur de la place Python. Soudain, il voit un homme en queue-de-pie et haut-de-forme tirer son orgue de Barbarie. Cela semblait si anachronique. C’était un mercredi, jour de marché, il s’en souvient. Il fait doux, cela devait être le printemps. Les marchands rangent leurs stands. Certains étudiants courent acheter les derniers beignets chez la gentille Vietnamienne à la roulotte verte. Il y a foule. Des jeunes, écouteurs vissés dans les oreilles, parlent fort. Des mamans, aux terrasses boivent leur café, jetant de temps à autre un œil sur leur progéniture. C’est là qu’un personnage sorti tout droit d’un roman balzacien surgit de nulle part et se mêle à cette comédie humaine du XXe siècle. Il se rappelle avoir souri.
Il voit sa vie un peu comme un tableau de Francis Bacon. Un peu dérangeante au premier regard mais qui, de plus près, est intéressante. Pour lui, en tout cas. Sa famille lui reproche de ne pas assez sortir. Voir du monde. Ils ont sûrement raison. Le problème quand on a pris son esprit comme demeure, c’est qu’on sculpte la réalité au burin de ses pensées. Il peut tailler tout ce qui le dérange. Il veut un quotidien poétique, beau, unique. Il choisit les mots qui façonnent sa vision. Des choses vues, imaginées. L’impact puissant des mots qui, une fois prononcés, deviennent réels, prennent forme, influencent le monde. Son monde. En musclant jour après jour son imaginaire, il brode le silence. Devient les arbres qui se balancent, la neige qui tombe. Ce n’est que de la fiction ? Non, sa réalité. Il habite les tableaux qu’il crée. Il s’y balade longuement avant de décider de les quitter pour un autre.
De sa fenêtre, il voit la neige mourir. La Sarine, elle, poursuit sa course, sans se soucier de ce qui se joue. La neige chute, s’écrase. Mais entre ces deux extrêmes, elle est libre.
III. Les rues
En écoutant L’apprenti sorcier, extrait de Fantasia de Walt Disney
Difficile de s’en sortir dans tout c’fourbi. Bien sûr, faudrait faire un peu d’ordre. Mais bon, comment trier toute une vie ? Sans l’amputer. Pis, malgré ou à cause de mon âge, j’suis pas prêt pour ça. J’aurais bien b’soin d’une vie d’plus. Là, j’ai plus assez d’temps. Trop d’idées, trop d’projets pour que j’m’encombre avec du rangement. Ce s’rait du gaspillage. Pis, pour être franc, ce ch’ni m’est précieux. On s’est apprivoisé. Pis, y a des trucs que j’réutilise tout l’temps. Ces p’tits nains en plastique par exemple. Y sont vivants à mes yeux. La preuve, parfois, j’leur cause. Et c’gros escargot en bois. Les gamins adorent tellement grimper dessus. Il y a laissé sa couleur, pas son âme. Certains objets m’suivent partout, à l’image de certains mots : magie, lumière, enfance… Ma foi, c’est comme ça. Je m’suis jamais posé douze mille questions, c’est pas main’ant qu’ça va commencer. La vie, elle s’arrête jamais. Moi non plus.
Avec ça, j’sais même plus c’que je cherchais. Tant pis, ça d’vait pas être bien important.
C’est marrant, ça m’fait à chaque fois l’coup quand j’suis dans ma cabane aux sorcières. Les coquines. C’est comme si elles voulaient qu’j’reste avec elles plus longtemps. Ou alors elles piquent mes pensées pour assaisonner leurs potions magiques… Oui, c’est ça. C’est pour leurs potions ! J’vais garder cette histoire pour les prochains visiteurs. Bonne idée ! « Il était une fois une sorcière appelée Malicie. Elle adorait inviter des gens, surtout les enfants, car ils ont toujours plein de choses à raconter. Et elle aimait ça, les histoires. Pour une raison bien précise, elle s’en servait pour ses potions magiques… ». La suite, j’l’inventerai sur l’moment.
J’me rappelle main’ant. Une gravure ! Une gravure de fées pour mon prochain parcours. Ça m’manque, le dessin. Quand on tient un crayon, on prend vraiment la mesure des choses. Au sens propre comme au figuré. On dilate le temps. Chaque détail, chaque courbe, chaque ligne, chaque trait, peut tout changer. Sacrée responsabilité ! Quand j’cause avec les gens, les mots sortent tout seuls. Tant pis si j’dis une connerie. Avec l’art, c’est différent. C’est plus posé, plus calme. J’accorde de l’importance à tout. Le dragon d’papier qui crache les joueurs d’Gottéron à la pato d’Saint-Léonard, j’ai réfléchi longtemps à la longueur de chacune des dents, aux couleurs qui allaient le mieux, qui embraseraient la foule en même temps qu’la fumée projetée. Quel bonheur quand mon dragon sort ses crocs ! Et les gamins, sur leurs patins, qui l’enflamment avec leur torche ! Ça m’fait penser qu’il faut qu’j’aille redemander des billets pour l’match de samedi prochain. Faut leur offrir des rêves aux gosses. Des souvenirs ! Et quand Gottéron joue bien, c’est une sacrée machine à rêves.
C’est pas tout ça, j’tourne un peu en rond dans ma cabane. C’est qu’j’ai encore pas mal de combines à faire aujourd’hui.
D’abord, faut que j’aille chercher mon écharpe rouge, histoire de me protéger la moindre. Y a un de ces vents aujourd’hui ! Une vraie journée d’automne. Puis enfourcher mon vélomoteur.
– Eh salut Boubi, ça joue ?
Toujours avec son accordéon sous l’bras sécol. Il doit sûrement y avoir une bastringue sous l’pont de Zaehringen, aux Zig Zag. Sacré Boubi, il va tenter d’se glisser dans la foule en pousser une. La musique contre un ballon de rosé. C’est un peu sa vie. Un bon bougre, j’l’aime bien. Il fait vraiment partie du paysage, du quartier. Un peu trop p’t-être. Les gens ont tendance à l’oublier. Comme un décor qu’on voit plus à force d’être dedans. Il demande pas grand-chose pourtant. Juste que’ques mots, un p’tit bonjour en passant.





























